Le métier d'éditeur : façonner les mythes qui nous façonnent
DOSSIER – En cette fin d’année, ActuaLitté inaugure un ultime dossier, qui n’est pas sans lien avec la féérie de Noël pour nombre d’enfants. L’histoire du Père Noël, qu’a-t-elle de commun avec l’édition d’un livre ? Les couleurs, dans le cas d’une couverture un peu criarde, mais certainement ni la hotte ni le passage par la cheminée. Avec l’aide de David Meulemans, directeur éditorial des Forges de Vulcain, décryptons mythes et réalités autour du métier d’éditeur.
Le 16/12/2019 à 09:01 par David Meulemans
4 Réactions | 1 Partages
Publié le :
16/12/2019 à 09:01
4
Commentaires
1
Partages

Et comme pour toute saga, voici l’épisode I, qui ne se déroule pas dans une galaxie lointaine.
pixabay licence
Ce serait bien que tu parles aux étudiantes et étudiants de notre université des mythes et réalités du métier d’éditeur. Je me doute qu’ils apprendront davantage quand ils feront des stages, mais là, ils ne sont pas encore en stage, alors si tu peux, dès maintenant, leur dire quelque chose, ce serait bien. Et je sais que ton expérience, elle est réduite, c’est celle de ta maison, qui est une petite maison. Mais cela reste une expérience intéressante. Partielle. Mais vraie.
directeur éditorial des Forges de Vulcain
Je me lance donc. L’intérêt d’étudier les mythes sur l’édition est de contribuer à changer les représentations que l’on se fait de ce monde professionnel. Pourquoi les changer ? Afin de changer le destin de l’édition.
La profession de foi des forges, la petite maison que je dirige, par exemple, s’achève sur l’expression d’une ambition : les éditions Aux forges de Vulcain veulent changer la figure du monde. Or, les Forges publient des romans. Le postulat de la maison est donc que les livres contribuent à changer l’imaginaire, et que notre imaginaire conditionne la manière dont nous agissons dans le monde.
Notez que je suis bien conscient que dire « on va changer le monde en faisant des livres », c’est se prendre un peu trop au sérieux. Mais dans l’édition, il faut souvent se prendre très au sérieux, sinon, on désespère assez vite. La profession de foi des Forges, c’est le mythe qui m’aide. Et puis, je n’ai pas dit qu’on allait tout changer : parfois, être conscient de l’effet que l’on a sur le monde, effet très petit, suffit.
Ainsi, ces mythes, ils nous façonnent, et nous les façonnons. Pour qu’ils nous façonnent en retour. Donc, les connaître, les comprendre, c’est voir comment ils agissent en nous et comment nous contribuons à les renforcer, par nos actions, ou nos paroles. Et cela nous montre aussi quels sont les mythes auxquels nous pouvons désirer prêter le concours de nos forces.
Économique, linguistique : vers une “préférence nationale”
Je vous donne un exemple. Ces jours-ci, beaucoup de maisons d’édition de littérature expliquent qu’elles vont « faire plus de français ». Elles veulent ainsi dire qu’elles vont diminuer la part de littérature étrangère dans leurs programmes de publication. Pourquoi ? Pour deux raisons principalement. Tout d’abord, traduire un texte est coûteux. Surtout s’il est long (la rémunération des traductrices et des traducteurs étant proportionnelle à la longueur des textes traduits – et aussi à la rareté de la langue traduite).
Ensuite, les romanciers et romancières étrangers ne sont que rarement disponibles pour assurer la promotion de leurs romans sur notre territoire — et les faire venir est onéreux. Ces deux facteurs écrivent une équation difficile : ces romans étrangers coûtent plus cher à produire, et rapportent moins. Il peut donc sembler qu’il est judicieux de « faire plus de français ».
En passant, vous noterez que l’on dit « faire plus de français », pas « faire plus de francophones ». Ce n’est pas nécessairement une erreur lexicale. Un texte francophone peut avoir eu une première vie dans son territoire d’origine, et il n’a donc pas la souplesse du texte français, inédit, que l’on peut faire modifier par son auteur ou son autrice. Ensuite, l’auteur francophone réside parfois loin de la France, et sera donc plus difficile à mobiliser pour la promotion du livre. On parle donc bien d’auteurs français (parfois belges ou suisses, ou luxembourgeois).
En outre, un texte francophone du Québec ou du Sénégal peut s’adresser d’abord aux résidents de son propre espace culturel. Donc, le texte ne sera pas assez familier aux lecteurs et lectrices français. Mais là, on aborde une autre question, que je n’aurai pas le temps d'évoquer : la progressive provincialisation du monde, la disparition de l’ambition universaliste dans l’écriture.
Longtemps, l’universalisme a consisté à considérer que tous les habitants de la Terre étaient passionnés par ce qui se passait dans les cafés du Quartier latin : en ce sens, se penser universels est un mythe tenace chez les écrivains français.
Revenons à ce point : faire plus de français. Il y a, dans ce choix stratégique, des mythes de l’édition, mais ils sont comme dissimulés. Ils sont dissimulés, car ils illusionnent non pas le public, mais les éditeurs eux-mêmes.
On pourrait d’ailleurs distinguer les mythes selon les personnes qui y souscrivent. Il y aurait les mythes de l’édition dans l’esprit du public. Et les mythes de l’édition dans l’esprit des gens du métier.
On pourrait ainsi s’amuser à faire la liste de ce que le public croit, mais est faux, on pourrait s’amuser à détromper le public, et rire de son ignorance, mais ce serait particulièrement idiot, dans la mesure où l’asymétrie d’information est un phénomène commun. Moi qui suis éditeur, je ne sais pas grand-chose de la médecine, de l’architecture ou du droit pénal. S’il venait à des médecins de ricaner entre eux de mon ignorance au sujet la réalité de leur métier, je trouverais cela malvenu.
Donc, il m’apparaît plus judicieux de parler d’abord des mythes auxquels les éditeurs et éditrices souscrivent eux-mêmes. La prochaine fois, je vous parle des mythes qui sous-tendent l’affirmation, « il faut faire plus de français ».
Dossier - Le métier d'éditeur : mythes et légendes au pays des histoires
















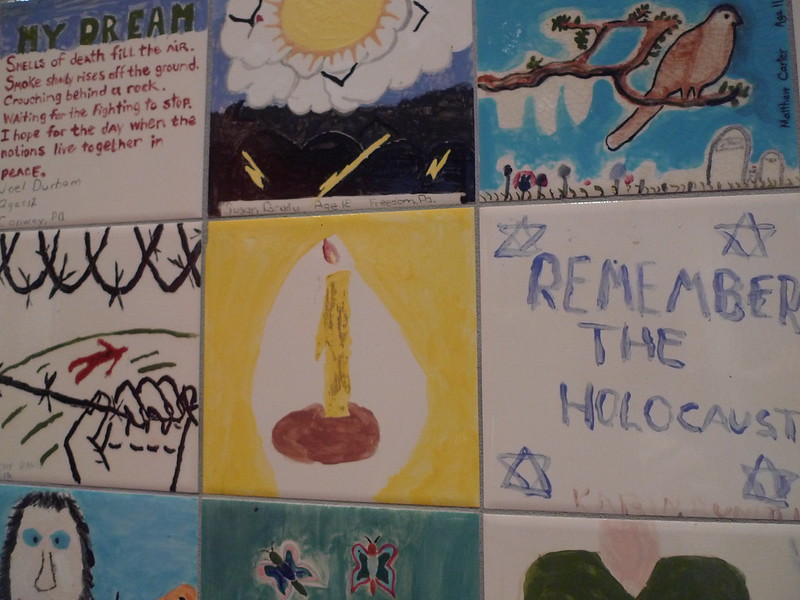


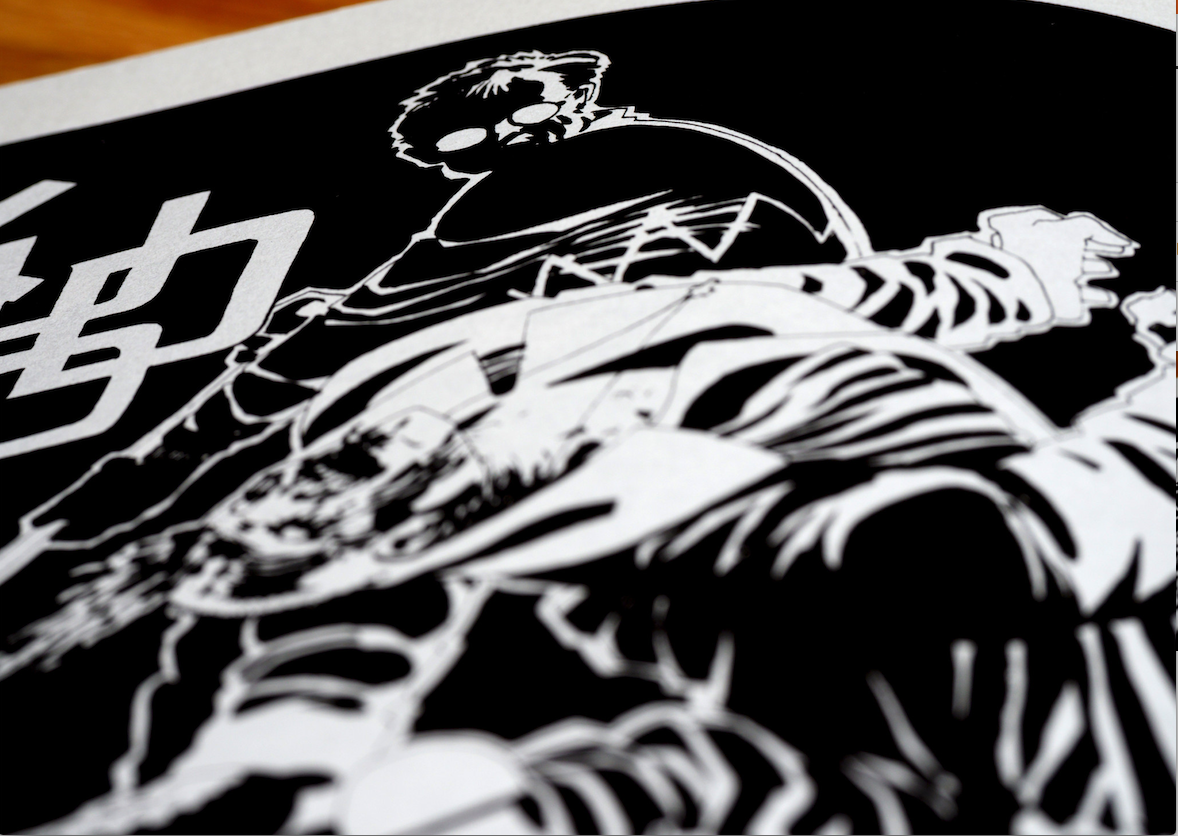

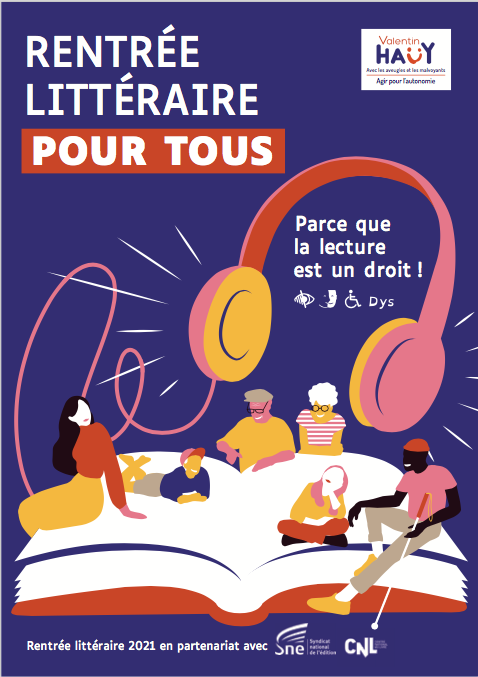

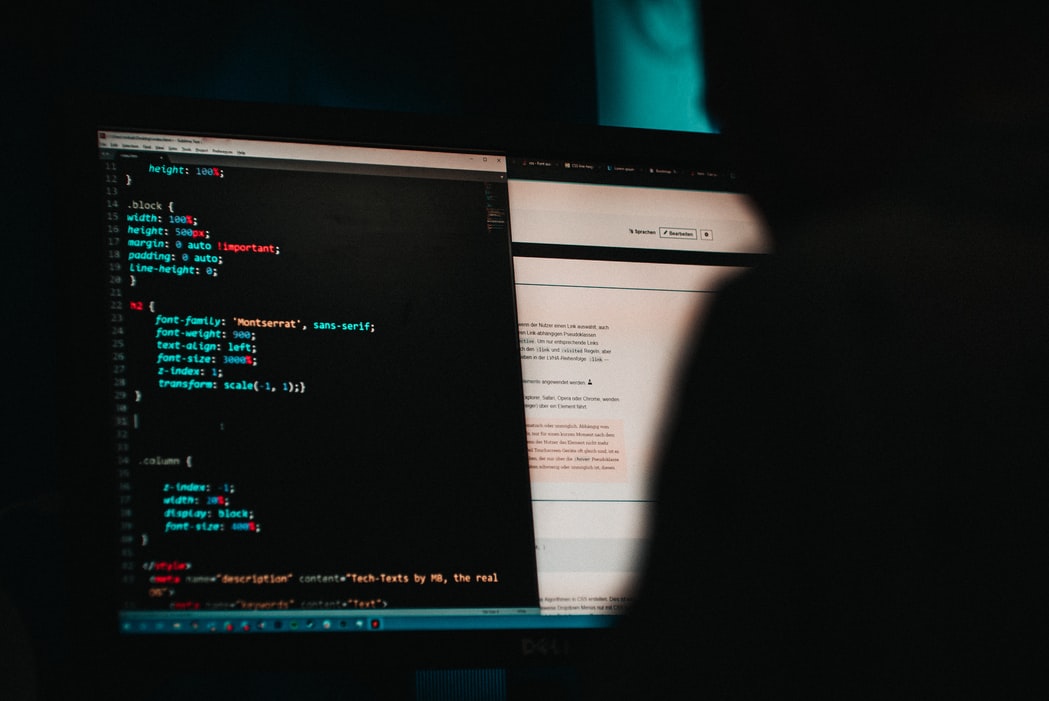
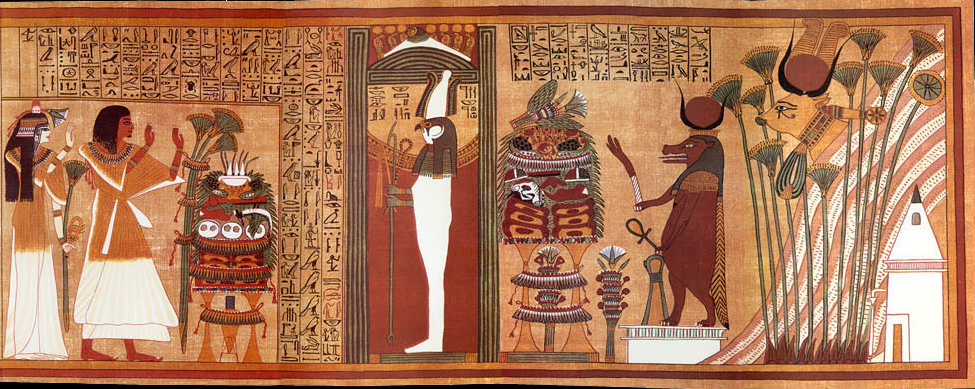
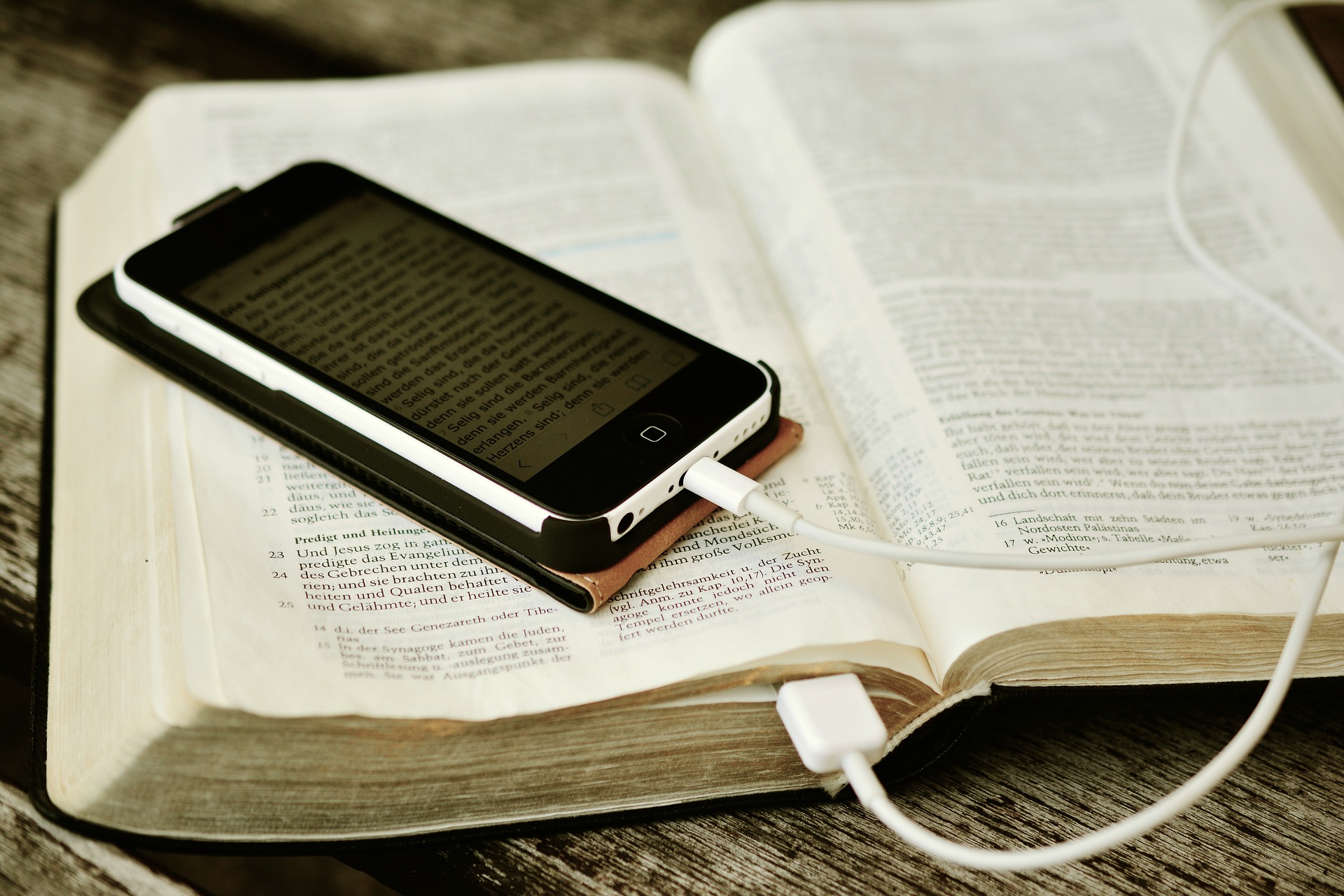

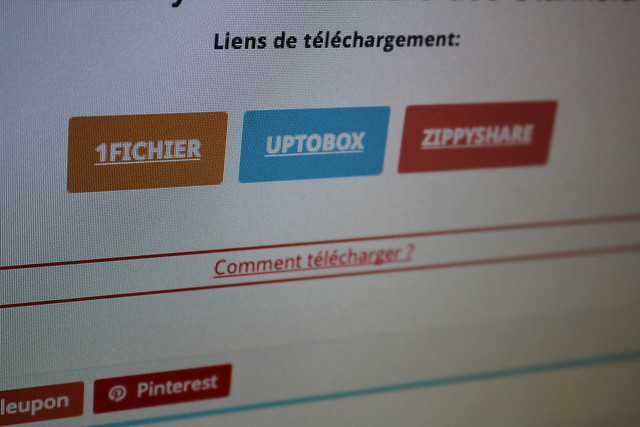



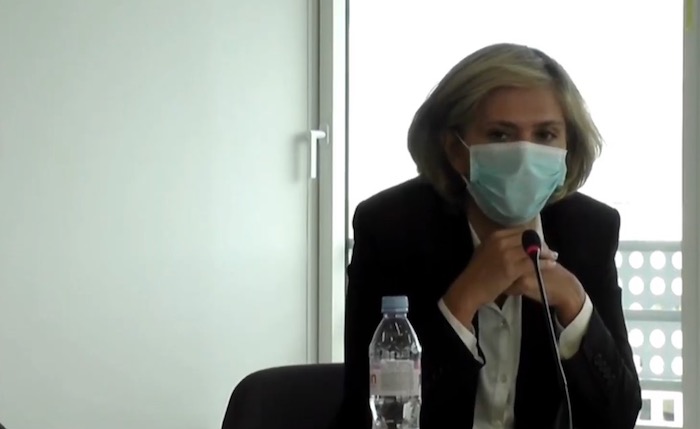
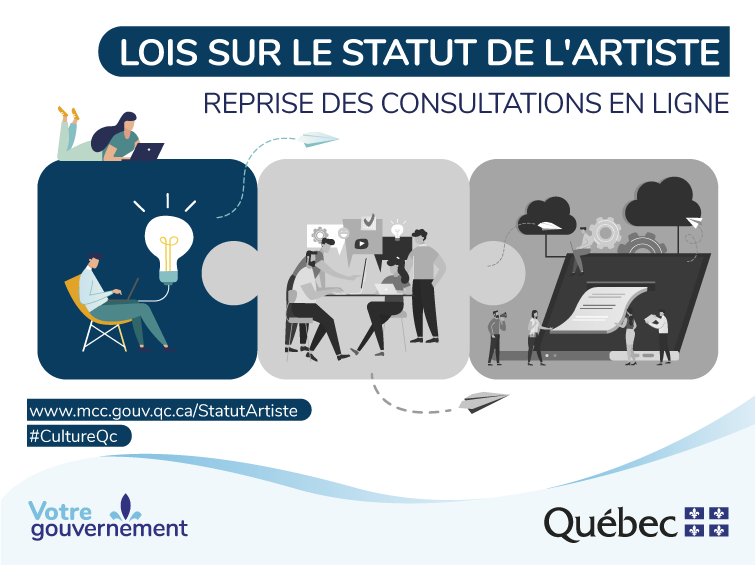

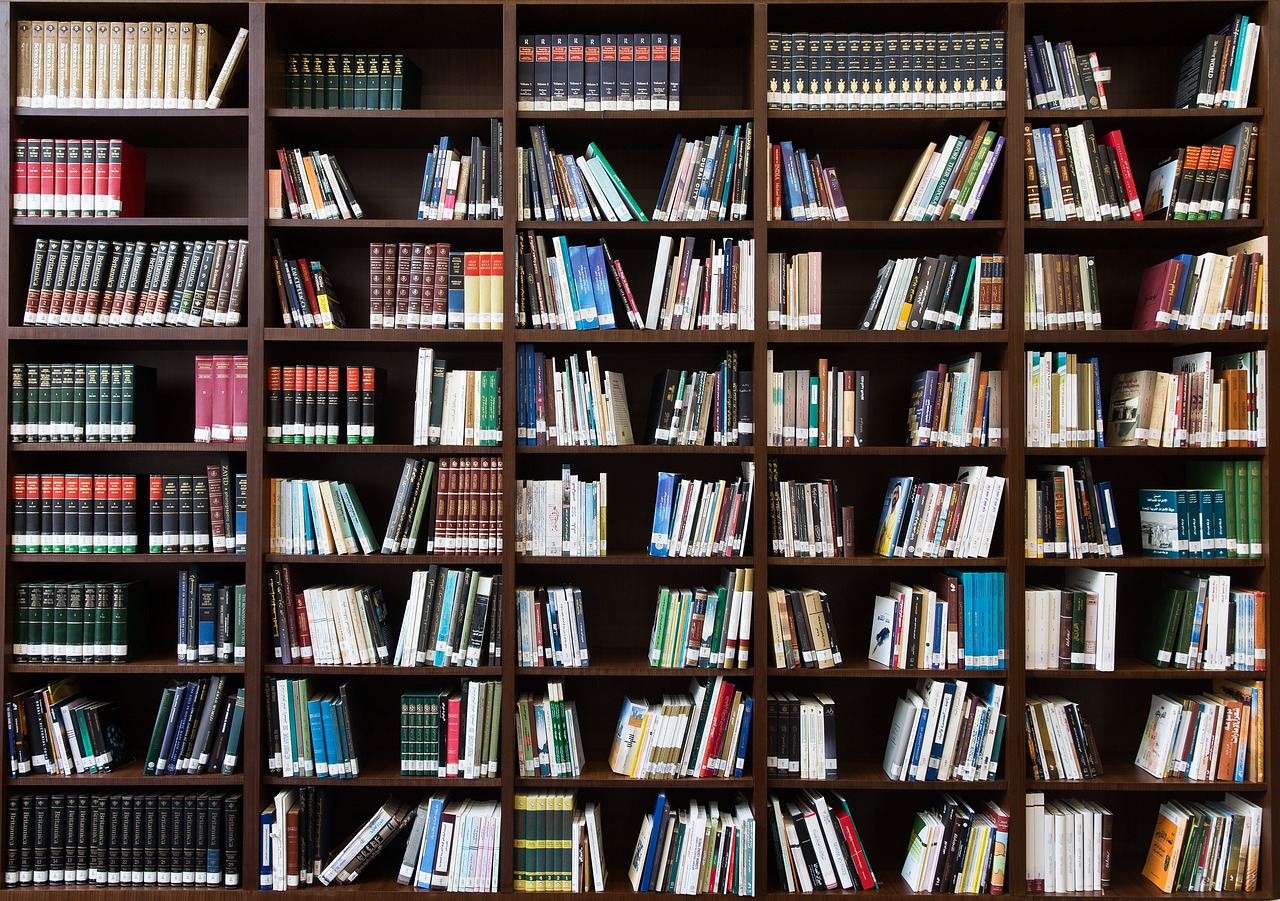




4 Commentaires
M2 Livre Dijon
17/12/2019 à 08:57
Le Master2 Métiers du livre de l'université de Bourgogne avait convié, le 15 novembre dernier, David Meulemans à s'exprimer sur ce sujet devant les étudiants : intervention très réussie !
DavidMeulemans
17/12/2019 à 11:04
@ M2 Livre Dijon ! Oui, c'était une belle journée, avec de superbes interventions (je parle des interventions des autres personnes, hein !). L'organisation était parfaite. Ce qui était remarquable aussi, c'était que la journée était elle-même vraiment "éditorialisée" : l'ouverture par une conférence / performance était très réussie et a permis de lancer cette journée sur le bon ton. Rétrospectivement, je me dis que toute journée de colloque devrait être pensée ainsi, comme un livre chapitré, avec un soin particulier apporté à l'ouverture et la clôture, et un souci pour les spectateurs.
Ce "feuilleton" sur Actualitté est la transcription des notes que j'avais sous les yeux lors de l'intervention. Ce qui explique que c'est à la fois plus délié et plus télégraphique qu'un article. :)
Aspirante éditrice :)
17/12/2019 à 14:23
Merci beaucoup d'avoir partagé votre intervention, elle me donne vraiment à réfléchir! Bonne continuation dans votre travail :-)
Signes et balises
18/12/2019 à 17:30
Merci pour ce billet.
Un autre livre en plein dans le sujet, et qui vient juste de sortir: "Barnum - Chroniques" de Virginie Symaniec, éd. Signes et balises
http://signesetbalises.fr/produit/barnum-chroniques-virginie-symaniec/
A lire par tous-toutes les aspirant(e)s éditeurs-éditrices!!
Voir la critique d'Éric Dussert sur L'Alamblog : http://www.alamblog.com/index.php?post/2019/12/16/Le-Barnum-de-Virginie