Les Ensablés - Raymond Guérin (1905-1955), le malchanceux
Chers lecteurs des Ensablés, comme je vous l'indiquais, nous rééditons cet été des articles susceptibles de vous donner des idées de lecture. Aujourd'hui un article paru en 2014 sur Raymond Guérin et qui a été traduit pour le magazine "Conservations littéraires" Raymond Guérin est, rappelons-le, l'auteur d'une oeuvre vaste et variée. Il a écrit en particulier une trilogie intitulée «Ébauche d’une mythologie de la réalité » dont il faut impérativement lire le premier tome intitulé "L'Apprenti"... .
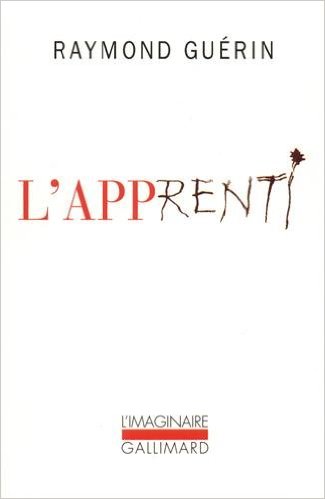
Par Hervé Bel
A la suite de l’Apprenti, il y eut tout de même Parmi tant d’autres feux (800 pages) et les Poulpes (idem). Ce dernier texte raconte la captivité en Allemagne de son héros récurrent, Monsieur Hermès. Guérin le termine peu de temps avant sa mort. Il est sûr qu’il tient un chef-d’œuvre : c’est du Céline, mais pas seulement ! Il tient enfin, il en est sûr, le succès, lui qui, depuis des années, en plus de sa profession, écrit, publie chez Gallimard, sans parvenir à percer. Il n’aura pas le succès et mourra, jeune, en 1955 à cinquante ans, d’un cancer, mais pas seulement, de déception aussi. L’existence évoque la vie obscure de nombreux écrivains (dont la mienne), partagée entre le travail alimentaire et la passion littéraire. L’espoir, au fond, c’est d’arriver un jour à vivre de sa plume. On regarde ceux qui y arrivent, on se dit : « Pourquoi pas moi ? Qu’ont-ils de plus que moi ? » Alors on accuse le favoritisme, on accuse le destin, et on reprend son œuvre : « Le prochain sera le bon ! » L’écrivain travaille, travaille sur ses heures de sommeil : Guérin était un passionné.
Raymond Guérin (1905-1955)
Raymond Guérin, né en 1905, ressemblait à un élève des grandes écoles de commerce de notre temps: grand, la figure longue, des lunettes, le cheveu brun et court. Sur les photos, il porte des costumes que l’on devine gris, ou bien, au bord de la plage, des polos ; on dirait un expert-comptable en vacances. Il était agent d’assurances à Bordeaux, ayant hérité de la charge de son père qui, lui, avait commencé dans la limonade (voir à ce sujet « Quand vient la fin » publié chez Gallimard (1942) qui raconte en détail, sans concession, la mort de son père). Guérin aurait pu vivre tranquille, en profitant d’un niveau de vie aisé. Mais, dans sa jeunesse, il avait souffert. Souffert… entendons-nous bien, une souffrance mesurée à l’échelle d’un jeune bourgeois des années 30… Mais tout de même. Sa souffrance fut celle d’un adolescent honteux de ses parents. Il se crut supérieur à eux, cultiva sa différence, devint un « littéraire »… Il souffrit aussi du stage qu’il fit à l’hôtel Crillon à Paris en tant qu’employé, à la demande de son père, et dont il rapporta son chef-d’œuvre « L’apprenti », bien après.
L’apprenti est d’une modernité étonnante. On y parle crûment des choses de la vie, d’un domaine, en particulier, relativement peu évoqué dans la littérature (Proust le fait mais de façon plus allusive, Paul Bonnetain de façon plus directe) : l’onanisme. Monsieur Hermès le pratique régulièrement dans sa chambre d’hôtel où il revient, chaque jour, harassé, après avoir servi les clients fortunés du palace où il a échoué. Monsieur Hermès est également voyeur. Chargé d’images, il se réfugie dans sa chambre et imagine, prenant du réel tout ce qu’il a collecté pendant la journée des scènes de débauche, allant jusqu’à s’identifier à une femme. Étrange et cependant banal. L’intérêt du roman est ailleurs, par le prisme qu’il prend dès de départ de ne jamais se détacher du point de vue du héros. Monsieur Hermès, homme seul, est un spectateur. Et ses habitudes sexuelles ne sont que la conséquence de sa façon de vivre : il observe, il regarde les gens vivre. On le suit dans son hôtel, gémissant de la bêtise, parlant à ses chefs, ses collègues, avec leur petite vie. Mais sa propre vie, elle-même, est petite, et il le sait. Dans la chambre, la femme et l’homme parlaient. Monsieur Hermès avait plaqué son oreille contre la cloison. Il ne bougeait pas. Mais qui eût pu voir son visage à cet instant, l’aurait vu durcir par une animation intense, sous le coup de l’émotion grave du plaisir. (…) Quelques minutes avaient passé. Monsieur Hermès s’était remis à écouter. Maintenant cela paraissait sérieux. Monsieur Hermès restait figé dans une position incommode, attentif au moindre murmure. Un murmure en effet s’élevait dans la chambre d’à côté, à demi recouvert par les grincements du lit. Des images s’imposèrent à Monsieur Hermès. Une certaine image surtout. Encore une qui y allait sur le billard, la salope ! Et ta sœur ? (…) C’était la femme. Elle se plaignait doucement, régulièrement, comme un faucheur donnant son coup de faux dans l’herbe de son pré, comme un menuisier penché sur son rabot. Le respect humain ? Les contingences ? Aux orties, aux orties ! Il n’y avait plus de temps ni d’espace. (…) Savoir si elle se souciait seulement de l’homme qui était sur son ventre ? Toutes les mêmes ! Il n’y avait que leur satané plaisir qui comptait. Prendre son pied. Seule, dans la nuit, seule avec elle-même, ouverte à une autre chair qu’elle sentait sans la reconnaître. Quelle différence avec lui dans tout cela ? Solitaire à un ou deux, ça ne changeait pas grand-chose.
Il y a du nerf dans ce texte, et tout est comme ça. Monsieur Hermès, héros de L’apprenti, est un « loup des steppes» perdu dans la vie parisienne, mais un loup sans canines, car, si Monsieur Hermès se plaint de sa vie, il ne fait pas grand-chose pour s’en échapper… Comme beaucoup d’autres, et c’est bien pourquoi ce roman est bouleversant. Il hait le monde, les puissants et les pauvres, mais il va chaque jour travailler pour servir les riches et cohabiter avec les pauvres. Il est si faible, si vrai, qu’on éprouve parfois de la difficulté à s’attacher à lui: il a tellement de morgue, il est si lamentable parfois, notamment avec les demoiselles modestes qu’il séduit puis qu’il lâche. Parfois, c’est très drôle. Monsieur Hermès a cependant quelque chose d’estimable : il écrit une pièce de théâtre, il veut être écrivain. Comme tous ceux qui écrivent, il quête les appuis, demande des avis. On ne le prend pas au sérieux, le lecteur lui aussi ne le prend pas au sérieux, il le connaît trop, il sait ses faiblesses, sa médiocrité… Comme si on ne pouvait pas être écrivain, parce qu’on est médiocre dans sa vie!
La suite de L’apprenti, avec Parmi d’autres feux montrera que la vocation de Monsieur Hermès n’était peut-être pas aussi ridicule que cela. Dans ce roman, une humanité sans fard, rarement brillante, rarement cruelle, plus simplement moyenne, physique, avec des odeurs écœurantes, des mesquineries. On dirait que Guérin, en la décrivant (dénonçant?), voudrait l’anéantir, faire œuvre de vengeance. Comme tous les purs, il attendait beaucoup trop de la littérature. Guérin a utilisé sa propre vie pour ses romans. L’écriture est « compacte », il faut du détail, toujours plus de détails, aucune concession, aucune facilité, dire et dire encore pour qu’enfin surgisse, chez le lecteur, une impression d’étouffement, « une nausée » devant le réel, pareille à celle qu’éprouve Roquentin, dans le roman éponyme « La nausée » de Sartre.
Dans une lettre citée par JP Kauffmann, Raymond Guérin écrit à propos de son œuvre : Il s’agissait de recréer une dizaine d’années de la vie banale d’un homme en tentant de m’identifier sans défaillance du début jusqu’à la fin au caractère, aux tendances, aux préoccupations, aux limites de ce héros, et ce, sans tricher jamais, sans truquer, sans oser le moindre clin d’œil complice au lecteur. Guérin veut tout dire, persuadé que la retranscription précise de la vie personnelle conduit à l’universalité, et donc à la littérature. Ce n’est pas faux, mais ce n’est pas forcément vrai. Et on doit reconnaître, parfois, que son œuvre a quelque chose à voir avec ces peintres du passé qui ont voulu représenter la réalité le plus précisément possible, aboutissant à des tableaux figés. L’homme est trop complexe, des mots à l’infini ne sauraient le circonscrire. D’ailleurs, Guérin le sait bien, mais il s’échine… Guérin, Don Quichotte du verbe. Vous aimerez beaucoup, beaucoup, L’apprenti, pour cette ironie désespérée qui s’en dégage ; pour cet effort de tout relater, même si c’est long ; et cette cruauté aussi, souvent réjouissante … Pour quelque chose d’autre encore, plus personnel… Comment, dans toutes les bassesses racontées à propos de Monsieur Hermès, ne pas en reconnaître certaines qui nous affligent?… Et de les lire comme un voyeur de soi-même, tenté et cependant mal à l’aise?
Au hasard, l’on tombe sur ces phrases : (…) Comment ne pas vivre en fonction d’autrui? Pour être vraiment celui qu’on est, il faudrait pouvoir vivre enfermé dans une coquille ou sur une île déserte. Était-il lui-même (…) devant les clients? Dès qu’on ouvrait la bouche, dès qu’on remuait le petit doigt, on cessait d’être tout à fait maître de soi. L’individu qu’on croyait être, de même que celui qu’on voulait être, vous échappaient. Et tout ce qu’on faisait, et tout ce qu’on disait, une fois que c’était sorti de soi, ça ne pouvait plus s’effacer, se modifier, se raccommoder (…). Devant soi, se formait aussitôt un nouvel être qui n’était jamais au diapason… (…)(…) Moi, moi, moi, et si je n’avais pas de moi? (…)(…) Pour ça, Monsieur Hermès avait bon fond. Quand il ne pigeait pas un chef-d’œuvre, il s’inclinait. Au lieu de le déprécier, il se persuadait que c’était lui qui était idiot. Les autres, ils exagéraient. Se prenaient pas pour des merdes (…)
Le style de Guérin, dans L’apprenti, penche vers Céline. On l’a reproché à Guérin. Je m’étonne toujours de ces reproches. Reproche-t-on à un compositeur de musique d’être influencé par un autre ? Entre Ravel et Debussy, ne pourrait-on pas dire qu’il y a des ressemblances ? Mais personne n’y songe, tandis qu’en littérature… Oui, Guérin penche vers Céline, mais principalement dans L’apprenti, parce que le propos s’y prête : le style de Céline est pour Guérin un outil servant son propos. Quand on lit Parmi tant d’autres feux, on y découvre Guérin qui s’essaie à du Martin du Gard, du Mauriac, du Proust… Peut-être que c’était cela le problème de Guérin : la difficulté de trouver son propre style, une trop révérencieuse admiration pour la littérature. On a noté que Guérin changeait de style à chacun de ses romans, et c’est vrai. C’était sa façon à lui, un peu naïve, de dire qu’il était un grand romancier puisqu’il pouvait adopter le style de plusieurs autres grands. On disait que Guérin avait mauvais caractère. Je le soupçonne sans confiance en lui, vindicatif pour donner le change à des collègues écrivains, à Gaston Gallimard… Guérin, un vieux garçon vieillissant qui provoque en se disant que ce n’est pas grave, et qui se désole si on le prend au sérieux. Se désole puis se révolte. Il souffre, il sait la pureté, la force de son engagement littéraire, mais en même temps n’y croit que par intermittence, finira par ne plus y croire du tout après l’échec des « Poulpes ». Guérin aurait dû s’installer à Paris, mais il aimait Bordeaux, la mer, le soleil et les baignades avec sa femme Sonia. Dieu merci, malgré sa vie trop courte, Guérin a eu de bons moments.
Lire Guérin, c’est connaître un moment émouvant. Outre le texte, passionnant, on y voit cette grandeur qui ne dit pas son nom, d’un homme qui sacrifie ses loisirs, sa vie, à l’idée d’atteindre par l’écrit une vérité absolue. Écrire tout pour qu’il n’y ait plus rien à écrire après. Clore l’histoire de la littérature, c’est bien ce que tous les écrivains ont en tête, même s’ils s’en défendent. Guérin, justement, ne s’en défendait pas : oui, c’était un Don Quichotte.
Bibliographie Raymond Guérin a beaucoup écrit. Je recommanderai pour commencer trois romans (sans parler de L’apprenti).
– La peau dure, un récit court, Quand vient la fin, qui porte sur la mort de son père à la suite d’un cancer (Galtier-Boissière pensait qu’il eût fait un beau prix Goncourt). Rien n’est épargné au lecteur, mais s’en dégage un profond accent de vérité, et une certaine beauté. Parmi tant d’autres feux, à lire après L’apprenti. Plus long, plus poussif, mais intéressant. On y parle de la jeunesse littéraire.
Pour ceux qui seraient devenus, comme moi, des passionnés de Guérin, on peut lire, comme les Proustiens lisent Jean Santeuil : Les poulpes, Zobain (récemment réédité), la Tête vide. La plupart de ces ouvrages sont publiés dans la collection Imaginaire. Sur Guérin, on consultera, outre le livre de JP Kaufmann, celui de Bruno Curatolo publié chez l’Harmattan « Raymond Guérin, une écriture de dérision. » Enfin je recommande la visite de la librairie du Dilettante (rue Racine à Paris), riche en bouquins et pour son libraire connaissant bien cette littérature oubliée.


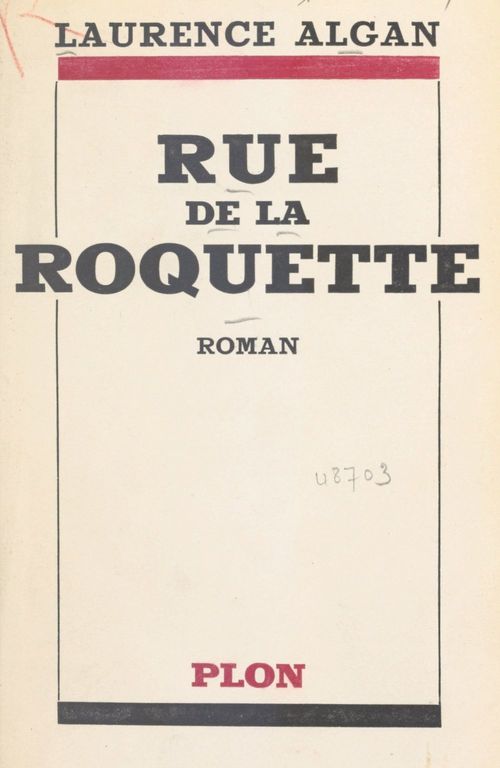
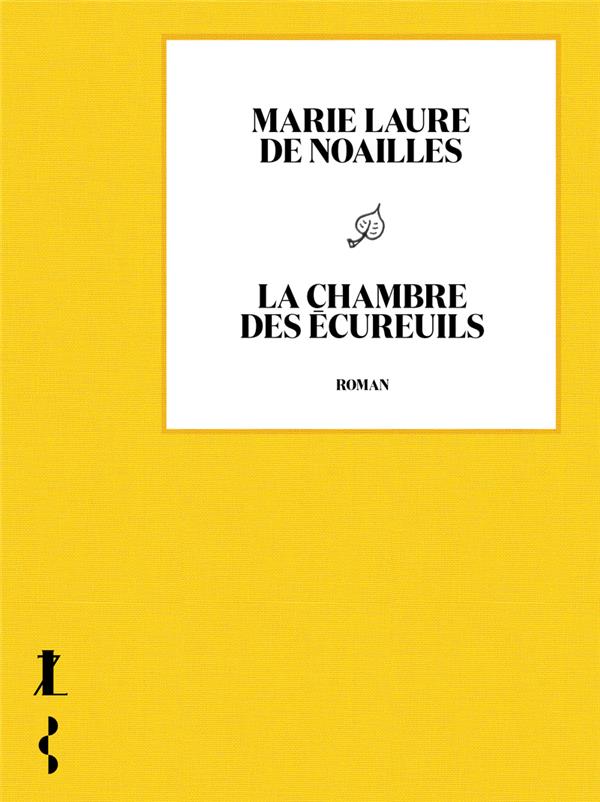
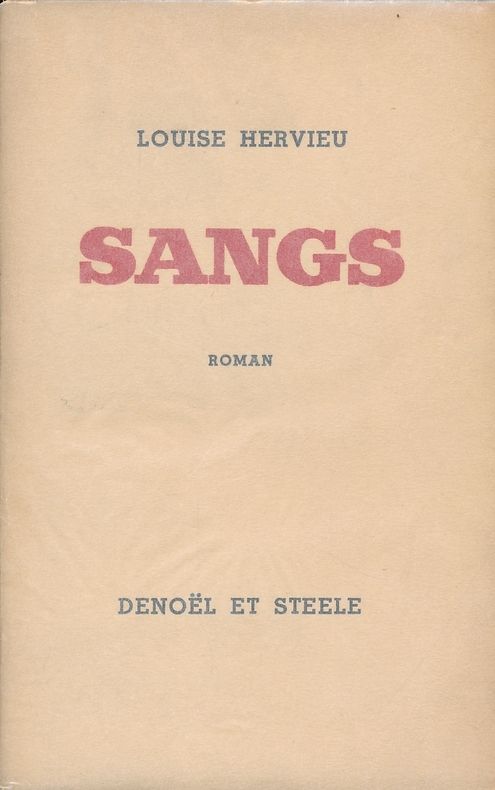
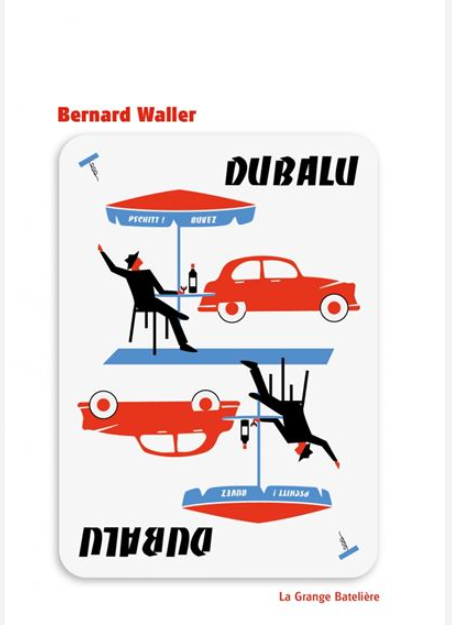
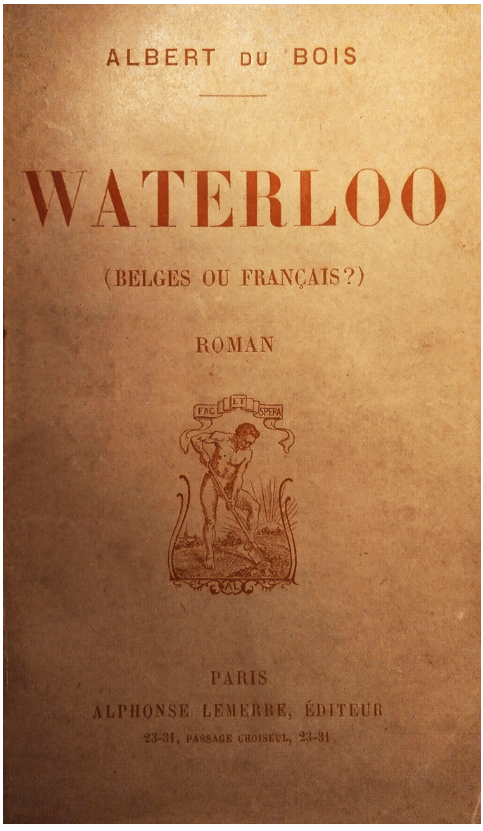
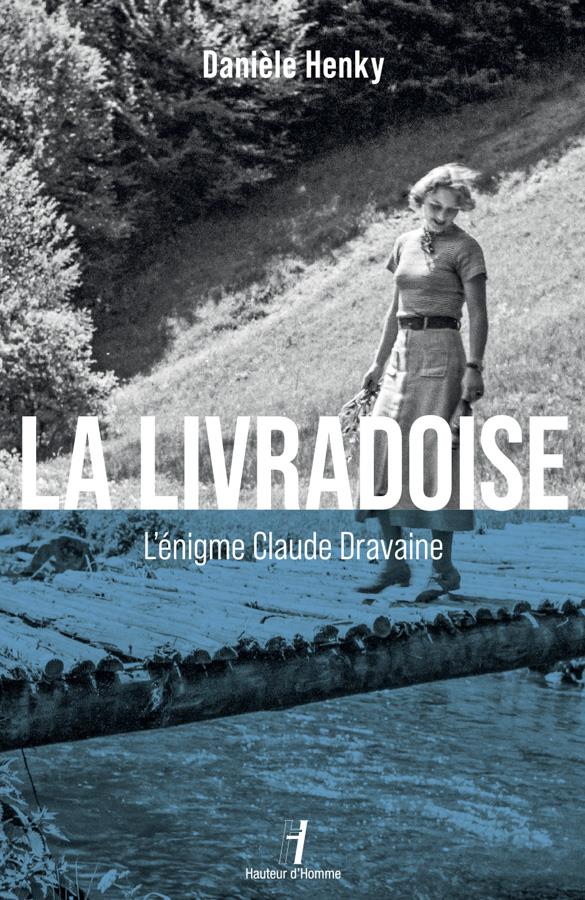
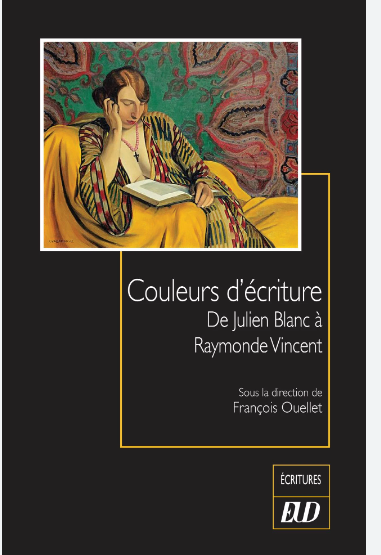
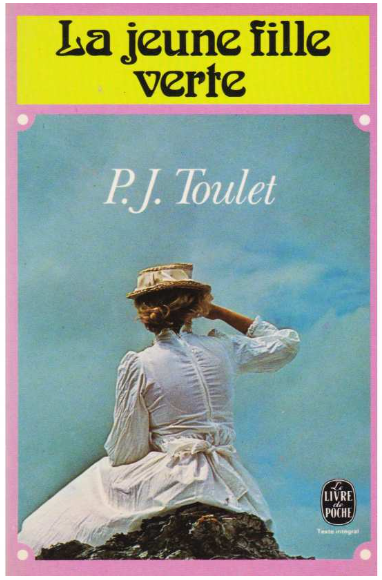
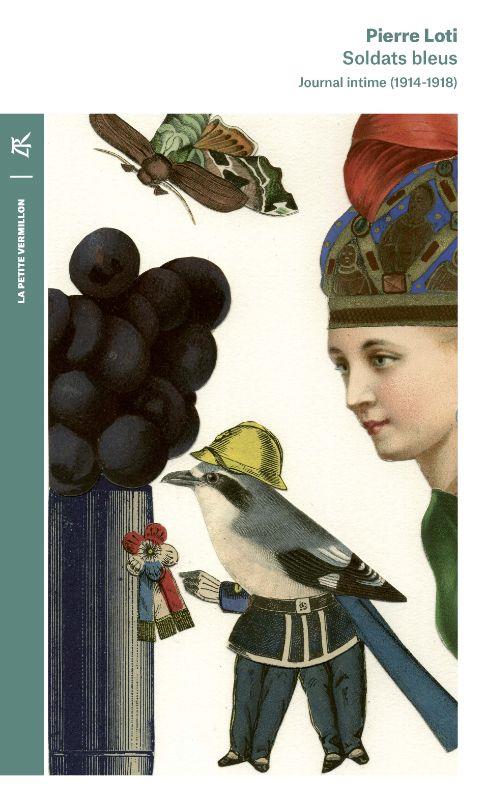
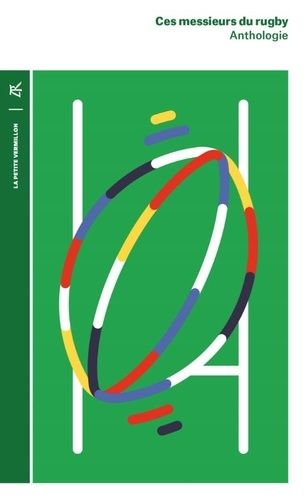
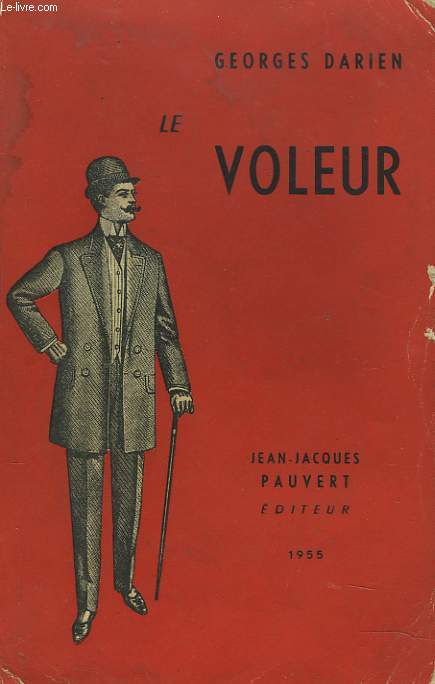
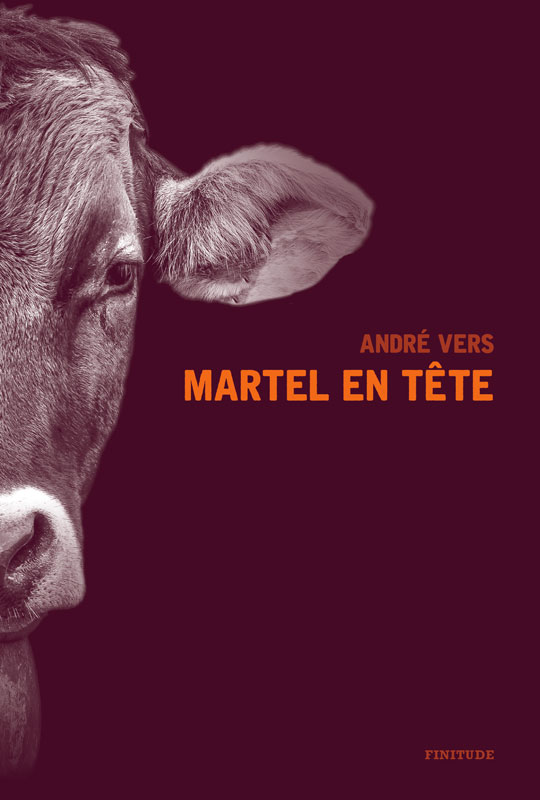

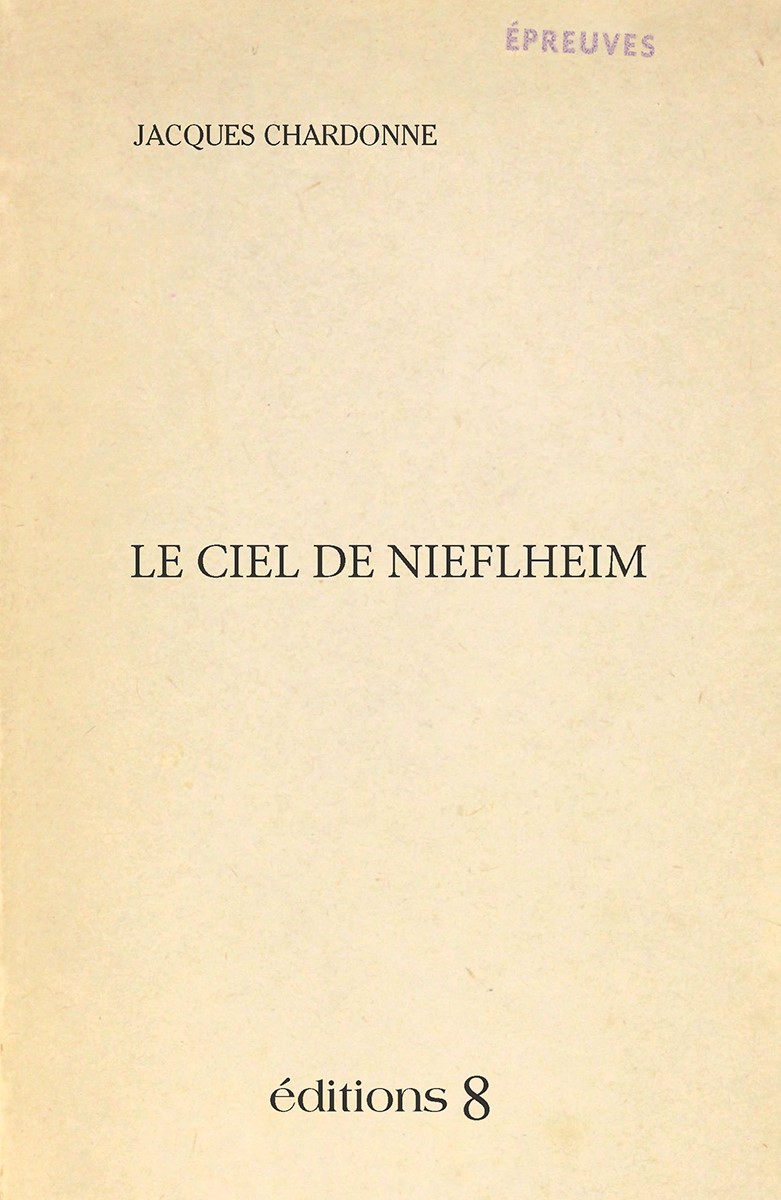
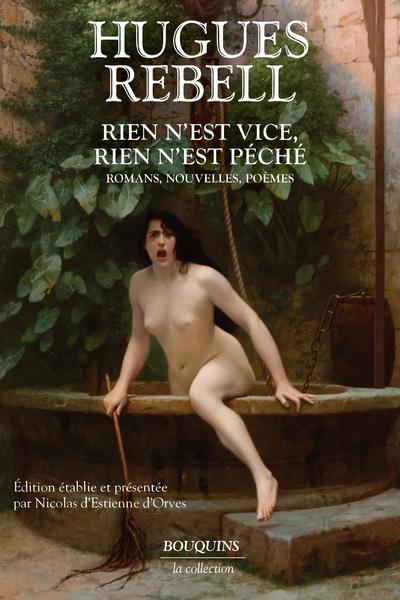
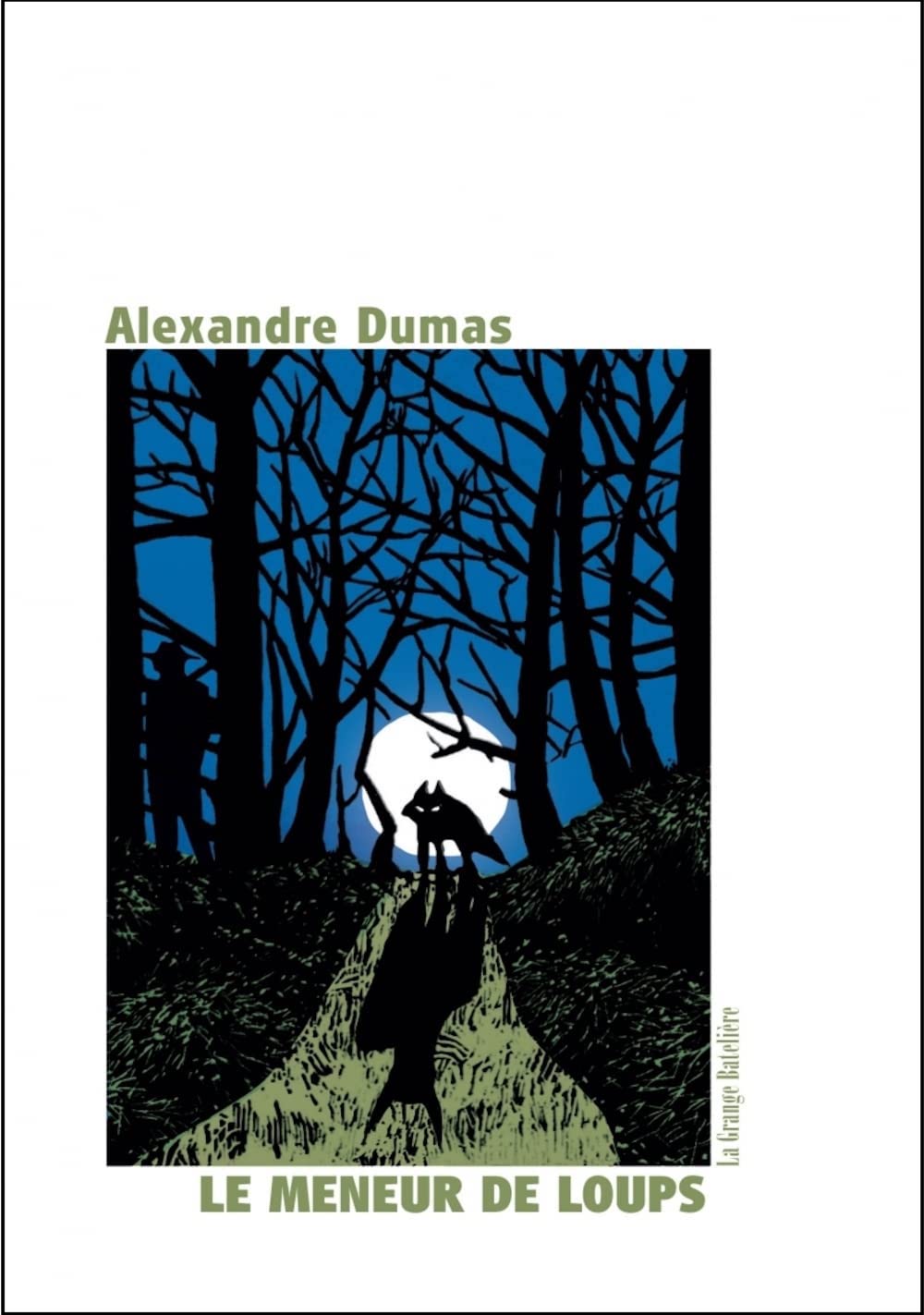
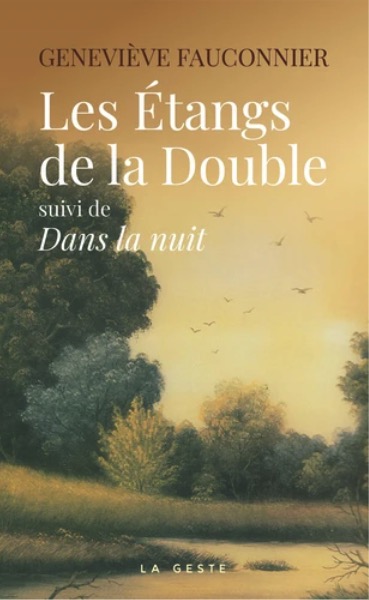
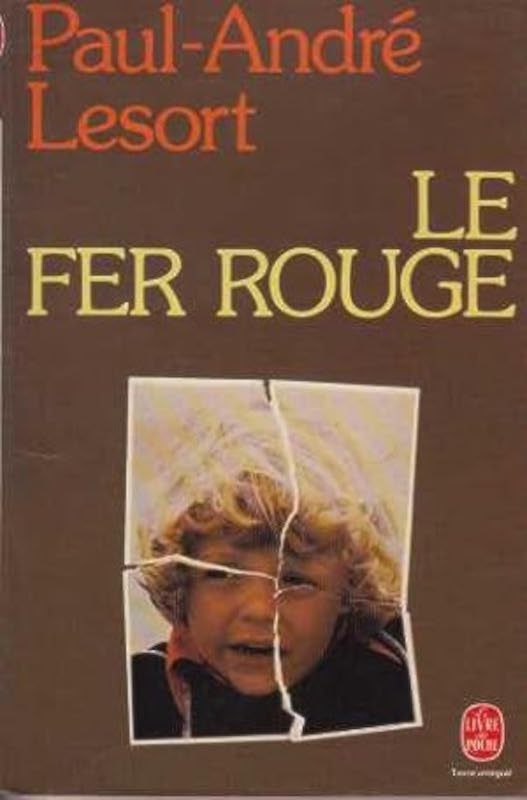

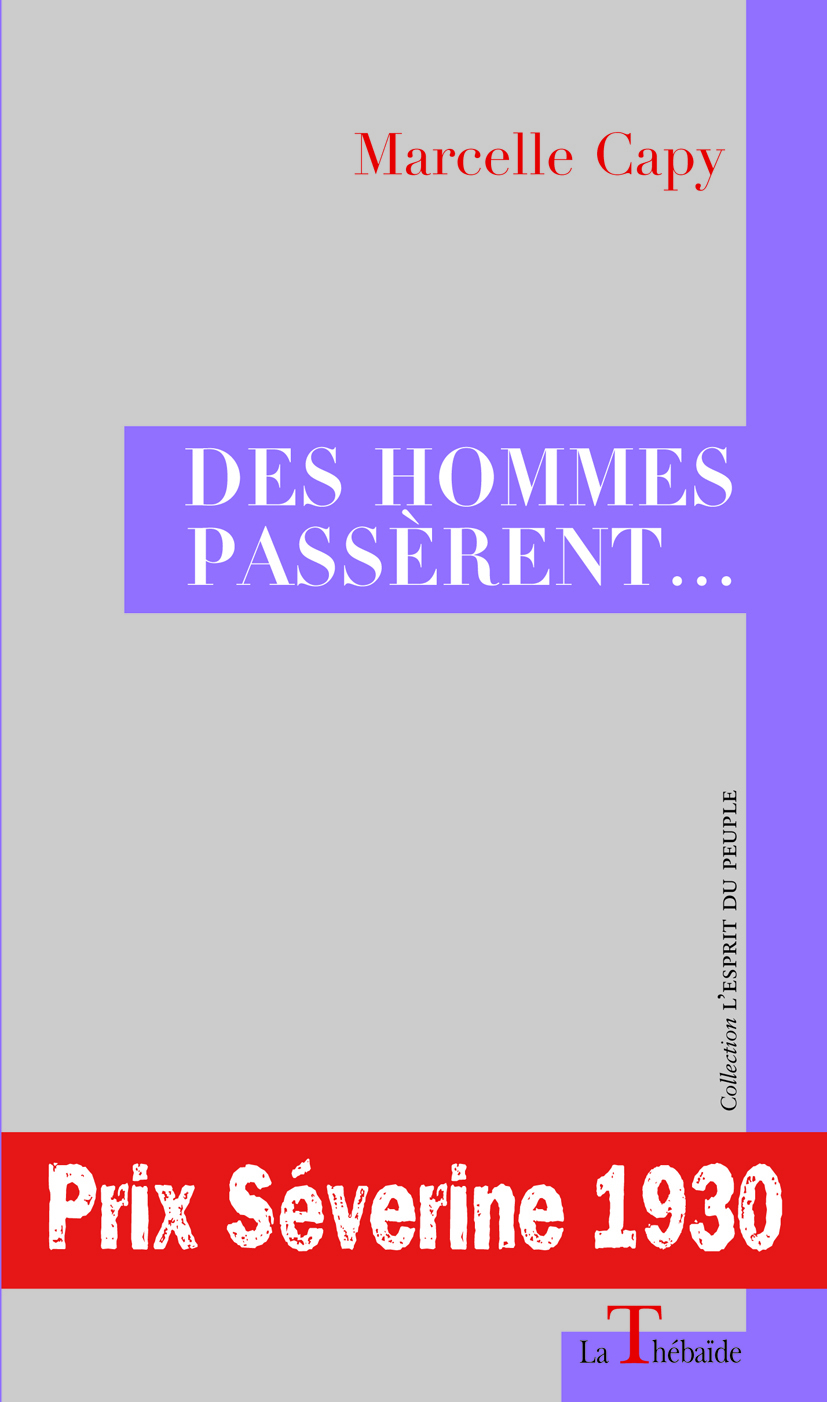
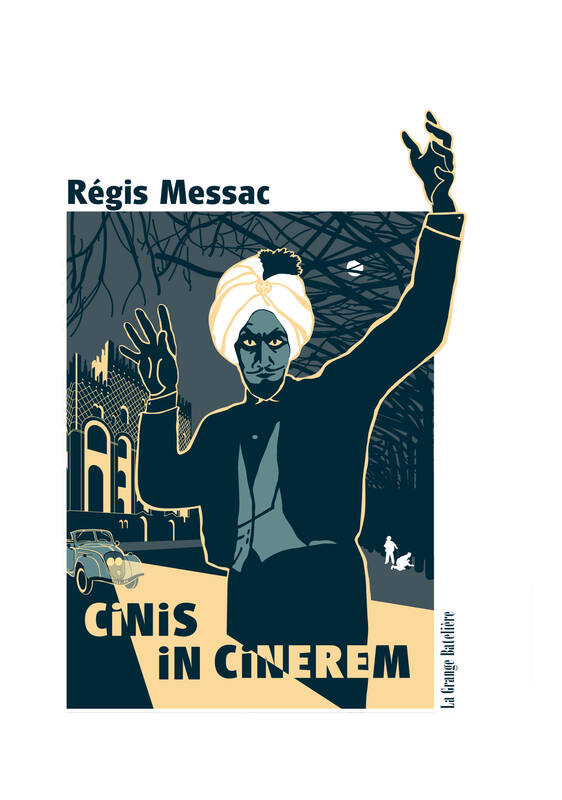
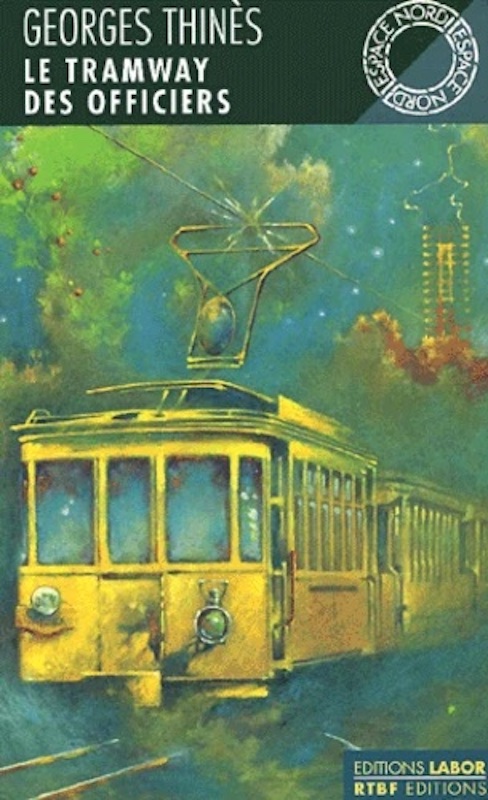
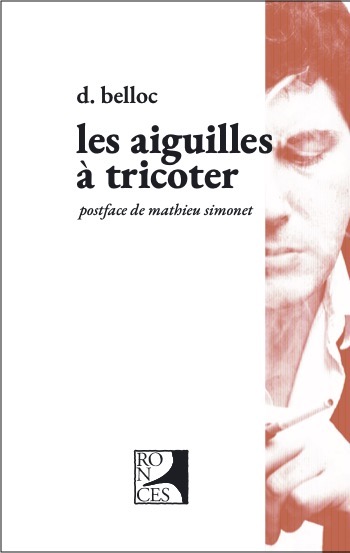
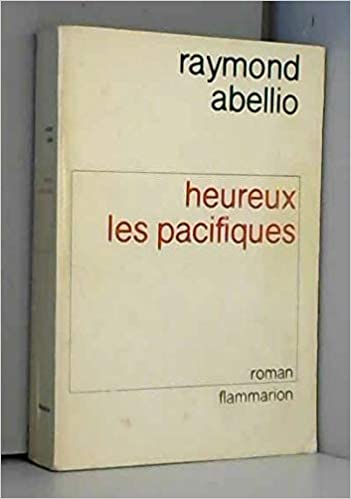
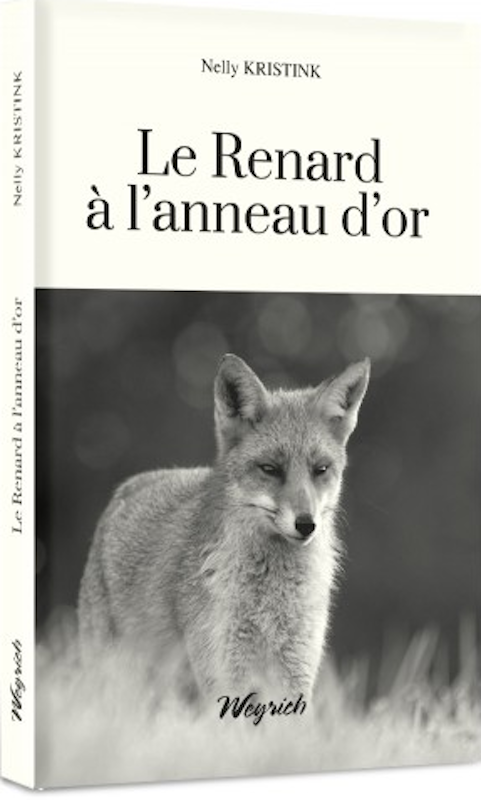
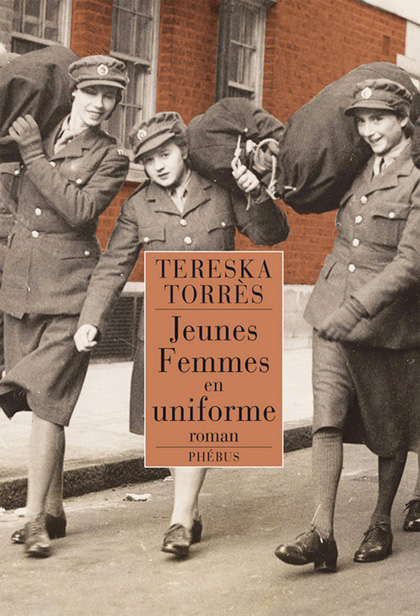
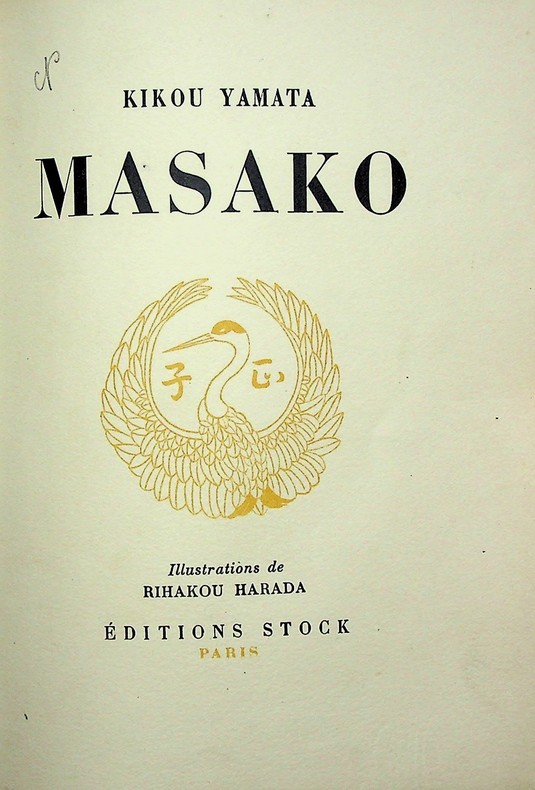
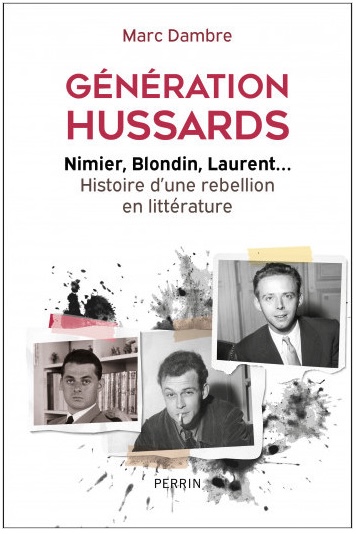
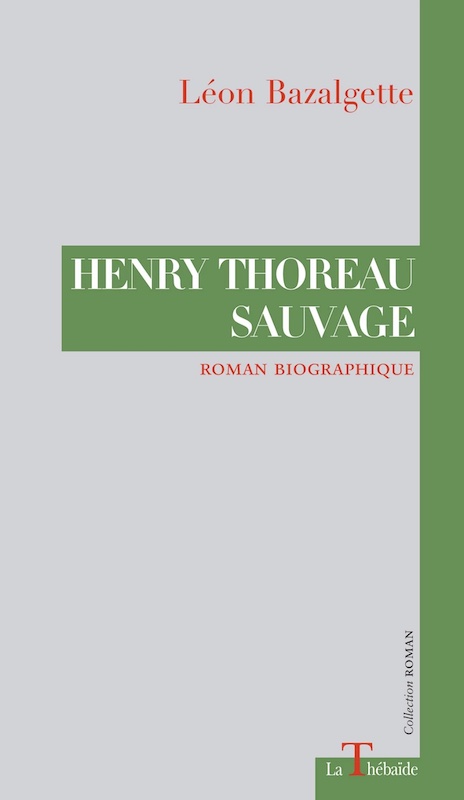
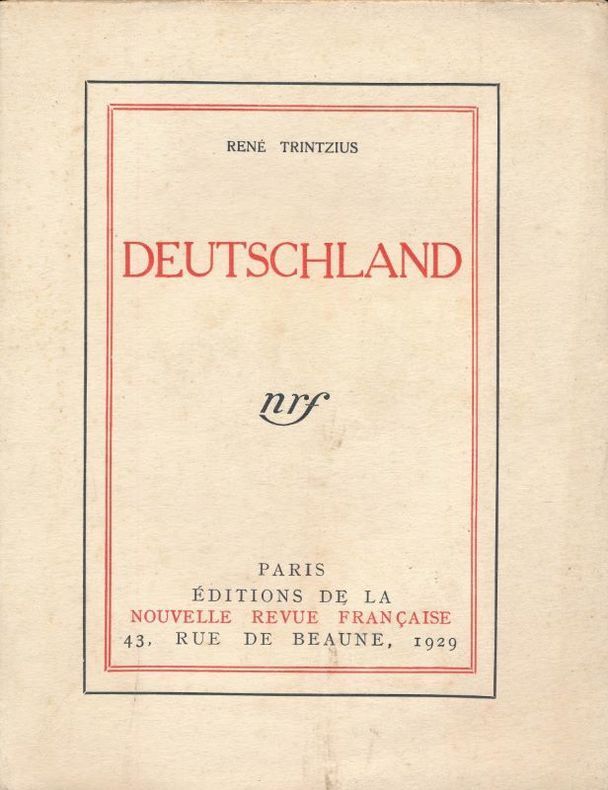
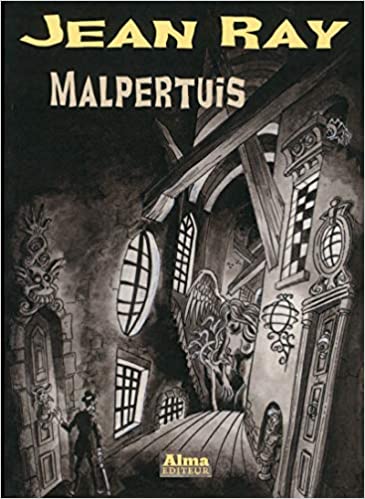
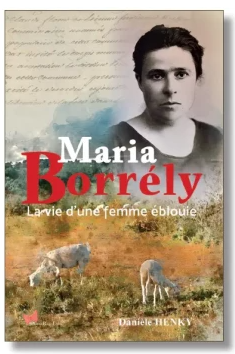
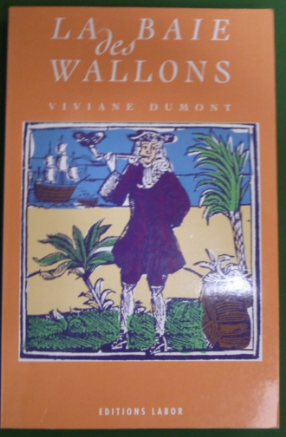
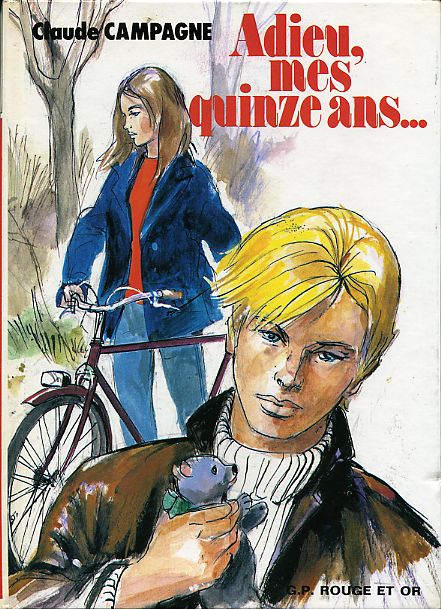
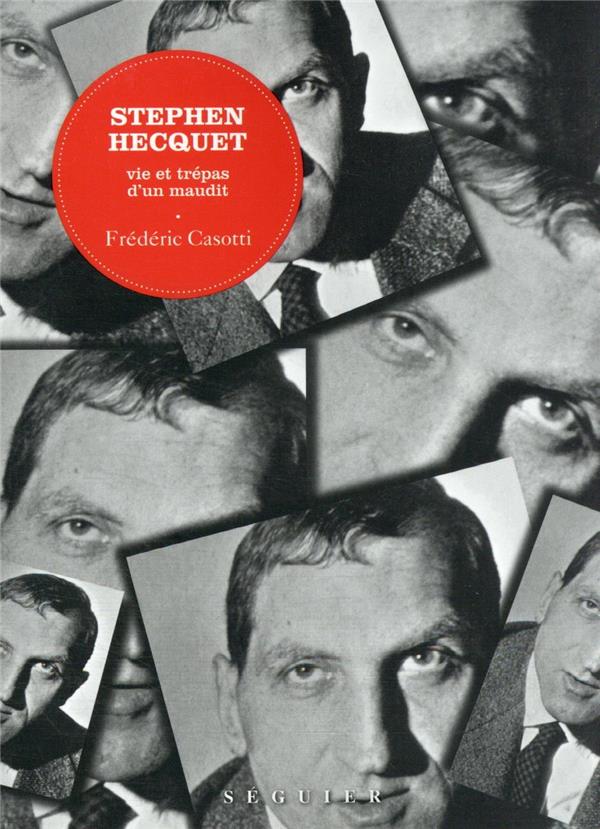
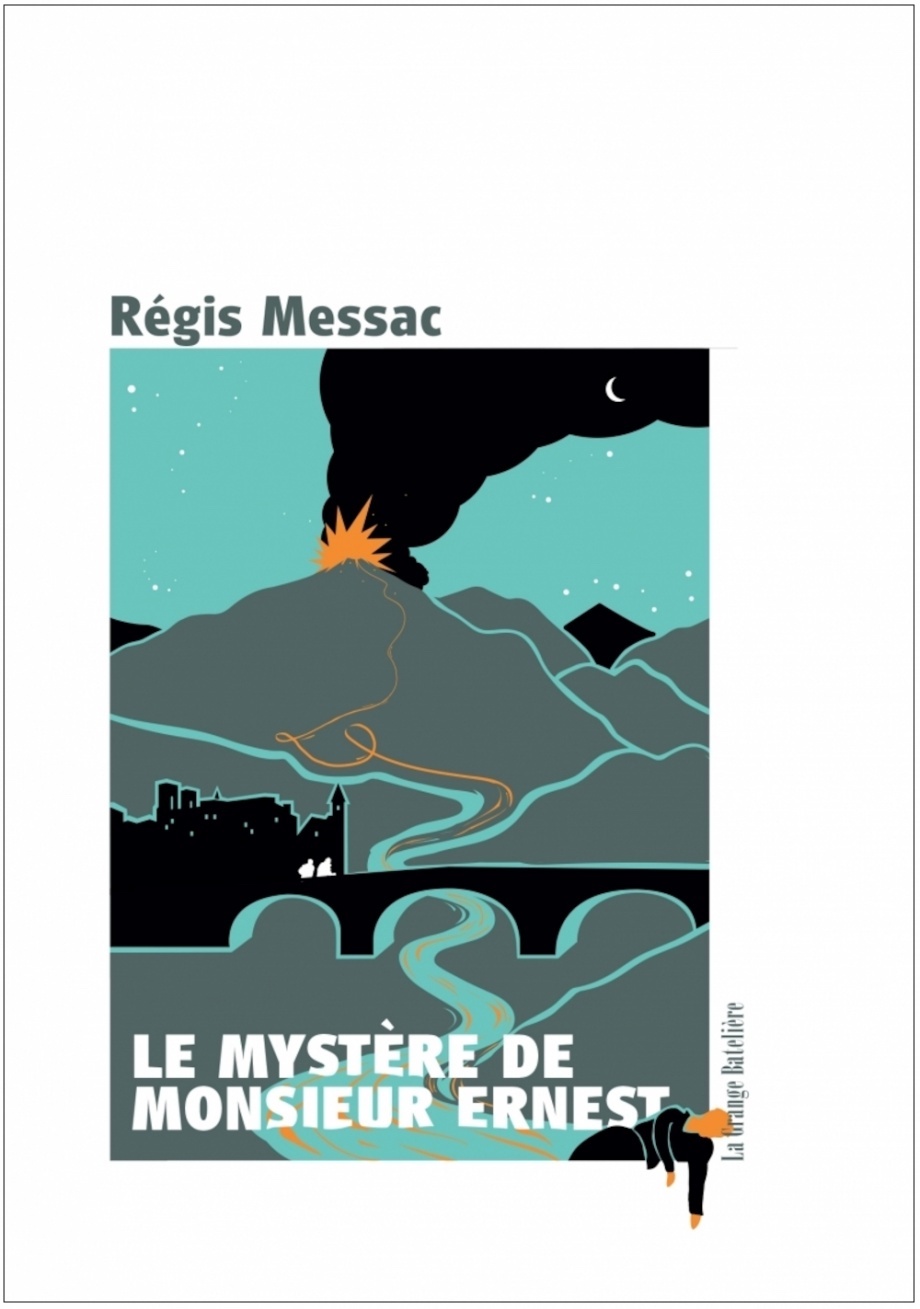


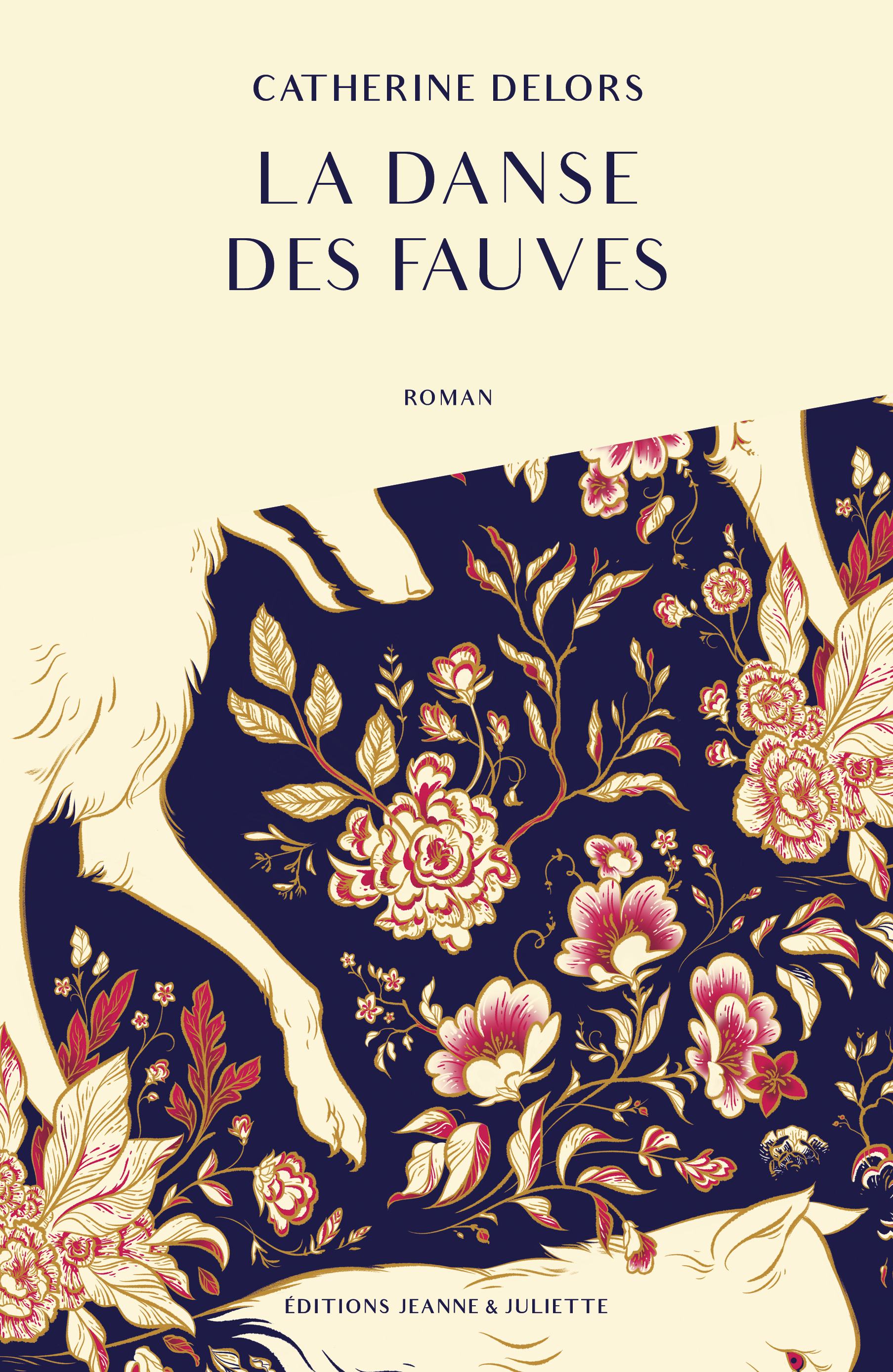
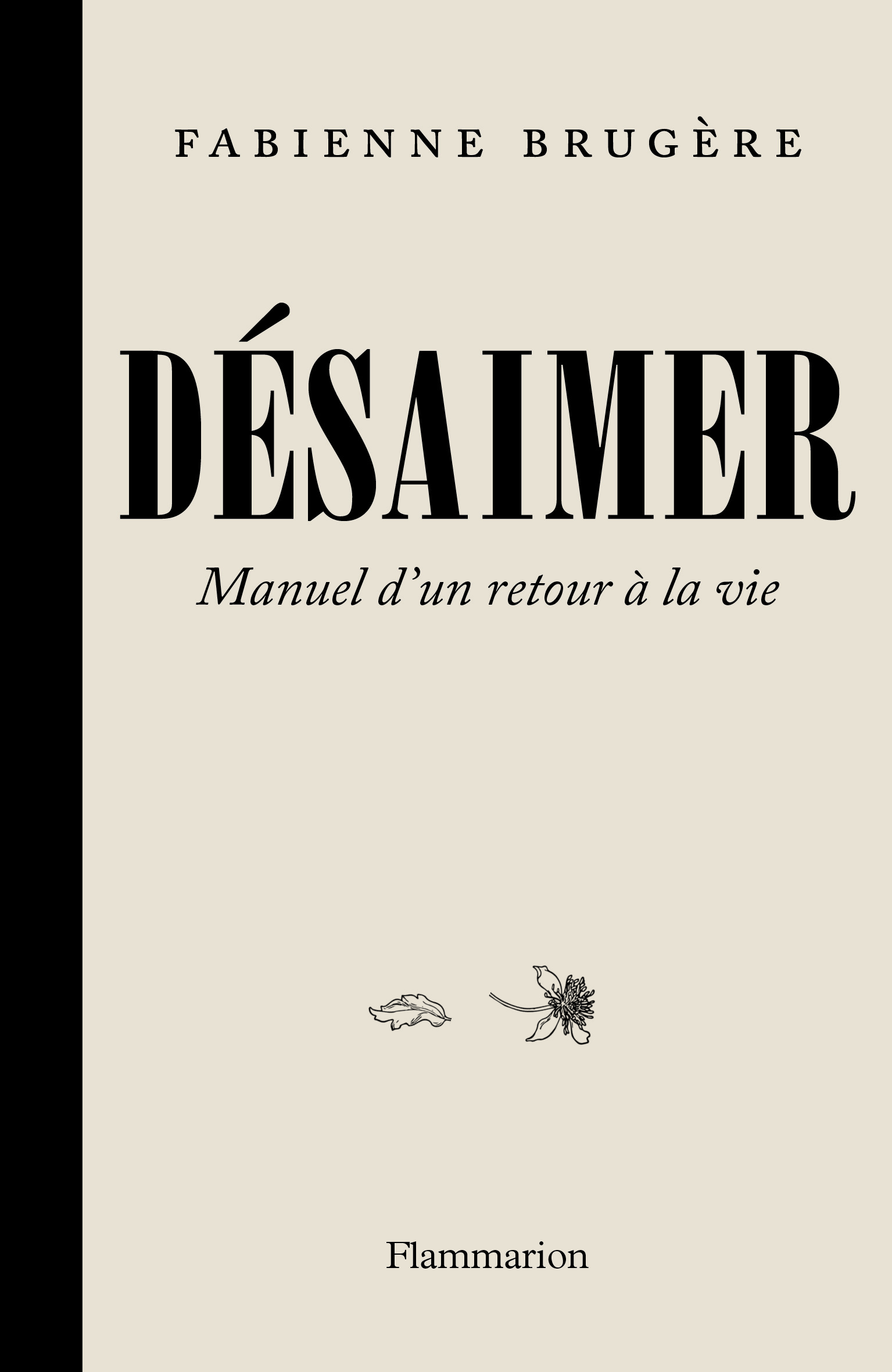
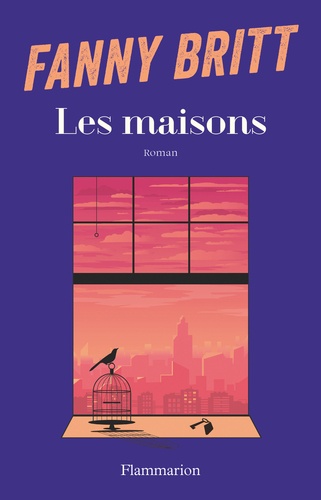
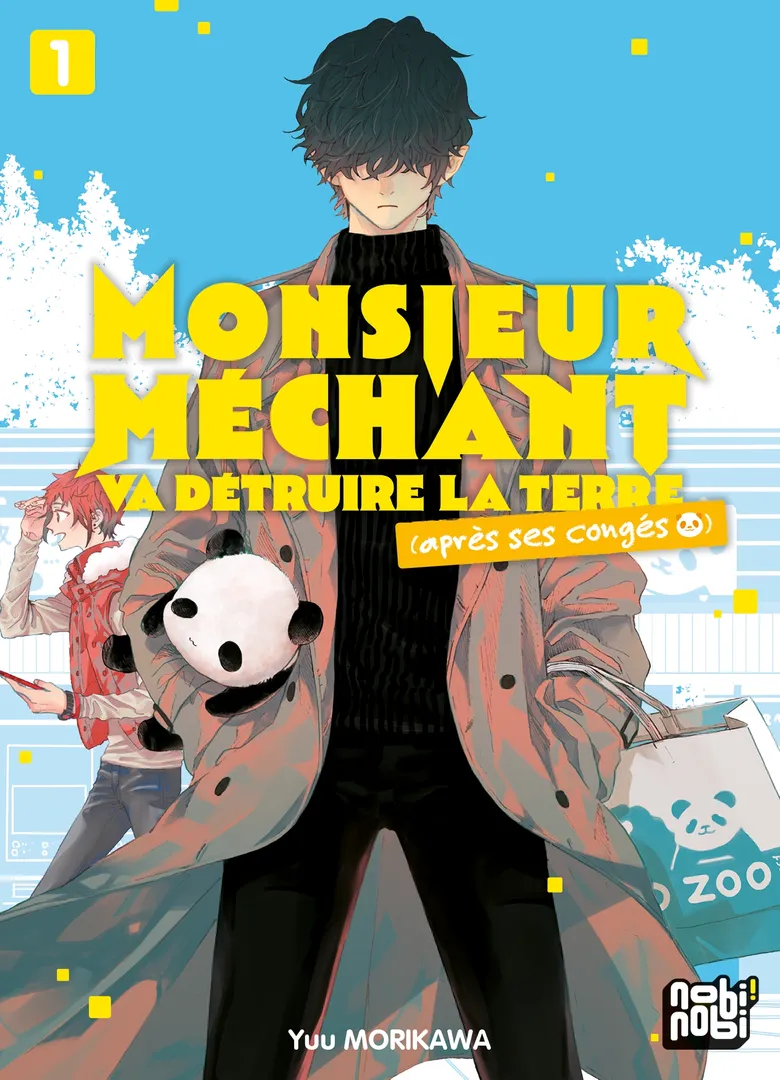

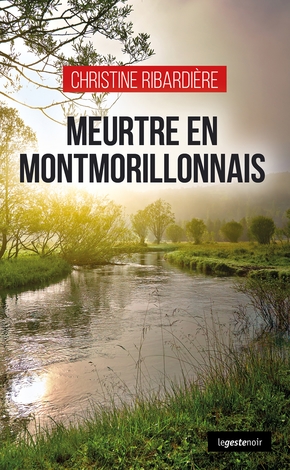
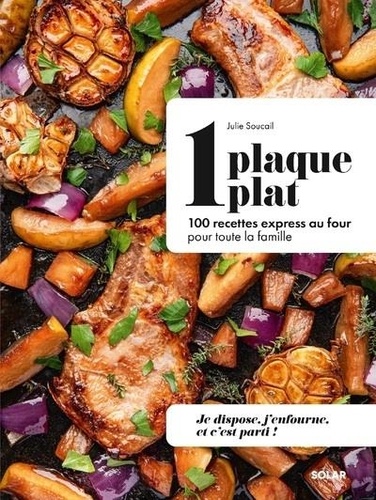
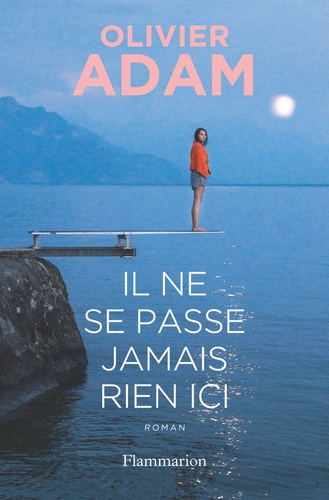
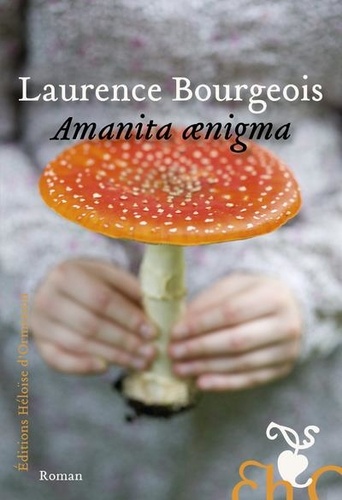
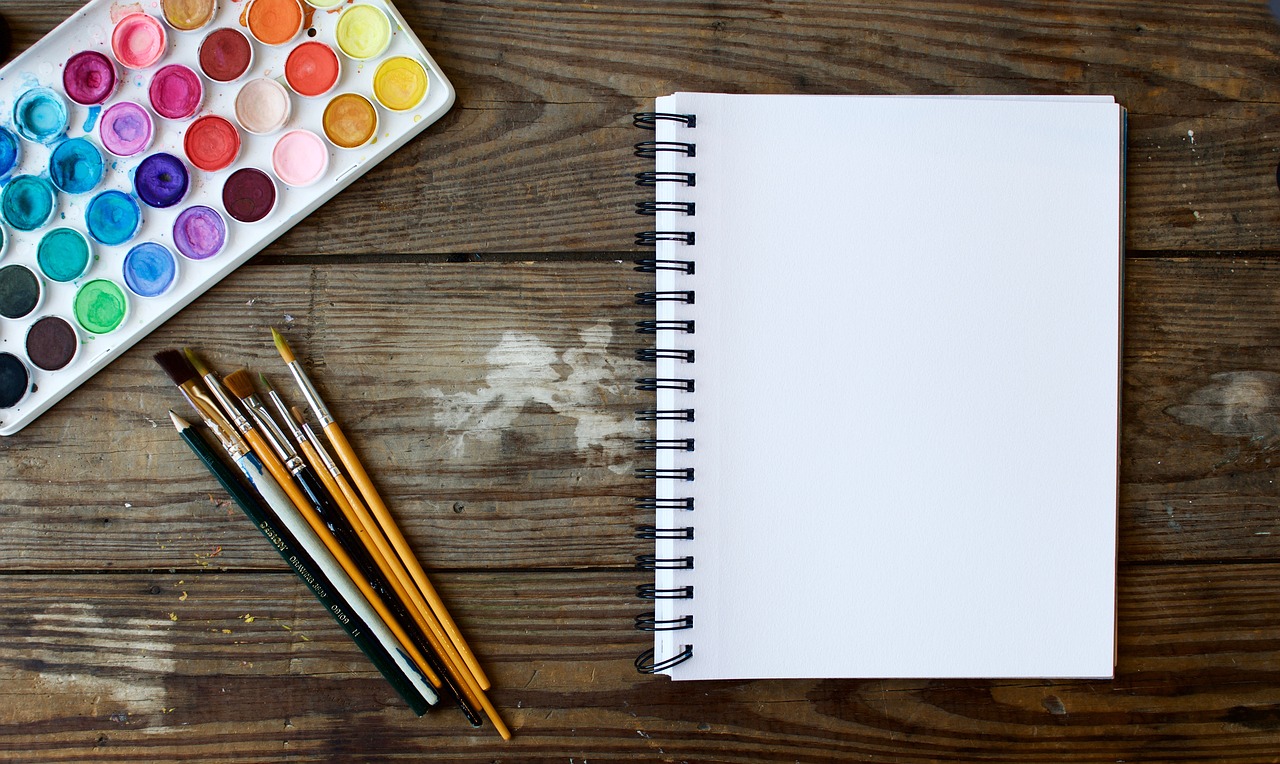
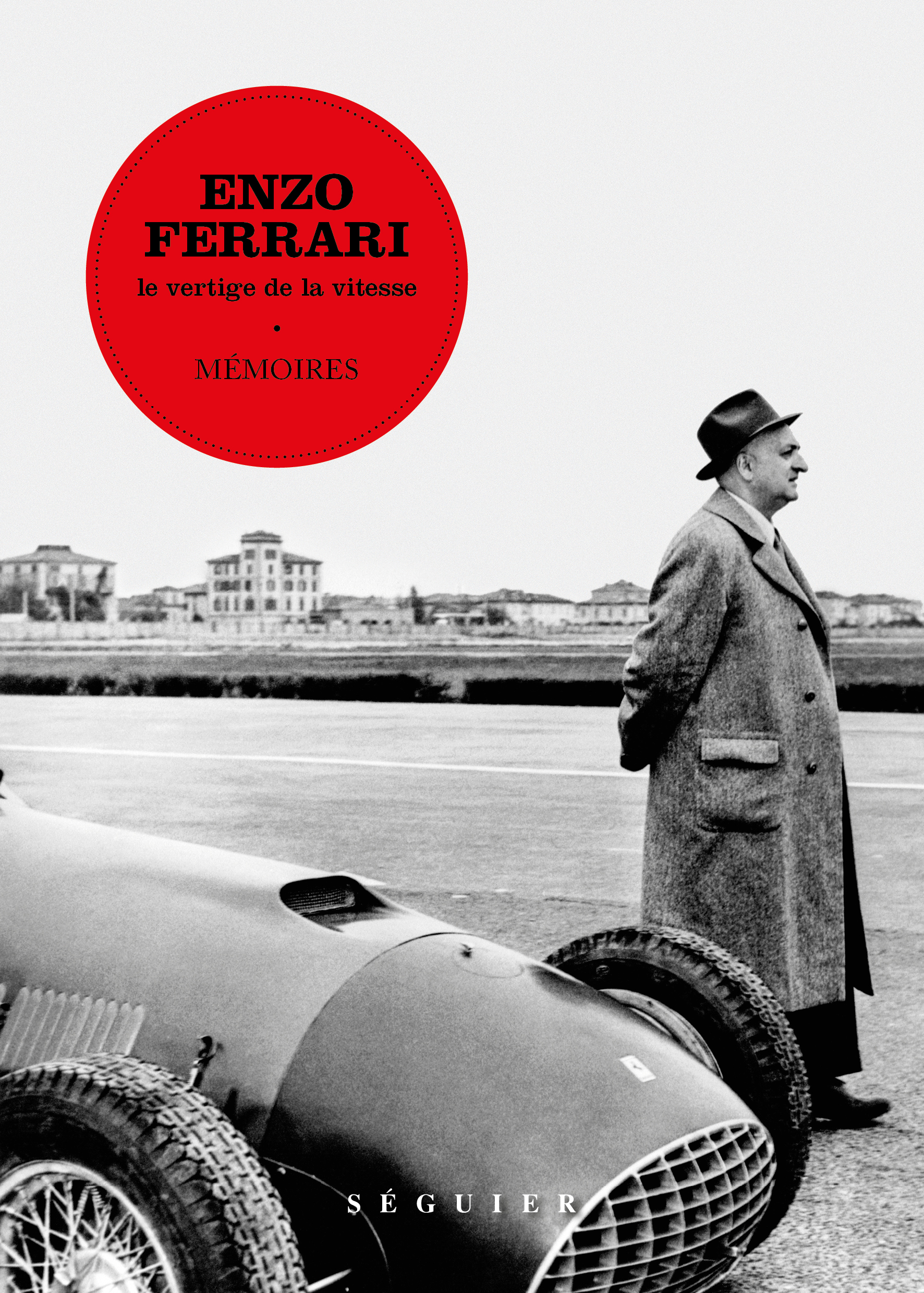
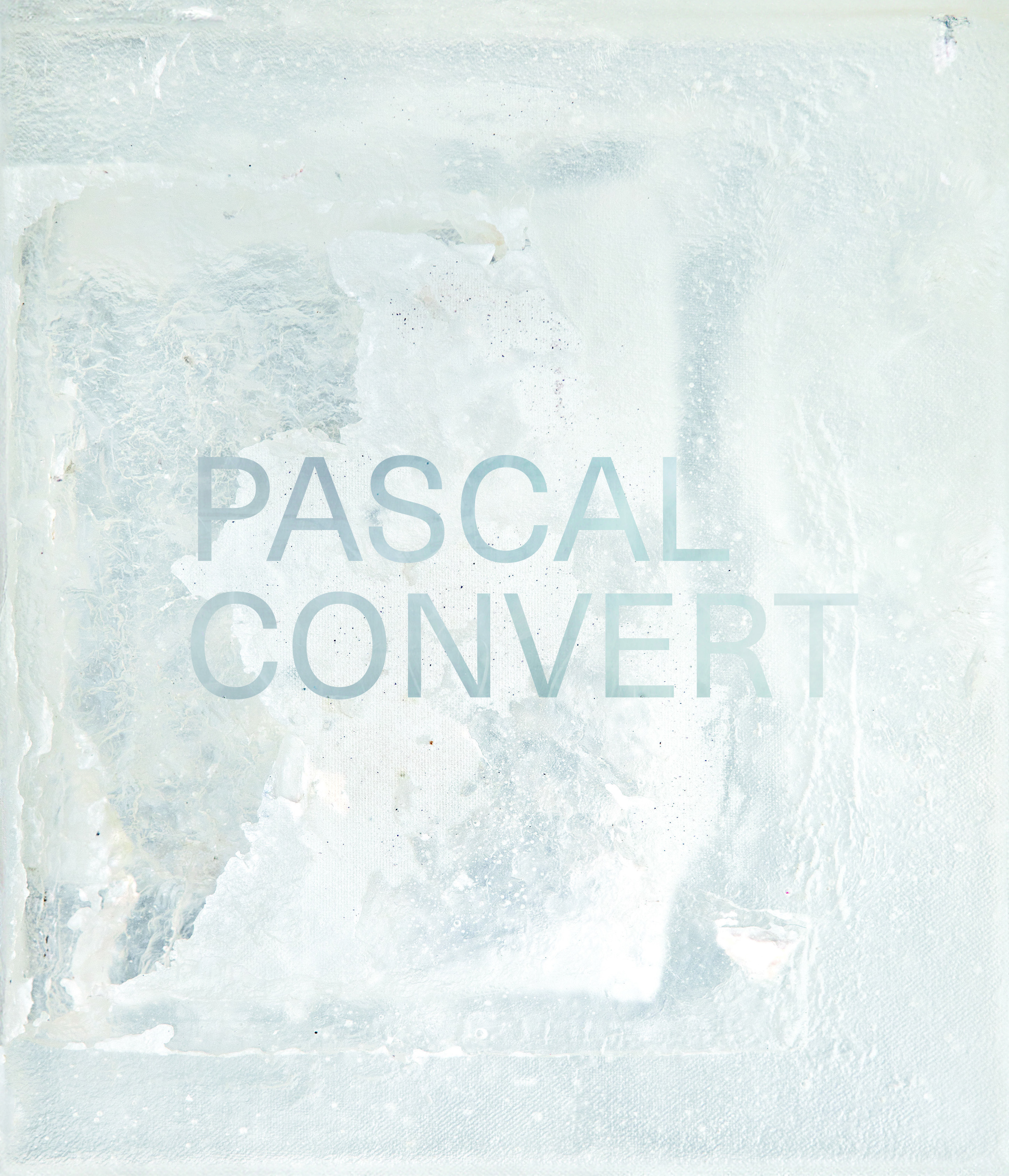
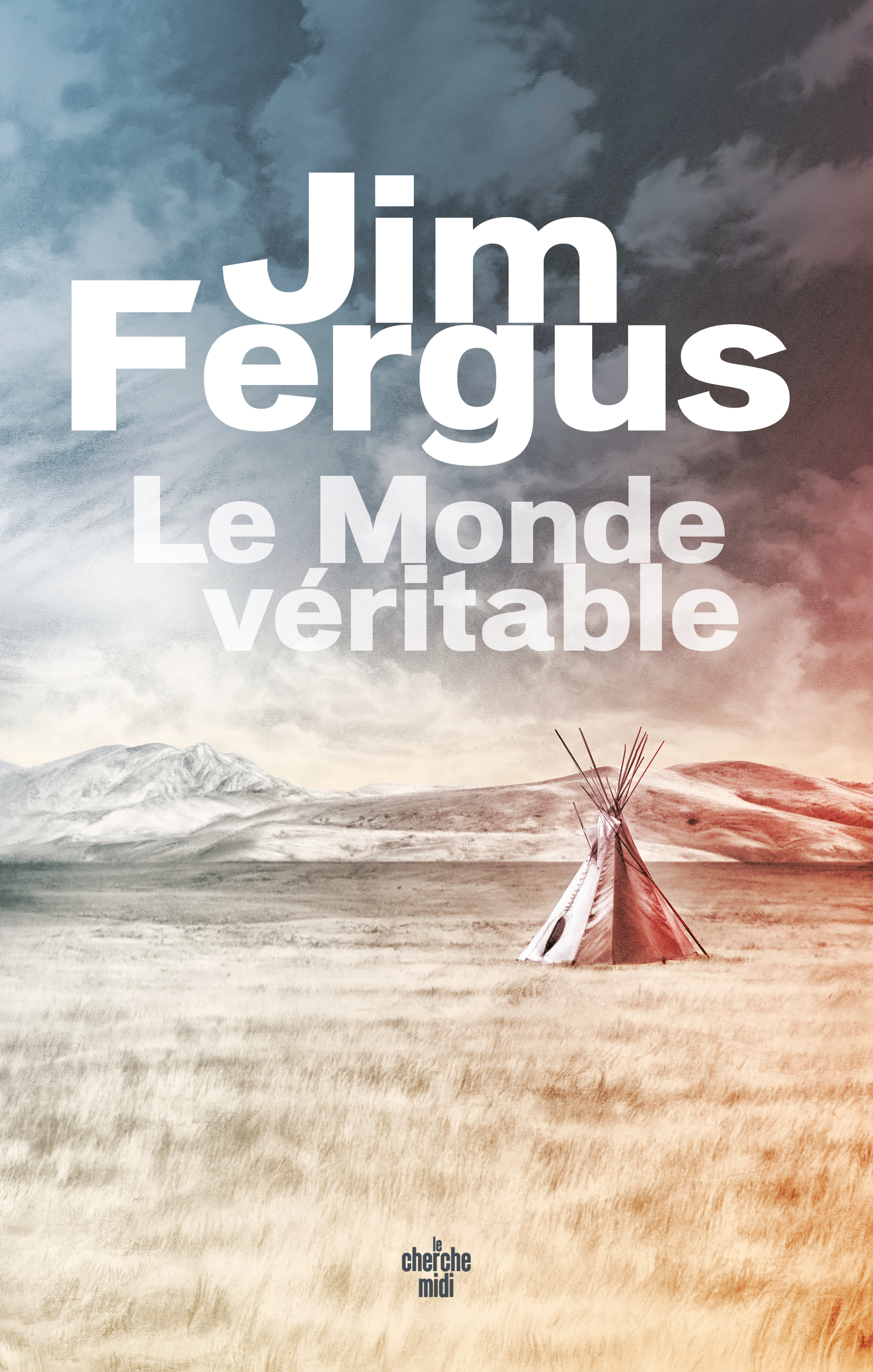
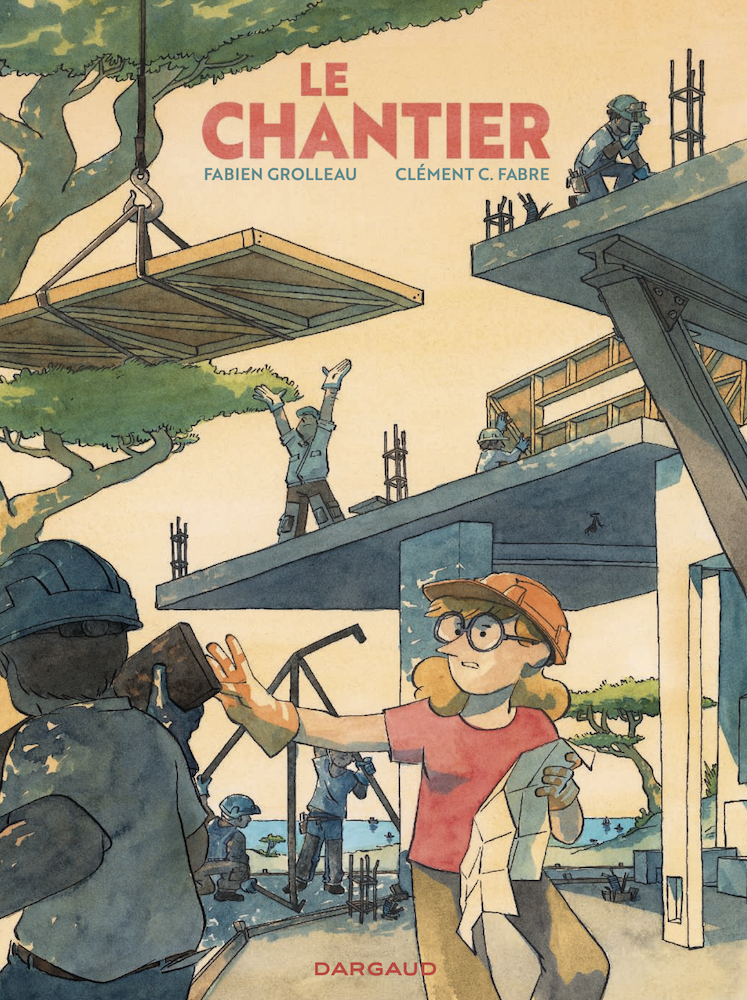
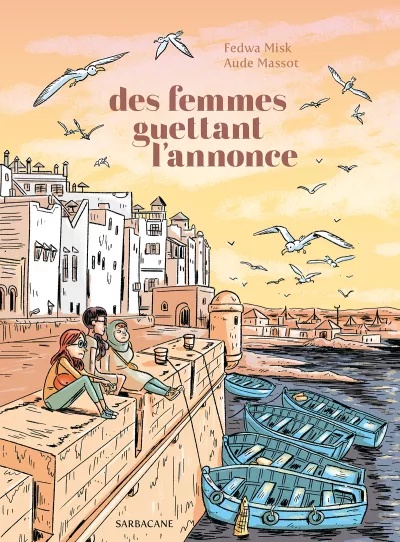

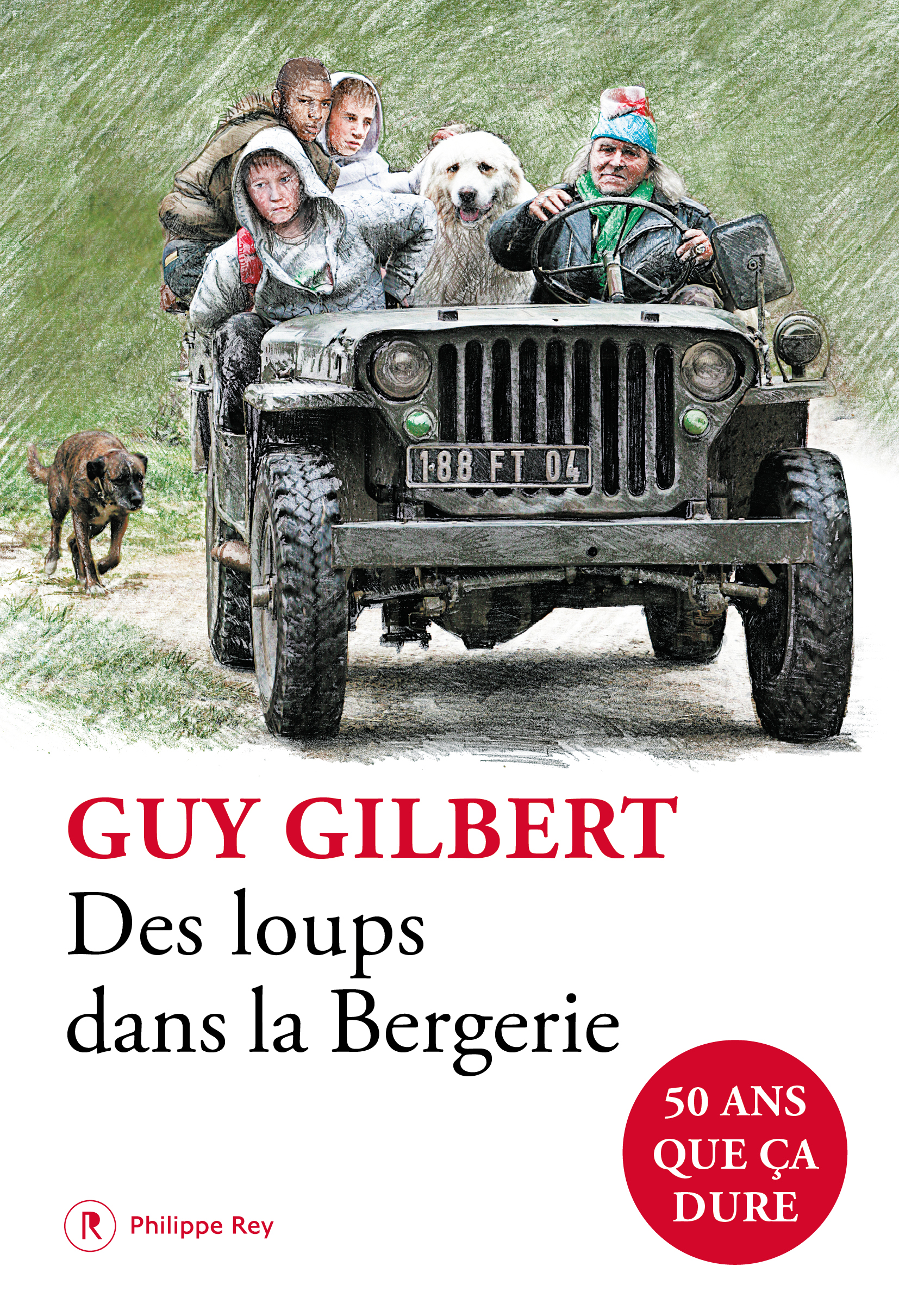
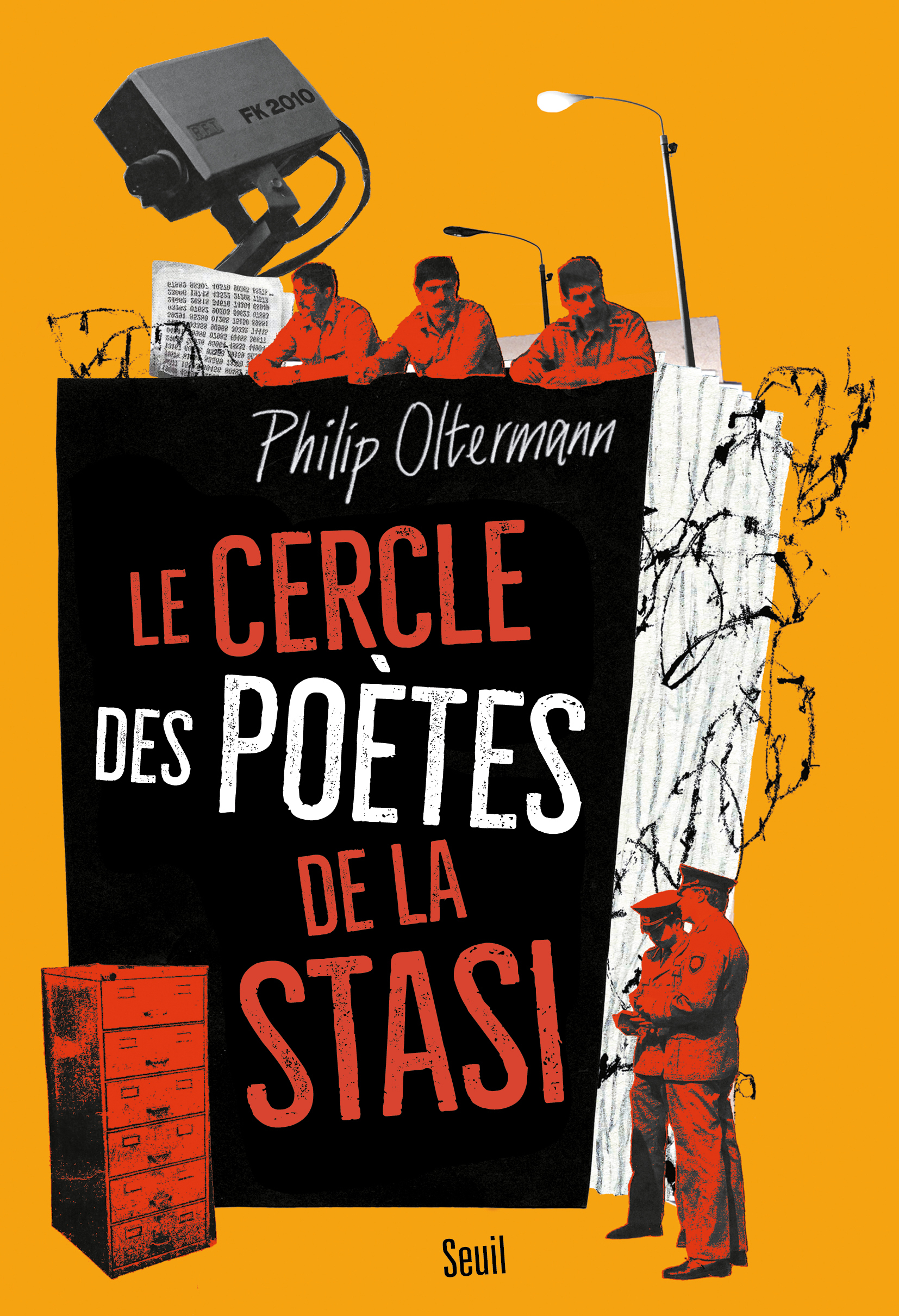
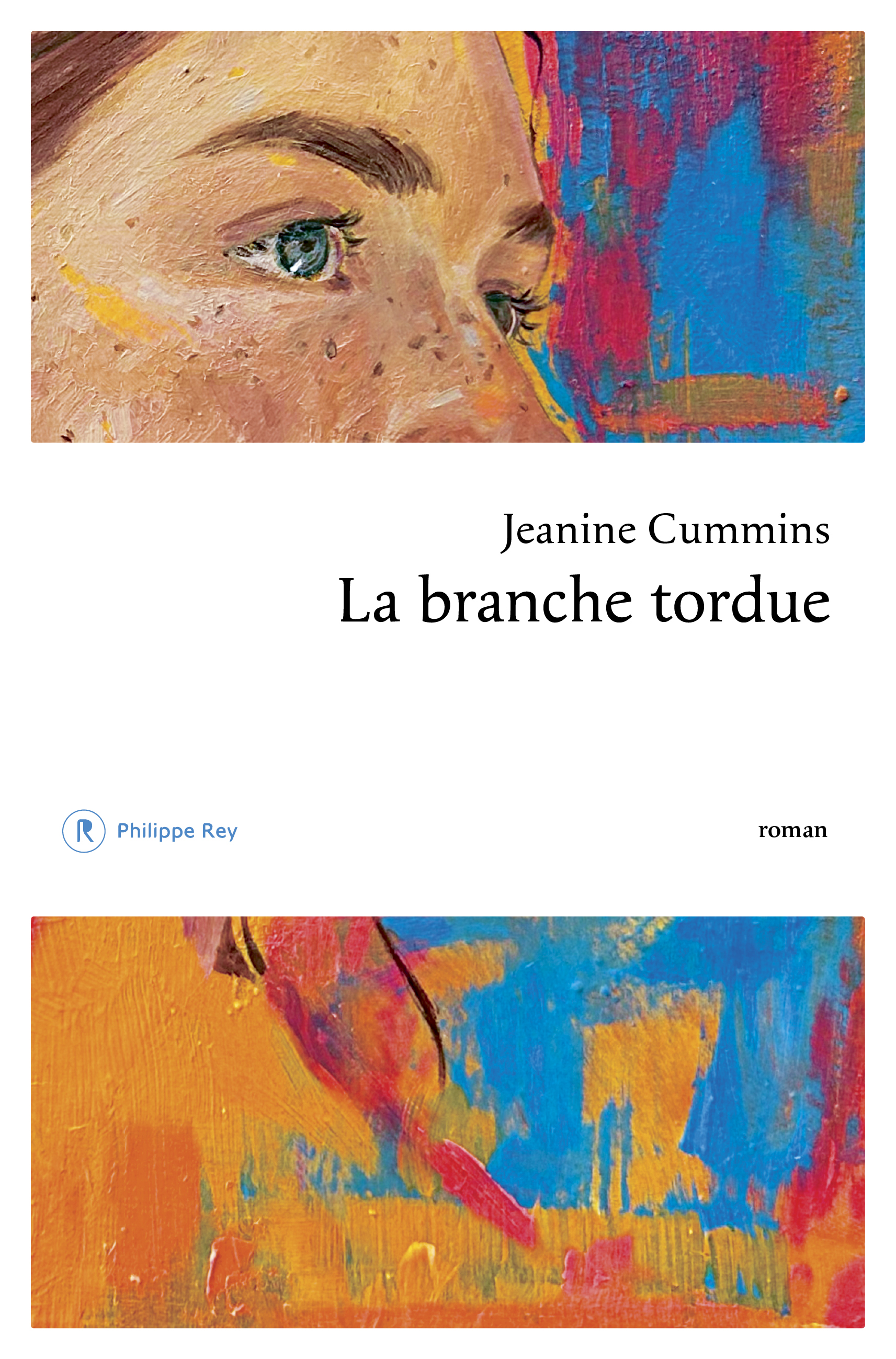
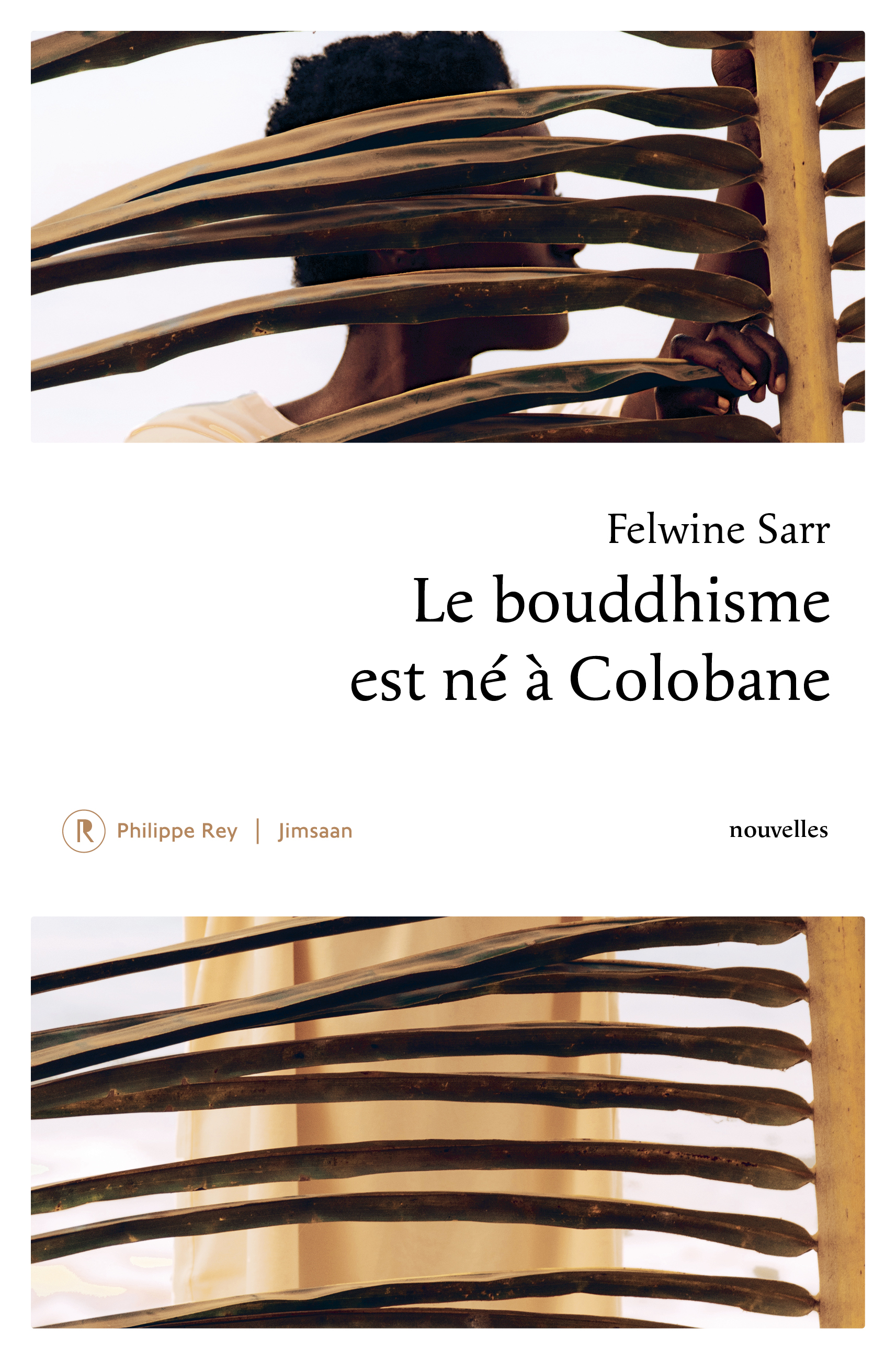
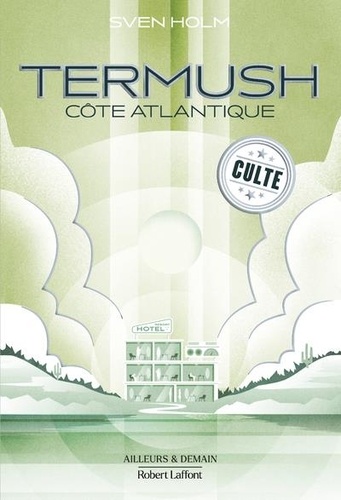
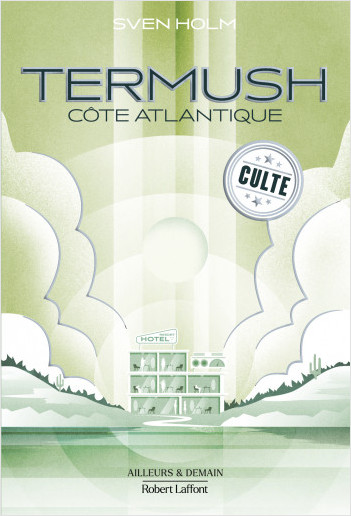
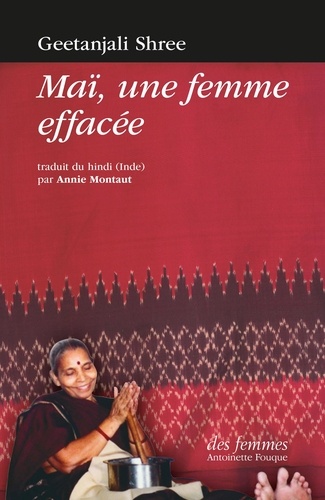

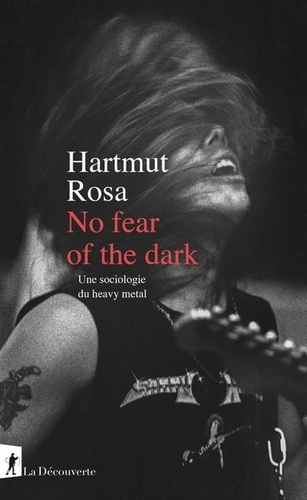
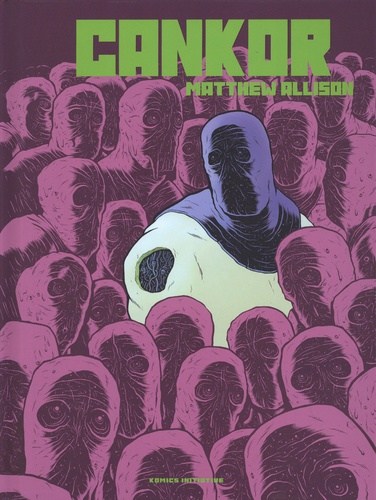
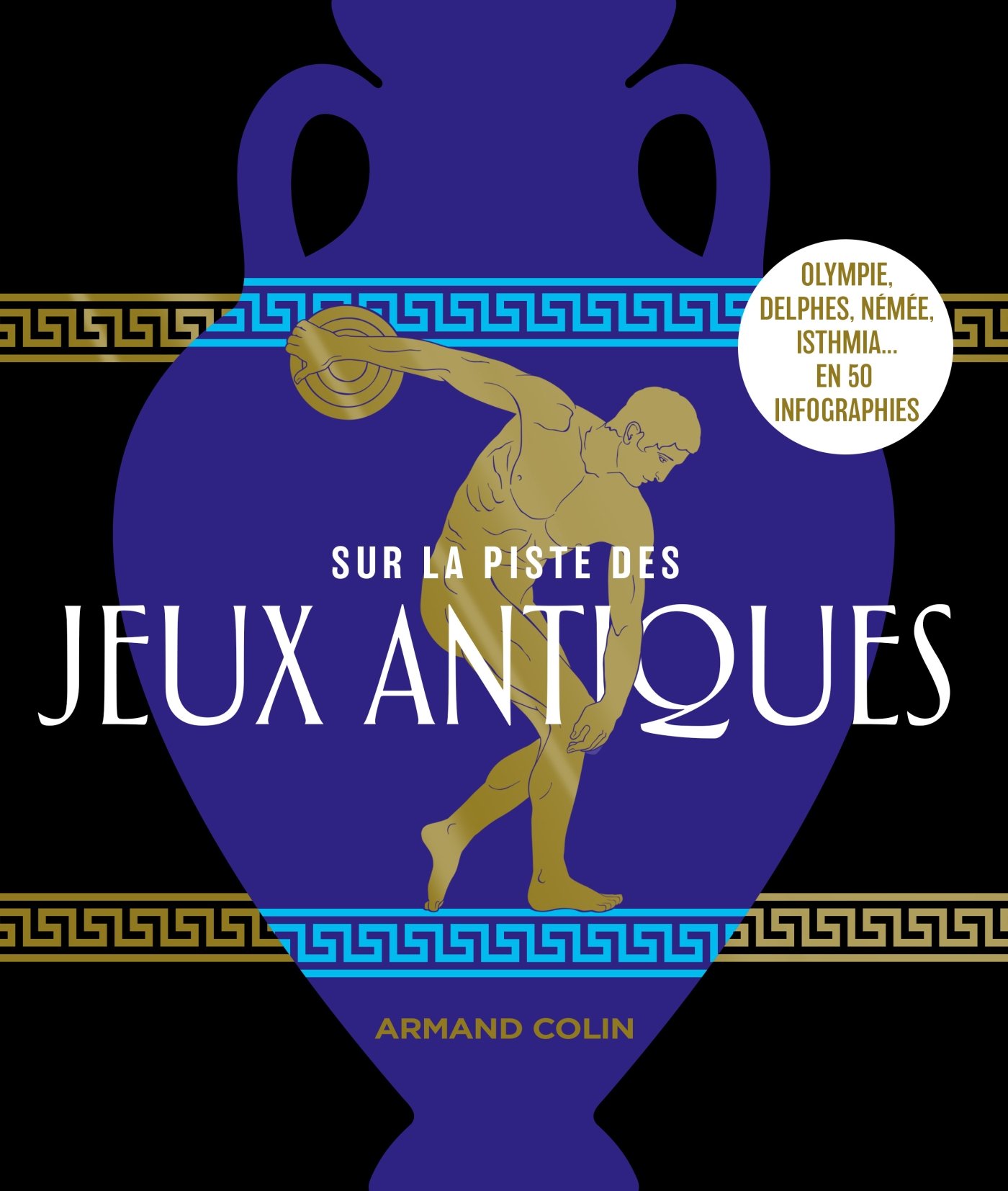
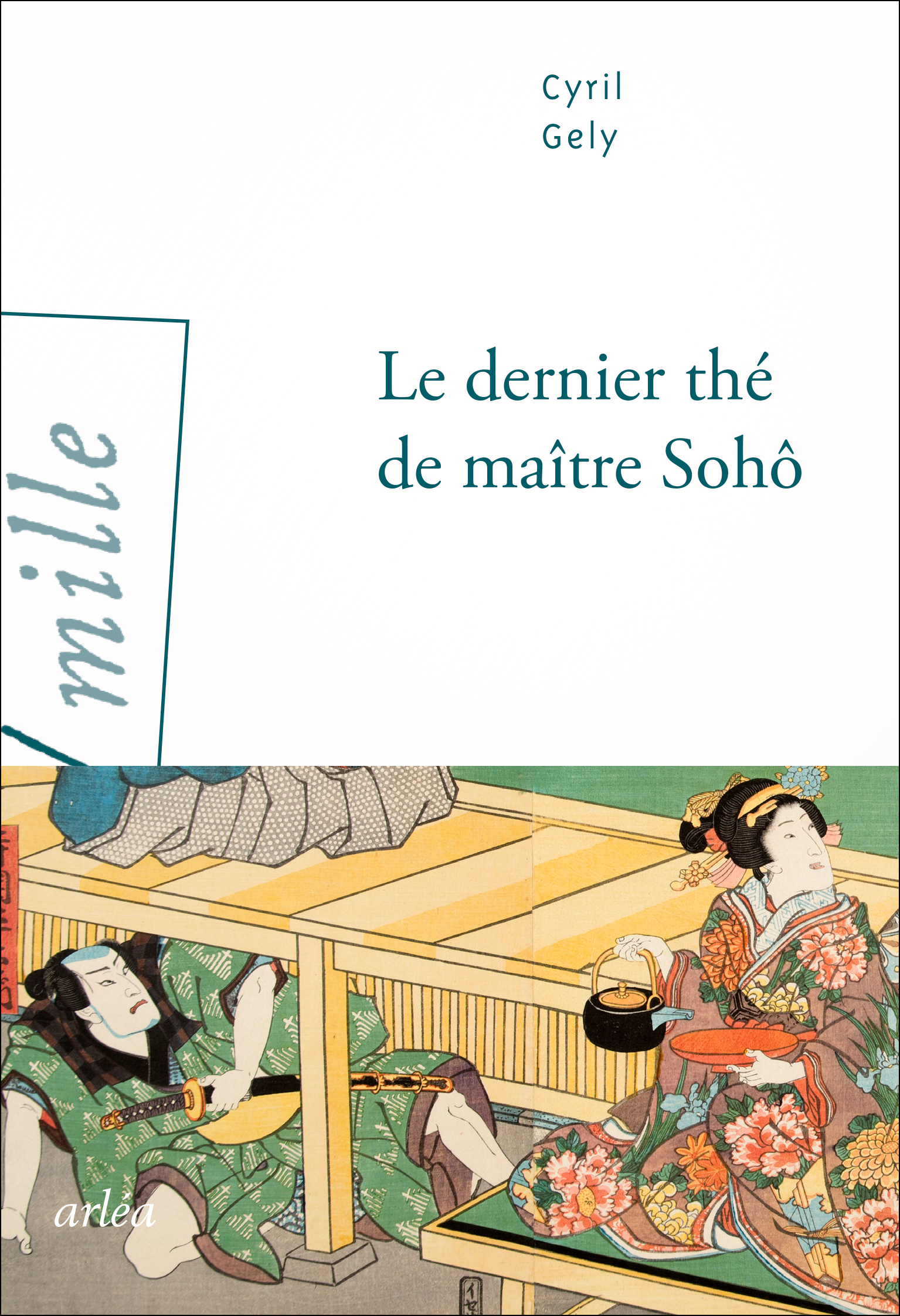
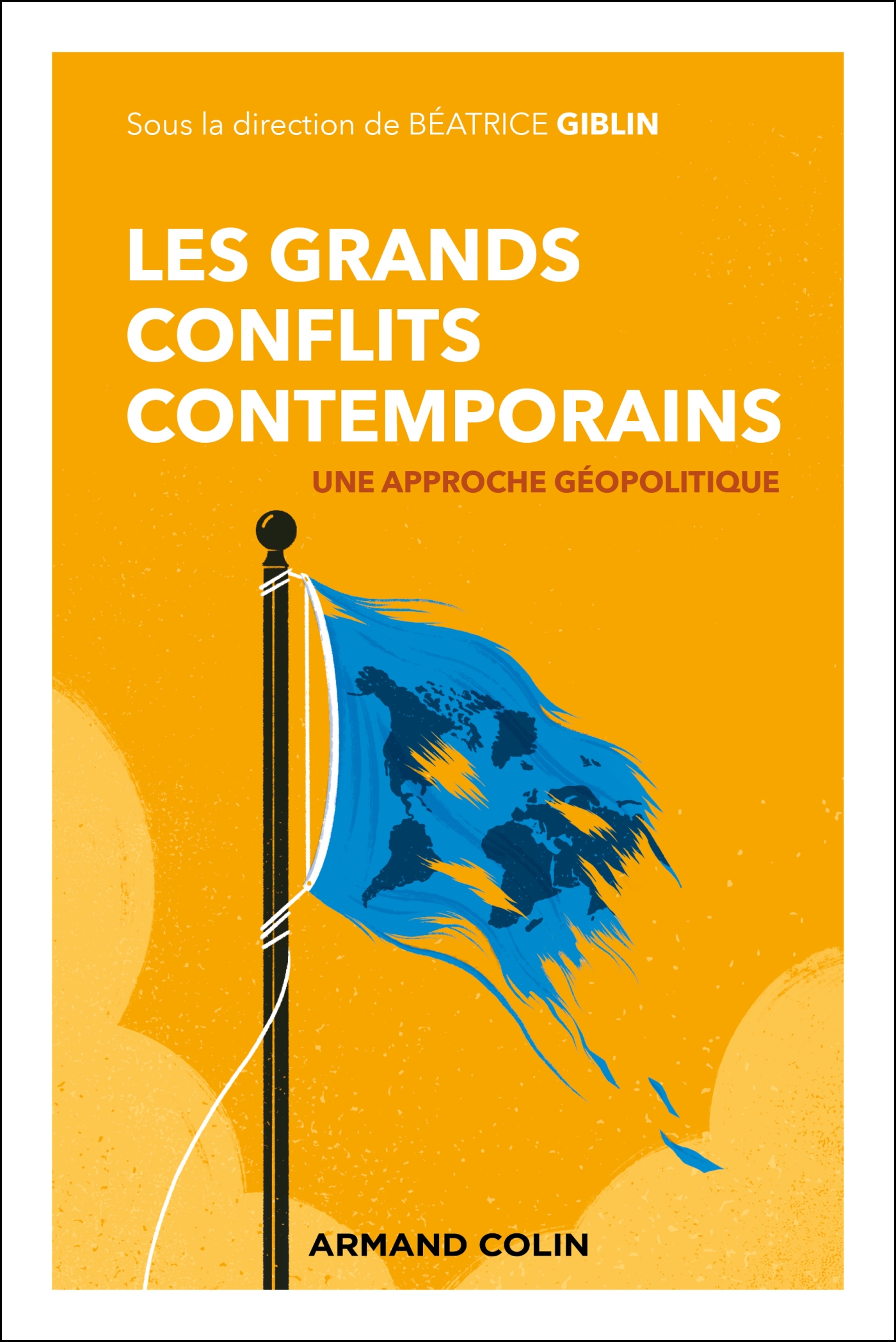

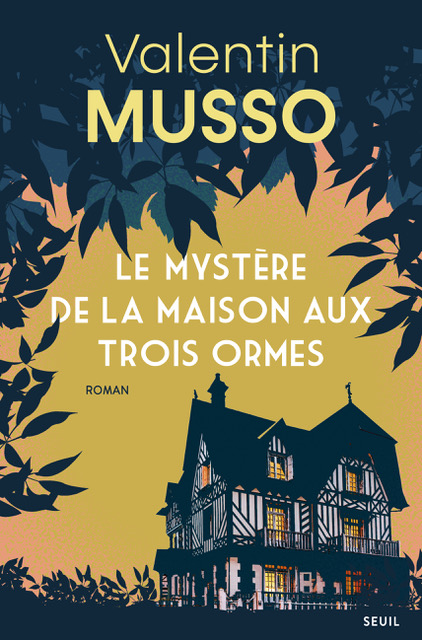
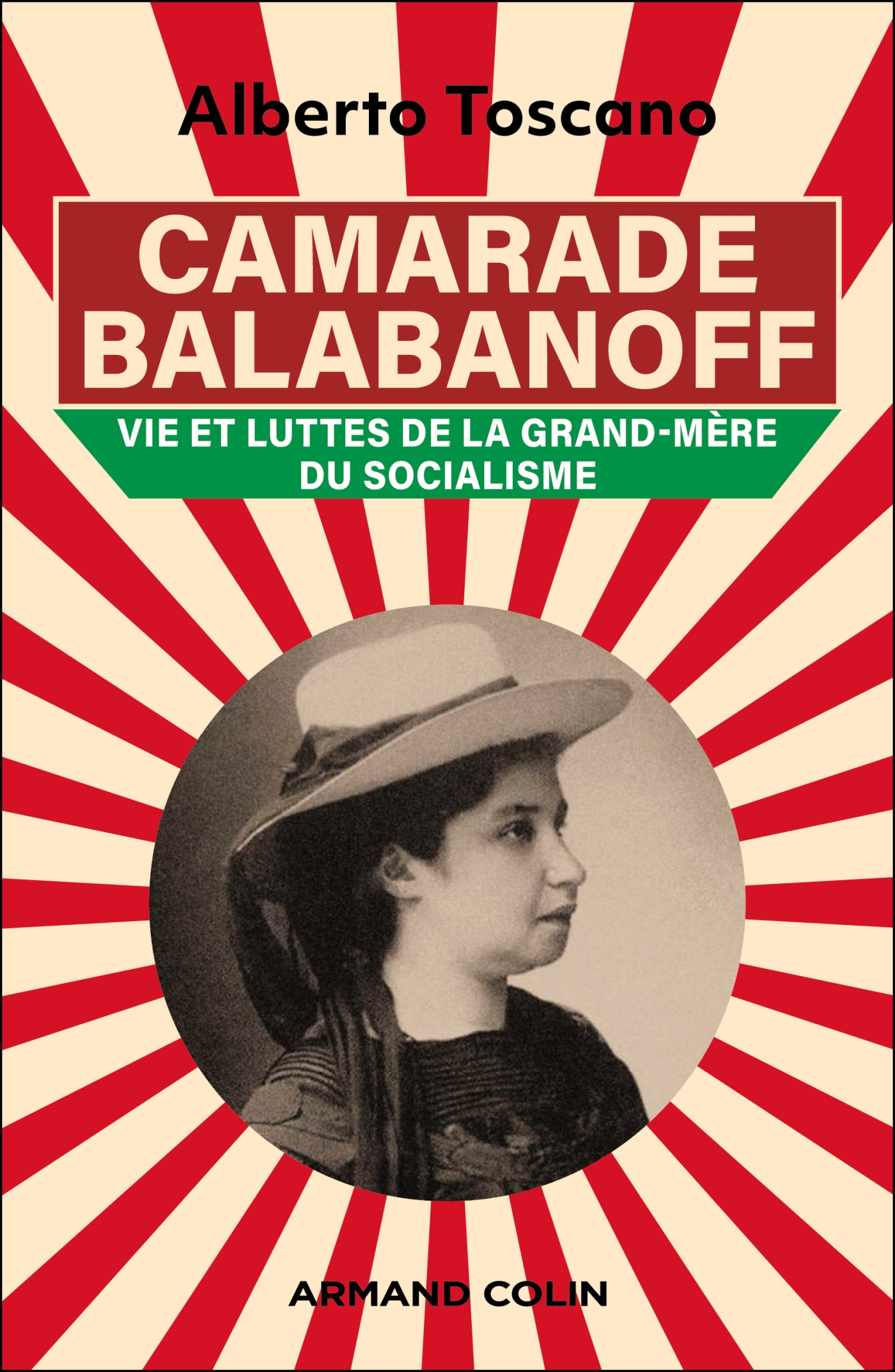
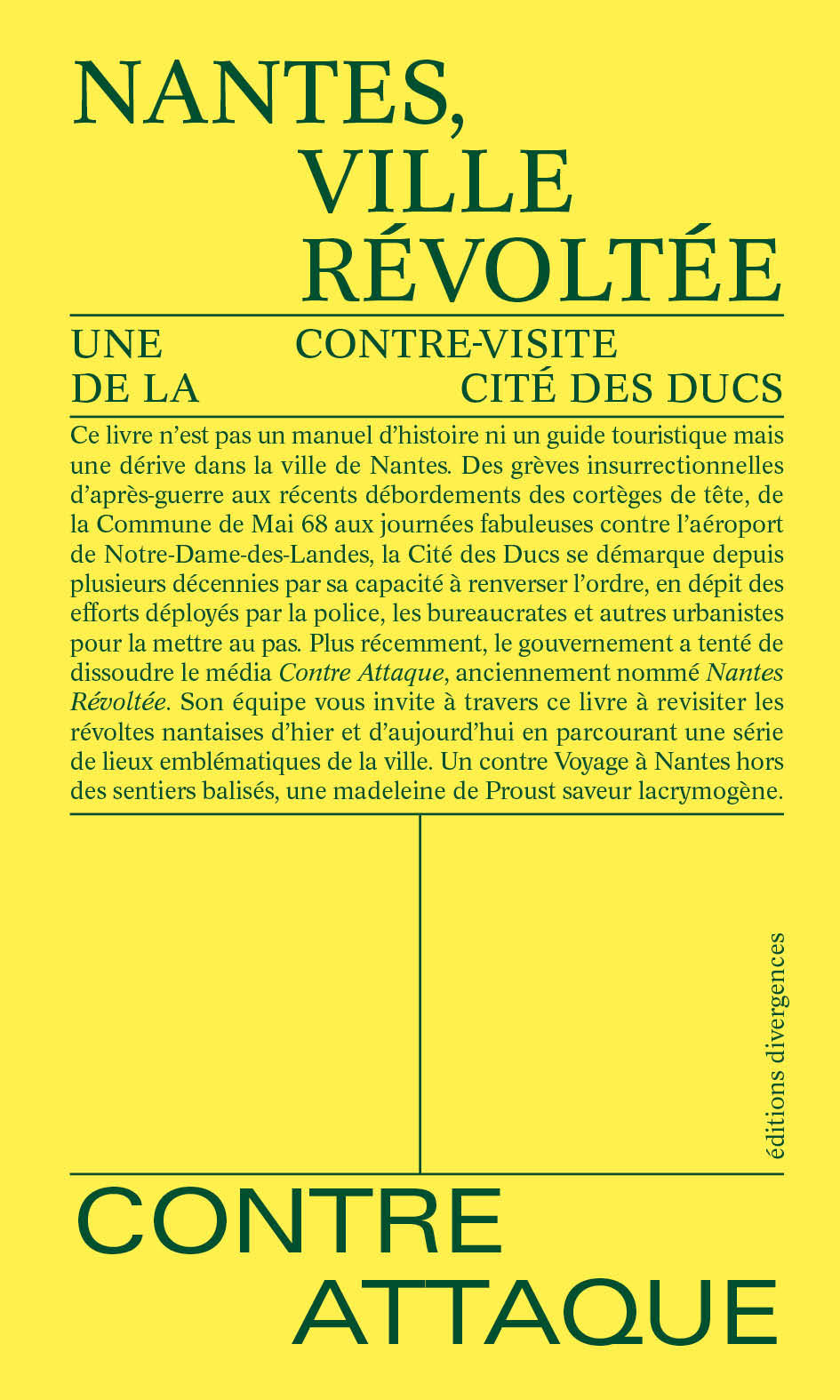
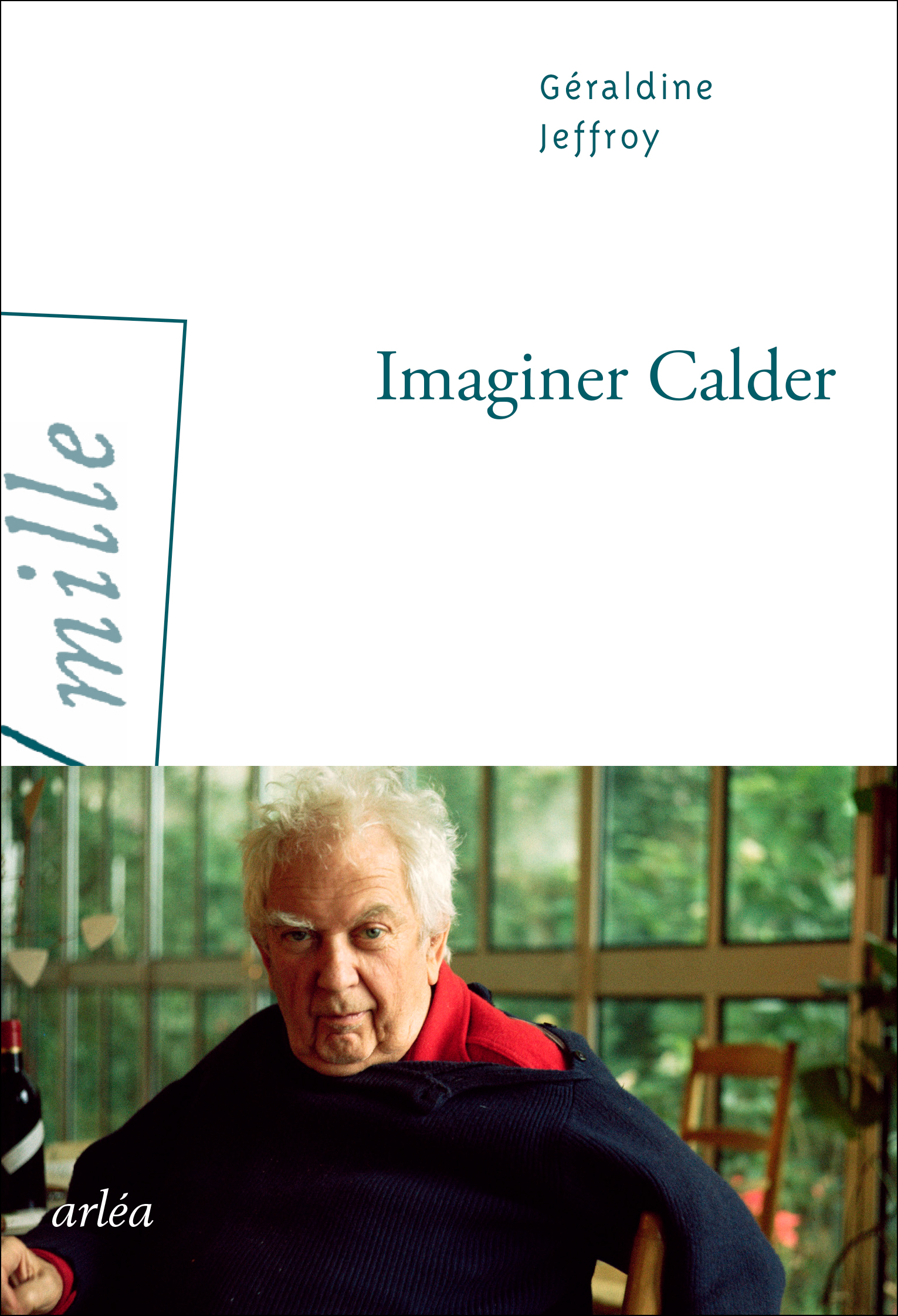

Commenter cet article