Les Ensablés - Chroniques du Lac: des écrivains français à Moscou dans les années 20, par Elisabeth Guichard-Roche
"Scènes de la vie future" ( cf article ici) m'avaient fait voyager avec bonheur dans les États Unis de la fin des années 20. J'ai vite décidé de poursuivre ce périple, mettant le cap plein Est, avec " le voyage de Moscou", récit du séjour de Duhamel en Russie. Dès les premières pages, je découvre que Duhamel est accompagné de son fidèle ami Luc Durtain, médecin et écrivain comme lui, qui publia, en 1928, un livre sur ce même voyage "l'autre Europe, Moscou et sa foi" (NRF) que j'ai lu dans la foulée
Le 08/03/2015 à 10:29 par Les ensablés
Publié le :
08/03/2015 à 10:29
.
Par Elisabeth Guichard-Roche
Enfin, au hasard d'une quatrième de couverture, je vis qu'Henri Béraud avait aussi publié un récit de son voyage en URSS en 1925 "Ce que j'ai vu à Moscou" (les éditions de France). Troisième lecture sur la Russie soviétique du milieu des années 20: un pays qui se remet avec difficulté de la grande famine de 1920-22, qui a enterré Lénine en janvier 1924 et qui, après le "communisme de guerre", expérimente la NEP depuis 1921. Les trois ouvrages offrent des réflexions sur les " Nepmen", nouveaux riches ayant su profiter de cette ouverture pseudo libérale: "Les temps sont changés. Aujourd'hui M. Bourdinoff, nepman, va aux eaux du Causase, et Mme Bourdinoff est en peau et perlouzes dès le petit lever."(Béraud). "Les nepmen, allure modeste, œil au guet, affectent volontiers une mise négligée; pourtant le drap est sérieux, les chaussures solides"(Durtain).
Les trois auteurs s'étonnent face au tramway moscovite (montée par la plateforme arrière, descente obligatoire par l'avant, "règle prescrite avant la Révolution, aujourd'hui inflexible, obéie comme sait l'être une loi soviétique" Durtain). Tous trois réfutent l'approche statistique mise en avant par le régime et nous conduisent au Mausolée de Lénine sur la Place Rouge : "Lénine est là. Je ne l'imaginais pas tel. D'après les photographies, les peintures, j'attendais un brun, quelque peu camard. C'est un petit rouquin, presque complètement chauve. Le nez semblé pincé. Le teint, rafraîchi par quelque artifice chimique, est naturel. La tête repose sur un coussin. Les mains sont croisées sur le ventre. L'homme est vêtu d'une blouse kaki. Des draperies cachent le bas du corps. Il a l'air de dormir. Il est si parfaitement conservé qu'on le croirait de cire. Je douterais même, n'était l'affirmation générale. C'est une momie." (Duhamel). Duhamel, Durtain et Béraud découvrent cette Russie nouvelle, immense et multiple, l'observent, cherchent à analyser et comprendre le fonctionnement du régime soviétique issu de la récente révolution .
Là s'arrêtent les similitudes entre Béraud - parti en reportage pour le Journal- et Duhamel /Dutrain invités par l'Académie des Sciences Artistiques pour un séjour au cours duquel ils donneront des conférences. Cette invitation a été initiée par Marie Koudaleva . Poète russe et proche de Romain Rolland, elle a fait la connaissance de Duhamel à Paris en 1925. Elle sera leur guide au cours du voyage. Le fait même d'être invité leur permet d'éviter l'hôtel et de loger à la "maison des savants", propriété du "Tsekoubou", société pour l'amélioration du sort des intellectuels: chambre silencieuse, claire, murs blancs et nus, parquets cirés chaque semaine mais salle commune pour les ablutions. L'approche de Duhamel est curieuse, ouverte et avant tout humaine: "pour l'homme qui montre quelque souci de l'homme, un voyage en Russie est, avant tout, une occasion de méditer avec fruit sur les expériences sociales, de cultiver son opinion sur la conduite et l'avenir de l'espèce". Duhamel parle des hommes, non des bolcheviques mais du peuple russe, de l'âme et des travers slaves: "tendance à la précipitation comme diraient les chimistes, ce besoin de s'agglutiner et de tenir conseil", lenteur, incertitude, fatalisme, insouciance, inexactitude horaire, bureaucratie...
Duhamel et Durtain sont séduits par la gratuité permettant aux ouvriers et aux écoliers d'aller au musée, au théâtre et au concert. Ils sont bluffés par la multitude des musées, la variété et la qualité des œuvres, subjugués par l'Ermitage, stupéfaits par l'affluence du public: "cette mainmise de l'Etat sur les trésors d'art privés est peut être la moins discutable de toutes les mesures de dessaisissement "(Duhamel). Les deux médecins apprécient les efforts déployés en terme de formation des classes populaires, d'hygiène et de santé, même si beaucoup reste à faire: manque de maturité de la nouvelle génération de savants, persistance de tapis dans certains hôpitaux, insuffisance de médecins et de place dans les hôpitaux moscovites, enfants abandonnés. Duhamel et Durtain conservent au cours des pages un regard critique soulignant les difficultés économiques, l'insuffisance industrielle, les piètres conditions de logement à Moscou; dénonçant la propagande et l'éducation proche de l'endoctrinement politique ("instruction sommaire - beaucoup plus sommaire que chez nous aux mêmes âges-et dont l'essentiel, à part une langue étrangère et un peu de science, est fait des quartes règles et du catéchisme marxiste" Durtain),
Au cours des derniers chapitres, Duhamel développe l'analyse, s'interrogeant sur les conséquences de la révolution bolchevique: dix ans après peut-on parler d'échec du communisme? La réponse est pragmatique : "l'histoire même de cette doctrine explique ses erreurs. Système essentiellement économique, le communisme ne peut prétendre à régler tout seul la vie des groupes humains. Il ne tient pas compte des sentiments, ni des passions, ni des besoins de l'âme. Il a longtemps opéré, si j'ose dire in vitro, ce qui, pour les sciences de la vie, représente un grand danger".
La conclusion laisse place à l'optimisme: les dirigeants russes ont acquis de l'expérience en dix ans et savent que gouverner n'est pas aisé. De fait, en 1926, la production industrielle dépasse le niveau d'avant guerre. En 1928, c'est au tour de la production agricole. Si le récit de Duhamel commence par l'arrivée à la maison des savants, Durtain, comme Béraud, consacre plusieurs pages au long voyage en train à travers l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes jusqu'à la frontière russe: neige, froid, douane, changement de train, lent cheminement dans un paysage illimité ou se succèdent boulots, mélèzes puis sapins, parfois entrecoupés de clochers à bulbes et de rares gares.
Comme Duhamel, Durtain s'appuie sur sa formation scientifique et les méthodes de travail pratiquées en laboratoire pour observer et décrire "un ensemble étrangement complexe, enchevêtré, contradictoire". Il souligne à plusieurs reprises l'immensité et la diversité de la Russie: "de Niegoreloïe à Vladivostok, de la Laponie aux Indes: grande table où sont servis le caviar des terres noires, les métaux ciselés de l'Oural, le brillant cristal des mers, les écailles des fleuves". Le titre de l'ouvrage "L'autre Europe" découle d'ailleurs de ce constat: "de même que l'on dit Amérique du Nord et Amérique du Sud, de même si nous disions Europe et Autre Europe?". J'ai lu avec plaisir et intérêt ce second récit d'un même voyage: anecdotes communes, descriptions similaires, brefs clins d'œil de l'un sur l'autre, réflexions laissant paraître la personnalité de chacun, style différent. J'avoue m'être un peu essoufflée au fil des pages de Durtain. La structure en sept parties comprenant de trois à sept chapitres n'évite pas les allers-retours. Le récit est plus dense et le style moins direct que celui de Duhamel, mais je n'ai pas résisté à la richesse des descriptions: "Ma foi, comment ne pas aimer ces hors-d'œuvre, jambons, fromages, monstrueux concombres, transparentes chairs de fleuve, saturées d'un sel qui y introduit l'Océan, noble caviar, savoureusement asphaltique dans les boîtes, mais qui, frais et amoncelé dans les saladiers, y semble une cueillette de groseilles aquatiques, dont chaque baie luit d'un regard batracien?".
L'ouvrage de Béraud, réunion de trente deux articles, est un récit plus brouillon. Les analyses sont rapides, presque taillées à l'emporte-pièce, le style souvent outré voire caricatural. Ainsi, à propos des conditions de logement moscovites: "C'est ainsi que le pouvoir soviétique a résolu la crise du logement. On appelle cela la"politique du tassement". C'est une promiscuité sans nom où la camaraderie se réduit à la communauté des besoins et des misères humaines." Il faut à l'évidence frapper le lecteur par des phrases choc:" ici, comme dans tout le pays soviétique, le rire est mort: on dirait que les vieux l'ont emporté dans leur tombe, entre leurs bras roidis par la rage et la famine. Ainsi l'on voit cette chose inexprimable: des gens que se soûlent avec un visage de pierre ". Au fil des pages, Béraud dépeint une société sombre et nauséabonde ("Moscou la sainte et la fougueuse...où persiste une odeur d'urine et d'encens qui est son odeur"), enlisée dans les difficultés économiques, entravée par les institutions soviétiques, aveuglée par la propagande et espionnée constamment par la Guépéou. Il décrit la fin du communisme, remplacé par une dictature bolchevique qu'il n'hésite pas à comparer voire assimiler au fascisme de Mussolini: "Rien, extérieurement, ne ressemble plus a la vie moscovite que la vie romaine: cortèges, emblèmes, crainte, silence. C'est-à-dire que la réaction et la révolution n'ont, après elles, laissé aux hommes déconcertés qu'un être sombre et masqué, le Dictateur inconnu, qui ne saurait subsister sans l'adhésion de certains groupes -nécessairement avantagés par rapport aux autres".
Le reportage de Béraud connut un véritable succès populaire lors de sa parution mais lui attira aussi l'inimitié des intellectuels communistes dont Paul Vaillant Couturier: "À l'époque, certains prétendirent que jamais succès de presse n'avait égalé celui-là ... Les lettres arrivaient par milliers" ( les derniers beaux jours, autobiographie).
Henri Béraud (1885- 1958), reporter international pour Paris Soir et le Petit Parisien, sillonna l'Europe entre les deux guerres (Grèce, Albanie, Italie, Autriche...) se surnommant le "flâneur salarié". En 1922, il reçoit le prix Goncourt pour deux ouvrages "le martyre de l'obèse" et "le vitriol de la lune". 1934 marque un tournant dans son parcours puisqu'il quitte le Canard enchaîné pour Gringoire. Condamné pour intelligence avec l'ennemi en 1944, il est interdit de publication et de réédition ce qui contribua à plonger ses œuvres dans l'oubli.
De son vrai nom André Nepveu, Luc Durtain (1881-1959) , médecin a été découvert par Jules Romain. Il effectue la 1ère guerre mondiale comme médecin aide major et écrit un long roman "douze cent mille" qui parait en 1922. Il se fait connaître au milieu des années 20 à travers ses romans-reportages se déroulant aux quatre coins du monde. Politique marqué à gauche, Durtain dénonça l'invasion de la Pologne par Hitler et s'écarta de la Russie à l'occasion du pacte germano-soviétique. Durant la seconde guerre mondiale, il contribua au journal socialiste les Nouveaux Temps qui bascula dans la collaboration en 1942. Durtain ne fut néanmoins pas inquiété par le Comité National d'Epuration. Dix ans plus tard (Novembre 1936), Gide signait "retour d'URSS" suivi en juin 1937 de " retouches à mon retour de l'URSS", réponse aux nombreuses critiques voire insultes suscitées par son récit de Voyage marqué par sa déception face à la Russie communiste. L'époque est différente: la NEP a été arrêtée brutalement, Staline règne en maître sur le pays multipliant les procès, purges et déportations

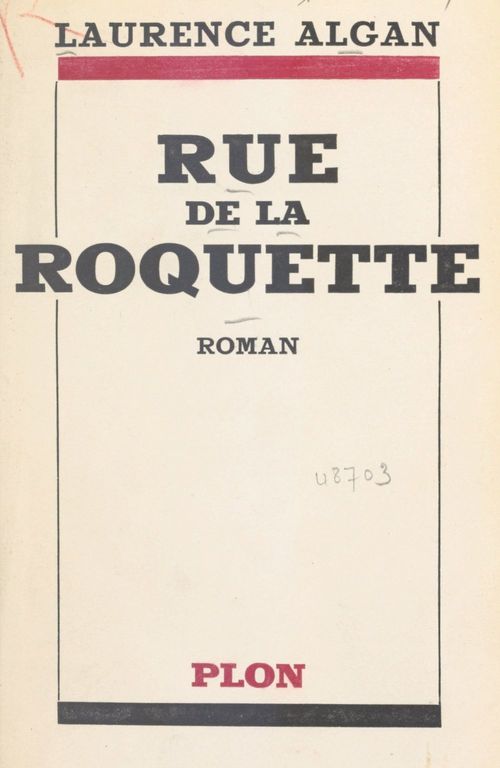
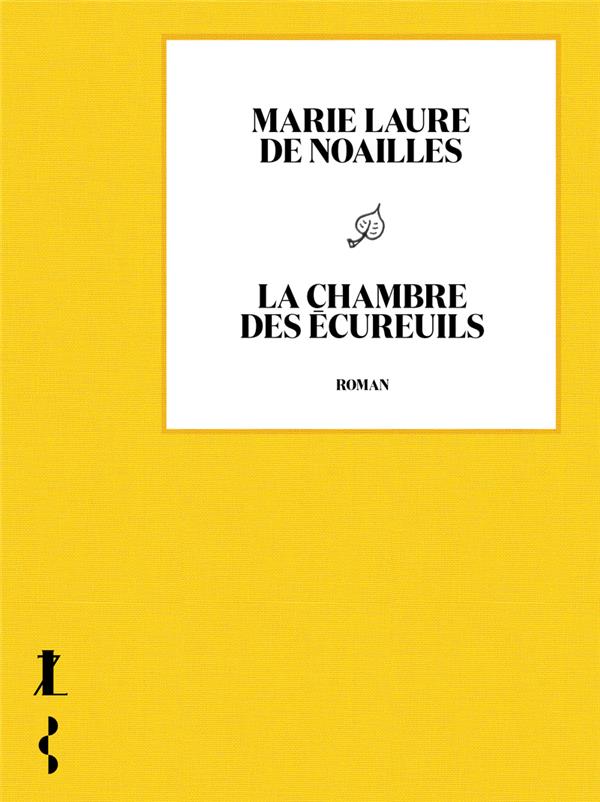
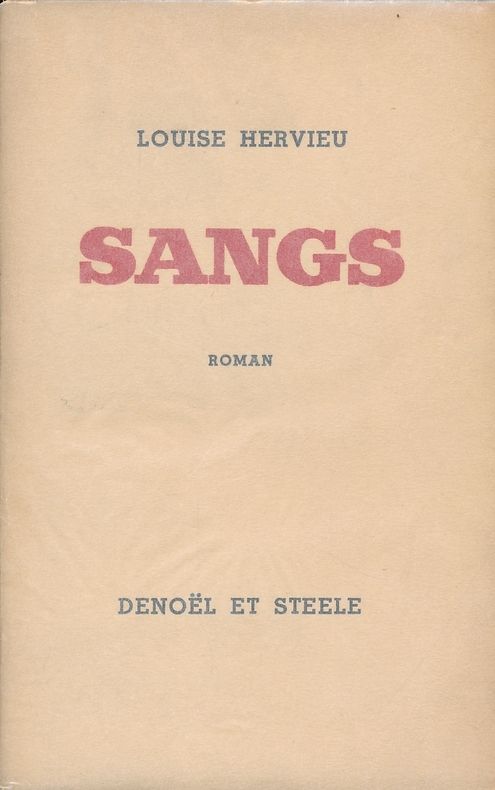
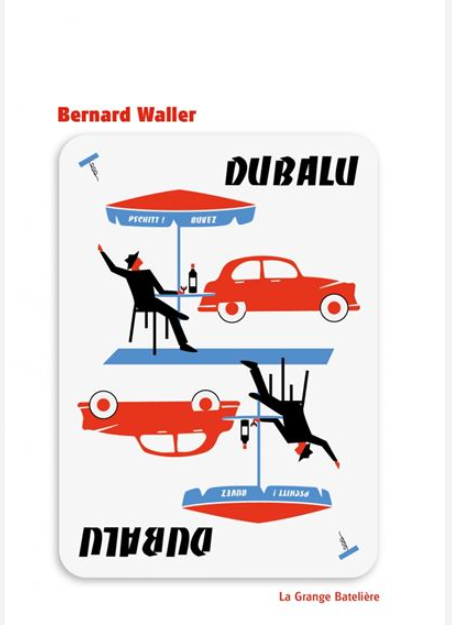
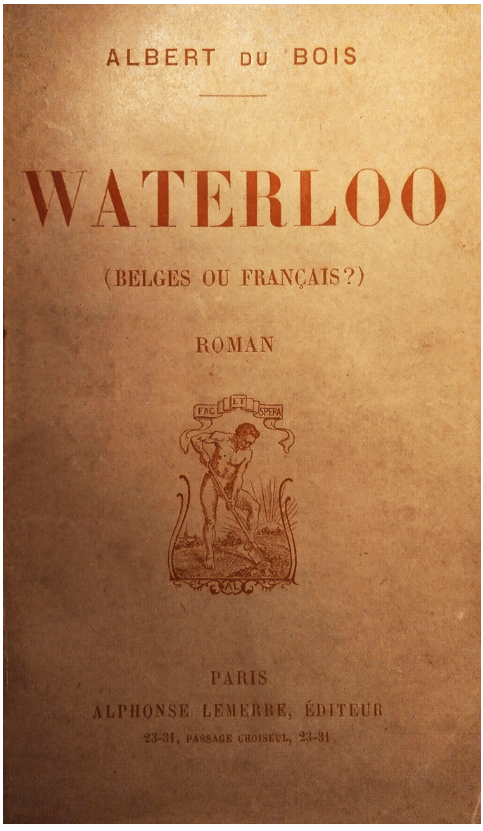
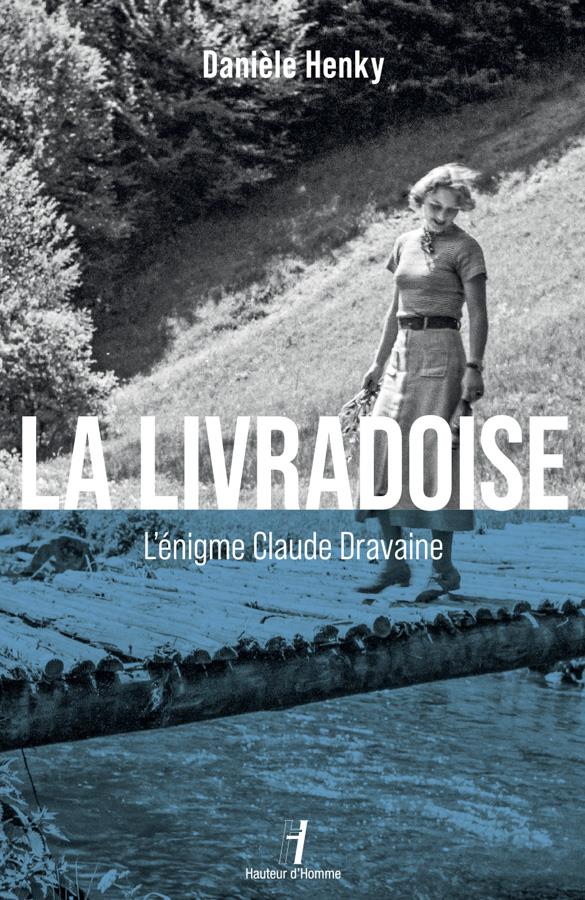
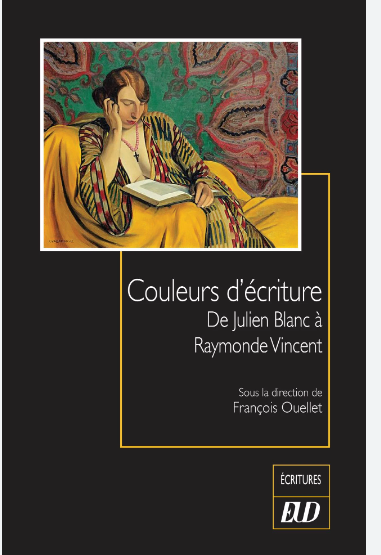
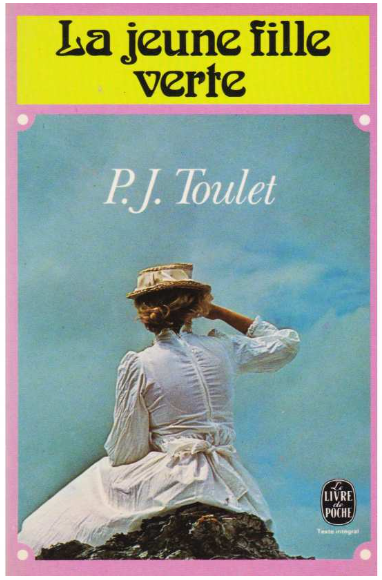
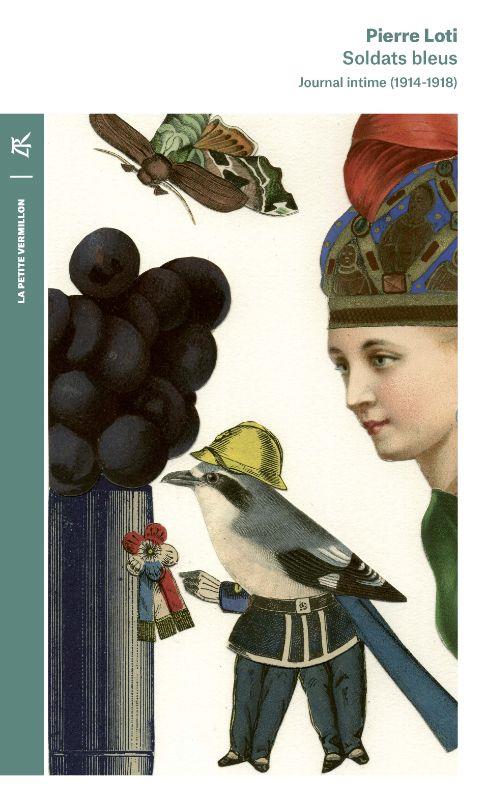
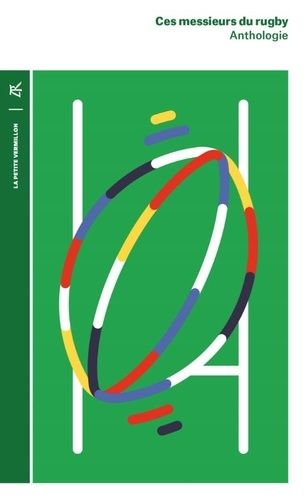
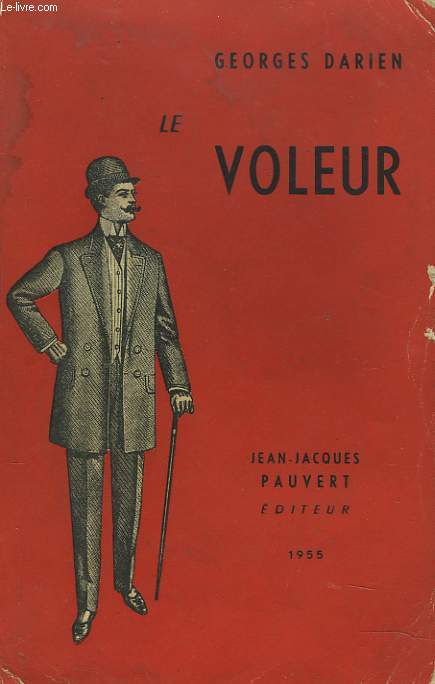
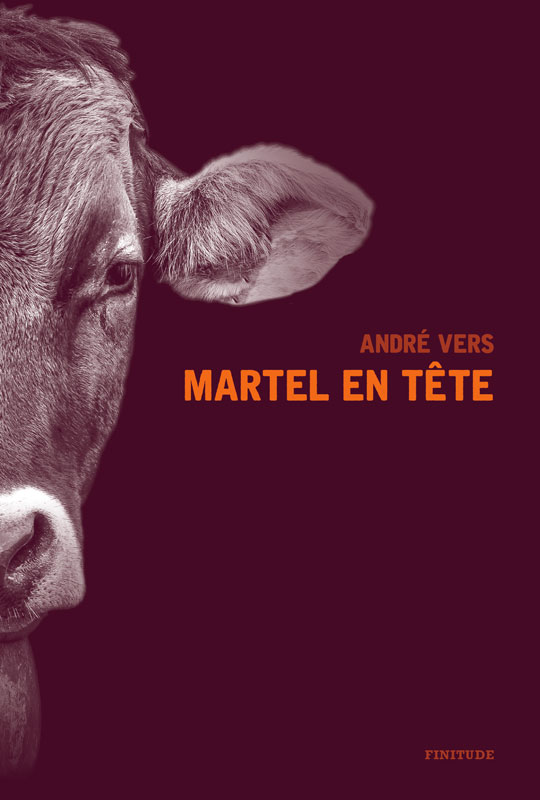

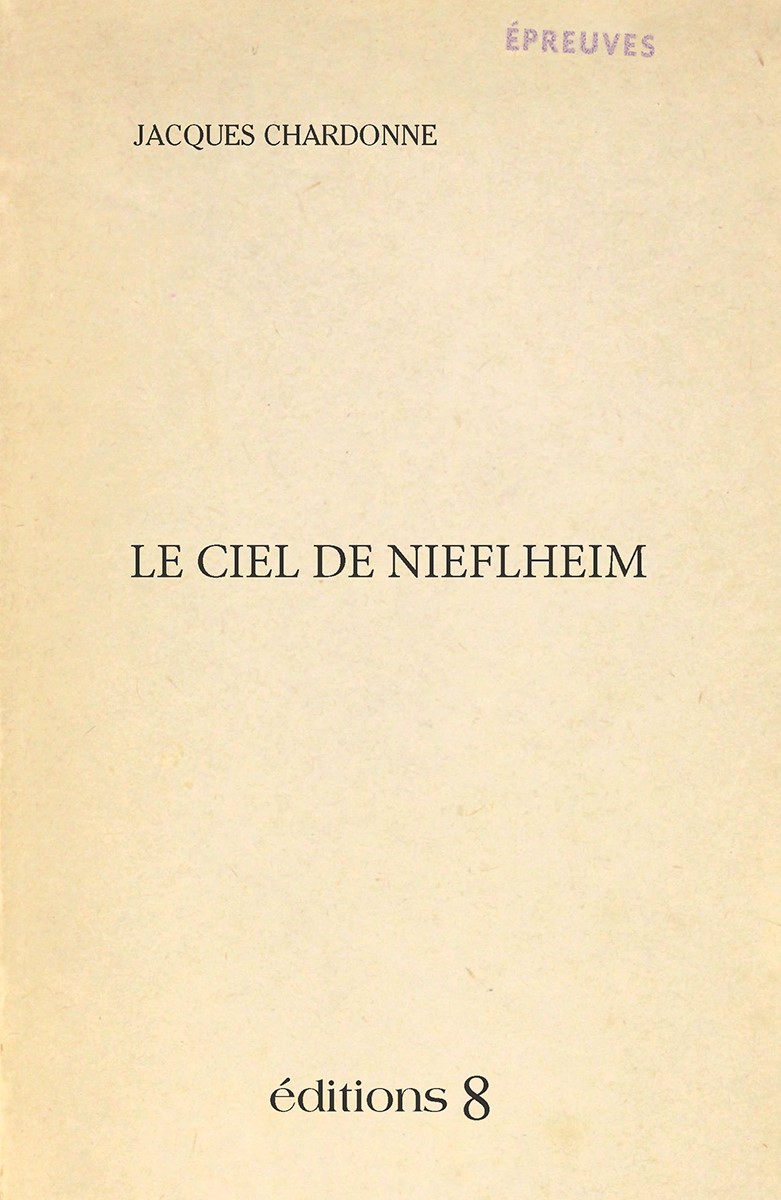
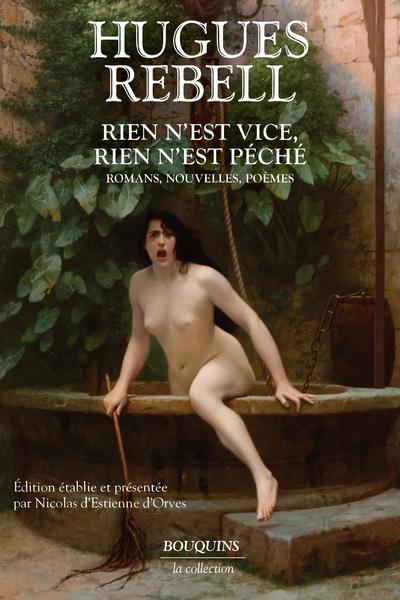
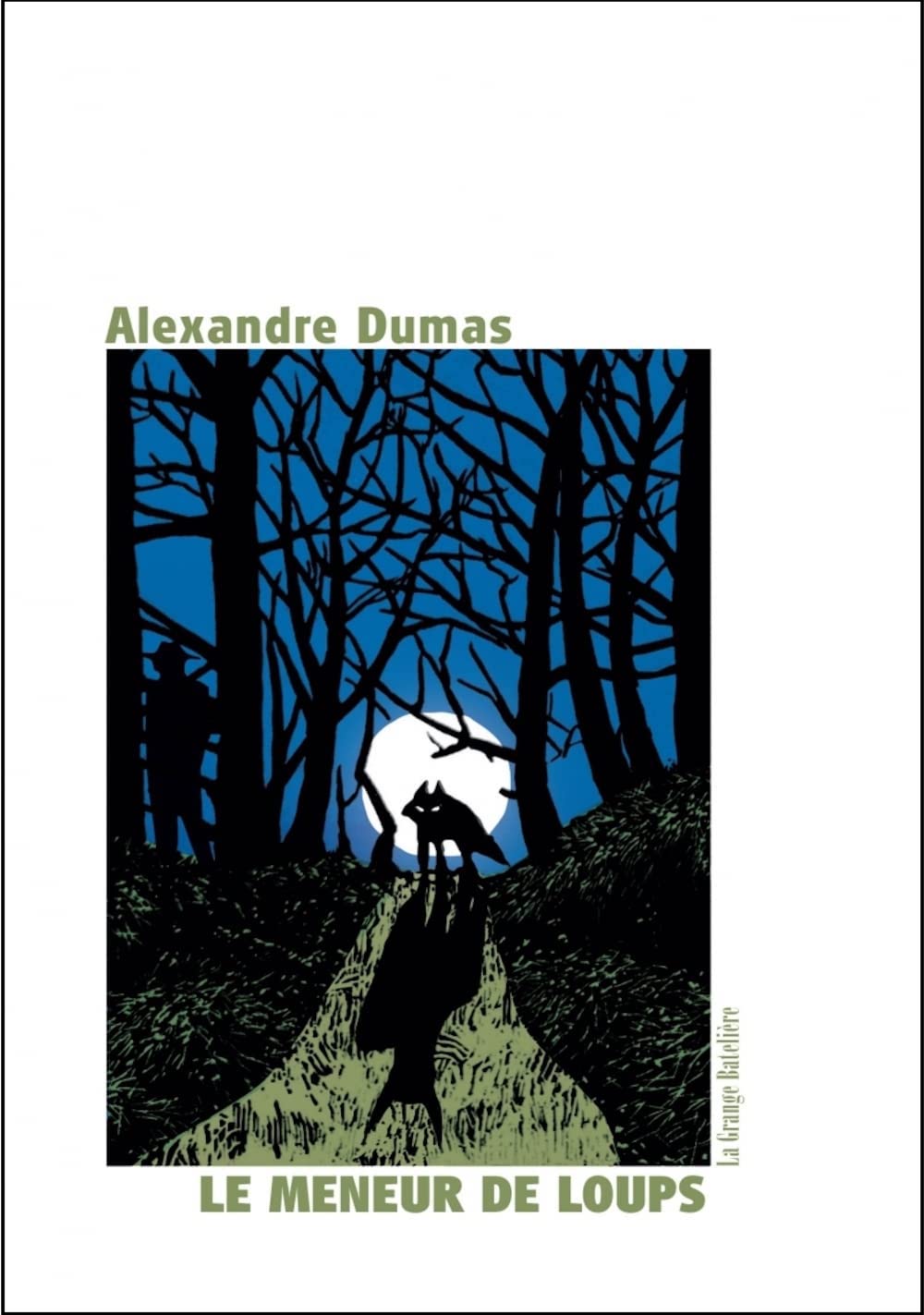
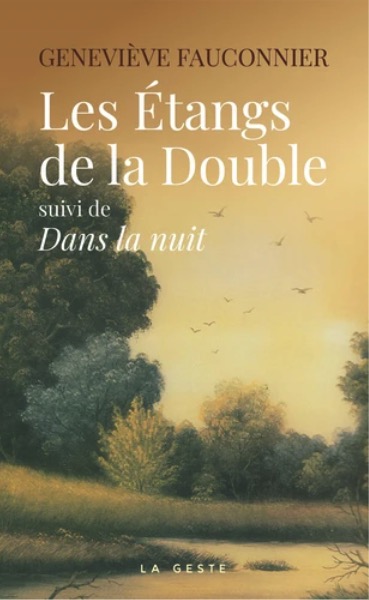
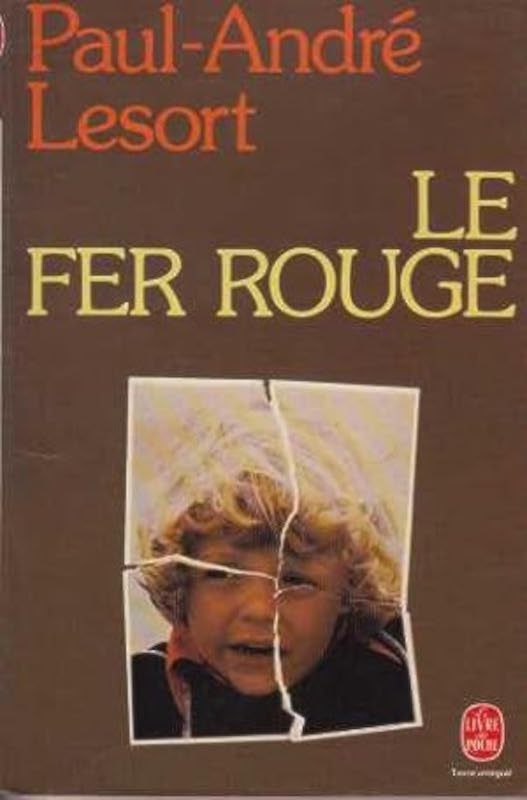

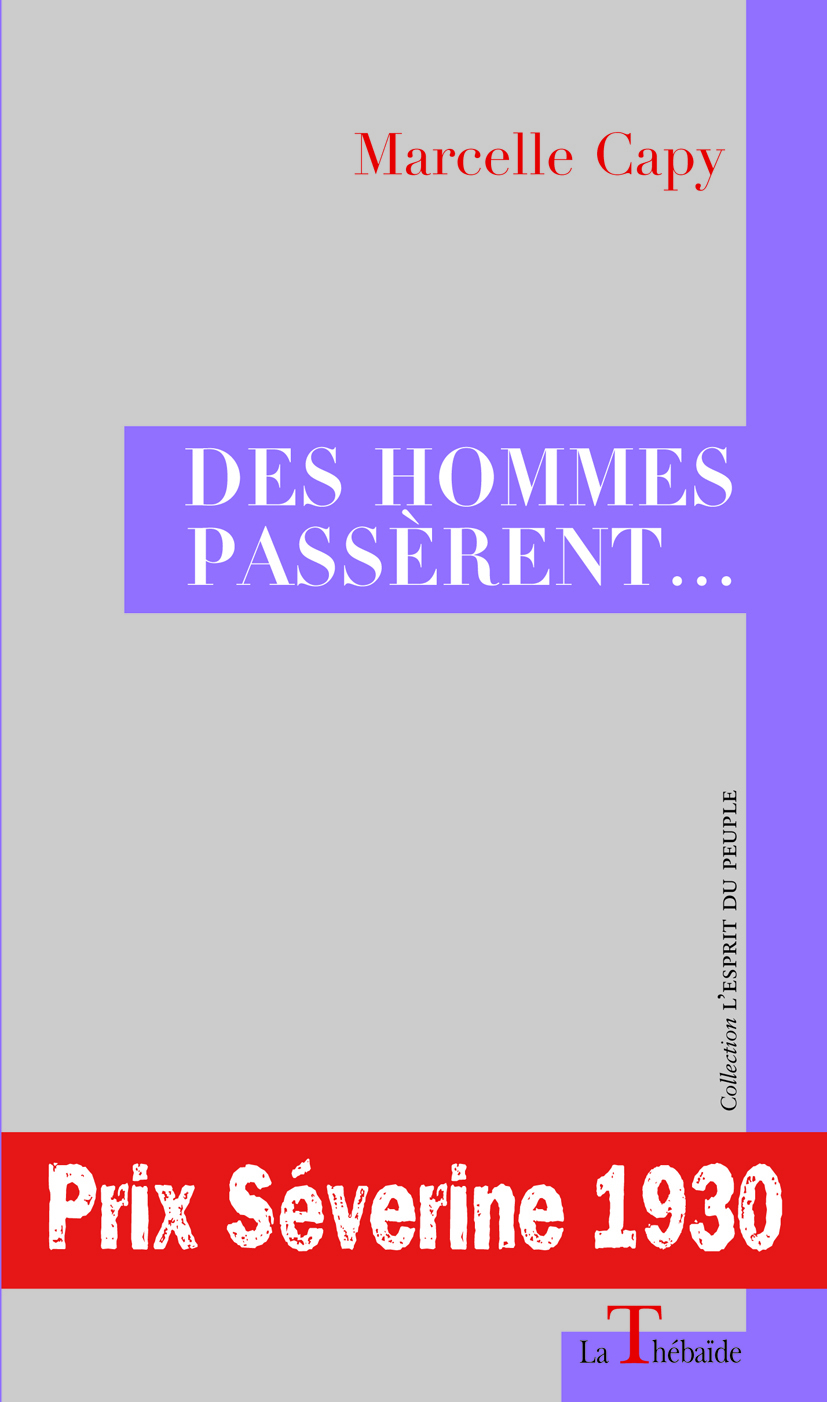
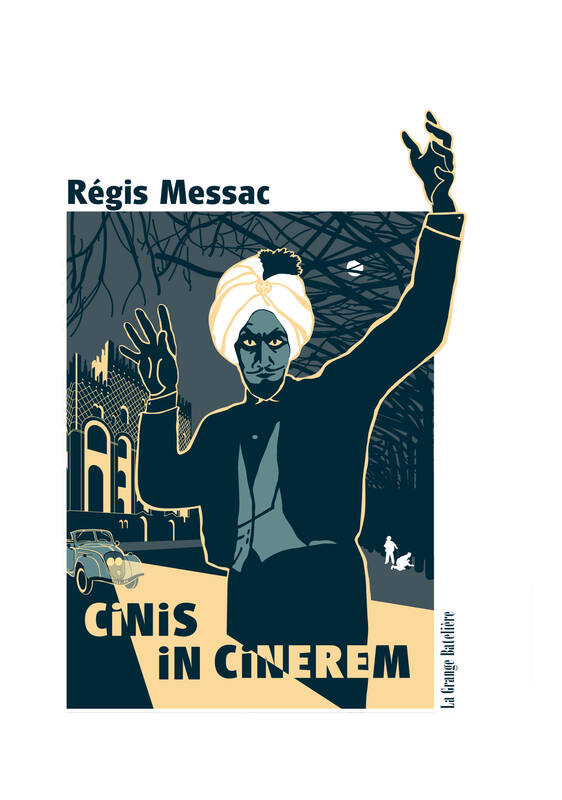
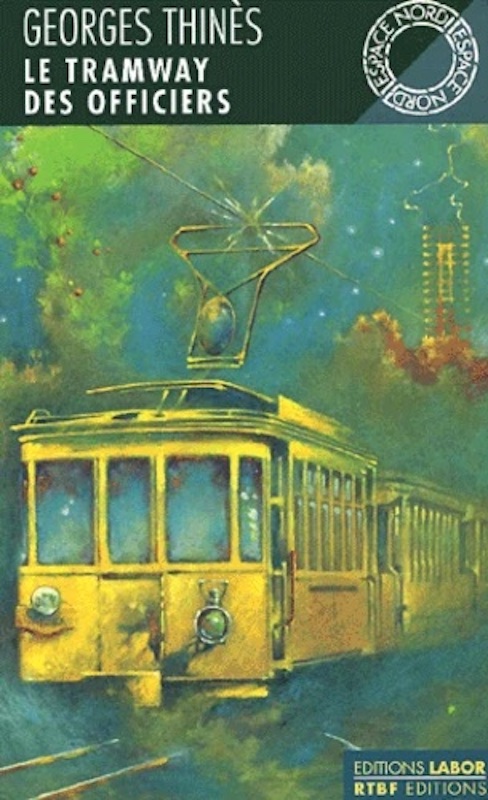
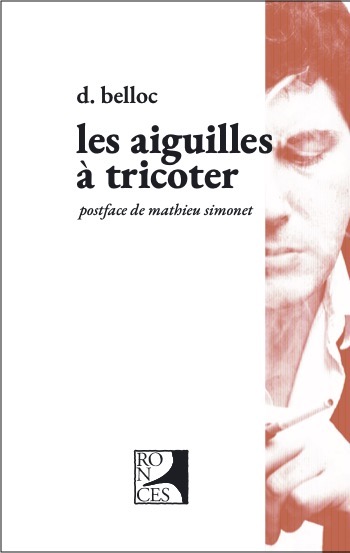
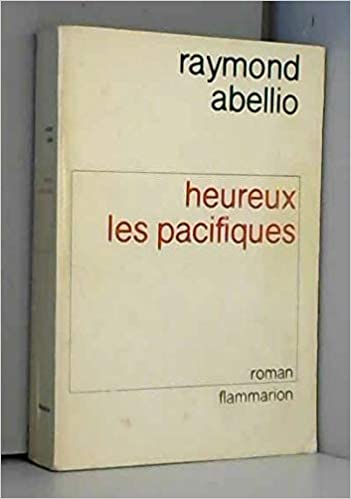
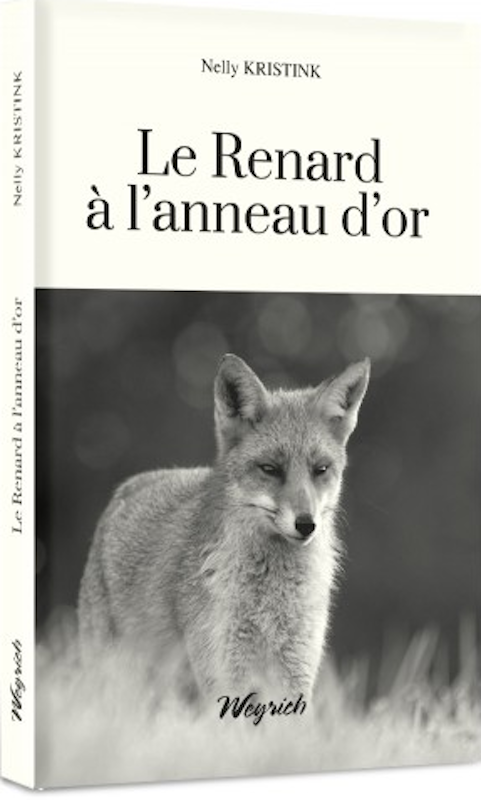
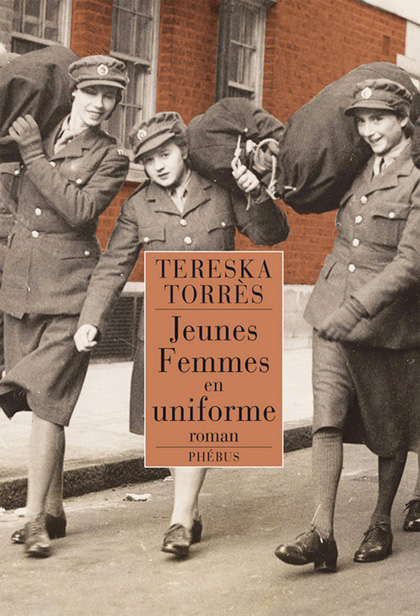
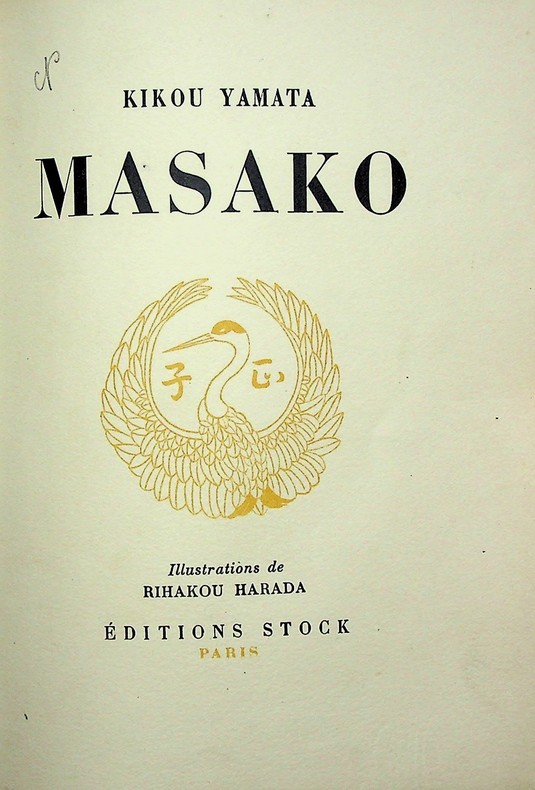
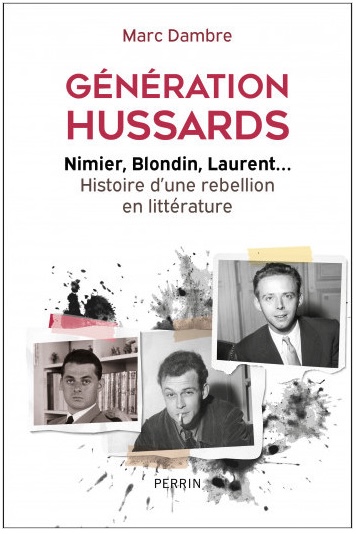
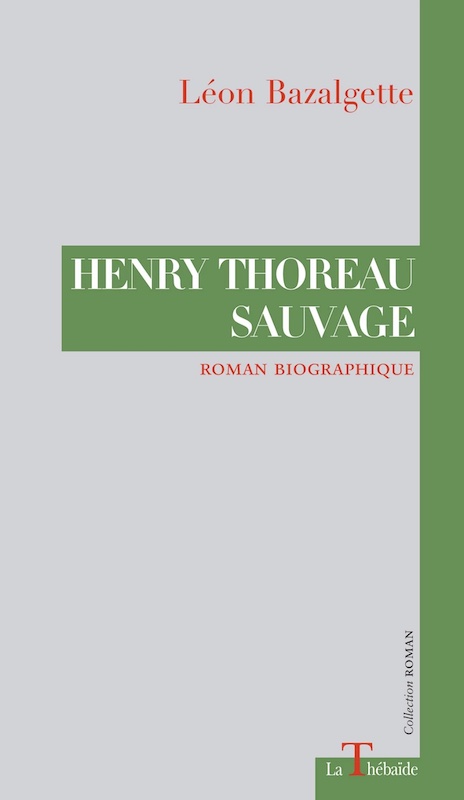
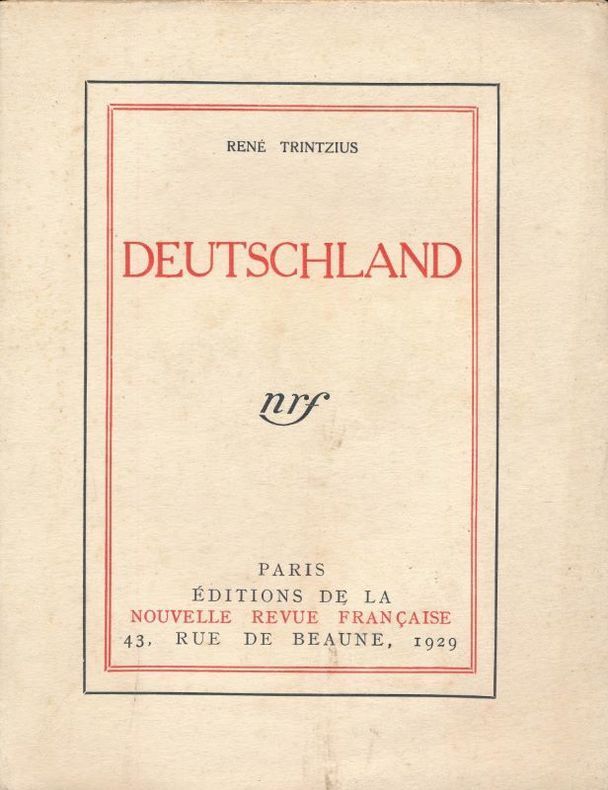
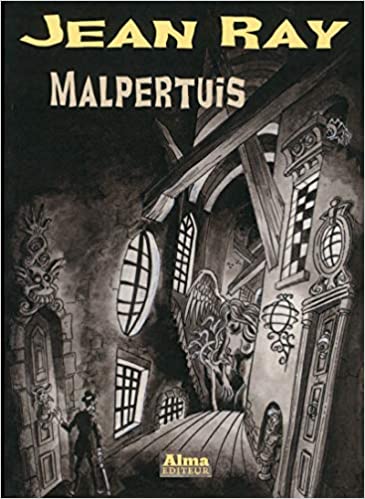
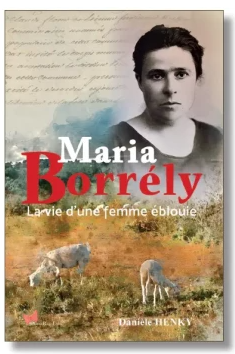
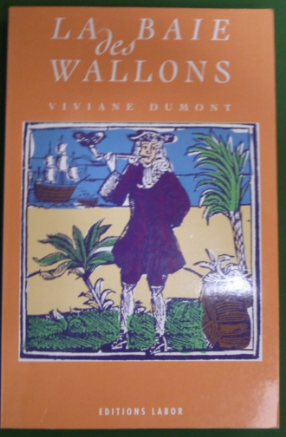
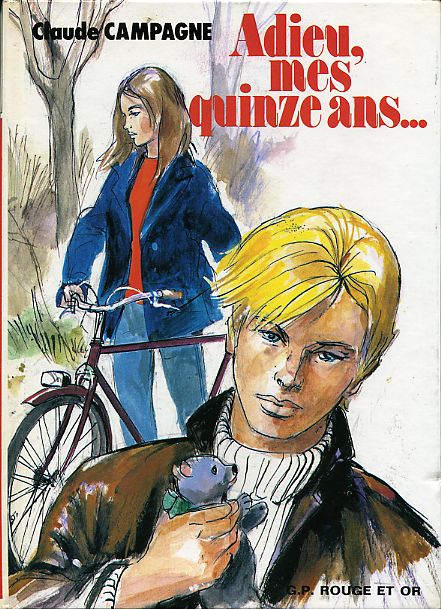
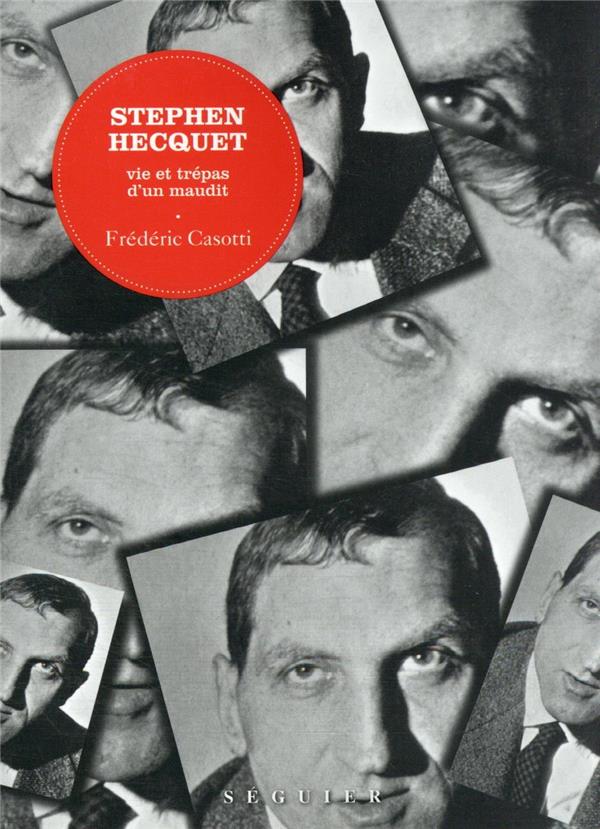
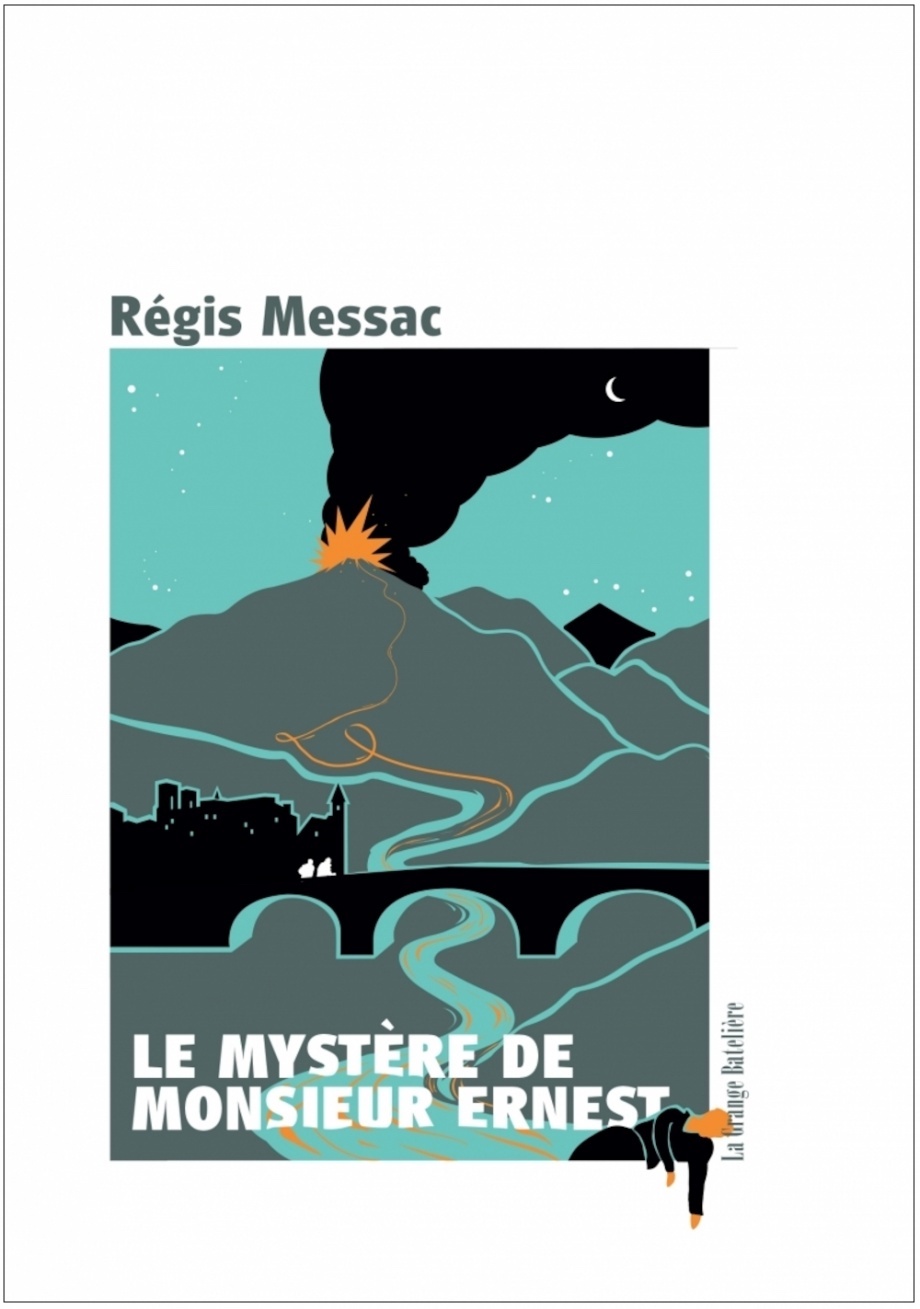
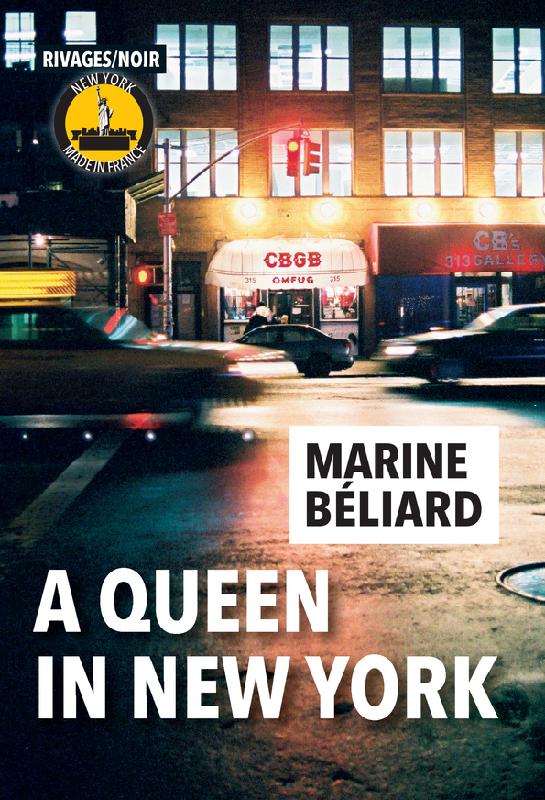
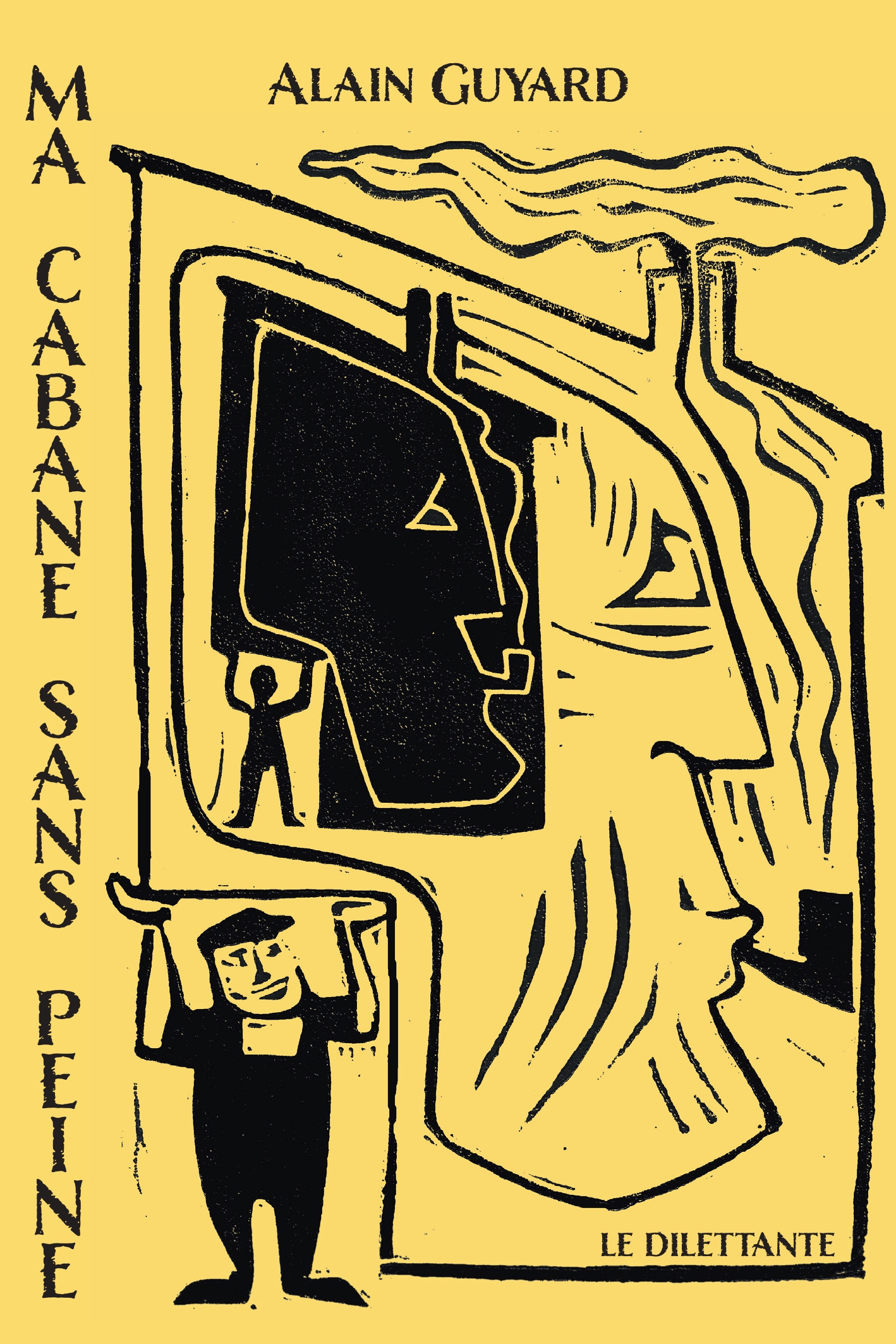
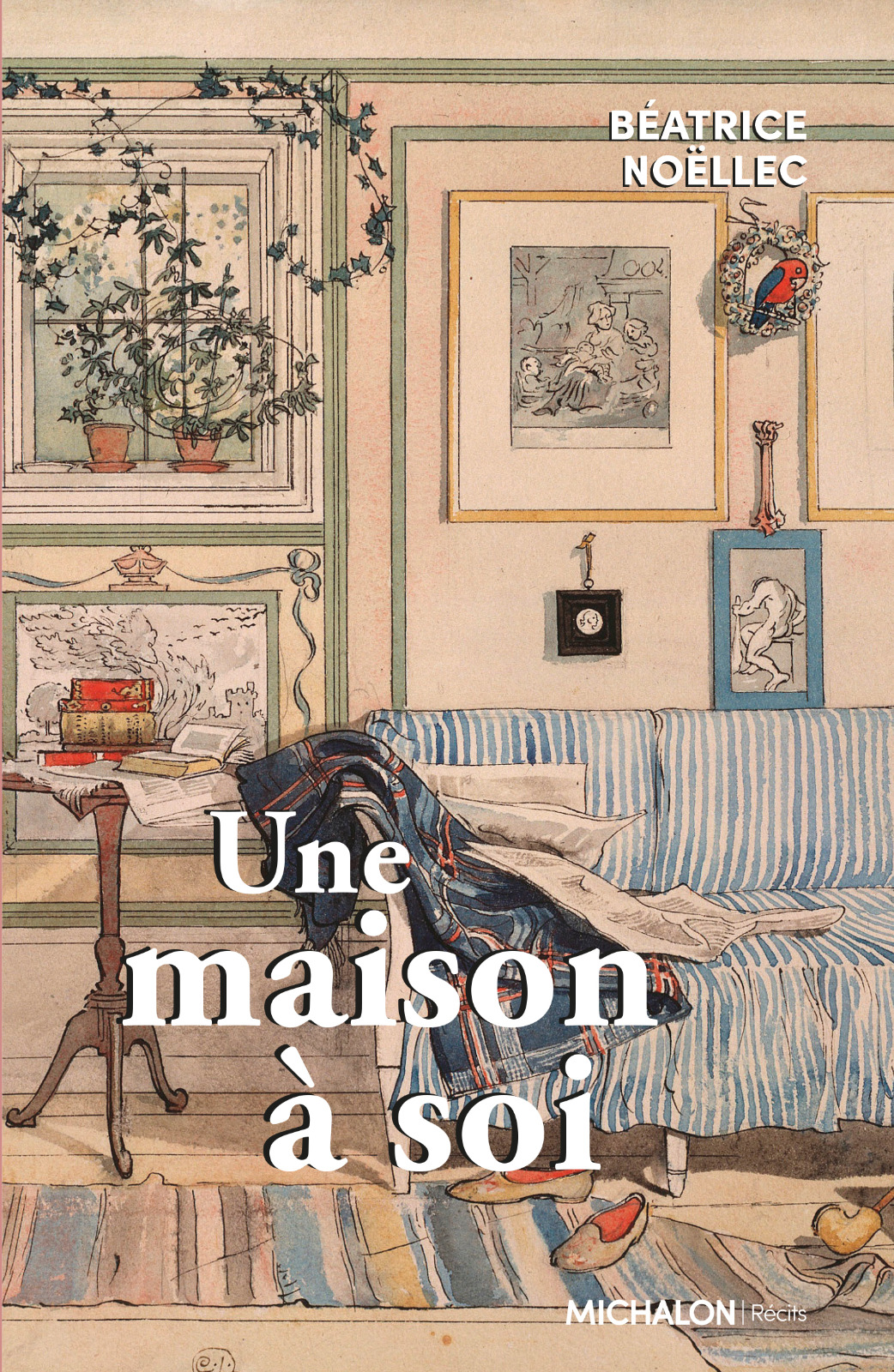
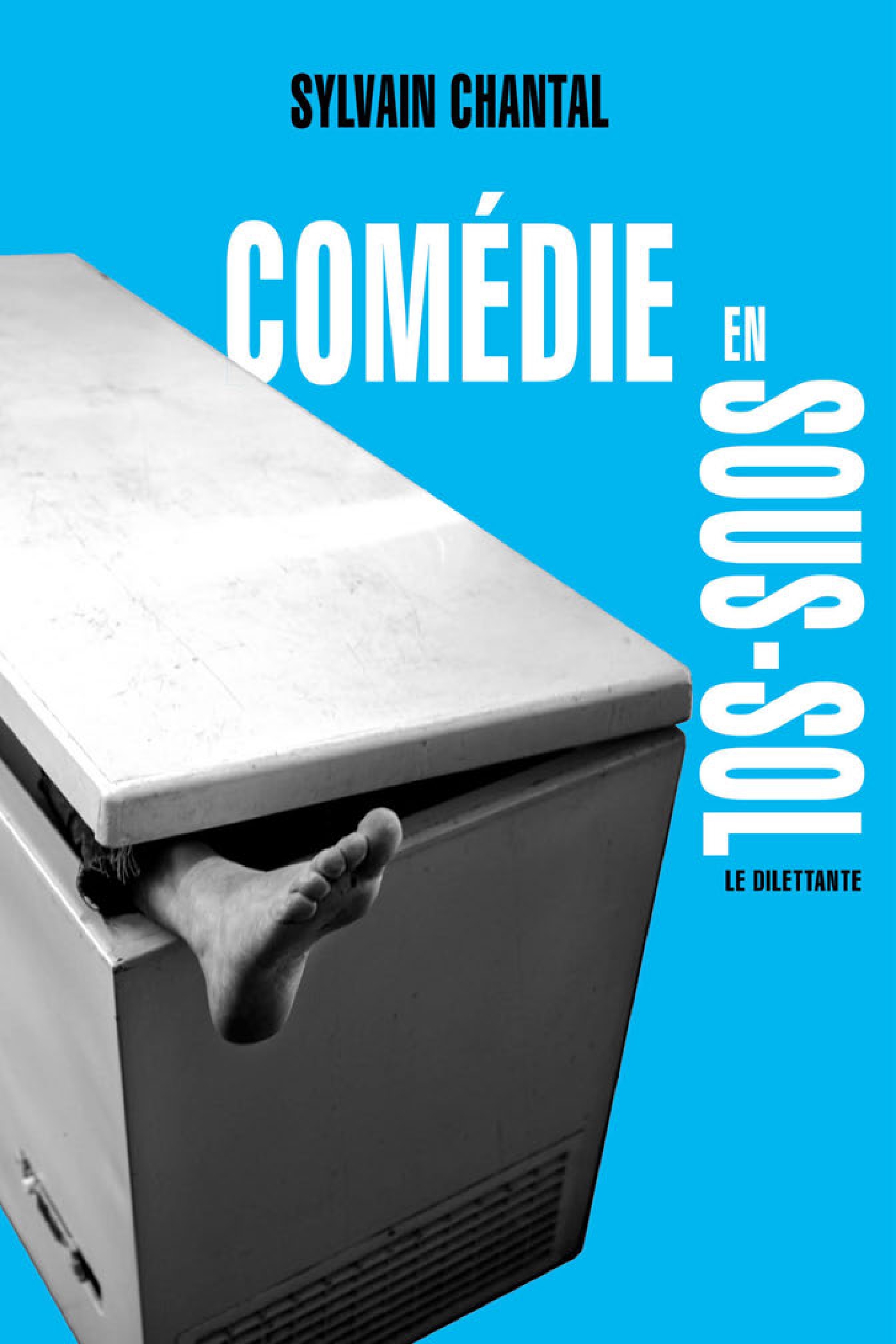
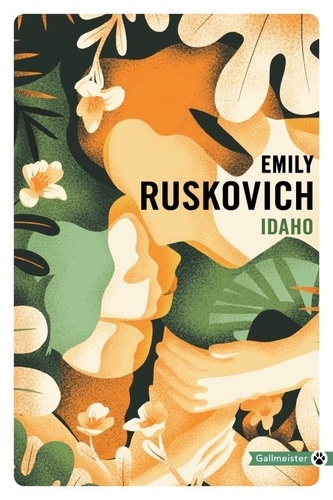
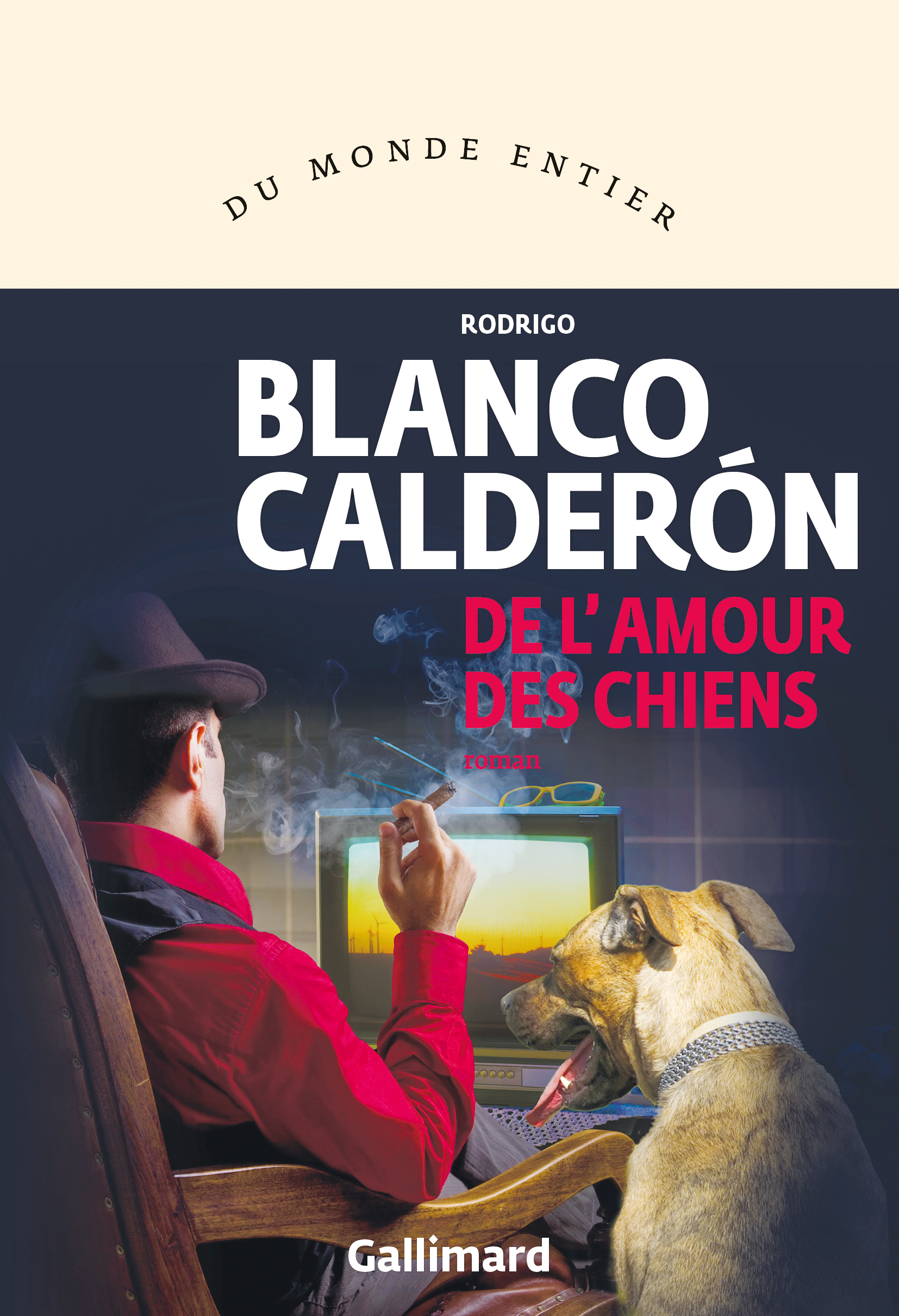

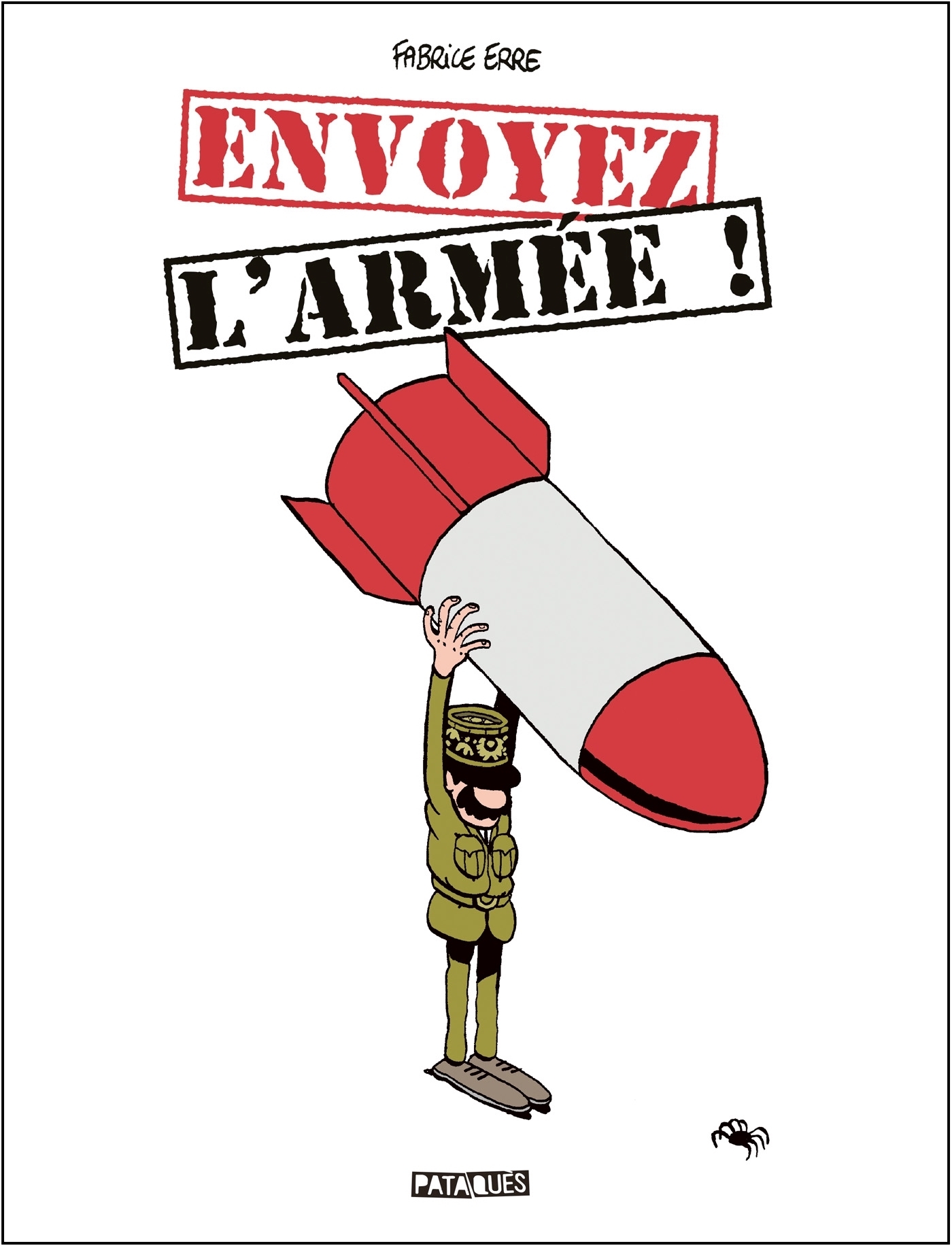
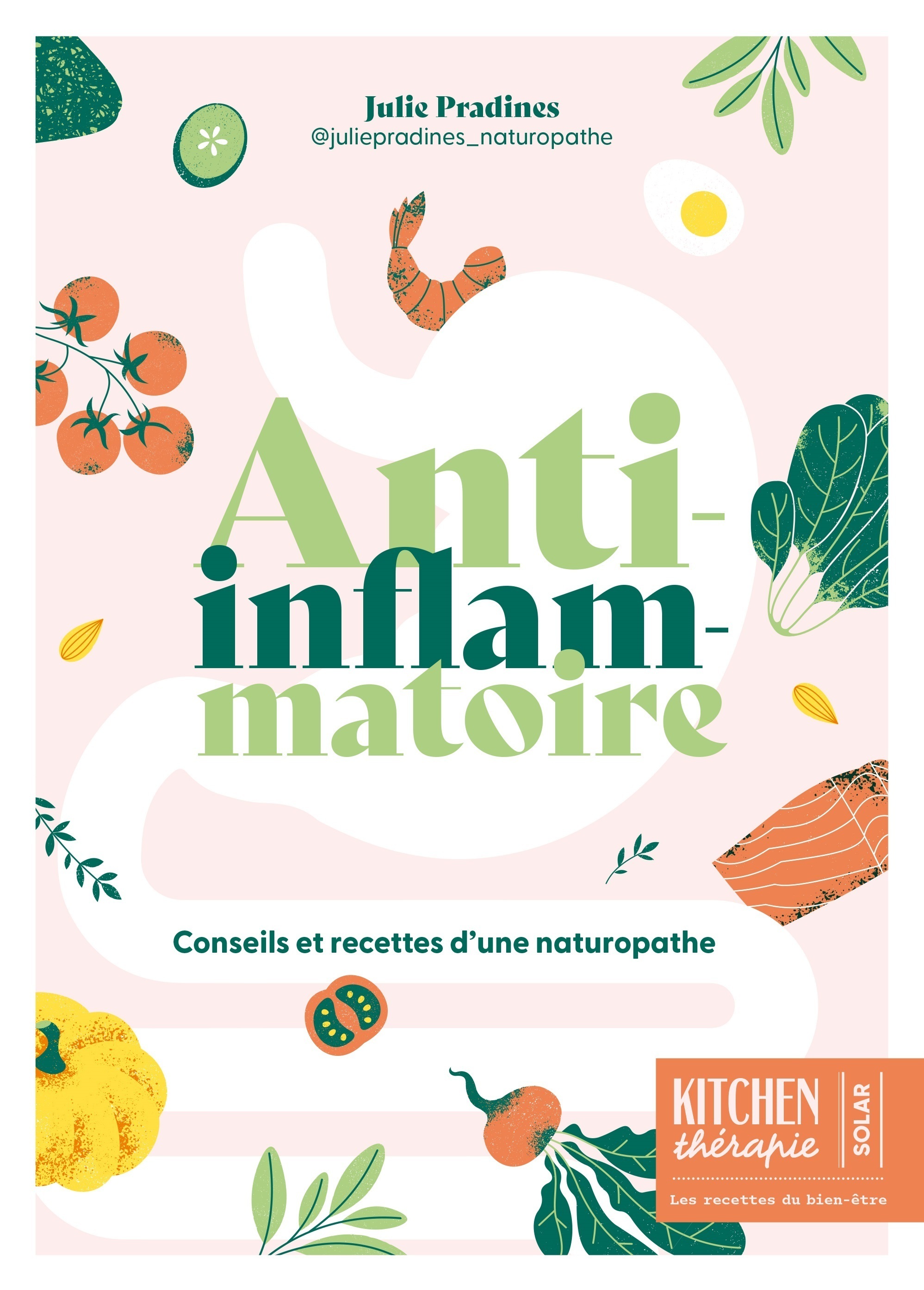
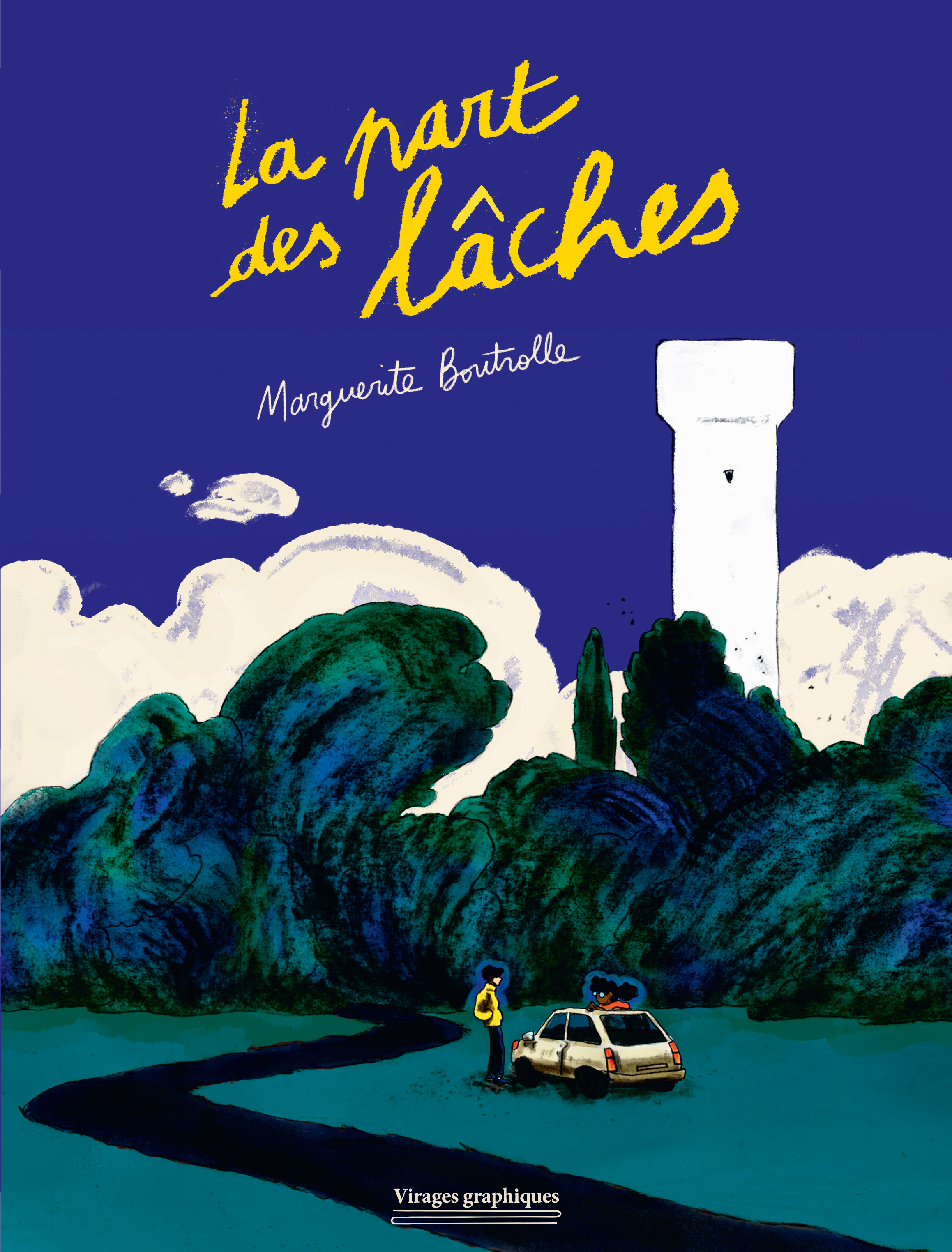

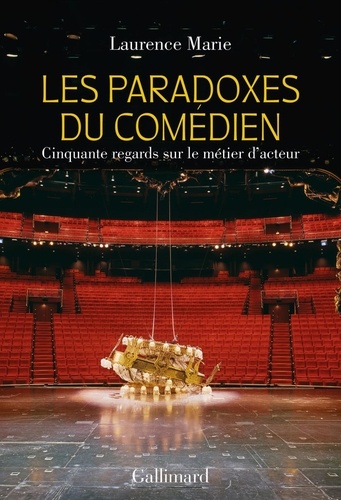
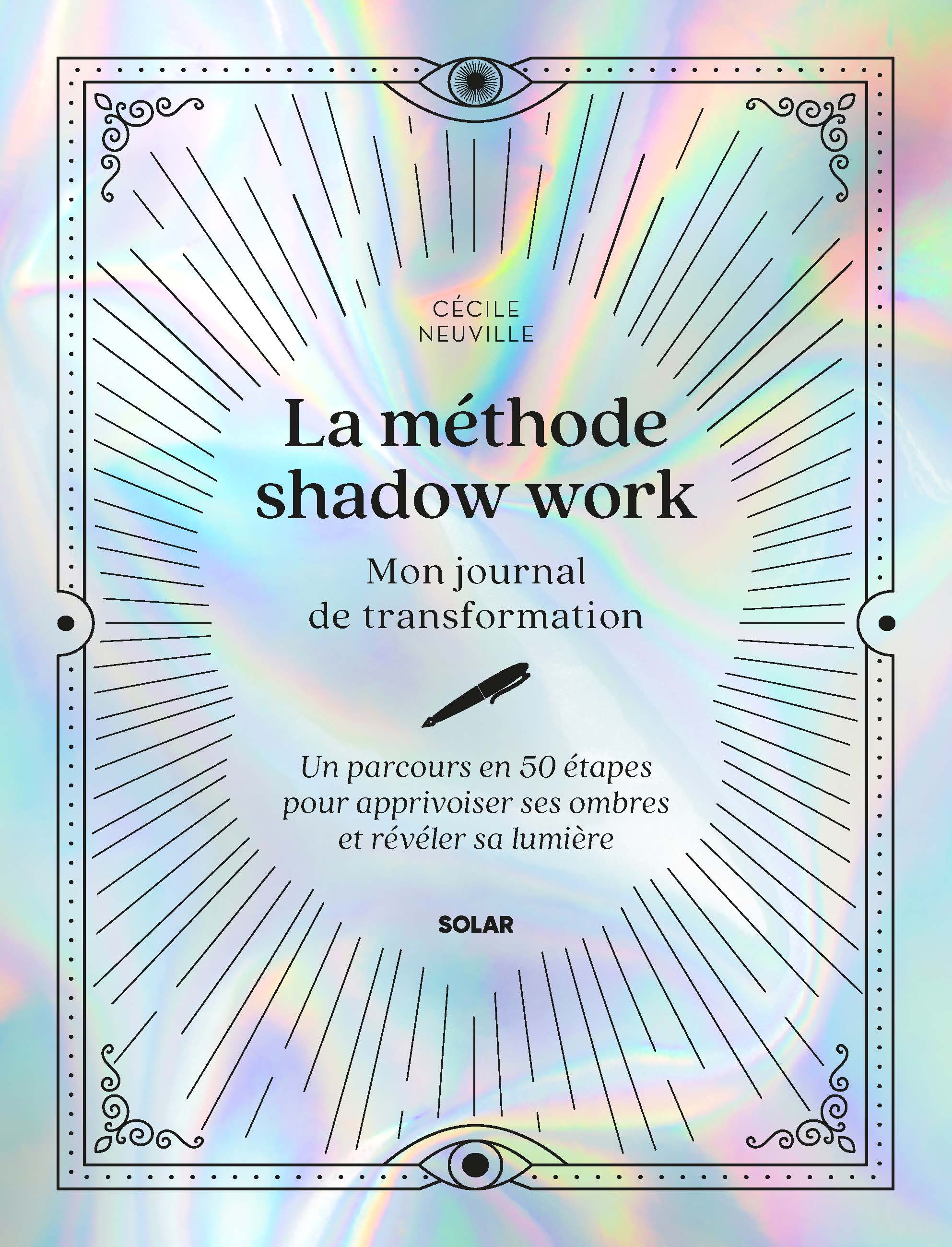
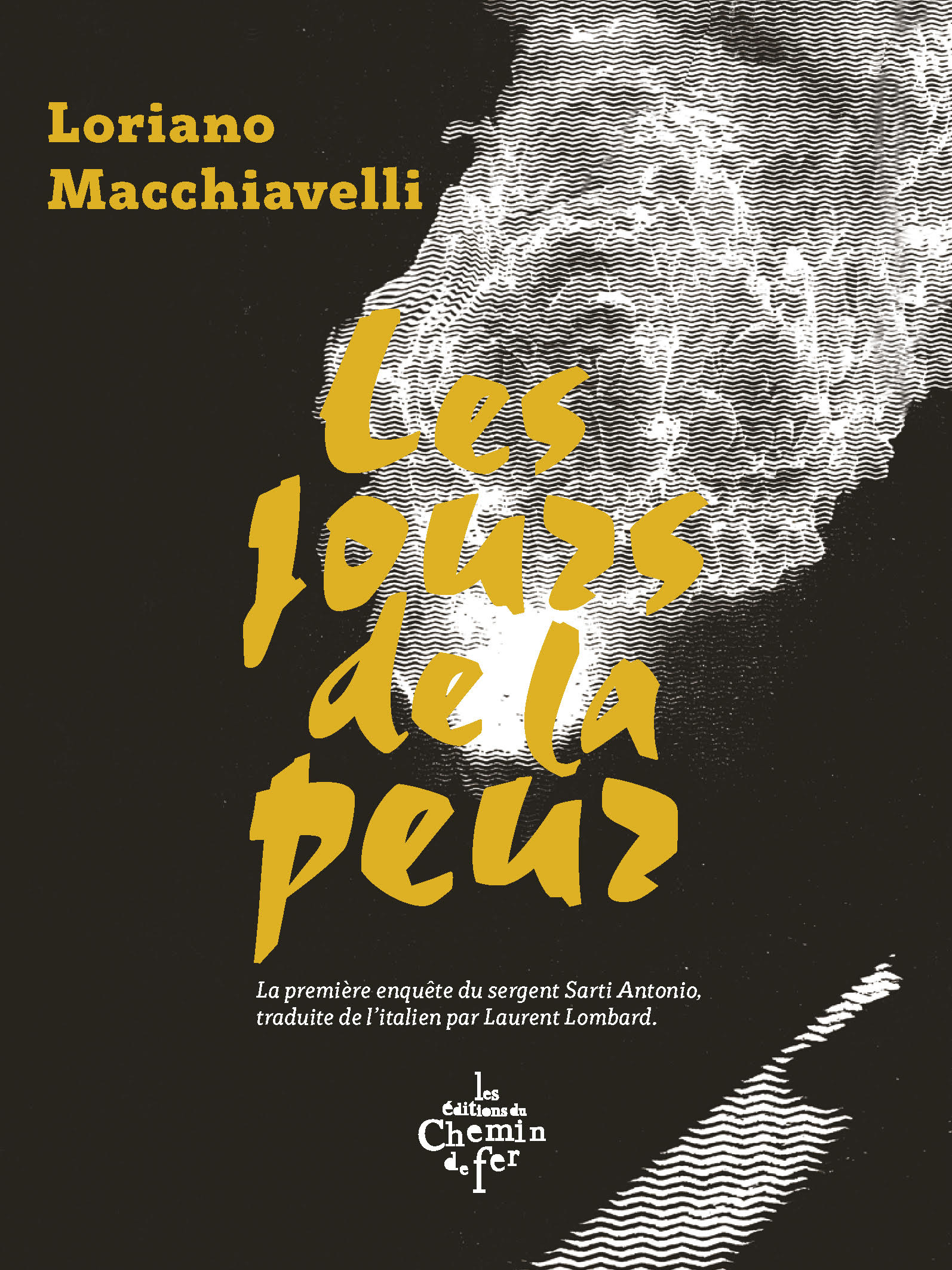
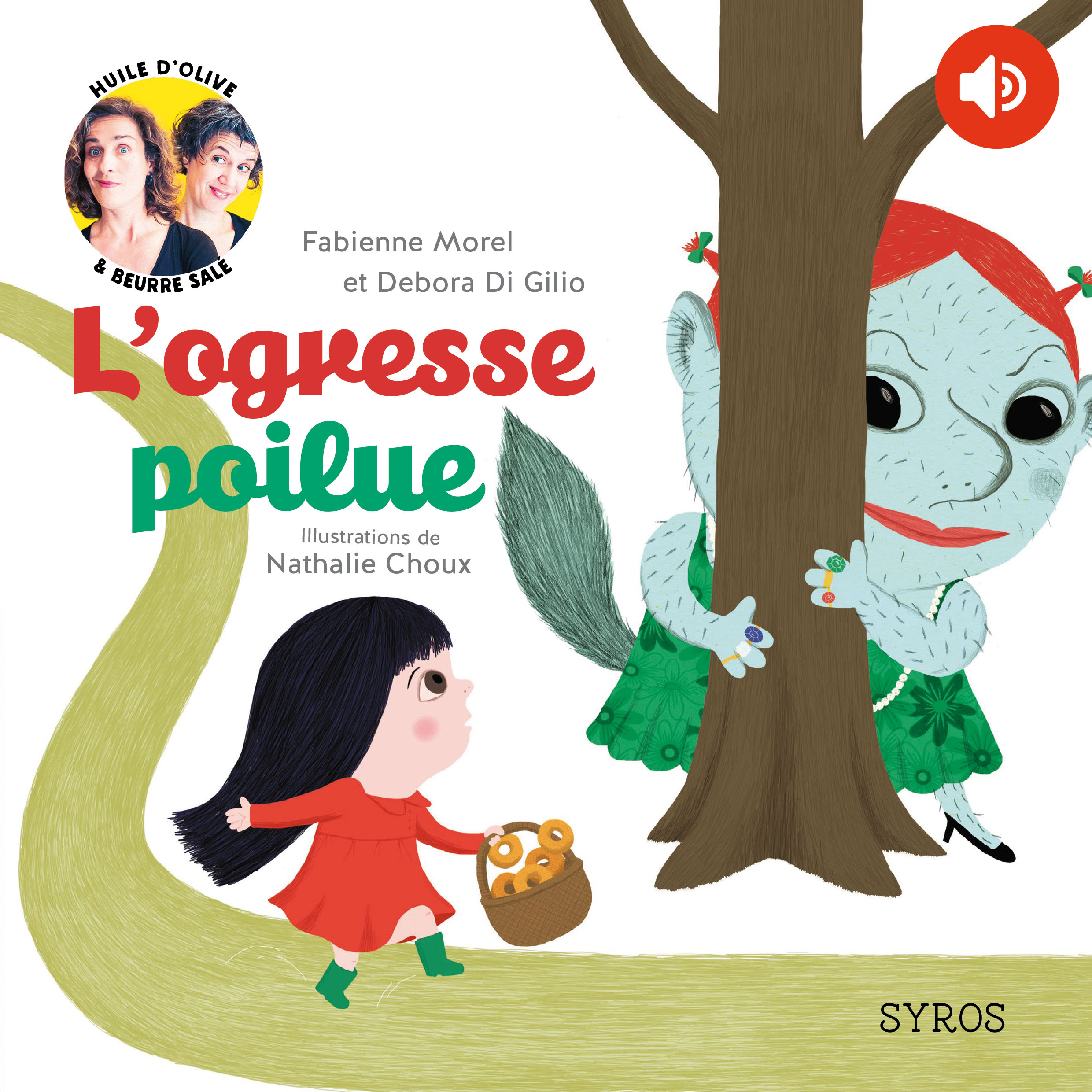
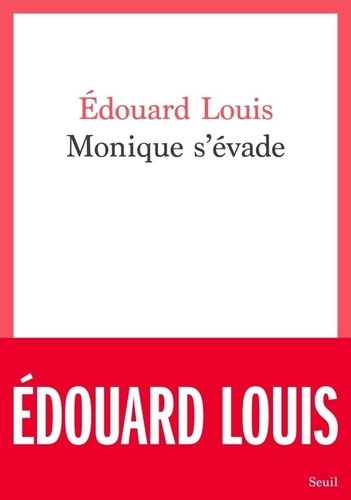
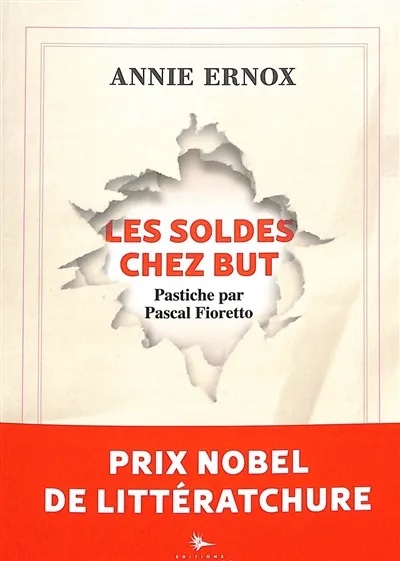
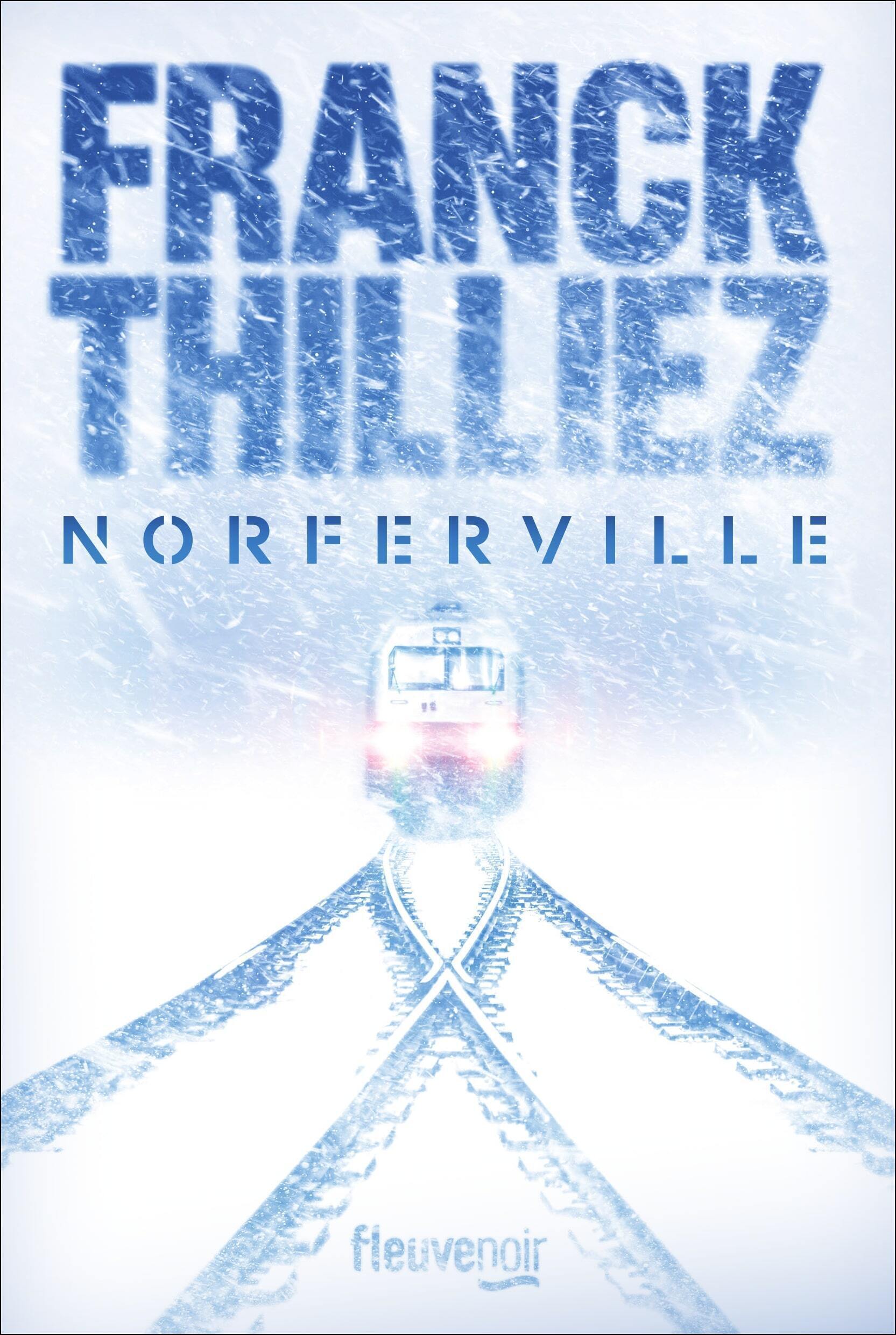
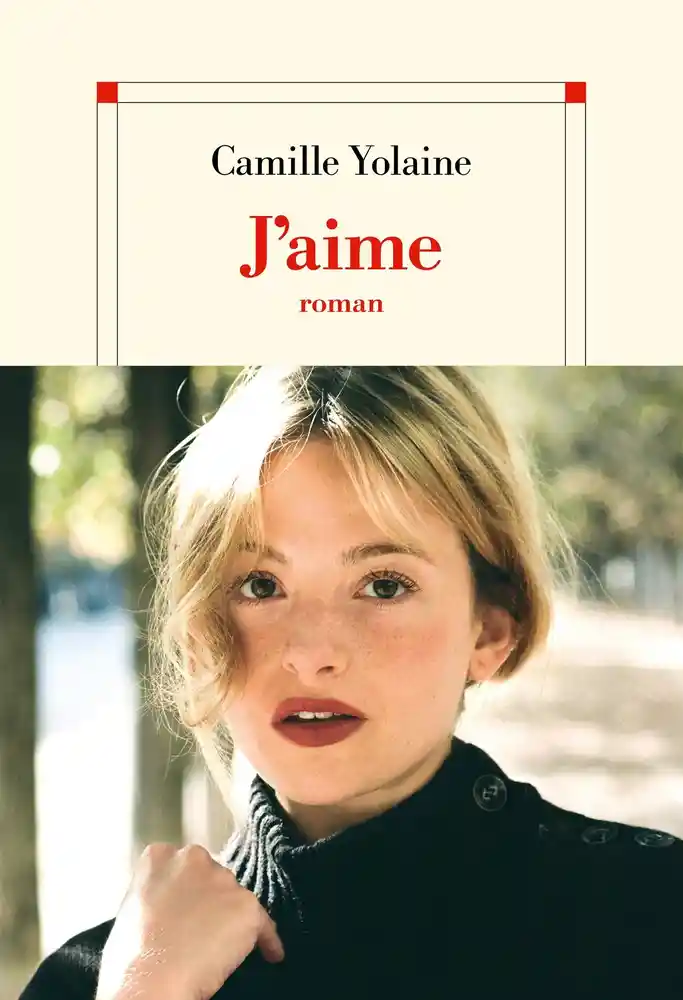
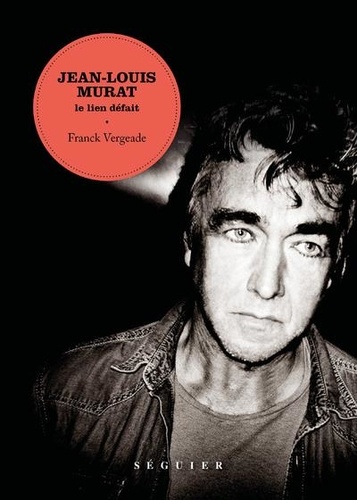
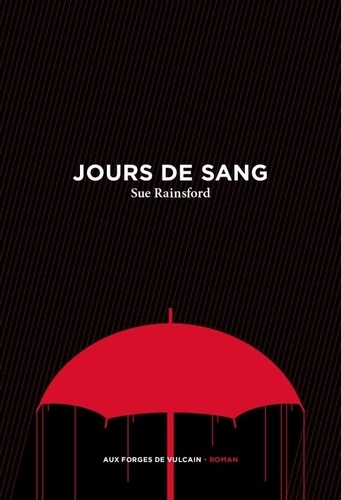
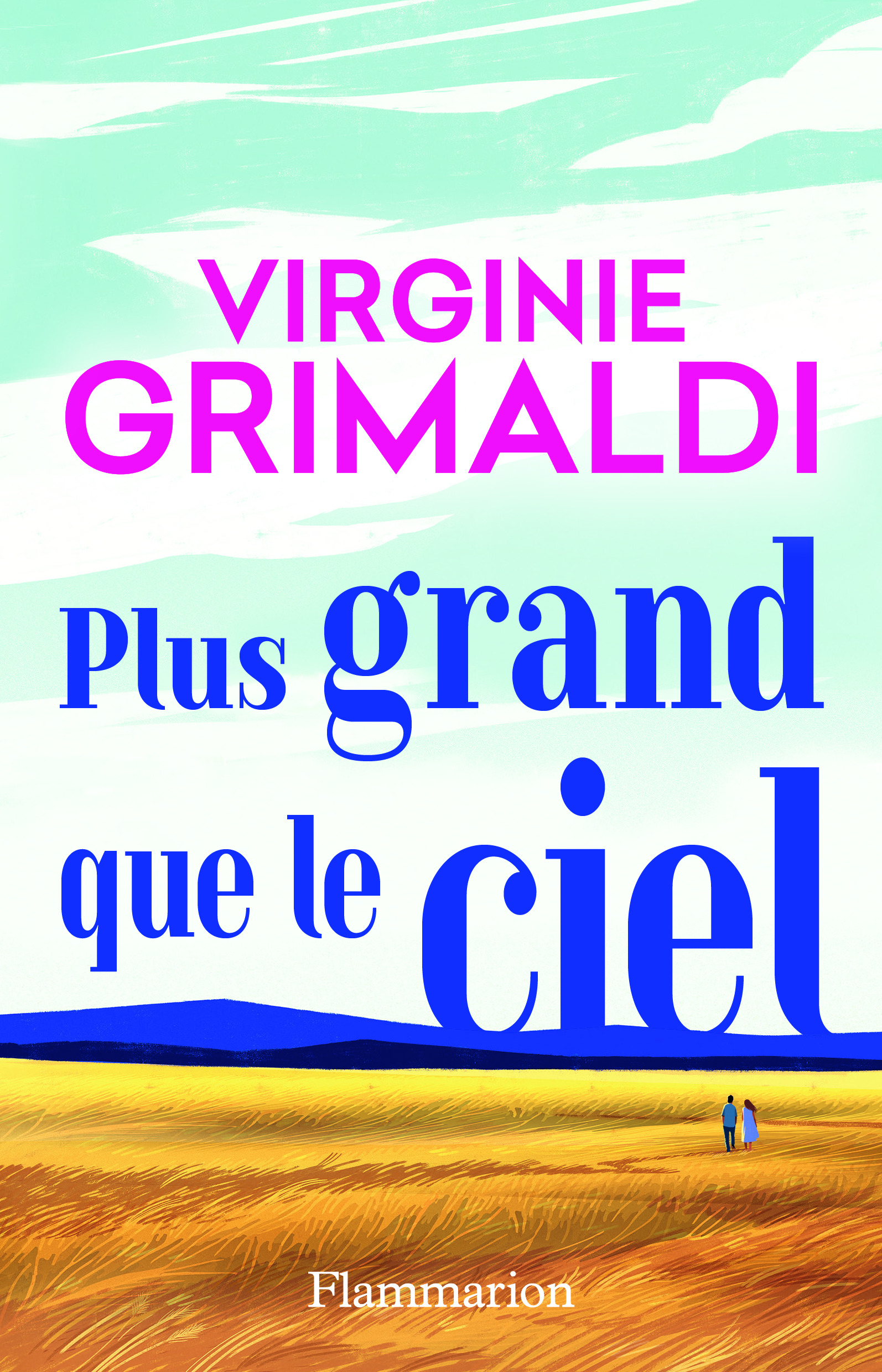
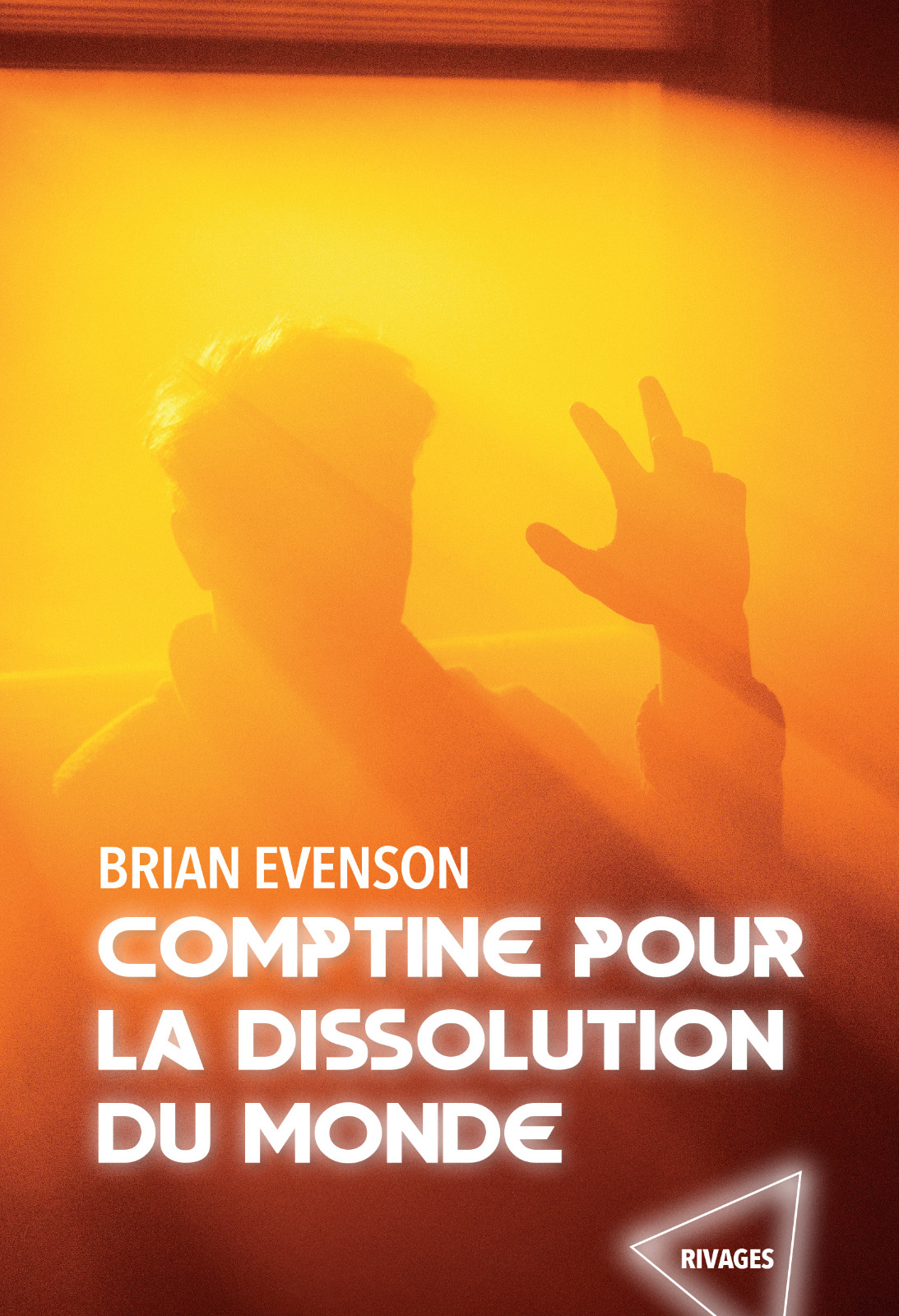
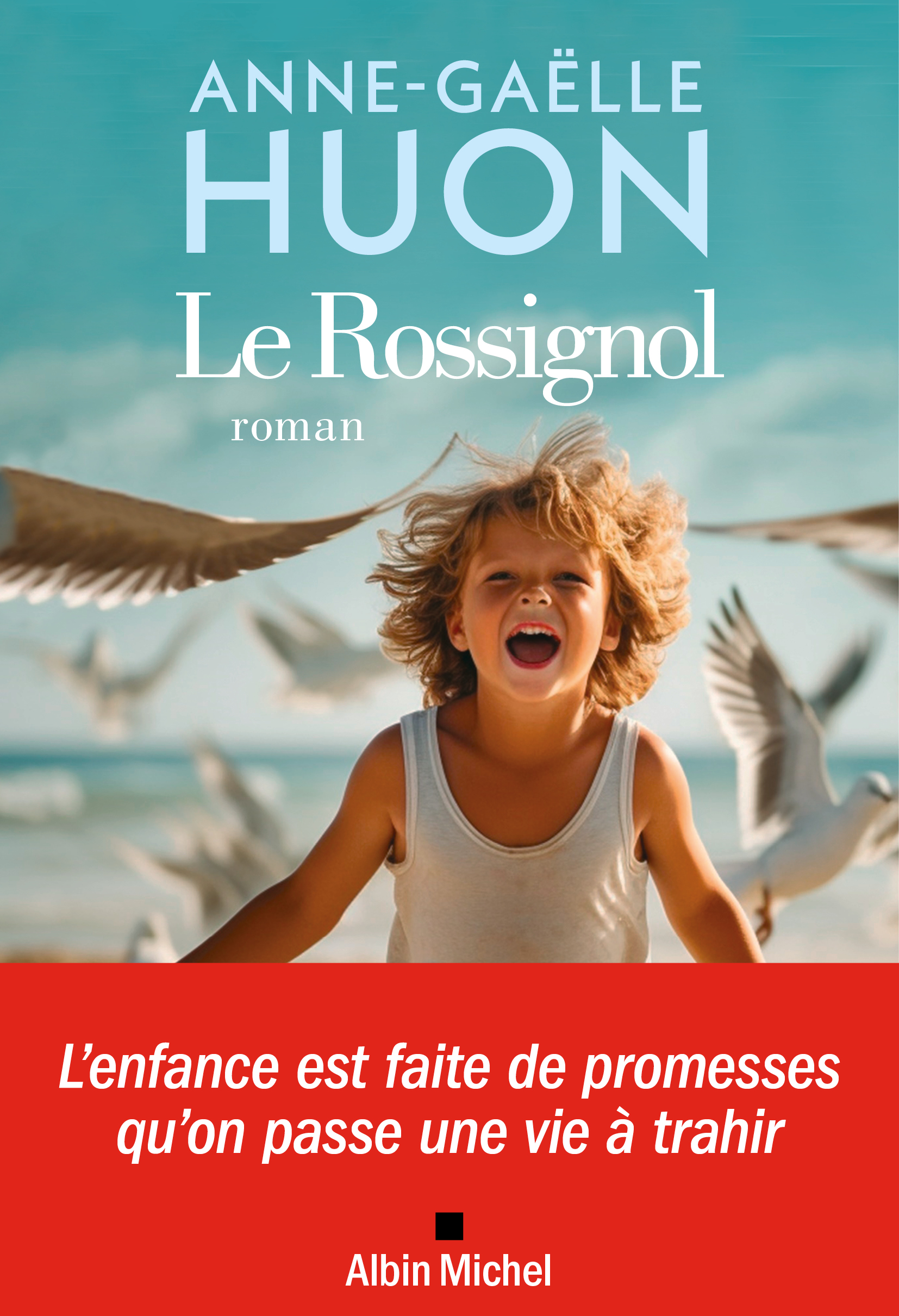
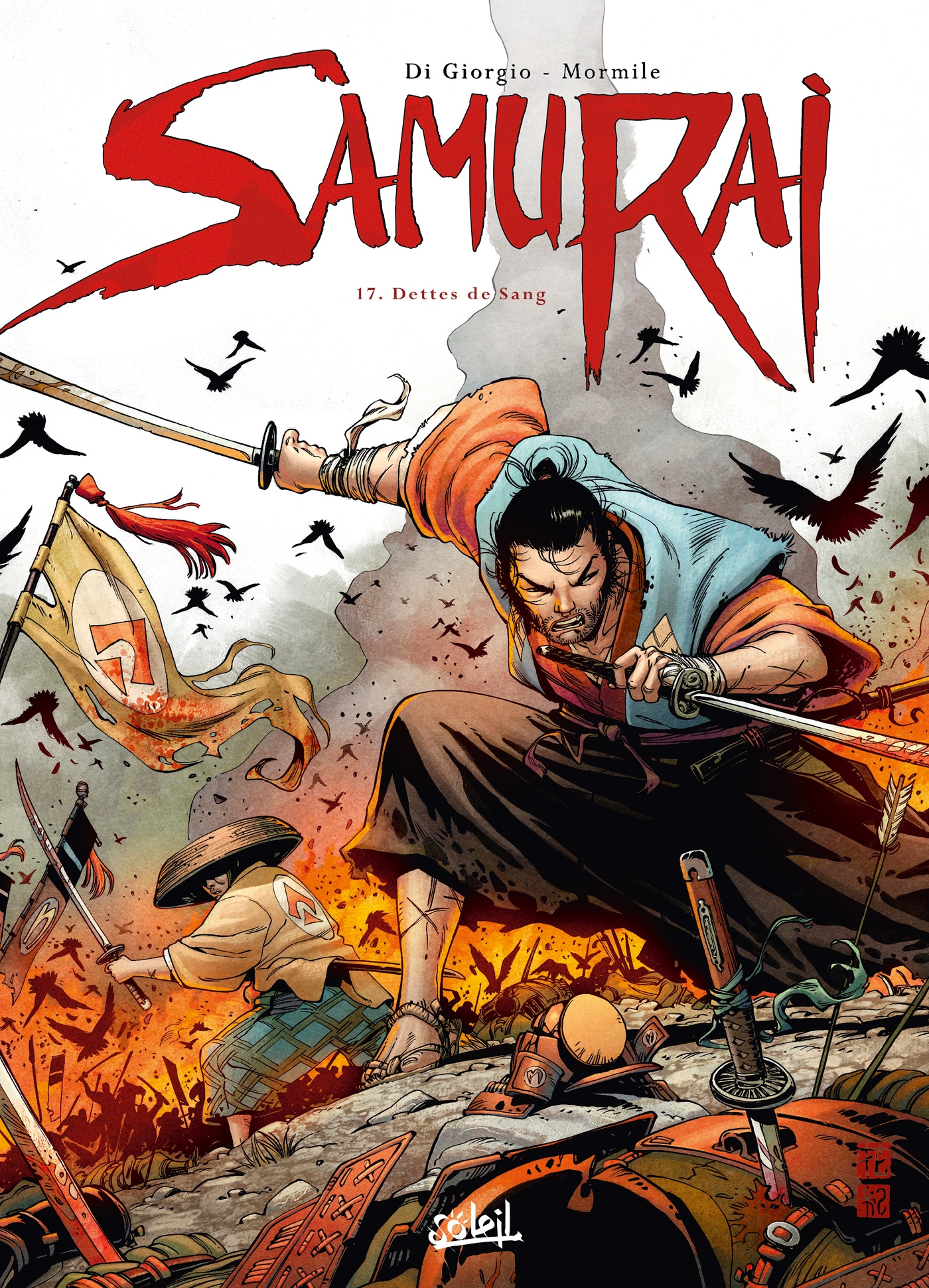


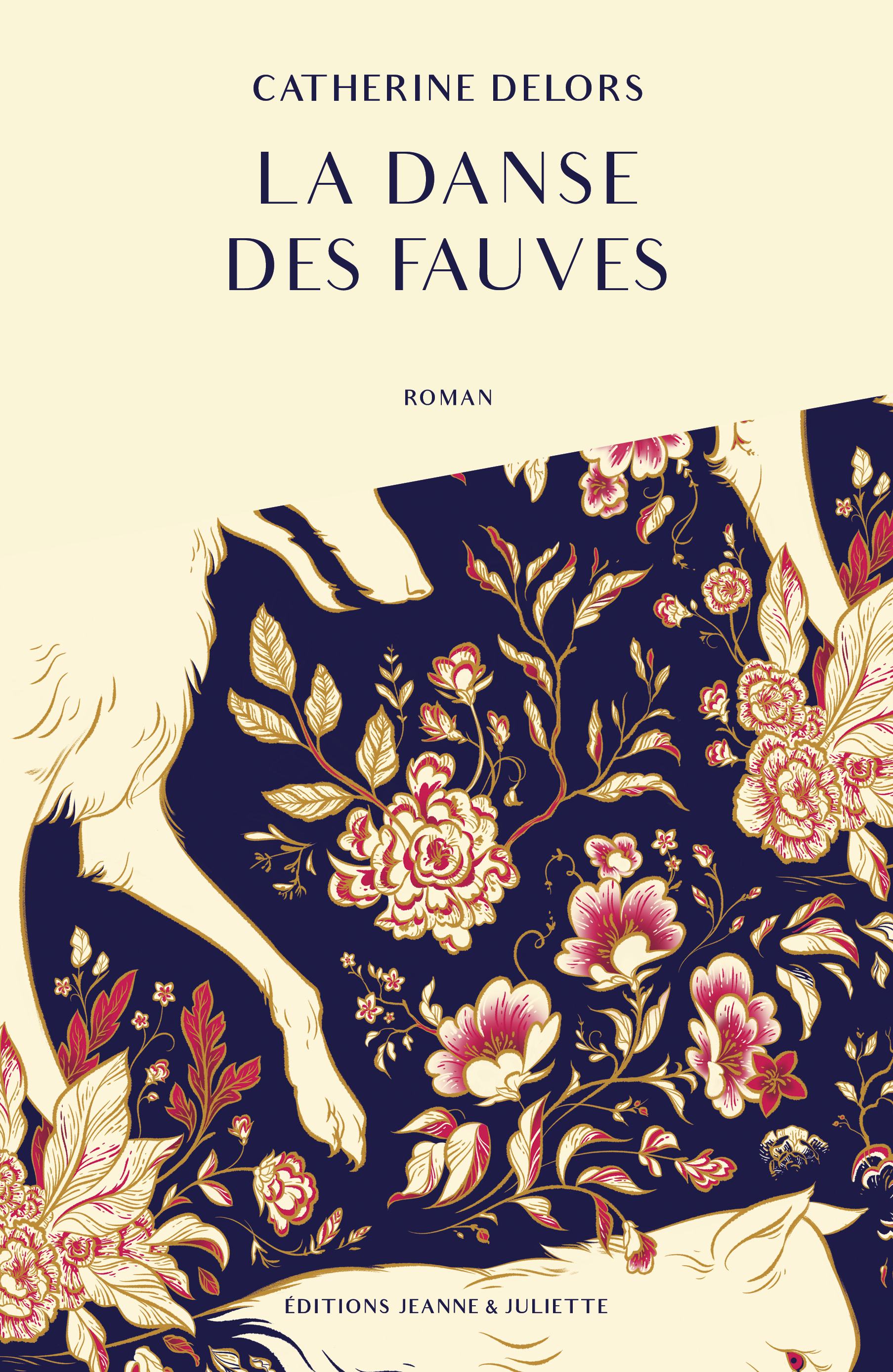
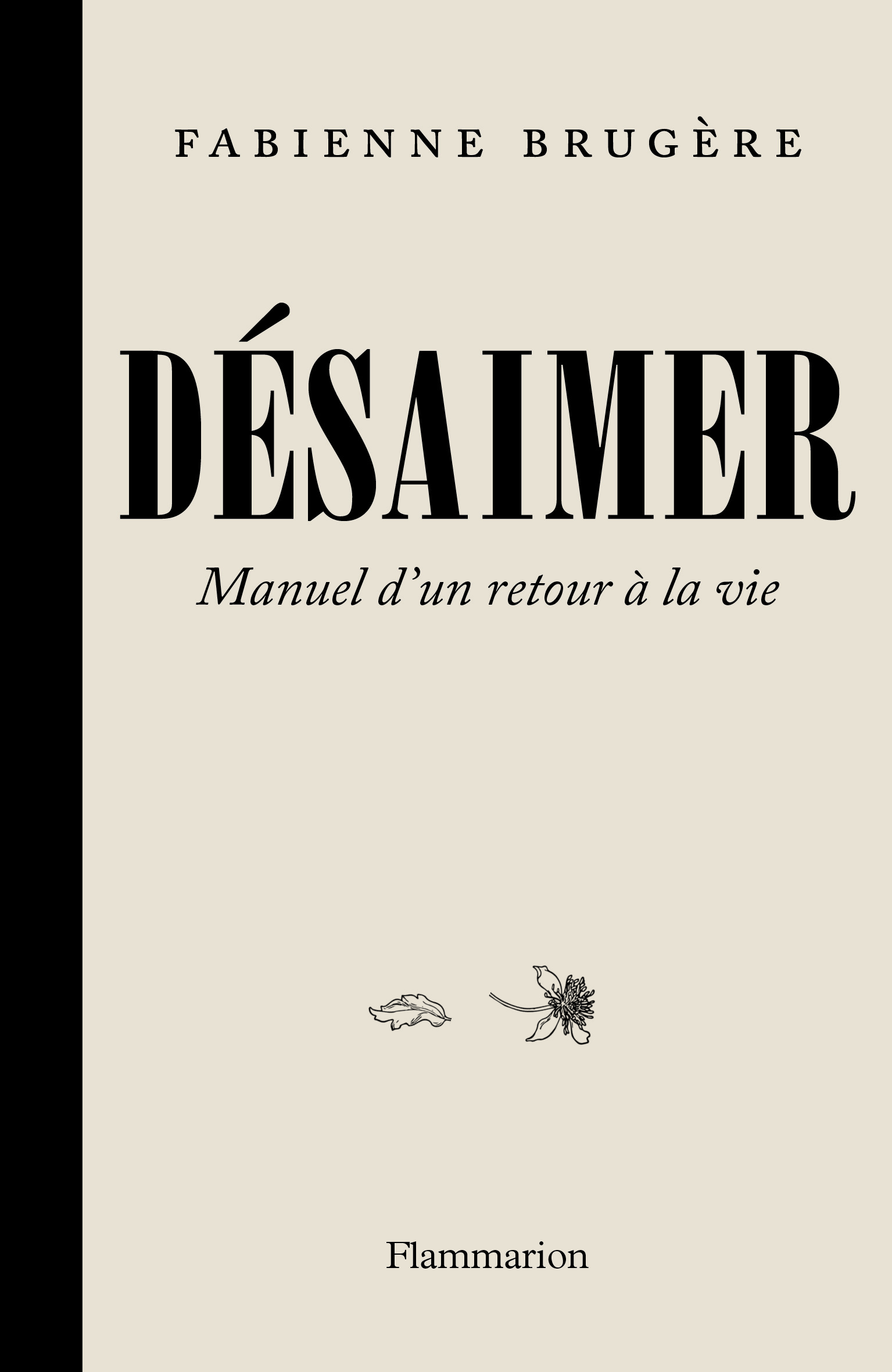
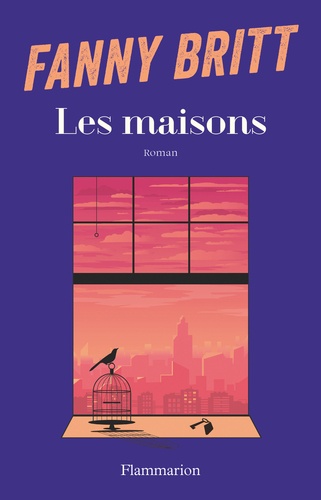
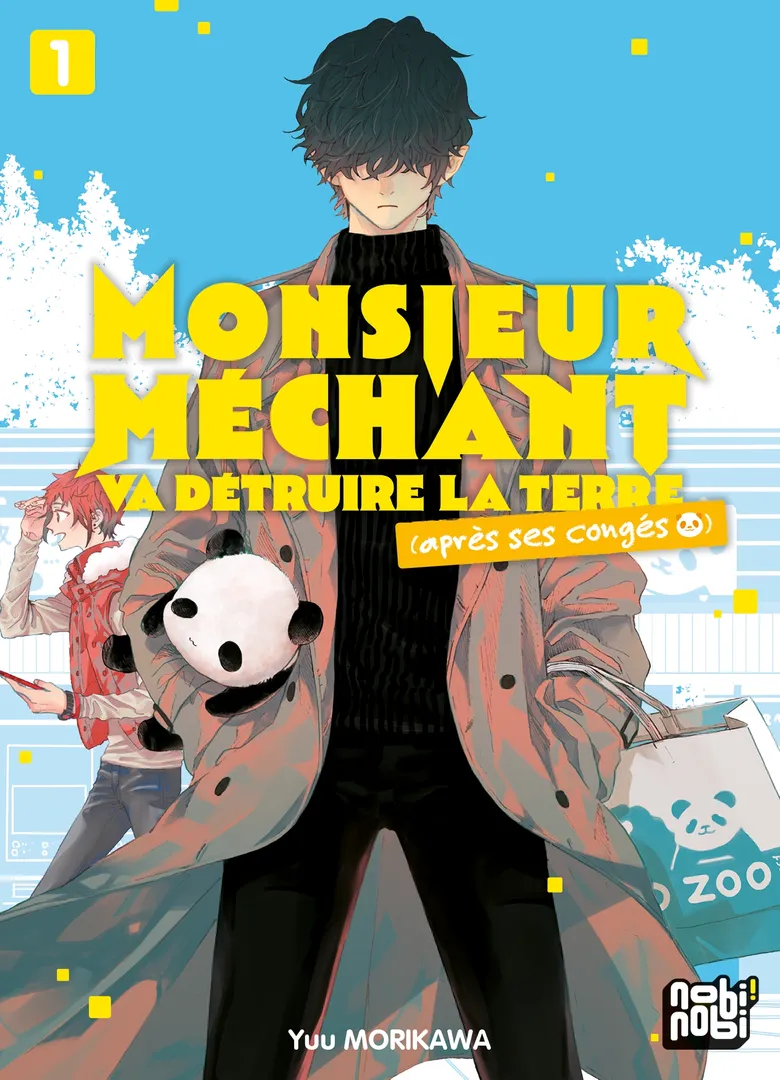

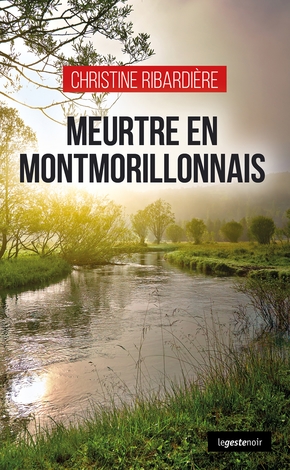
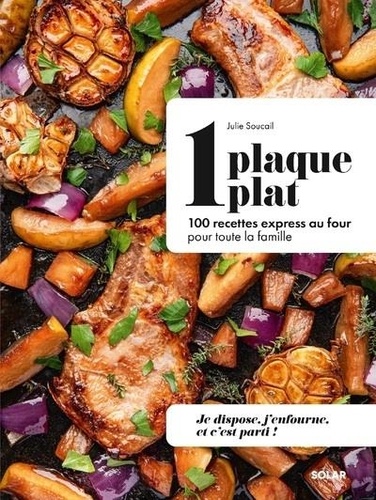
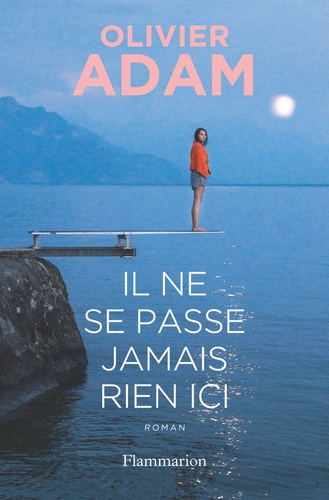
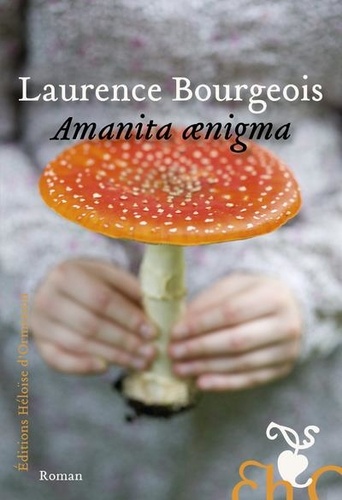

Commenter cet article