« Ouvrir la voix » avec la réalisatrice et afroféministe Amandine Gay
« Ne suis-je pas une femme ? » de bell hooks, classique de l’afroféminisme américain, vient d’être traduit pour la première fois en français dans la collection Sorcières (Ed. Cambourakis). Sa préfacière Amandine Gay sera, avec la traductrice Olga Potot et l’éditrice Isabelle Cambourakis, au Festival Vo-Vf, le monde en livres, le samedi 1er octobre, pour évoquer ce livre qui « écrit l’histoire des femmes noires jusque là systématiquement évacuées de l’Histoire ».
Le 20/09/2016 à 16:30 par Claire Darfeuille
Publié le :
20/09/2016 à 16:30
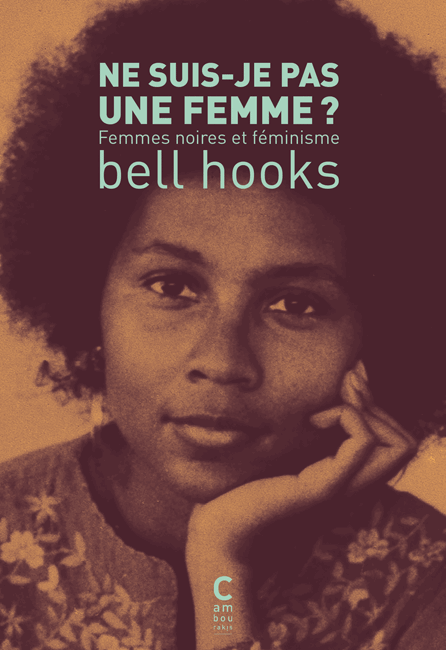
Ne suis-pas une femme ? de bell hooks (Cambourakis, 2016)
Amandine Gay, vous avez découvert « Ne suis-je pas une femme ? » de bell hooks à l’âge adulte. En quoi ce livre a-t-il été une révélation ?
Amandine Gay : Je l’ai lu à l’âge de 21 ans, en version anglaise, alors que je rédigeais mon mémoire de fin d’études à Science Po qui portait sur « Les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société française contemporaine ». J’étais entrée à Science Po en 2002 à 17 ans et j’étais bien entendu la seule Noire sur les deux cents élèves de ma promotion. A 15-16 ans, je connaissais des figures de la culture noire américaine telles que Angela Davis ou les Black Panthers, mais je n’avais jamais lu de textes dans la littérature que l’on nous proposait au collège et au lycée, auxquels je pouvais m’identifier. Avec le livre de bell hooks, j’ai pris conscience que je n’étais pas seule, que d’autres avaient vécu les mêmes situations, pensé les mêmes choses et qu’en plus les avais théorisées. Donc, cela a été une sorte de grande validation a posteriori. J’aurais préféré y avoir accès plus jeune, pour être prête au moment où sont survenues les premières agressions racistes. D’autant que je n’ai pas bénéficié de la transmission de l’Histoire de l’Afrique pré-coloniale qui peut s’opérer dans une famille noire ou dans un pays où la majorité est noire puisque j’ai été adoptée et élevée dans une famille blanche, dans la campagne lyonnaise.
Il y a selon vous une lacune dans l’enseignement en France de textes auxquels des adolescentes afro-descendantes pourraient s’identifier ?
Amandine Gay : Même dans la littérature jeunesse, il existe peu de personnages auxquels une jeune fille noire puisse s’identifier. Et l’Histoire de l’Afrique pré-coloniale n’est pas enseignée non plus. Rien de ce qui pourrait permettre de s’inscrire dans l’Histoire, de faciliter sa construction, de nourrir sa fierté de femme noire n’est proposé aux élèves. J’ai 32 ans à présent, peut-être les choses ont-elles évolué, mais pour ma part, c’est en étudiant l’afro-féminisme américain que j’ai découvert Maryse Condé, par exemple. Qu’il faille faire un détour par la culture américaine pour découvrir une grande auteure française, c’est un comble ! J’ai aussi beaucoup appris en m’engageant dans les mouvements féministes.
Pouvez-vous revenir sur la notion d’ intersectionnalité très présente dans le livre de bell hooks, encore peu connue en France ?
Amandine Gay : Il s’agit de prendre en considération le croisement de plusieurs dominations subies par les femmes noires qui se trouvent à l’intersection de différents types de discriminations : de race, de genre et de classe sociale. Le mot n’est pas formulé en tant que tel dans le livre de bell hooks, mais elle prend déjà en compte ces croisements. J’ai vraiment découvert le concept formulé par Kimberlé Crenshaw dans les milieux militants un peu plus radicaux après avoir quitté le mouvement Osez Le Féminisme, je cherchais alors un endroit où je n’aurais pas à choisir entre être femme, noire, queer…
Vous vous êtes donc d’abord engagée dans le mouvement « Osez le féminisme », puis vous vous en êtes écartée. Pour quelles raisons ?
Amandine Gay : Dès la première année, j’avais fait la réflexion à l’amie que j’accompagnais que c’était « super blanc ». Il y avait deux Noires, trois Arabes dans l’assemblée, mais la majorité était des femmes blanches, de la classe moyenne, un peu catho… Leur discours sur les lesbiennes, les travailleuses du sexe, les minorités en générale dénotait une incompréhension totale de ce qui sortait de leur univers et était surtout très éloigné des personnes concernées. Et puis, j’en avais assez de cette relation paternaliste ou maternaliste avec des personnes qui pensent savoir mieux que les premières concernées ce qui est bon pour leur émancipation. Ou bien, qui se focalisent sur des points secondaires, comme le mariage forcé ou l’excision qui concerne moins de 2 % des femmes noires en France* et font l’impasse sur les gros problèmes de la communauté noire française qui sont l’accès au travail, l’accès à des postes qualifiés après les études, l’accès au logement même quand on a le salaire et les papiers, etc. y compris pour des afro-descendants français depuis plusieurs générations. Toutes ces questions éminemment liées au racisme systémique de la société française.

Amandine Gay © Enrico Bartolucci
Ce sont des questions qu’ abordent les jeunes Afropéennes à qui vous donnez la parole dans votre film « Ouvrir la voix » dont la sortie en salle est prévue début décembre ?
Amandine Gay : Oui, j’ai suivi deux lignes. Je voulais d’une part montrer à quel point nous, Afro-descendantes, étions des personnalités diverses. On dit « les Noir-e-s », comme s’il s’agissait d’un groupe homogène ! Les 24 filles du film, afro-descendantes françaises ou belges, ont toutes des parcours et des profils très différents, mais la seconde ligne est ce que nous avons commun : notre expérience d’être minoritaire dans le milieu occidental blanc. On a ainsi toutes eu des difficultés, quel que soit notre milieu social d’origine, à faire accepter nos orientations scolaires. Pour la méthode, j’ai élaboré un questionnaire basé sur ma propre expérience auquel répondent les jeunes femmes interviewées et le mouvement du film se déploie du moment où l’on découvre que l’on est Noire jusqu’au jour où on décide ou non de quitter la France.
Vous avez fait le choix de votre côté de partir au Canada. Pourquoi ?
Amandine Gay : Pour des raisons d’abord économiques et professionnelles. Je veux faire des films et de la recherche. Dans un milieu français qui refuse de parler de la question raciale, c’est compliqué. Par exemple, comment travailler sur l’adoption transraciale, mon actuel sujet de recherche, si je ne peux utiliser le concept de race. Le mot race compris au sens de construction sociale et non comme appartenance à une ethnie. Ce qui m’intéresse est de savoir par quel processus de racisation on est mis dans telle catégorie sociale et ce qui est rattaché à cette catégorie sociale. Et j’ai besoin du concept de race pour l’étudier. Par exemple, on utilise l’expression « contrôle au faciès », mais on ne contrôle pas les faces de tout le monde, on contrôle les Noirs et les Arabes, donc l’expression adéquate est « profilage racial », c’est celle utilisée dans le monde anglo-saxon, « racial profiling ». Il faut donc ramener la question raciale au centre du sujet, car il s’agit de racisme. Beaucoup de termes ne sont pas traduits littéralement, « Affirmative action » par exemple pourrait-être traduit littéralement par « Actions affirmatives ». Pourquoi le traduire par « discrimination positive » ? Ces choix de traduction sont des choix politiques.
Maîtriser la langue anglaise a-t-elle été une source d’émancipation pour vous ?
Amandine Gay : Complètement. C’est parce que je lisais l’anglais que j’ai pu avoir accès à tout un pan de la réflexion développée aux États-Unis non disponible en français. C’est un énorme privilège. Plus jeune, j’étais déjà intéressée par la culture afro-américaine, je regardais les films de Spike Lee, je traduisais les paroles des chansons de Nas qui sont truffées de références culturelles, et d’autres groupes de hip-hop. Ce mouvement, le hip-hop, parce qu’il est une école d’interrogation politique du monde majoritaire, a changé ma vie.
Table ronde « Traduire le black feminism » avec Isabelle Cambourakis, Amandine Gay et Olgo Potot, le samedi 1er octobre de 12h à 13h au festival Vo-Vf, le monde en livres à Gif-sur-Yvette (réservations gratuites, ouvertes sur le site).
* 53 000 femmes adultes excisées résidant en France, selon l'Ined, sur une population évaluées, en l'absence de statistiques ethniques, à 3 à 5 millions de Noir-e-s.















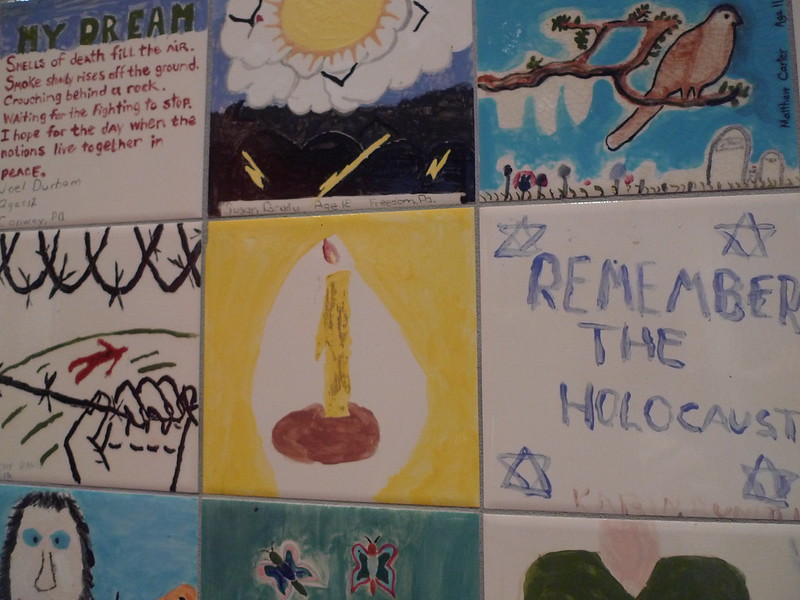


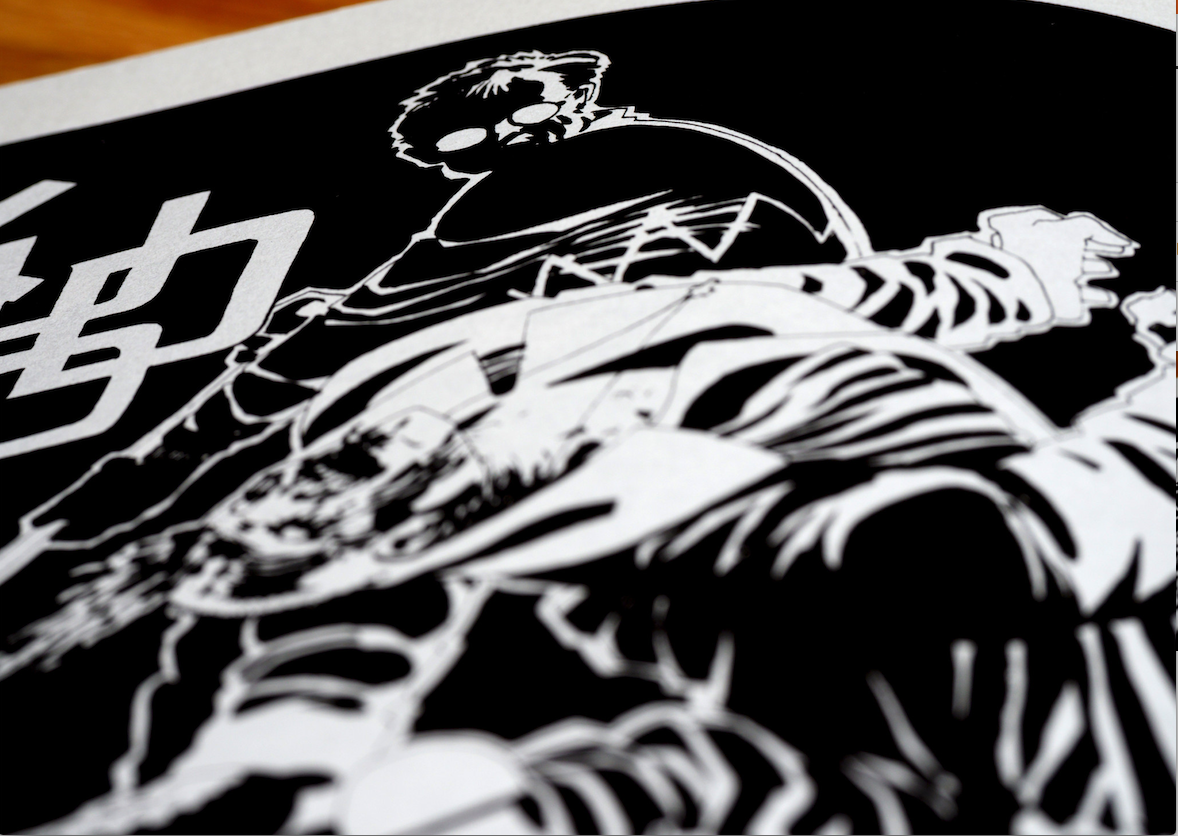

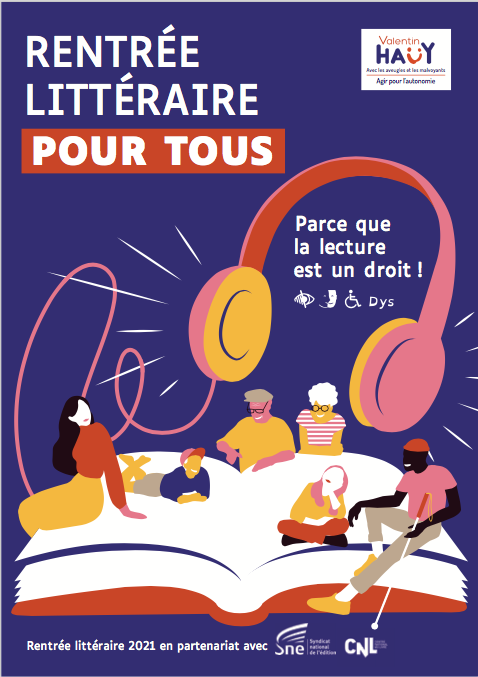

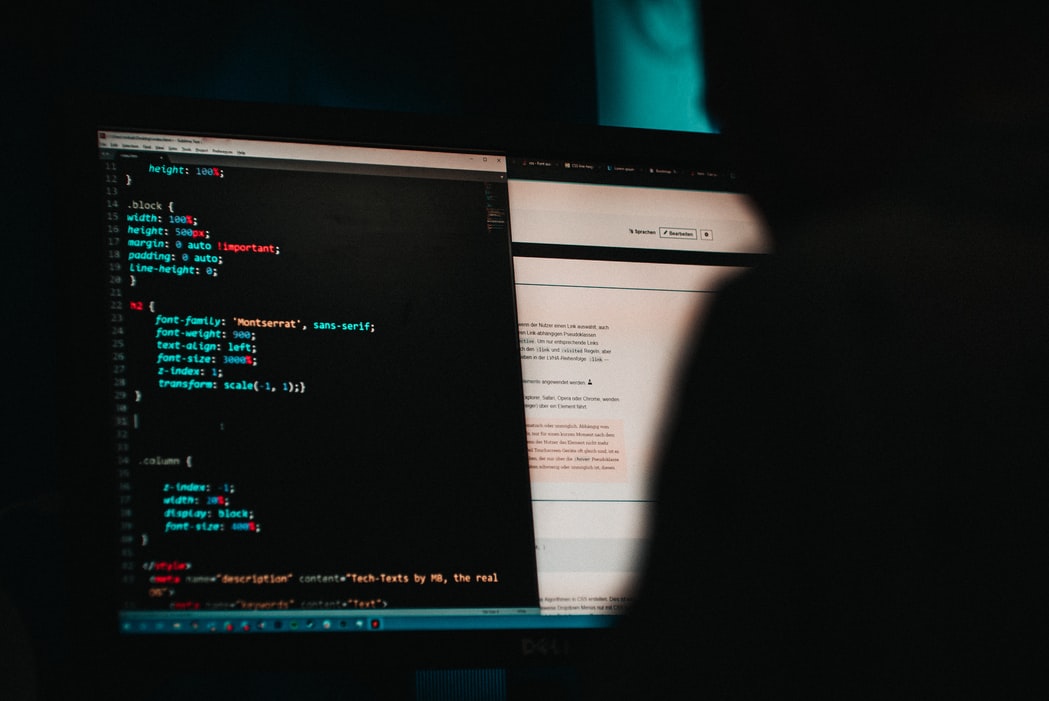
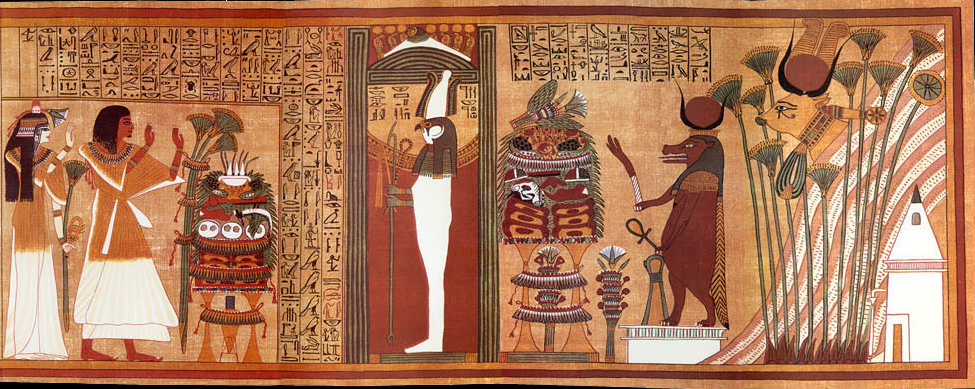
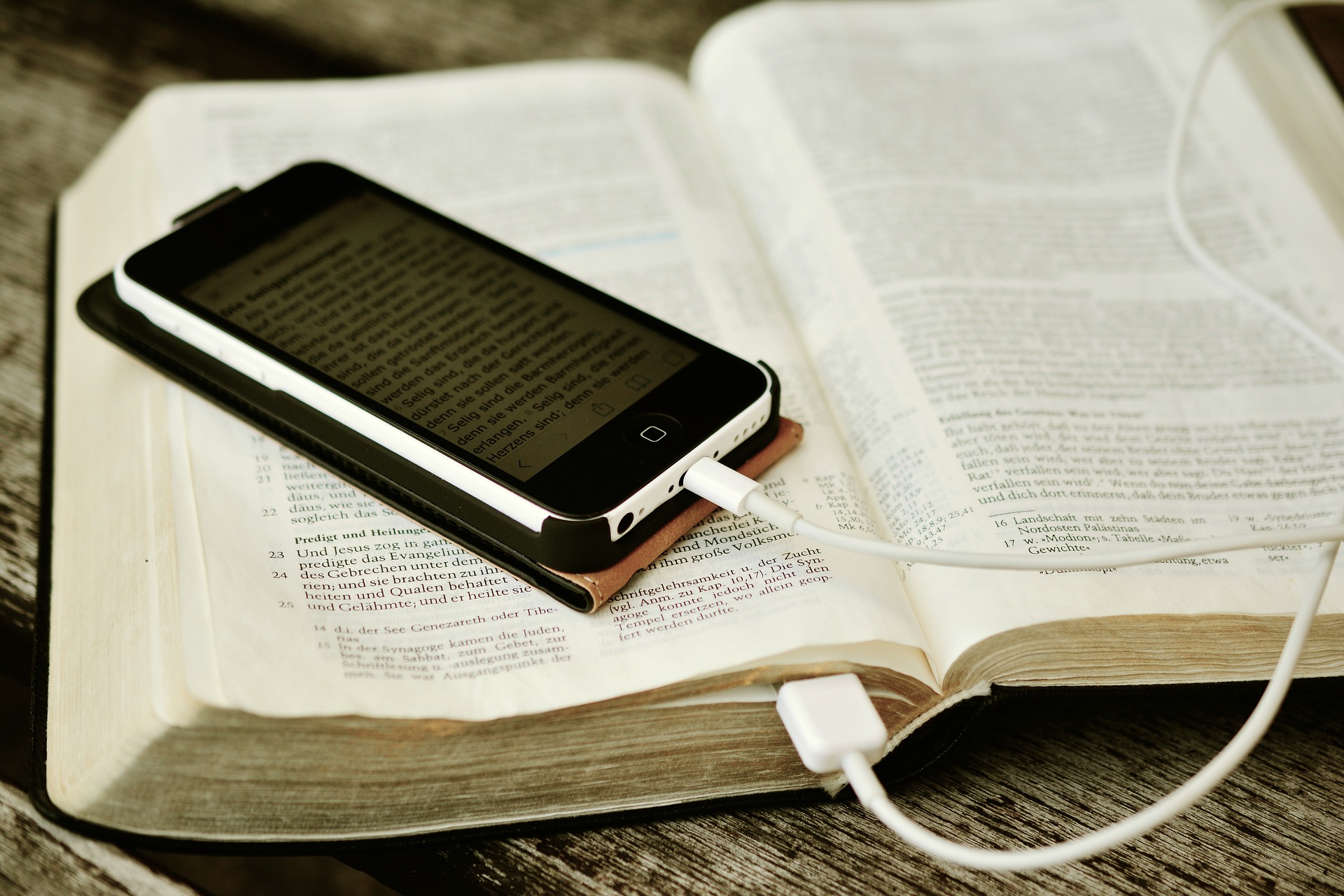

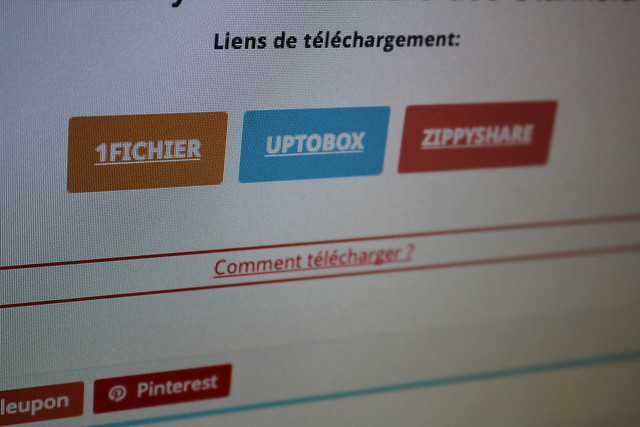



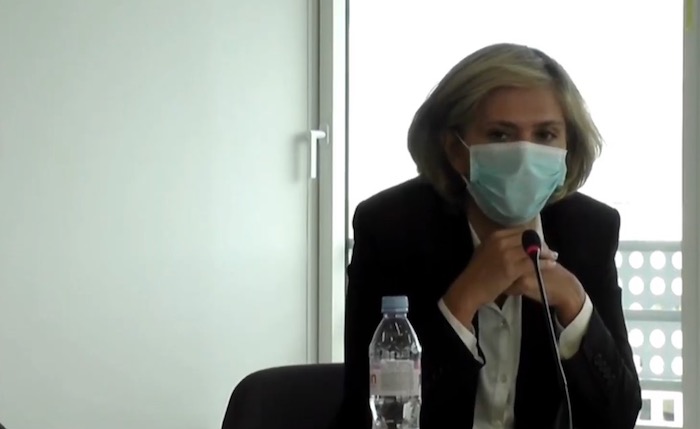
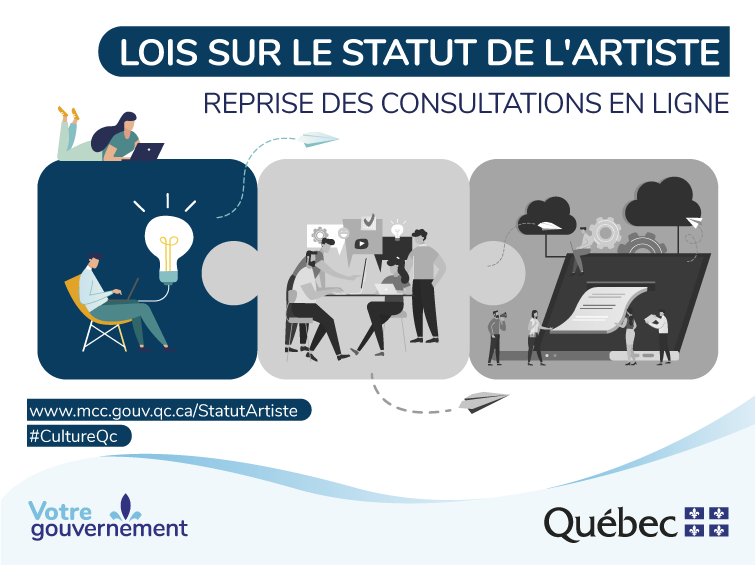

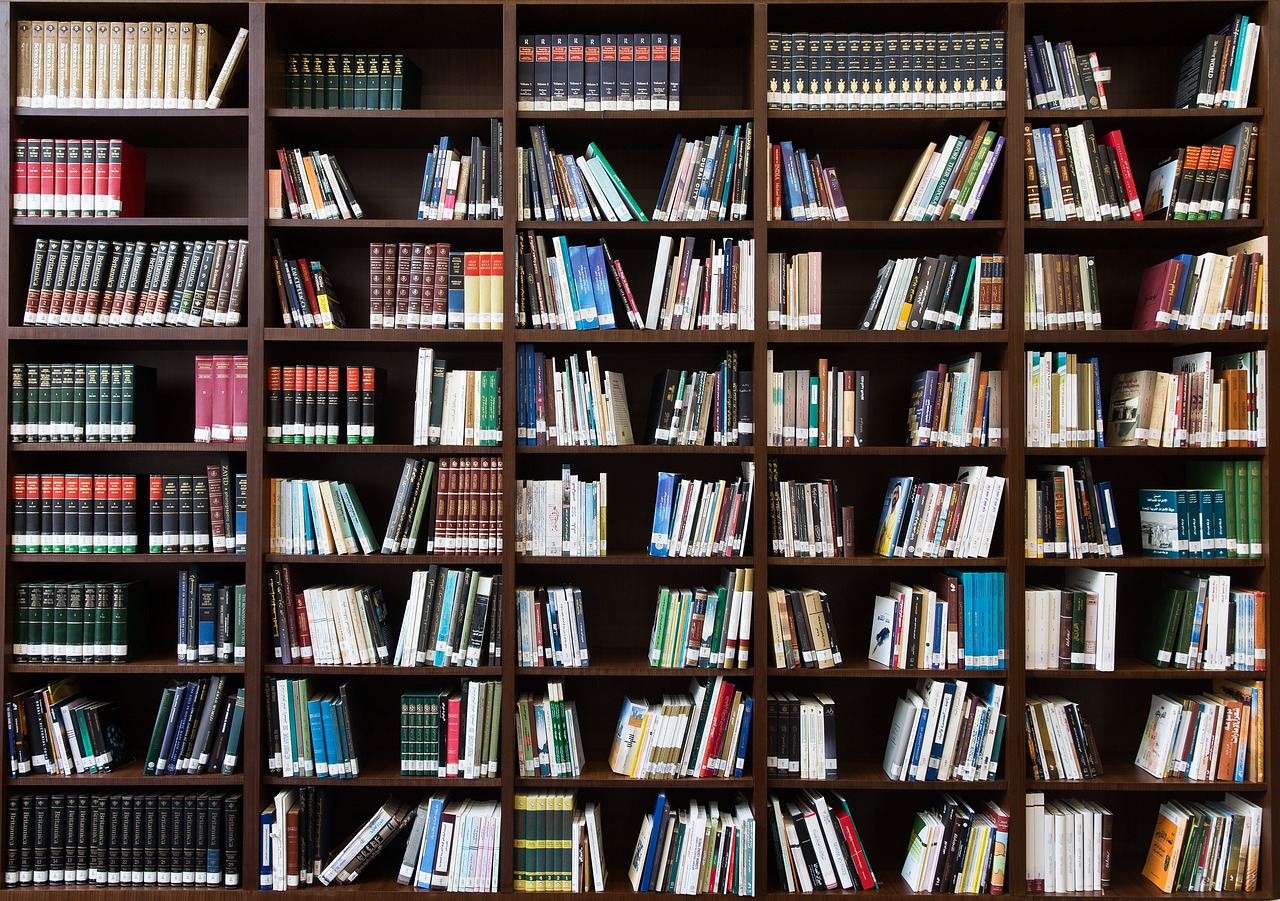



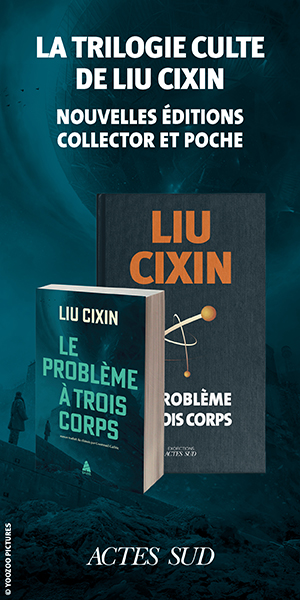

Commenter cet article