Les Ensablés - Notes de voyage de L. Jouannaud: "L’Epervier de Maheux" (1972), de Jean Carrière (1928-2005)
Ce roman fit l’heur et le malheur de son auteur. Il lui apporta le Prix Goncourt, mais après la fortune et la gloire, vinrent la dépression, les drames personnels et la stérilité littéraire : « Le prix Goncourt est un gâteau couvert de mouches et bourré de fèves sur lesquelles on se casse les dents. » [1] Le succès fut exceptionnel : deux millions d’exemplaires vendus en France, une quinzaine de traductions.
Le 26/02/2017 à 09:00 par Les ensablés
1 Réactions | 1 Partages
Publié le :
26/02/2017 à 09:00
1
Commentaires
1
Partages
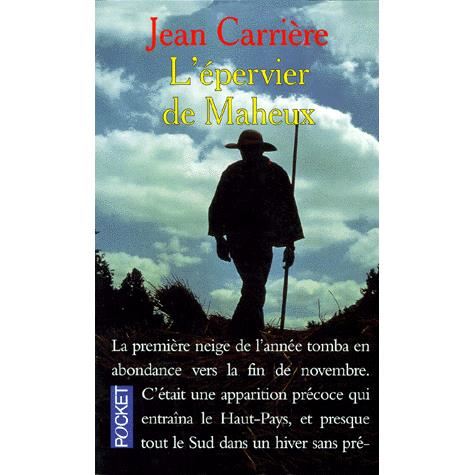
Par Laurent Jouannaud
L’auteur raconte la vie d’une famille qui survit puis s’éteint dans les Cévennes, dans le Haut-Pays, un pays « brutal ». C’est un roman très noir. Les Reilhan vivent à Maheux, un lieu-dit, en bordure de forêt. La nature y est impitoyable : il n’y a presque que deux saisons, l’été trop sec et l’hiver trop froid. Carrière décrit longuement le ciel, les forêts, la neige, la montagne : et en effet, tout dépend des conditions climatiques plus ou moins clémentes, plus ou moins propices à l’homme. Ils ont un champ de blé, des chèvres et coupent du bois. Ils vendent des champignons, des fromages, du gibier. On se nourrit principalement de châtaignes. Le père, le Taciturne, né en 1895, a réussi à se marier de justesse. Sa femme, dont le père était alcoolique et les frères mineurs de fond, a cru échapper à la misère en épousant ce montagnard. Elle déchantera, mais tiendra le coup. Elle aura deux fils, Abel en 1922 et Joseph-Samuel en 1931.
Après la guerre, la famille subit un premier revers grave en 1948 quand Joseph-Samuel se casse une jambe, cet hiver qui fut si froid, « les flammes auxquelles on tendait les mains semblaient purement décoratives ». Désormais, pour le même nombre de bouches à nourrir, il y a deux bras en moins. Pour sa convalescence, l’infirme a besoin de se refaire une santé : les économies y passent. Il est alors décidé que Joseph quittera la montagne, vivra à Florac chez le pasteur qui a besoin d’ « un secrétaire ou quelque chose dans ce genre ». Il ne rentrera qu’en fin de semaine, ensuite très rarement.
Et puis le père meurt : il avait encore les quelques notions de religion qui permettent d’expliquer le monde. Dieu quitte la maison avec lui. Il meurt en paix, dans la nature, dans son champ de blé de la Grand-Terre, usé sans doute mais en accord avec le décor, si on peut dire : « Comme toute cette agitation pour vivre ou survivre comptait pour peu de chose ! La preuve : il n’en restait presque rien. » On découvrira son corps au bout de trois jours. Cette belle mort et l’enterrement du cadavre décomposé permettent à Jean Carrière de mettre dans la bouche du docteur Stéphan, le médecin du canton, celui qui accouche, soigne et délivre le permis d’inhumer sans se faire payer par les pauvres, une longue méditation philosophique sur l’ « irréelle réalité » de l’existence humaine, c’est-à-dire que rien ne sert à rien.
A partir de ce de moment-là, Abel est le héros de l’histoire. Il réussit à se marier avec Marie Despuech, la Noiraude, qui risquait bien de rester vieille fille. Elle quitte Mazel-de-Mort, le dernier village avant Maheux, pour monter vivre chez Abel et sa mère. Cette nouvelle famille ne prendra pas : la Noiraude met au monde un enfant qui meurt aussitôt. La mère décline vite, elle perd la boule, elle pourrait mettre le feu, il faut l’enfermer au grenier : « ni folle, ni saine, entre deux eaux, dans ce mélange hideux de la vérité et du délire. Trente ans d’attente déçue, de souffrance, d’espérances détruites. » Et la nature vient donner le coup de grâce au couple, la nature qui ne se donne pas pour rien, à laquelle il faut tout arracher : la source tarit pendant un été féroce qui a vidé les citernes. Abel décide alors de chercher l’eau au cœur de la roche. Il achète de la poudre et creuse une galerie dans le flanc de la montagne qui doit bien garder sa sève quelque part. C’est un travail de titan : creuser, piocher, sortir les gravats, étayer. Trois mètres, cinq mètres, trente mètres, cinquante mètres. La Noiraude le regarde faire : « Lui ne pensait plus qu’à sa galerie, sacrifiait tout à cette tâche démente, et elle, lui obéissait, entrait dans son jeu avec cette passivité sinistre qu’on destine aux fous et que leurs lubies et leur cruauté imposent. »
Pourtant, à une dizaine de kilomètres plus bas, il y a de l’eau au village de Saint-Flavien. Abel descend en chercher avec une citerne qu’il remonte avant la grande chaleur du jour. Lui et sa femme pourraient s’installer chez le père de la Noiraude : il y a de l’eau, une bonne terre, de la place. Mais Abel refuse de descendre. La civilisation n’est pas loin. D’ailleurs, Julien, le jeune frère, a choisi de descendre. De la petite ville des Cévennes, il est même parti en Suisse et travaille dans une librairie protestante sur la recommandation du pasteur : il y vit heureux comme on est heureux dans les villes. Il suffirait de descendre de quelques kilomètres pour vivre mieux, là où vivent le facteur, le pasteur, le médecin. Abel refuse : il préfère se battre contre la montagne. Sa femme finira par redescendre chez son père : « Tu te crèves, tu te crèves, pendant ce temps les autres s’enrichissent, on donne des primes à droite et à gauche, et nous restons là, à attendre que le ciel nous verse sa corne d’abondance. Des fois je me demande si tu n’es pas fou. » Et lui mourra enseveli dans sa galerie, accident ou suicide, peu importe : « Ecrasé comme une noix dans Sa main ; vaincu parce qu’il faut que tout le monde soit vaincu et que Sa volonté soit faite. » La majuscule ne renvoie plus exactement à Dieu, mais au mystère de l’existence, au destin, à la vie, à l’absurde.
Ces personnages ont existé, dit l’auteur, le roman se veut réaliste. Abel Reilhan est mort en 1954, apprend-on à la dernière page. En 1972, quand paraît le roman, on peut penser que ce fait divers appartient au passé et que ce récit est dépassé grâce au progrès, à la civilisation, à l’état-providence. Comme l’écrit l’auteur dans une courte préface, ces cas extrêmes sont des exceptions. Mais le succès formidable du roman et sa force toujours actuelle montrent que Jean Carrière a raconté une histoire éternelle. D’abord, cette effrayante vie de misère malgré un incessant labeur est encore celle des hommes du Tiers-Monde : on y vit sans eau courante, sans électricité, sans éducation, la faim au ventre dès l’enfance et pour toujours. Et même ici, la misère existe, cachée, honteuse, supportable sans doute, mais toujours ignoble. L’auteur semble par moments exiger la qualité de vie pour tous au nom de l’humanité, mais son roman n’est pas un hymne à la civilisation moderne et au progrès technique. Le bonheur de Julien est bien plus terne que le malheur de son frère aîné. Voici ce que lui-même en dit : « Vivre vieux, quelle importance ? Mais au moins vivre autrement que je ne vis, en ayant combattu au niveau de la vie, et pas comme moi, cloué à vendre des livres dans une boutique d’arrière-province, et à respirer, tous les soirs surtout l’été l’odeur de la défaite, d’une sorte d’indélébile trahison. » C’est ce que le médecin athée a appelé « l’enfer de la paix. »
L’auteur demande cette qualité de vie pour tous, c’est une question sociale, mais il donne à penser que ça ne suffit pas à justifier une existence, c’est une question métaphysique. Il aurait suffi à Abel Reilhan de descendre de quelques kilomètres, de s’installer chez son beau-père. Il a refusé de quitter sa terre et ses coutumes, ce que son frère a accepté de faire. Bref, c’est un sédentaire, pas un nomade, il est « de la vieille race des hommes-arbres ». Mais c’est aussi un solitaire : son beau-père lui a tendu la main, il l’a refusée. Que peut donc un homme seul ? Rien. Il aurait fallu descendre avec les autres, au début du siècle. Abel, avec sa vieille pétoire qui n’a que soixante mètres de portée, tire en vain sur l’épervier qui tourne autour de Maheux, au lieu d’emprunter le fusil de son beau-père.
Rester ou partir ? Partir, est-ce trahir ? Trahir pour survivre, est-ce vraiment une trahison ? Vaut-il mieux suivre une illusion jusqu’au bout ou renoncer aux illusions ? Qui est le plus fort, qui faut-il admirer, celui qui croit à l’impossible ou celui qui accepte la réalité ? Car accepter la réalité, c’est rester fidèle à l’essence matérielle, « minérale », de l’homme. Jean Carrière hésite. Nous aussi. On ne dira pas qu’il aime ses personnages qui vivent par moments moins noblement que des bêtes, mais il les respecte, il ne condamne personne. Telle est la bête humaine, esclave de l’univers et supérieure à lui puisqu’elle est consciente de son esclavage, « roseau pensant », comme l’a dit Pascal.
« J’ai payé cher la gloire d’un instant. » [2] Instant glorieux que ce 21 novembre 1972, vers une heure de l’après-midi, quand on lui attribue le Goncourt : « Le succès s’abattait sur moi comme un rapace ». Ensuite, Jean Carrière a connu l’insomnie, l’angoisse, le harcèlement médiatique, la tentation du suicide, l’alcool, les médicaments. Au centre de sa difficulté à vivre, il y a l’impossibilité d’écrire. Comment faire aussi bien que L’Epervier ? Comment ne pas refaire L’Epervier ? Comment ne pas décevoir son public et ses pairs ? Comment être à la hauteur des ses modèles (Giono, Gracq, Faulkner) ? « Le découragement me prit : je n’aurais jamais assez de talent pour faire oublier la gloire imméritée que m’avait obtenue la chance plus que le mérite. J’étais décidé à ne plus mettre les pieds à Paris, à me terrer dans mon trou, à me taire tant que je n’estimerais pas disposer de moyens qui fussent à la hauteur de mes ambitions. » [3] Il aurait peut-être suffi de dire à Jean Carrière que bien des auteurs, des grands, des classiques, n’ont écrit qu’un seul grand livre, qu’un seul chef d’œuvre. Un grand livre, c’est déjà beaucoup en une vie.
Laurent Jouannaud - Février 2017


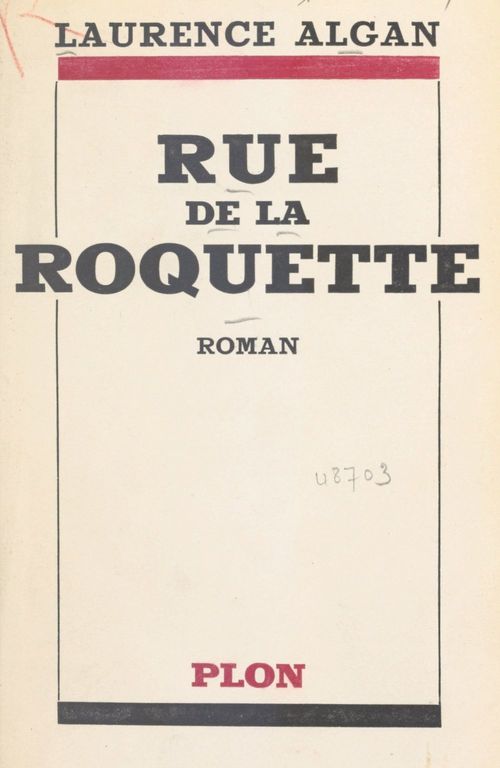
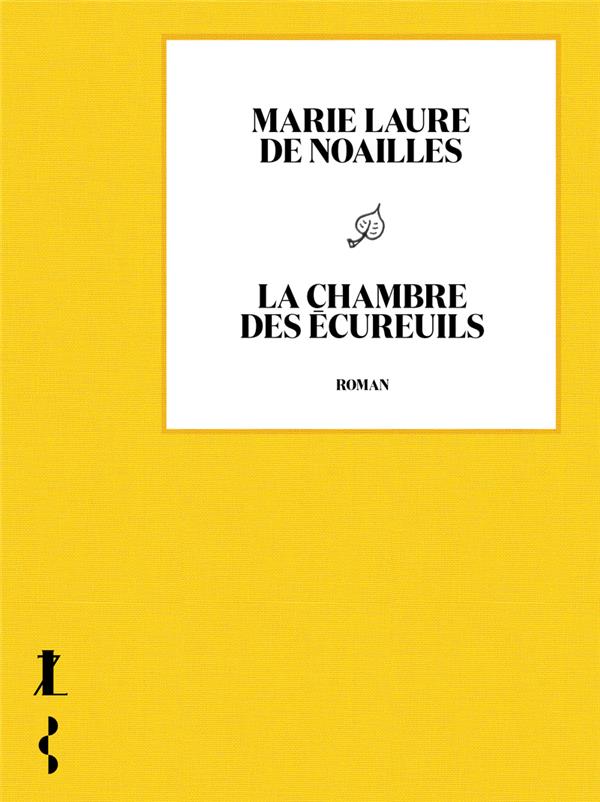
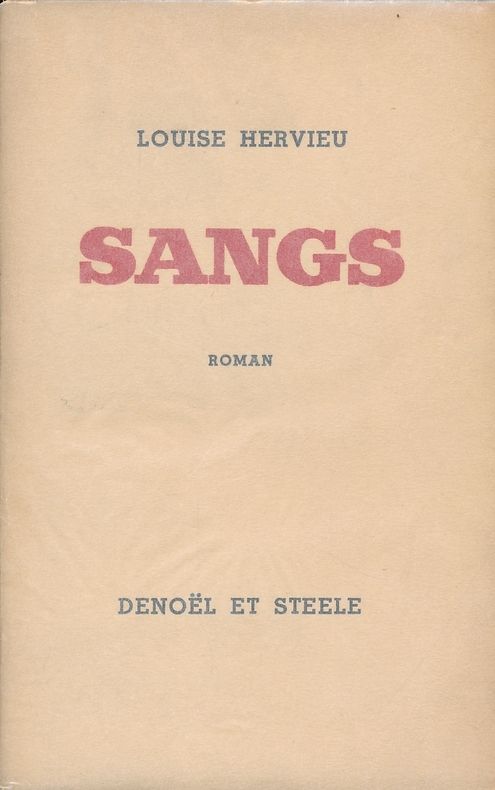
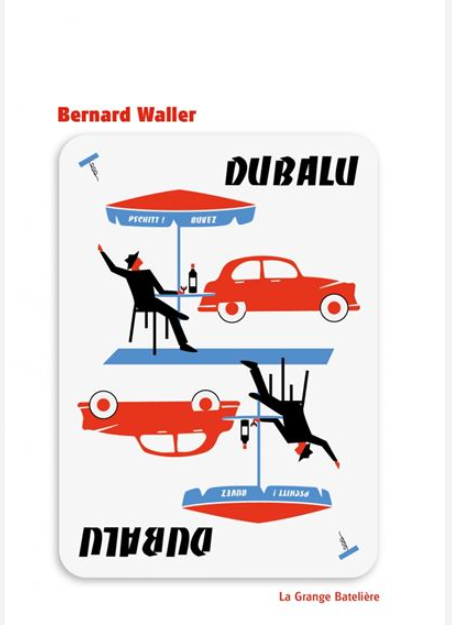
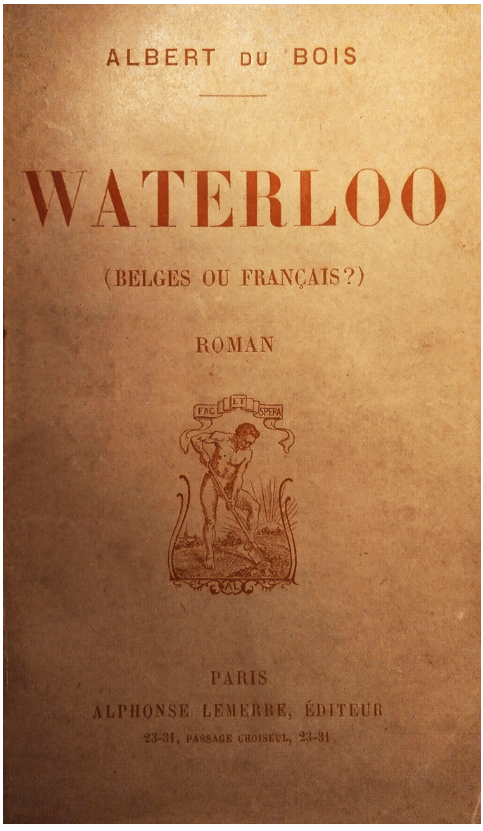

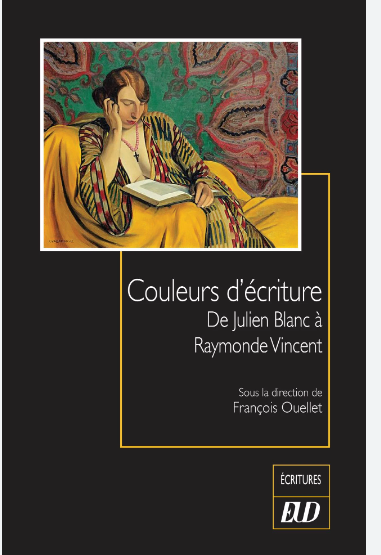
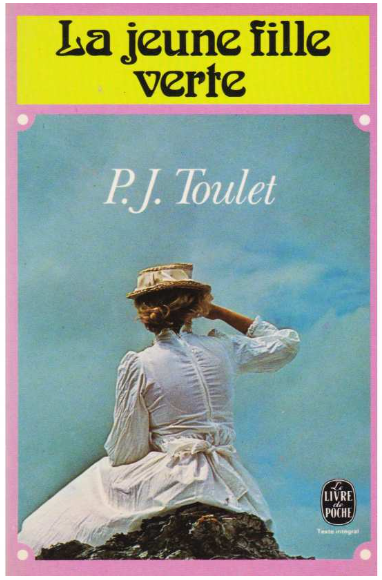
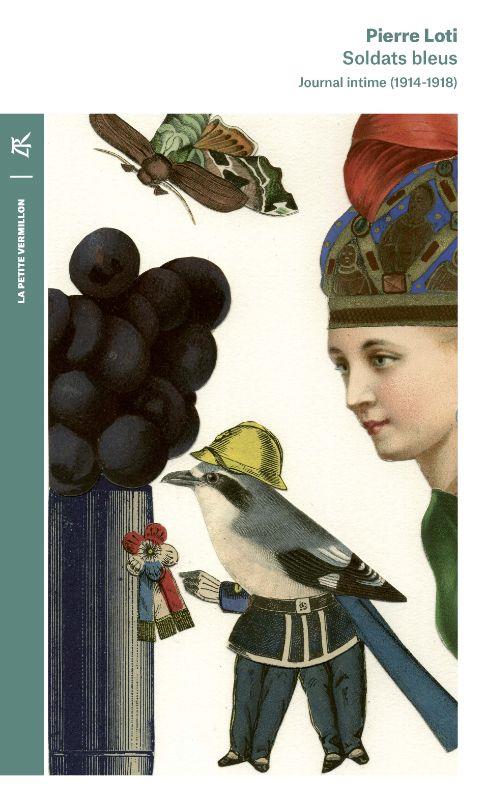
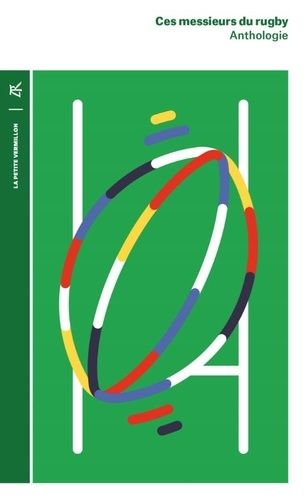
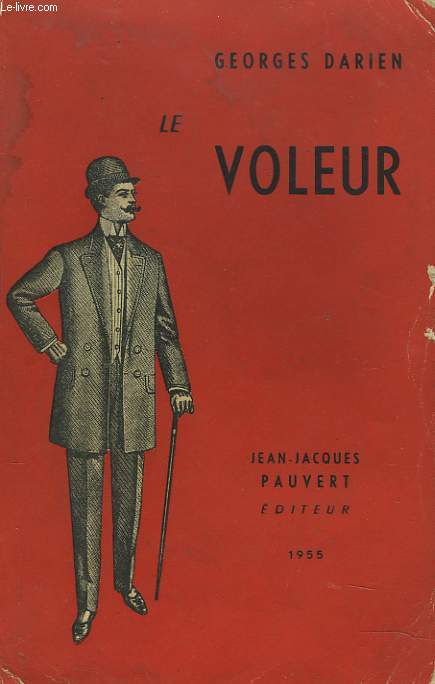
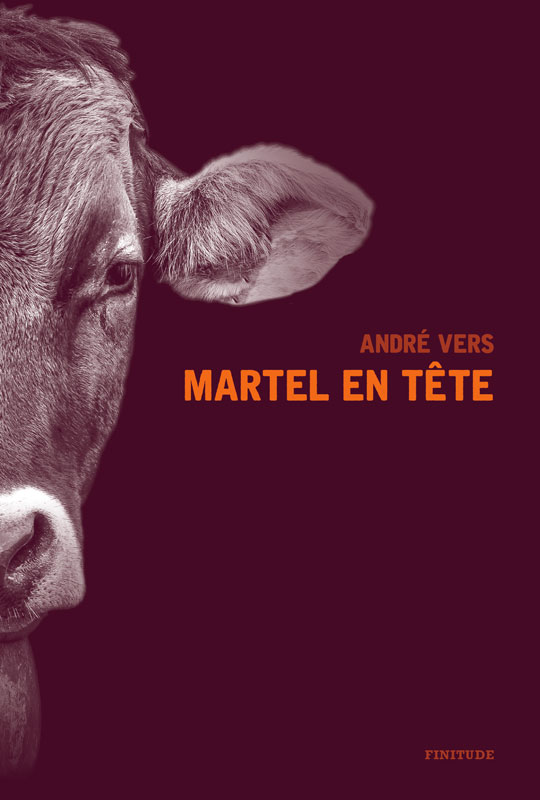

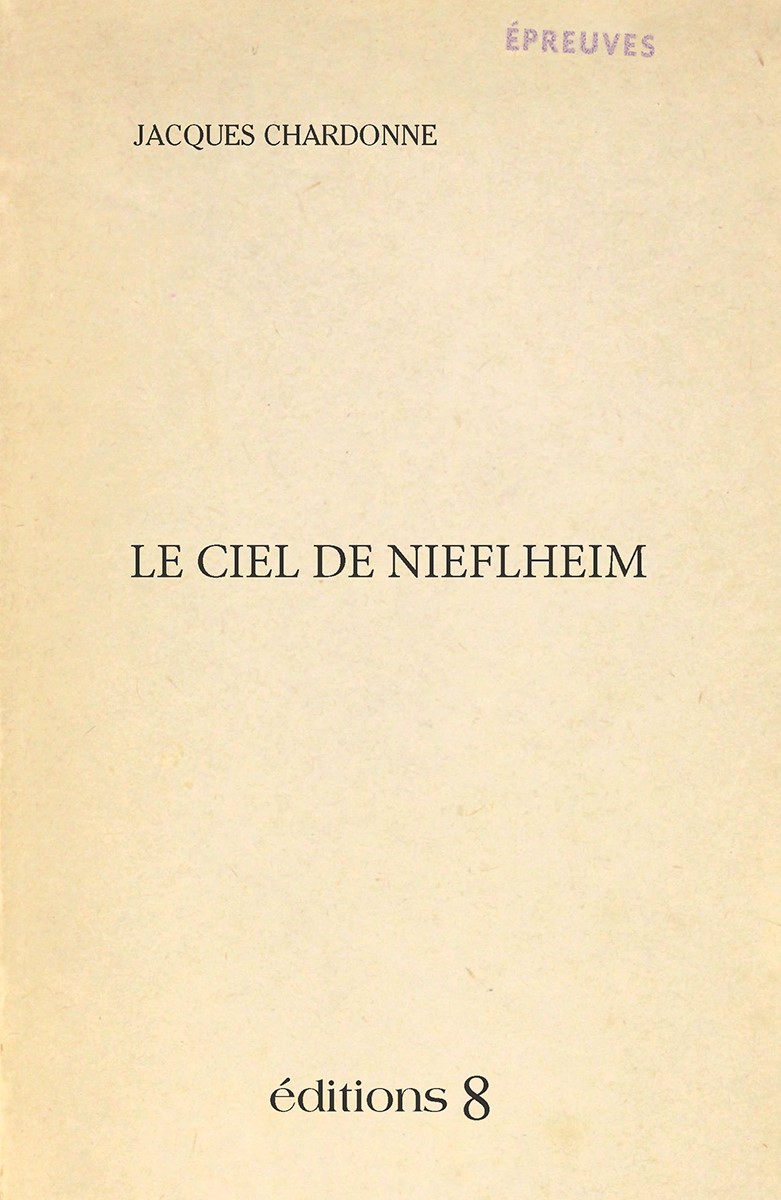
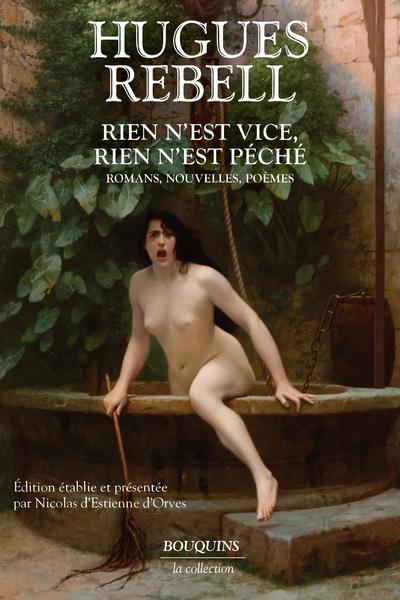
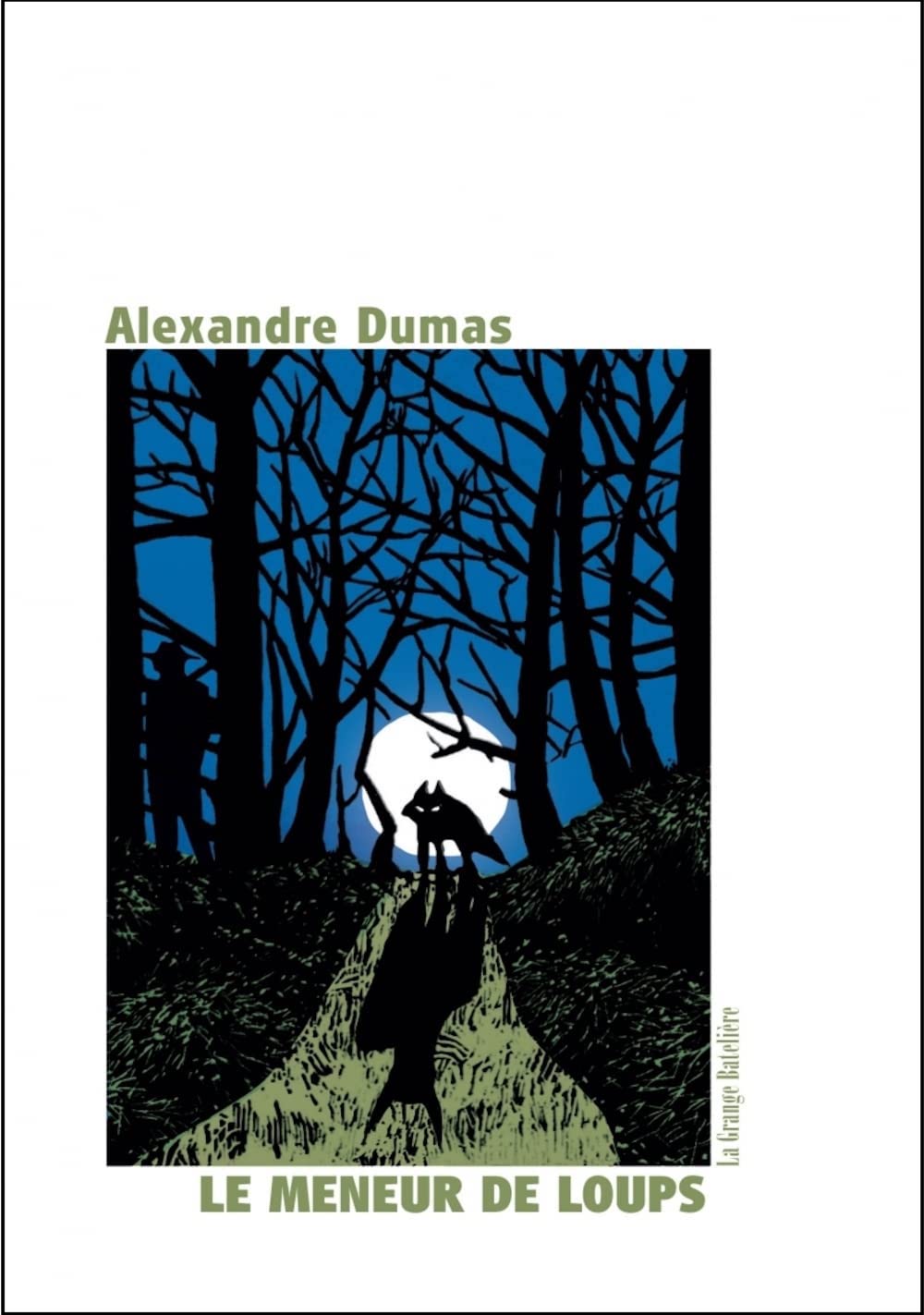

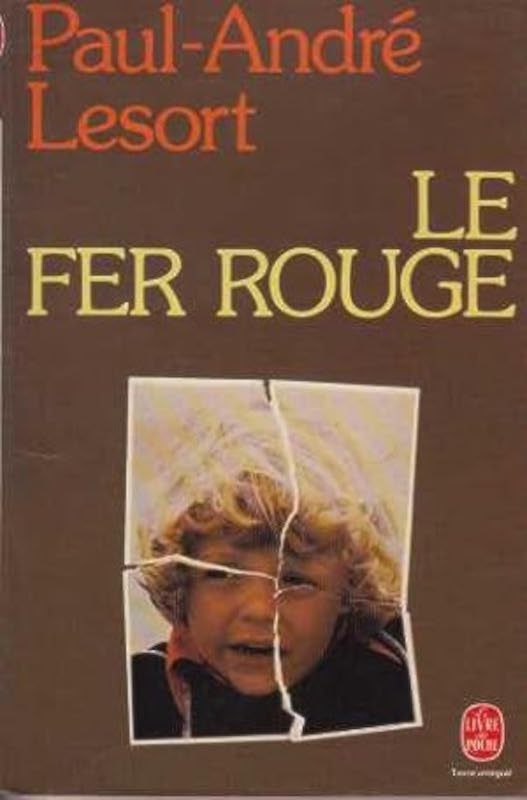


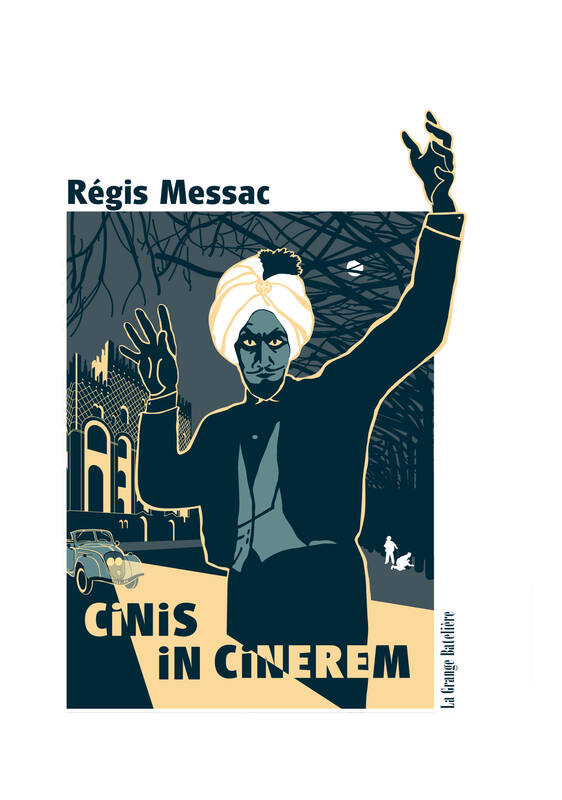

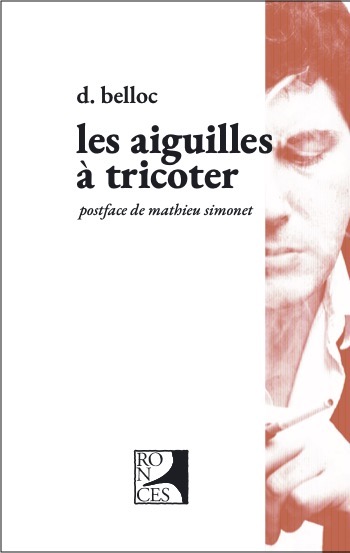
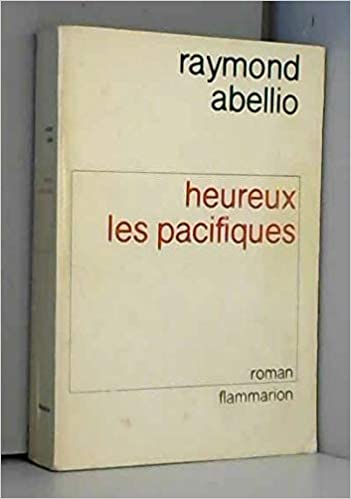
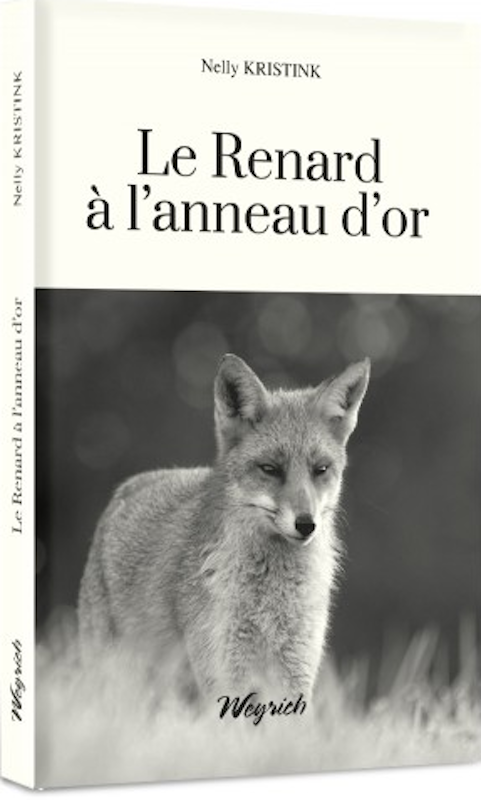
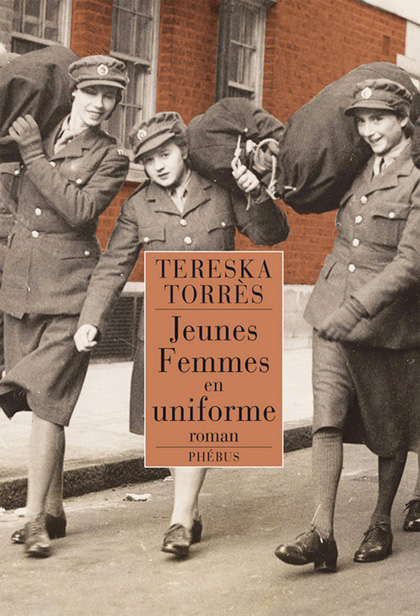
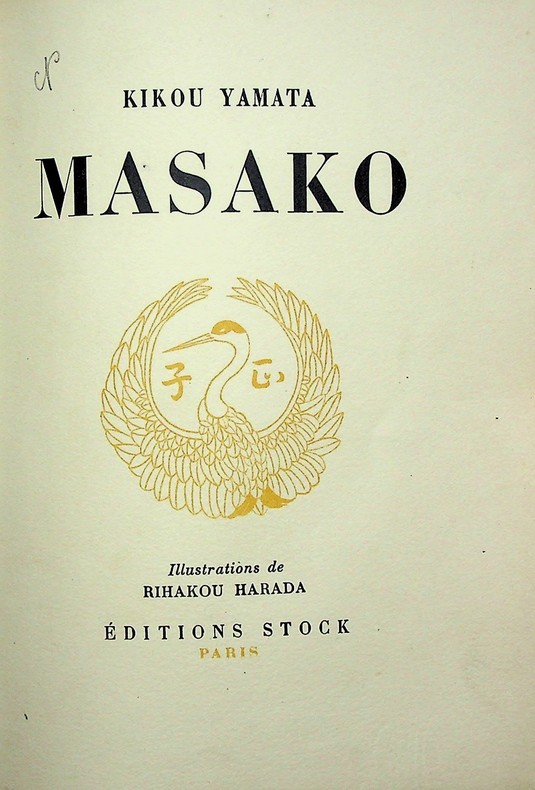
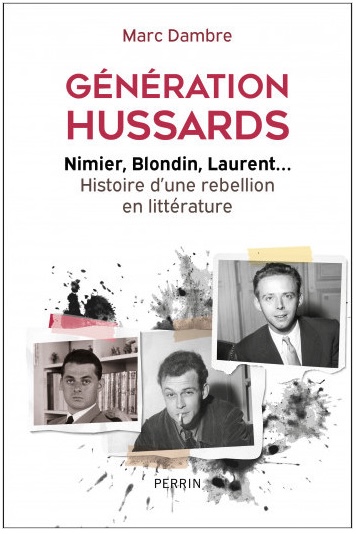
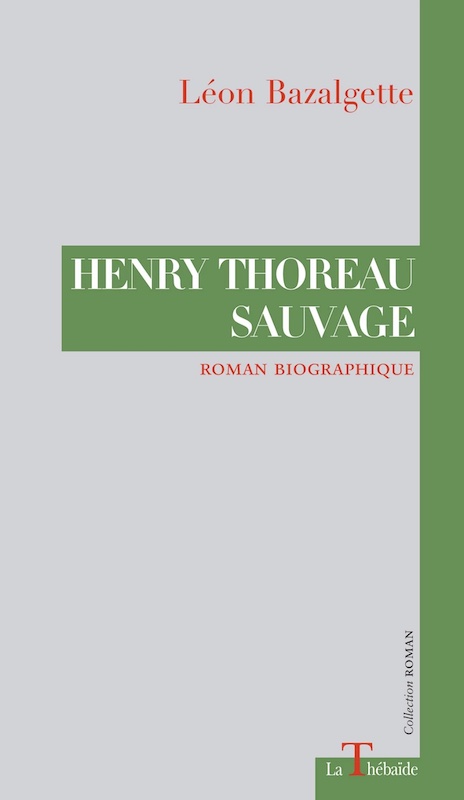

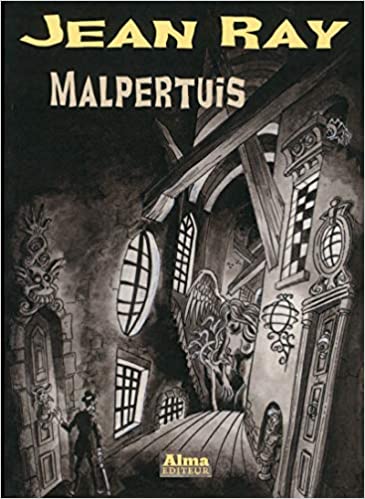
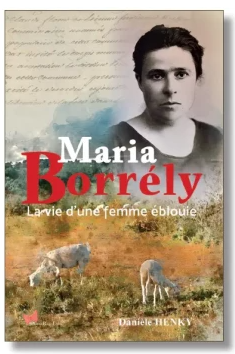
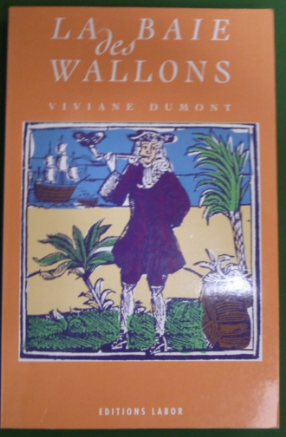

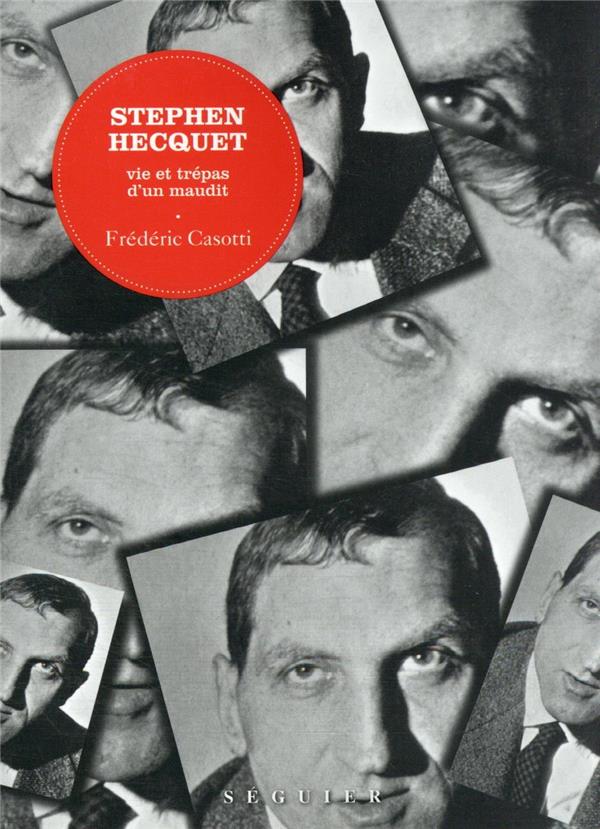




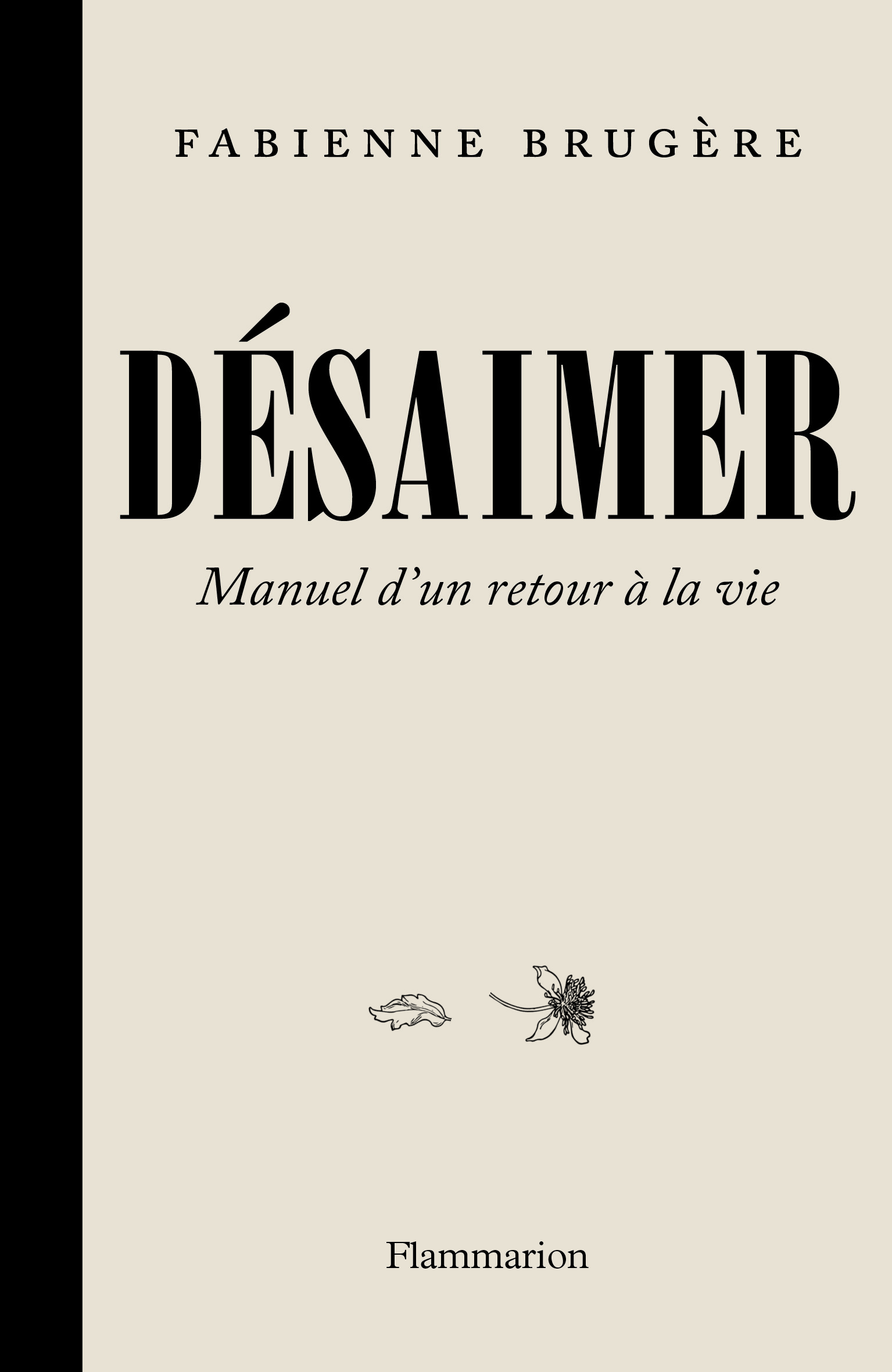
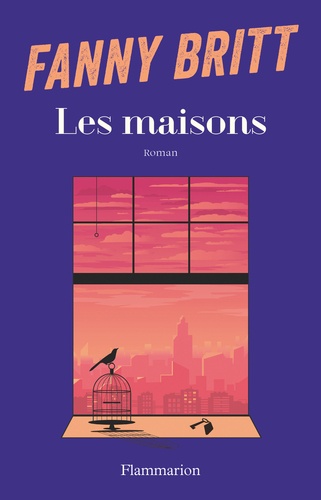



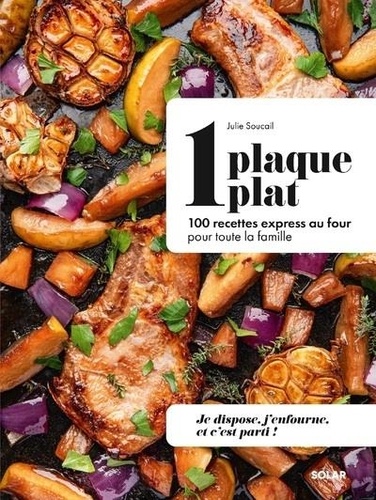
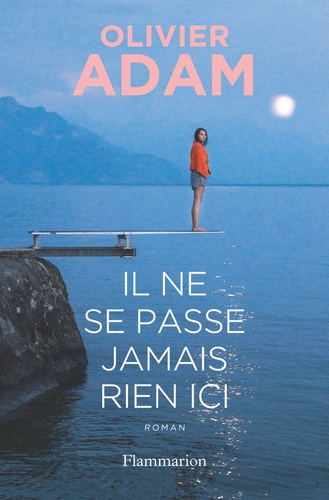
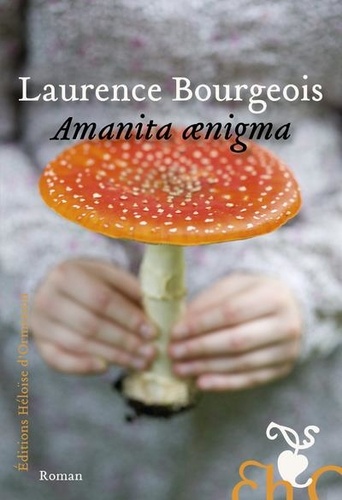



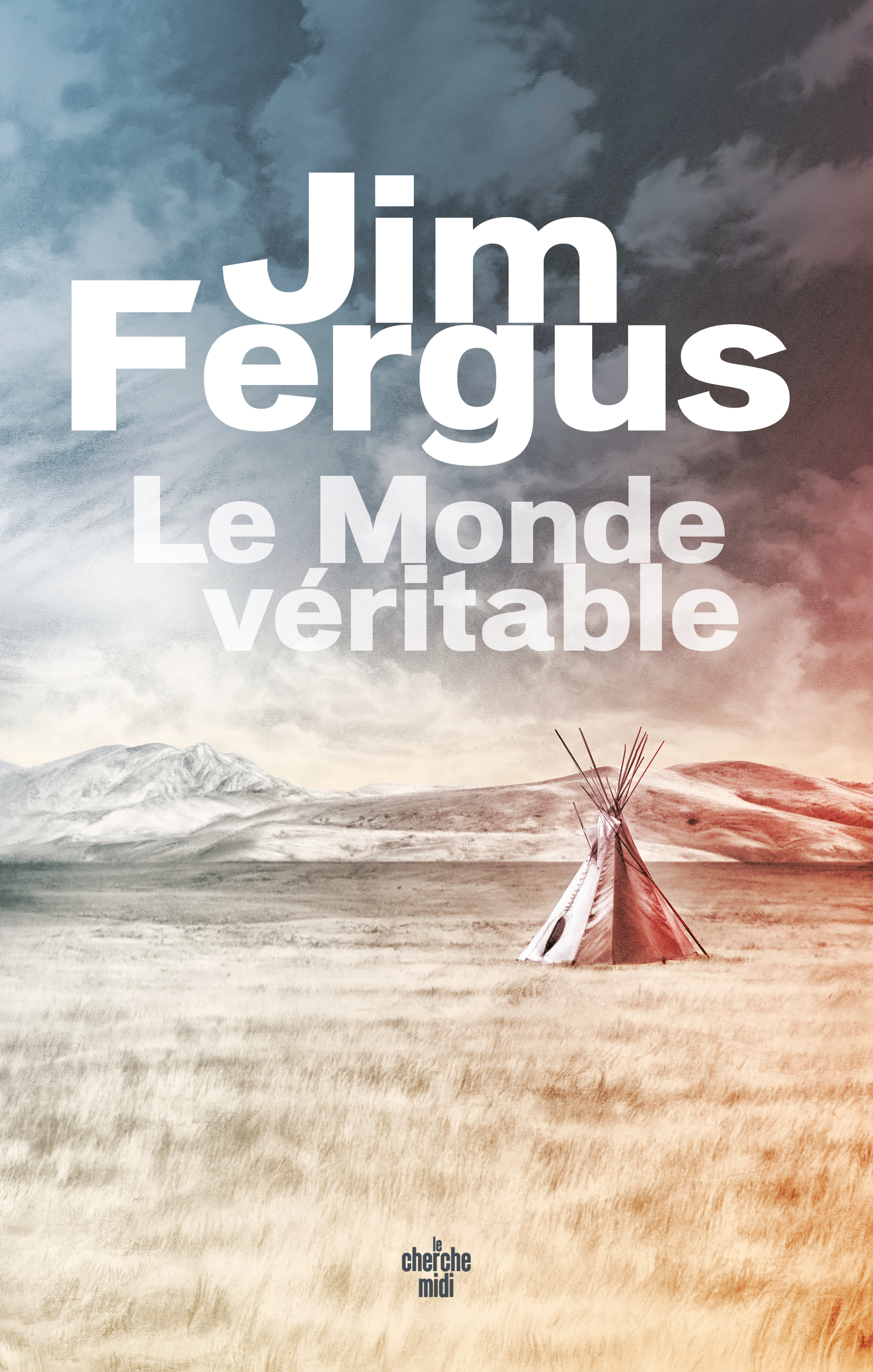

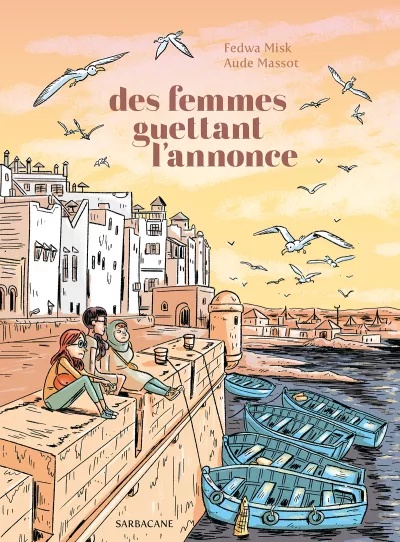

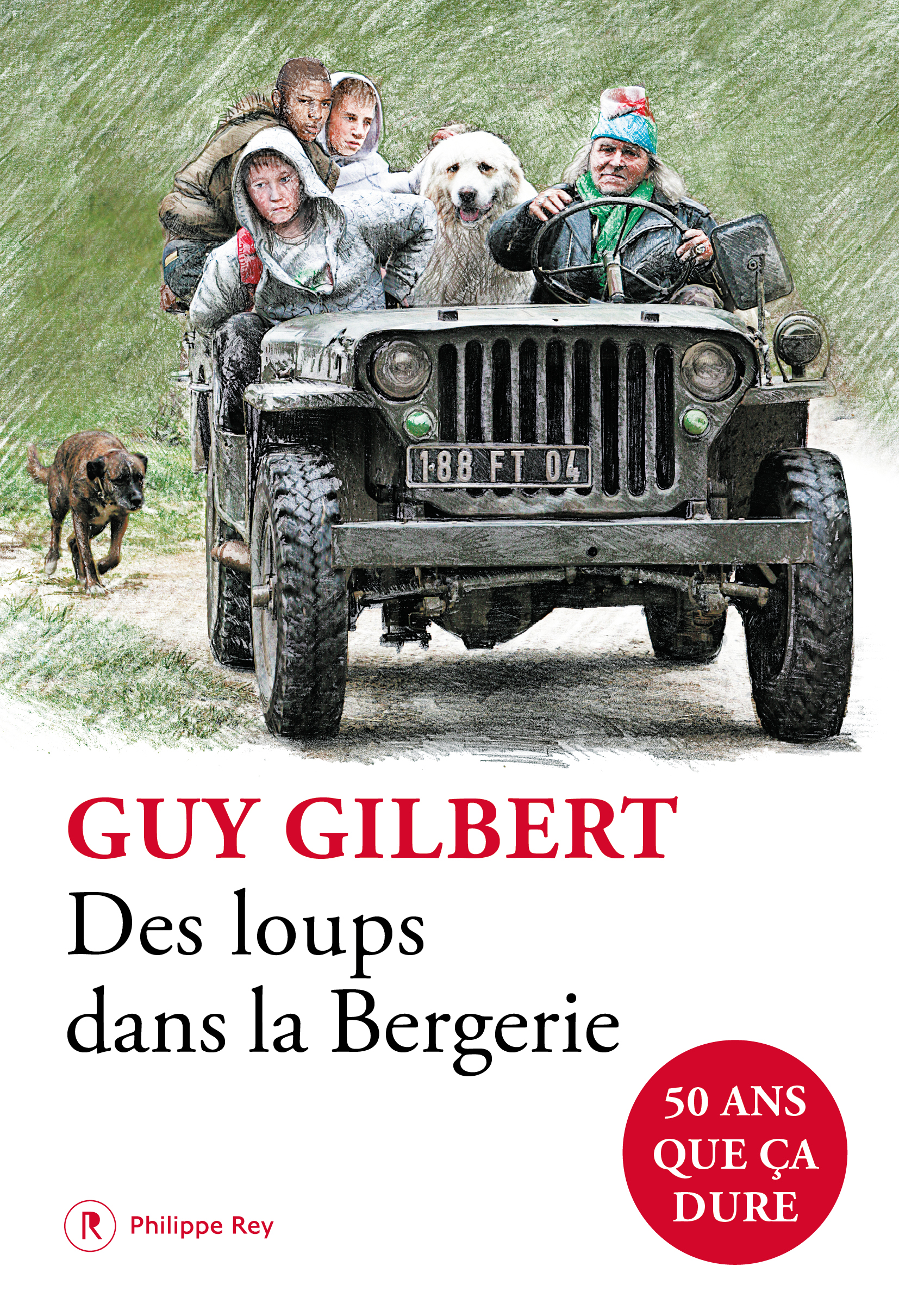
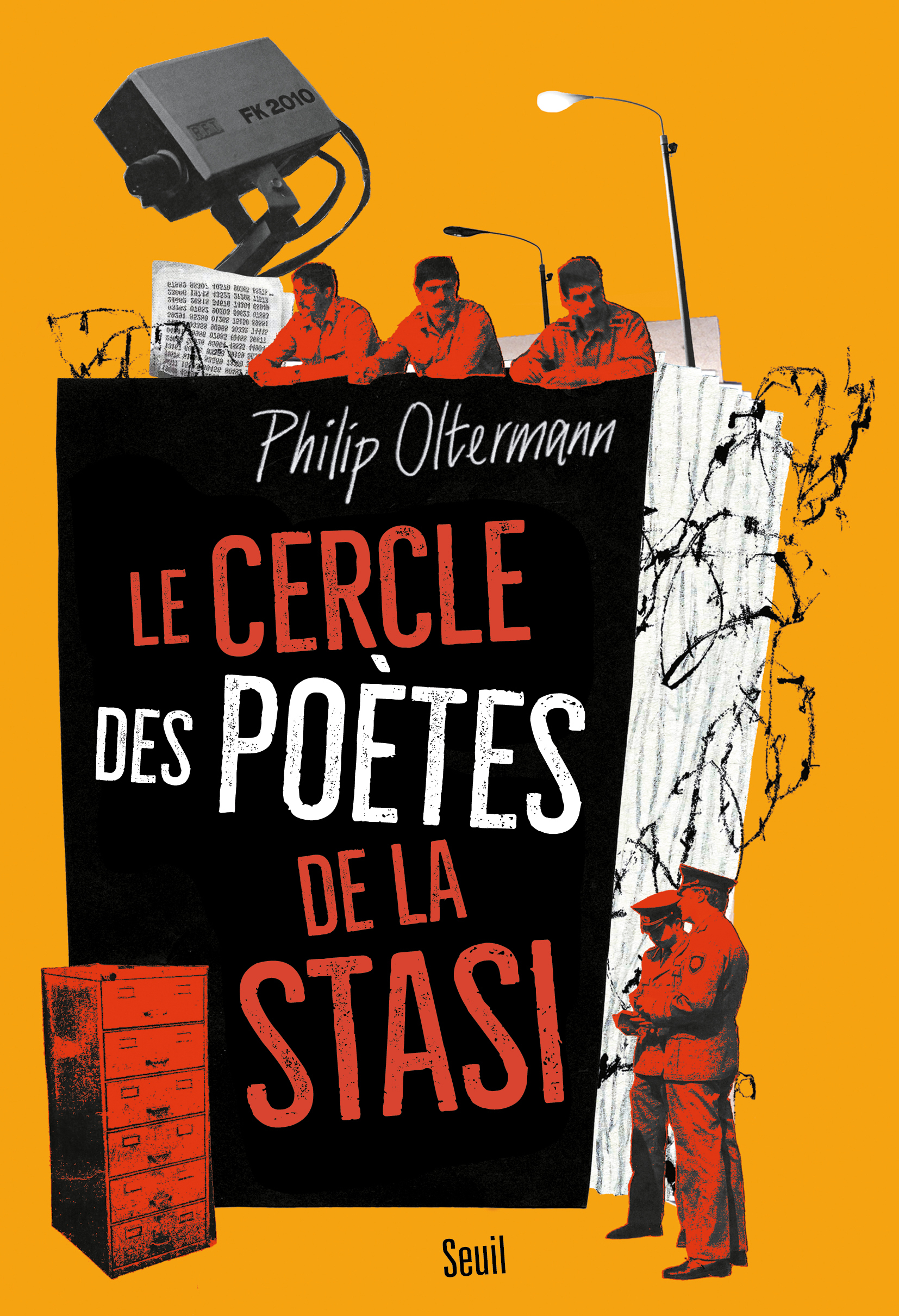
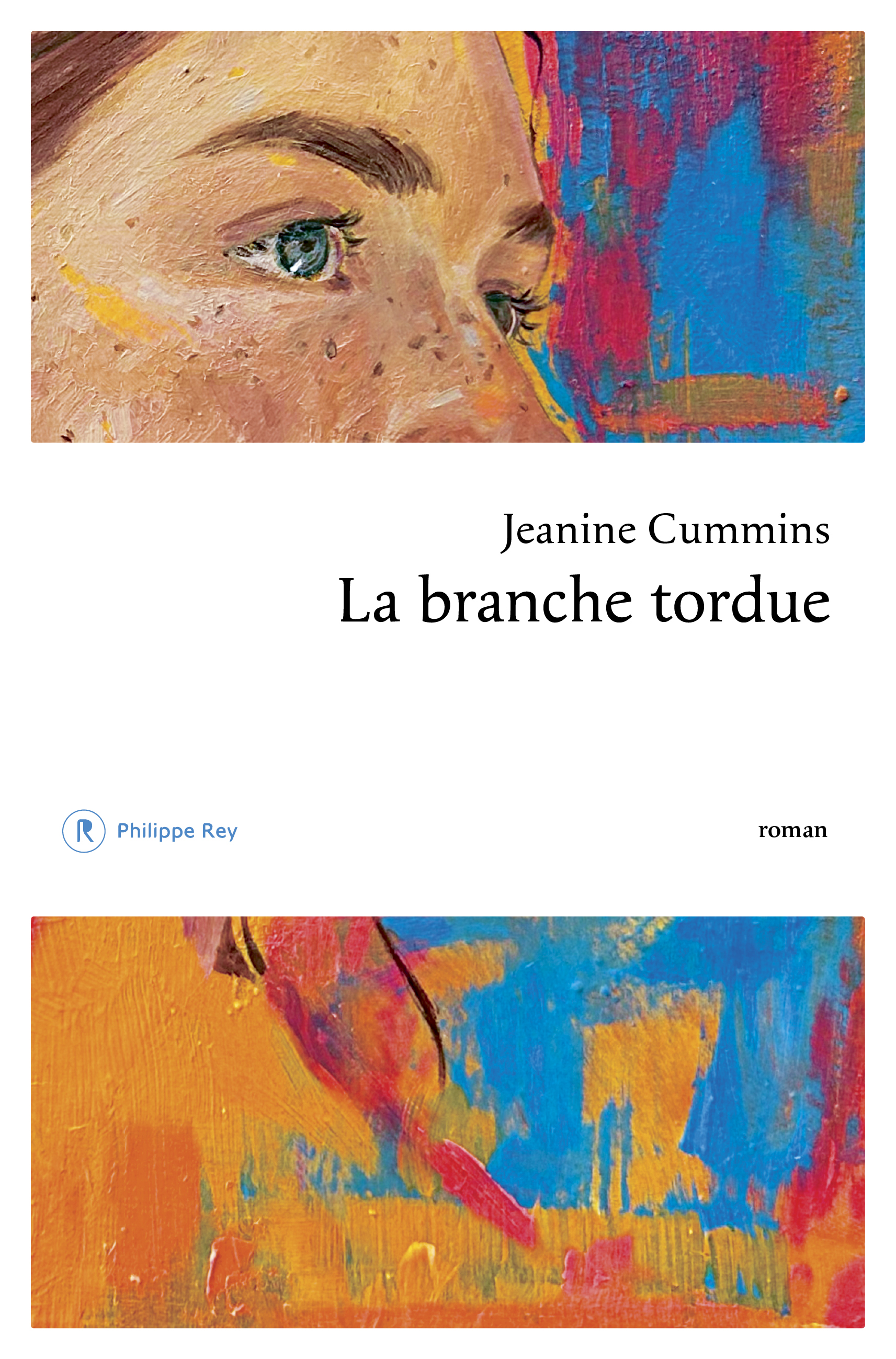

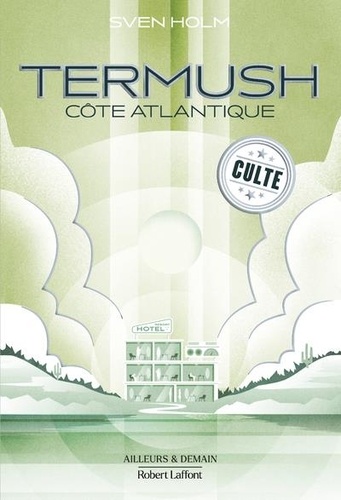
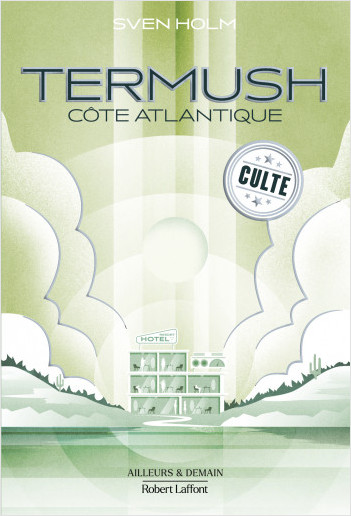
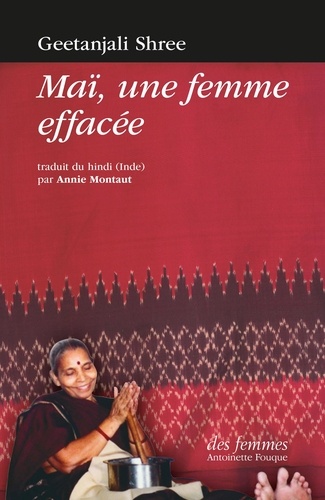

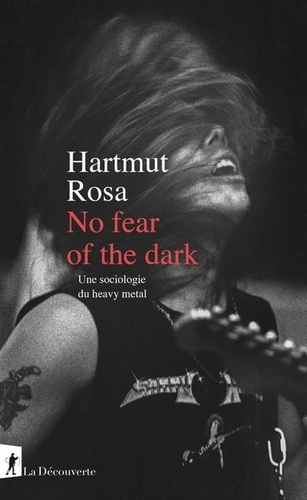
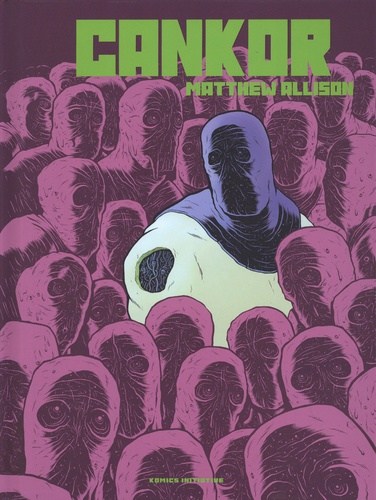
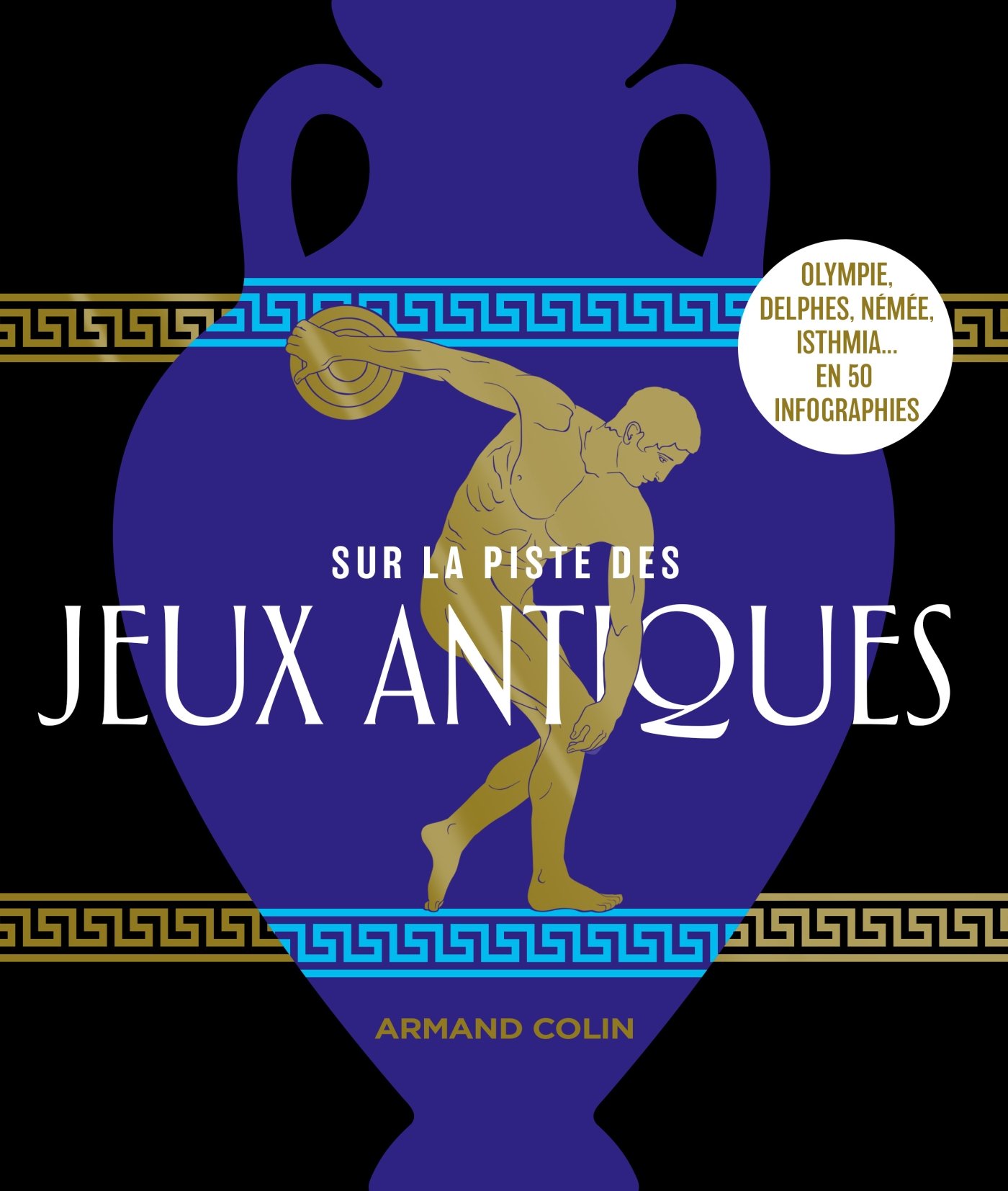
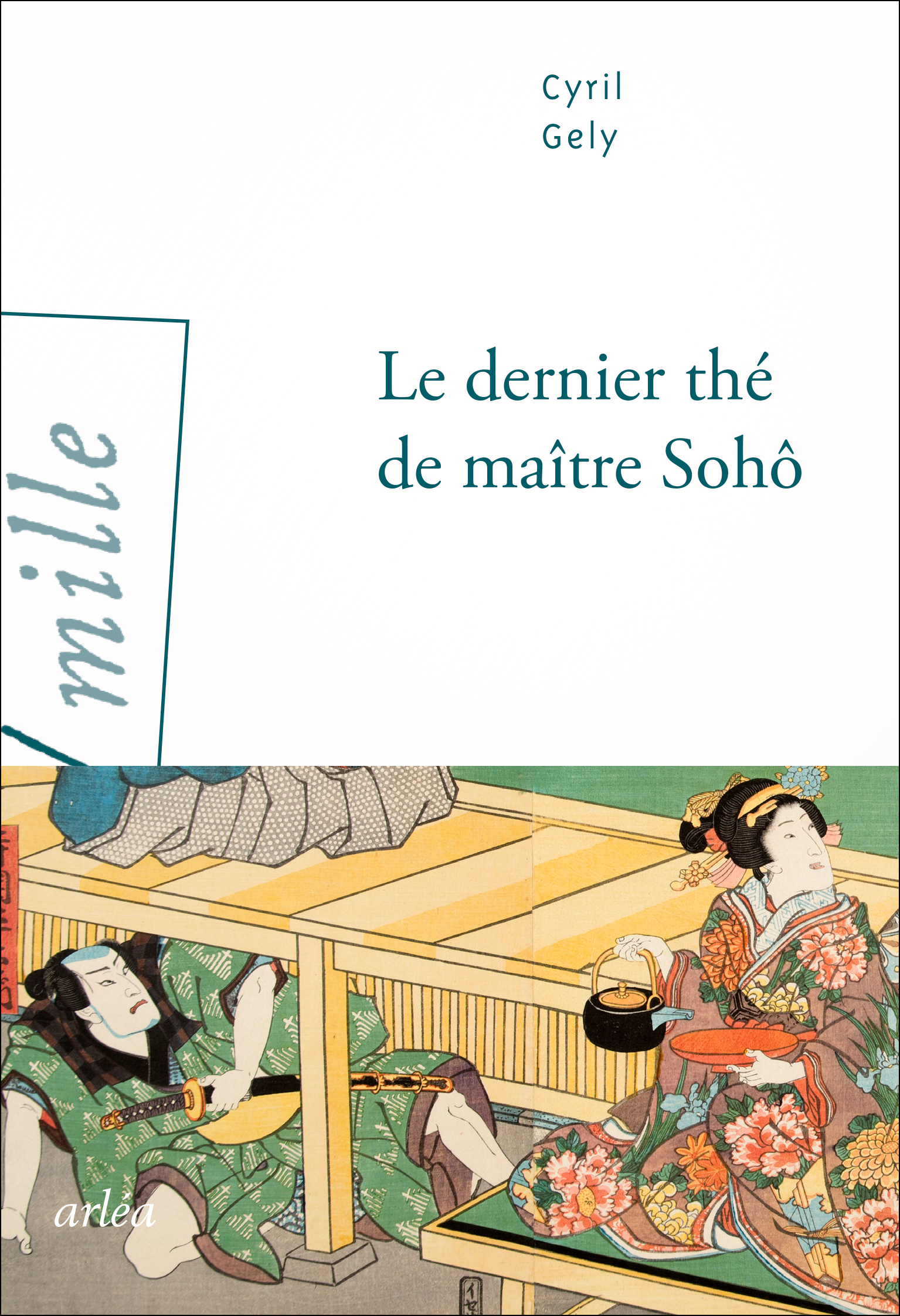



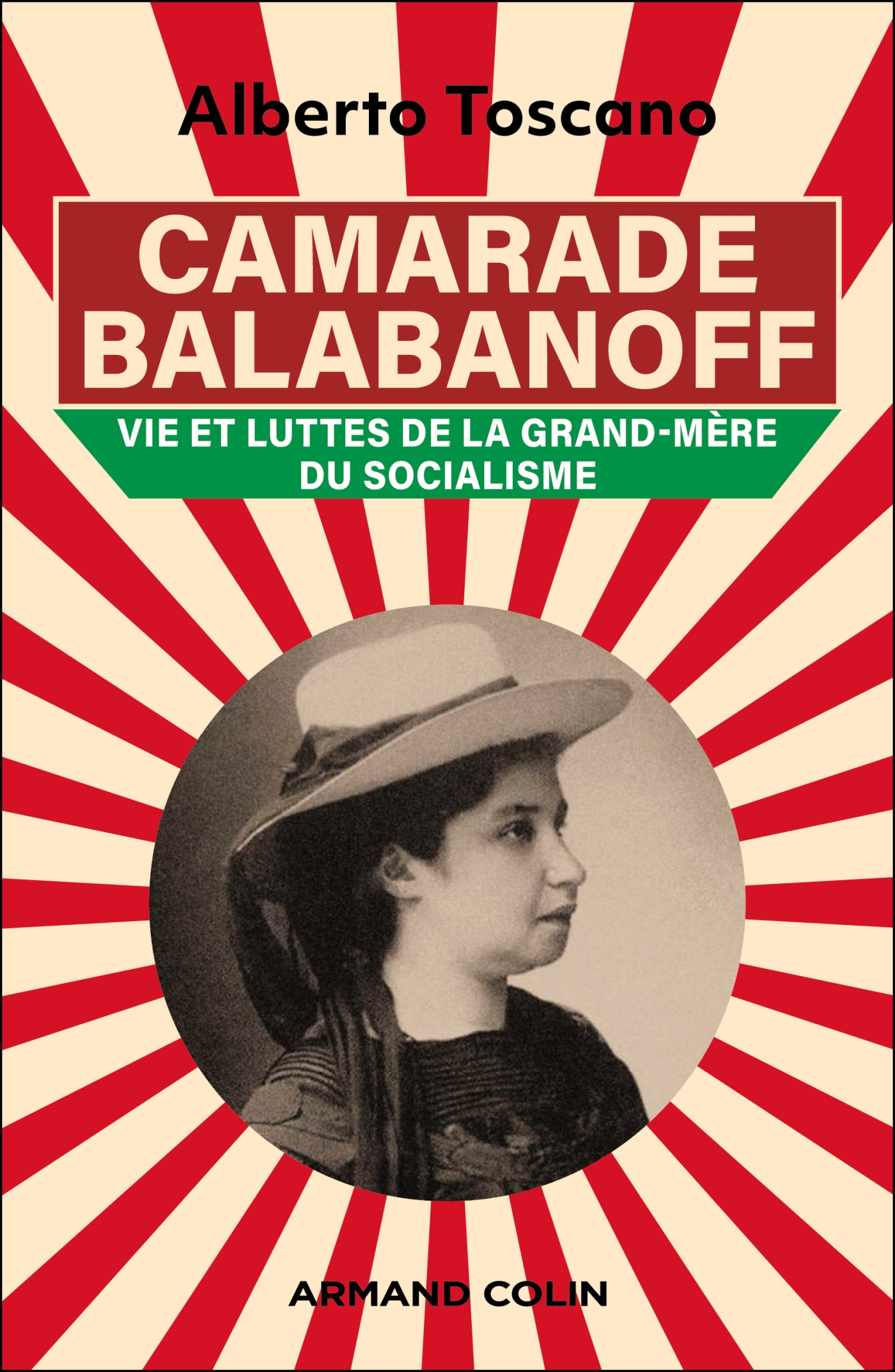
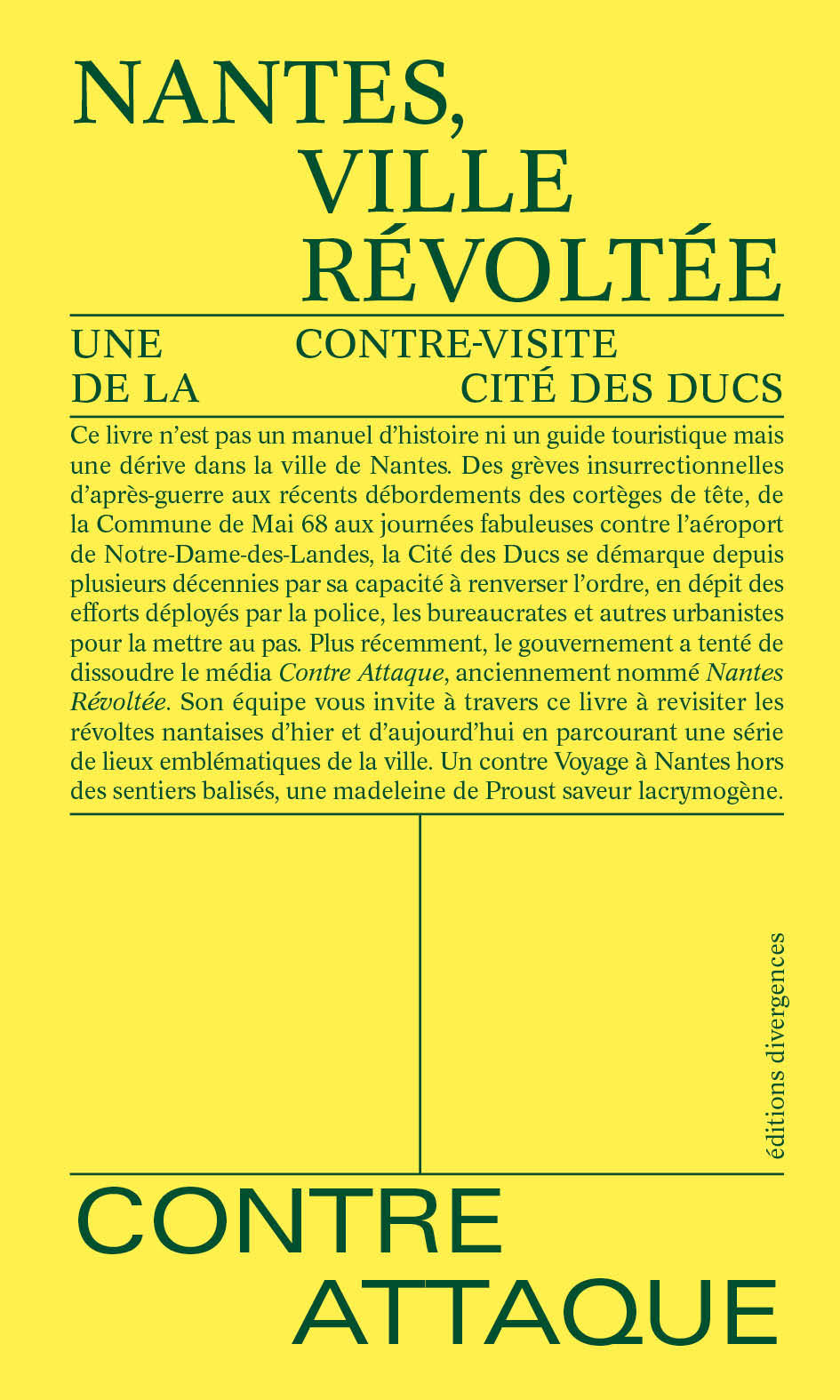
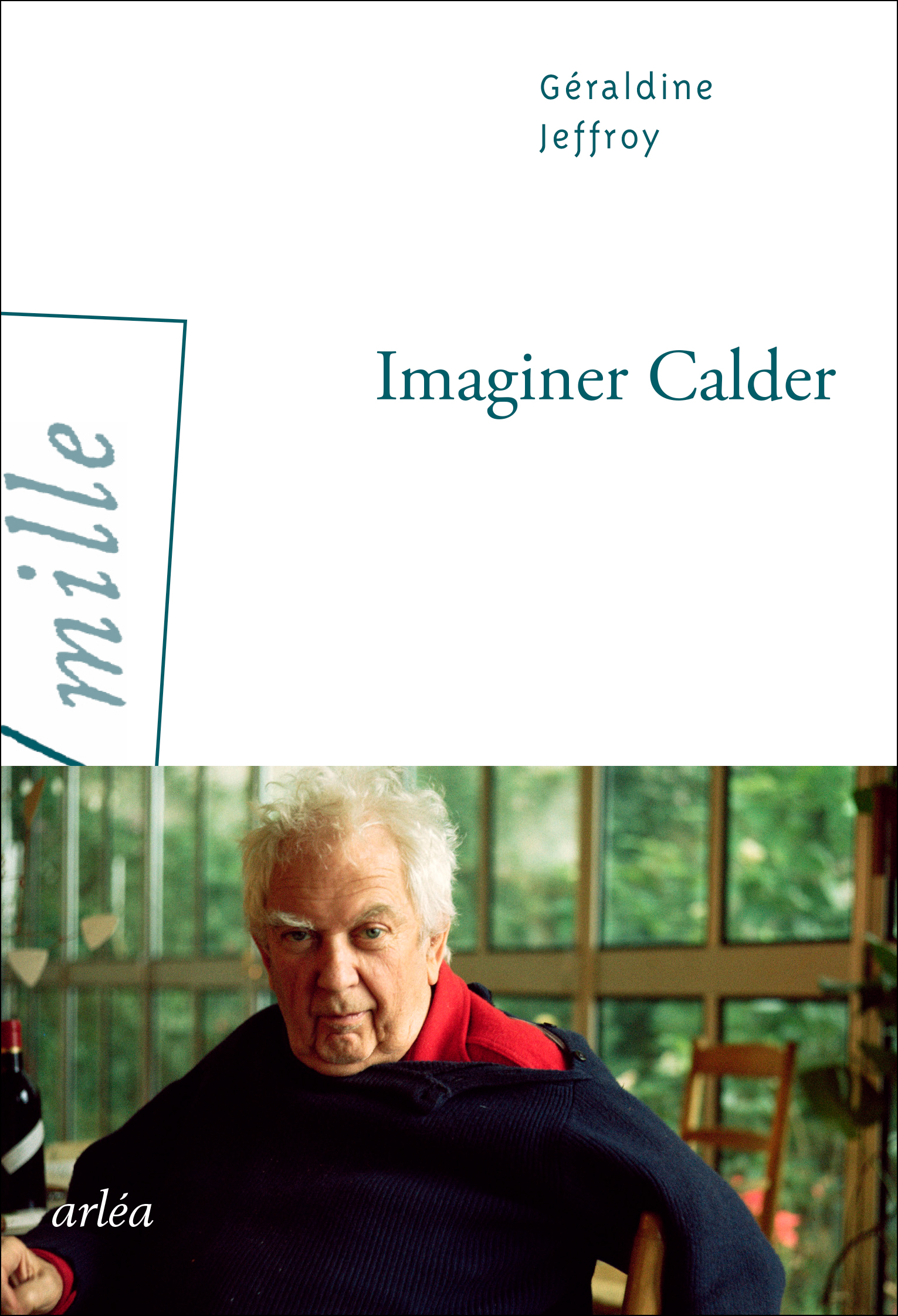
1 Commentaire
HOLVOET
06/02/2021 à 18:31
Je tiens à vous remercier pour cet article que j'ai lu, bien sûr, avec un vif intérêt.
A chaque fois que je lis l'Epervier de Maheux, c'est toujours avec un bonheur intense (doublé, je l'avoue, de mélancolie) tant l'écriture de Jean Carrière est musicale et picturale.
Ce même talent d'artiste-poète se retrouve (à une hauteur égale) dans la seconde partie de La Caverne des Pestiférés : les Aires de Comeizas.
La France a perdu en 2005 l'un de ses grands écrivains. Jean Carrière est pour moi un classique.