Feuilleton de la rentrée : Fragments d’Anastème - Chapitre 3
Le feuilleton Anastème de Sébastien Célimon se prolonge. Troisième épisode : où les tensions sociales et historiques se dévoilent.
Le 24/08/2017 à 09:46 par Auteur invité
Publié le :
24/08/2017 à 09:46

« La grande guerre patriotique était finie depuis seulement deux ou trois ans. Le Vodj Staline avait mené l’union à la victoire. De nombreux fils avaient péri dans les combats, beaucoup étaient revenus blessés et la souffrance était partout, souvent tue, mais visible dans les épaules tombantes et les regards épuisés. Le retour des soldats victorieux avait été longuement fêté. C’est dans cette période que le petit cirque et sa troupe avaient été créés et avaient commencé à sillonner la région.
Je n’avais même pas dix ans. Je ne comprenais pas tout ce qui se passait. Ce qui comptait pour nous, c’était que nos attractions redonnent le sourire aux gens. En retour ils nous nourrissaient. J’avais connu un peu la faim, et je la rejetais de toutes mes forces. J’étais capable de voler pour me nourrir. Le cirque m’assurait un repas tous les jours, ce qui était inespéré pour moi. Des galettes noires, des fruits, du kvas ou de la vodka, de la viande pour les animaux et du foin pour le cheval, les gens faisaient preuve d’une grande générosité malgré les efforts demandés à chacun dans la reconstruction. À l’approche de la Volga nous pouvions espérer recevoir du poisson frais.
Dans les villages, les bourgs, les cours d’usine voire sur les bords des chemins, tout le monde nous guettait. Les gens aidaient à raccommoder les toiles figurant les décors, donnaient du matériel, bois taillé, outils de seconde main, tissus, cordes. À cette période, les cirques et théâtres ambulants transmettaient aussi bien les nouvelles qu’elles secondaient la Poste, amenaient des paquets et des présents que des familles distantes s’envoyaient. Ce n’était qu’habitude et tradition. Les cadeaux rapportés par un acrobate avaient ainsi une valeur bien supérieure que déposés par un postier. Ils étaient auréolés de magie et de gaîté.
Nous disposions de l’autorisation de circulation et de représentation dans plusieurs Oblasts. Je crois me souvenir que la présence d’un soldat décoré dans notre troupe n’y était pas étrangère. Nous devions donner aux autorités le circuit que nous comptions suivre, et à quelle période. Partout nous devions montrer patte blanche. Suivant les accueils, nous pouvions décider de rester un peu plus longtemps à un endroit ou à l’inverse, face à une hostilité parfois difficile à comprendre, nous écourtions. Le temps était aussi un curieux juge, déversait sur nos représentations une pluie sale, drue, soufflait soudain pour rendre inaudible un numéro musical ou glaçait les sangs sans préavis. Quand le soleil ne nous consumait pas alors que nous aurions dû ressentir les frimas de l’hiver. Mais c’était notre vie et à notre manière nous l’aimions. Nous ignorions alors que la télévision d’État commençait à émettre en ce temps-là et qu’elle allait rendre désuet notre métier.
Les commissaires politiques nous regardaient d’un bon œil, car nous célébrions et remémorions les grandes batailles glorieuses de la grande guerre patriotique. Smolensk, Koursk, Korsoun, et surtout, la plus prestigieuse, Stalingrad. On évitait de parler de la bataille de Moscou, pourtant victorieuse. La menace était alors passée trop près, le péril était comme le feu, même s’il n’était pas exactement là, on pouvait sentir sa brûlure.
Nous connaissions les noms des généraux de l’Armée rouge par cœur. Nous ne parlions plus de Joukov tombé en disgrâce, même s’il est revenu aux affaires après la mort de Staline. J’étais pour ma part fasciné par le maréchal Boris Chapochnikov. La seule raison, à la réflexion c’est que j’avais le même prénom que lui et qu’il était dit que Staline le considérait comme un héros de guerre et le respectait. Ce n’était pas rien. Chapochnikov était mort juste avant la fin de la Grande Guerre patriotique et était donc considéré comme un de ses grands maîtres d’œuvre.
Nous écorchions volontairement les noms des généraux allemands et de leurs alliés. Nous reprenions les jeux de mots des journaux officiels rapportés par ceux, rares, qui savaient lire. Ça donnait des expressions déformées de bouche en bouche qui rendaient hilares les spectateurs.
J’avais rejoint la troupe assez tôt, dans des circonstances étranges qui ne sont pas le sujet de ce récit. Il se trouvait en tout cas que j’étais seul. Mon père avait disparu. Je lui ai longtemps attribué un destin où il finissait dans un camp de rééducation pour m’avoir abandonné. Et ma mère était sûrement morte. Je ne les avais jamais connus, un parmi des milliers d’orphelins de guerre, et cela n’avait pour moi aucune importance. Déjà, je ne tenais pas en place, et, si je ne dois retenir qu’une chose de mon arrivée dans la troupe, c’est que je la dois à Kostia, le contremaître. Il avait besoin d’un aide pour les tâches les plus dégradantes et qui nécessitaient une petite taille. Je fus choisi et cela a changé ma vie. Je n’en ai jamais eu la preuve, mais je pense que Kostia avait demandé mon adoption ou négocié mes services. Sinon, je ne peux pas expliquer qu’un jeune enfant russe puisse ainsi se promener sans attirer l’attention dans un pays aussi soucieux de son organisation. Kostia m’appelait parfois avec affection “fils”, mais je ne le prenais pas au sérieux. Les surnoms étaient légion en ce temps-là. Fils, compagnon, camarade, grand frère… Au quotidien, tout le monde m’appelait Bo.
Je me souviens très bien des émotions ressenties la première fois que j’ai vu ce petit cirque ambulant. Il n’avait pas de nom, mais se distinguait grâce à son immense ours apprivoisé qui s’appelait Bolchy. C’était un ours brun âgé d’une vingtaine d’années à l’époque, assez commun. Il exerçait sur moi une véritable fascination. Sa force tranquille, le respect qu’il imposait en toutes circonstances, la gentillesse dans ses yeux capable de virer à la méchanceté en une seconde. Outre Bolchy qui obéissait à Feodor le montreur d’ours, il y avait deux jongleurs-acrobates. Il y avait Bert le dresseur de chiens, Madame Do la conteuse, Syz la jolie danseuse d’origine tzigane qui portait des costumes traditionnels ukrainiens pour éviter d’être embêtée sur ses origines. Il y avait Ivan le gardien, l’ancien soldat dont le statut nous facilitait les choses. Il y avait au début un chanteur d’opéra qui s’était fait emmener par la police quand il s’était trouvé qu’il était un réfugié polonais. Je n’ai jamais su son nom.
Notre troupe accueillait des artistes de passage, itinérants, éphémères compagnons de voyage. Les uns et les autres partageaient les tours qu’ils avaient appris. L’honneur et la richesse des saltimbanques tenaient dans notre accueil chaleureux et dans le partage. Dès que l’un de nous créait un nouveau tour, il s’empressait de l’apprendre aux autres. Du coup, tout le monde savait faire un peu tout, des acrobaties comme de la musique, diriger les chiens, comme raconter une histoire avec plusieurs accents. Si l’un était malade, l’autre pouvait le remplacer, assurer le tour espéré. Cette solidarité était le ciment qui permettait au cirque de tenir malgré les intempéries et les périodes plus difficiles.
Nous avions trois roulottes et deux charrettes, tirées par des chevaux et des ânes. Bolchy disposait d’une cage considérable dans laquelle il ne rentrait que pour s’étaler et faire une sieste bruyante. Il avait toujours une chaîne reliée à son cou. J’étais persuadé qu’il pouvait s’en détacher sans problème. Il avait aussi une muselière en fer forgé qu’il ne supportait pas et qui le rendait agressif, pour le plus grand plaisir de ses nombreux admirateurs. Quand Kostia n’avait pas besoin de moi, j’aimais faire régner la discipline auprès des enfants aventureux fascinés par Bolchy.
J’avais un petit truc qui impressionnait garçons comme filles. Sous prétexte de montrer mon autorité sur l’ours, je montais sur des échasses et tendais un bâton dans sa direction. Bolchy allongeait alors son bras et faisait voler d’un coup de patte mon bâton, ce qui me mettait en colère. Je le réprimandais alors, usant les mots appris de Feodor, et Bolchy masquait de ses grosses griffes son visage de honte avant de s’asseoir l’air désolé, la tête dans les épaules. J’étais le maître de l’ours. Et comme l’ours est sacré en Russie, j’étais donc quelques instants le plus important personnage du pays. Les cris d’admiration des enfants ne disaient pas autre chose.
Mon monde se composait alors des visages des membres de la troupe et des vivats du public. Les odeurs se mêlaient dans mon esprit, suie, charbon, goudron, fourrure musquée, corps suant d’alcool ou transpirant de fatigue. Sys et Madame Do s’aspergeaient d’eau de toilette de mauvaise qualité qui soi-disant attiraient les hommes, mais moi me faisaient fuir. Le rouge du Parti et le gris du monde étaient les couleurs dominantes en ce temps-là.
Cela faisait donc deux saisons que je vivais au rythme du cirque. Je me sentais pleinement à ma place et ces gens étaient ma famille. Et puis, ils sont arrivés.
****

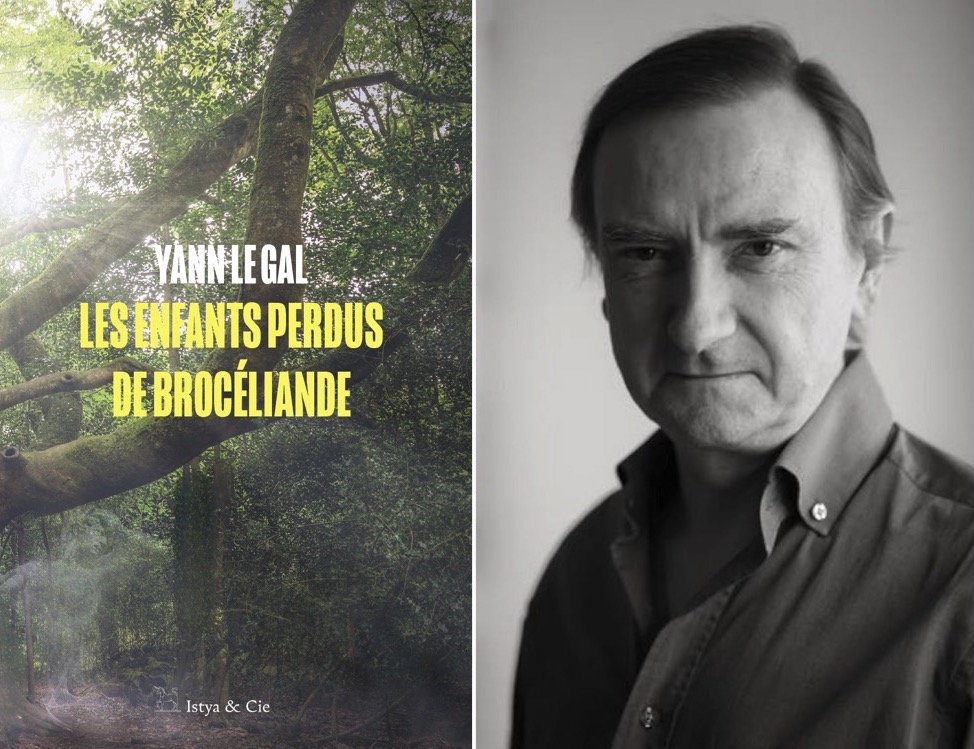











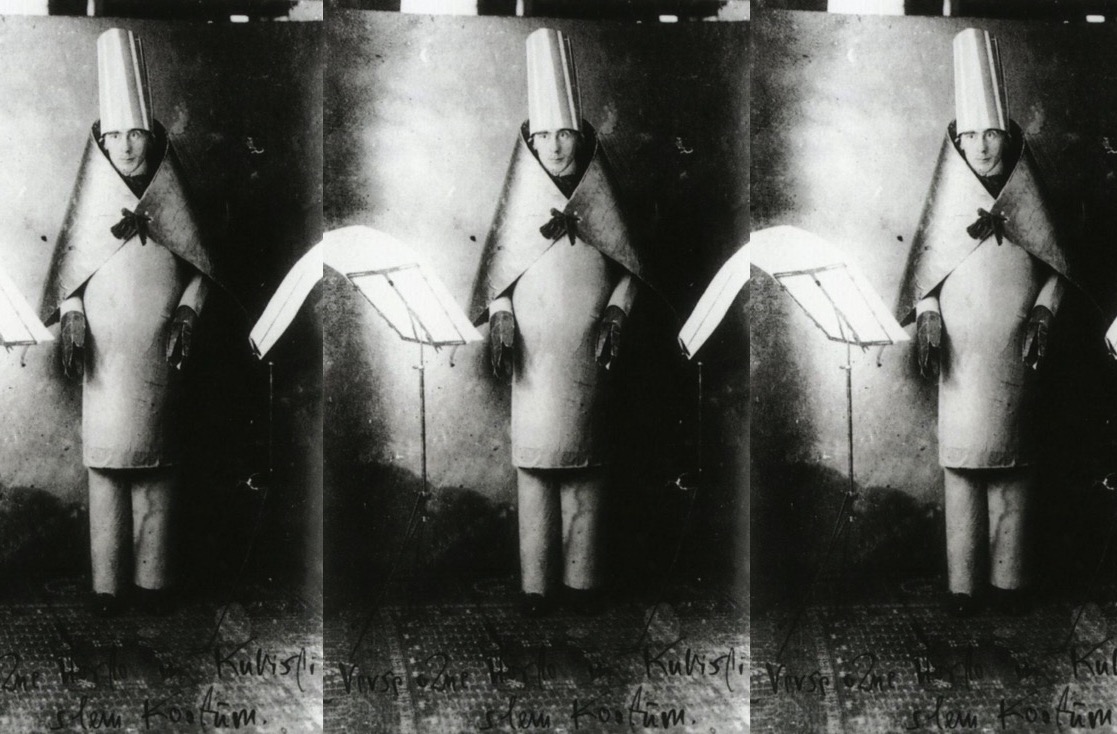























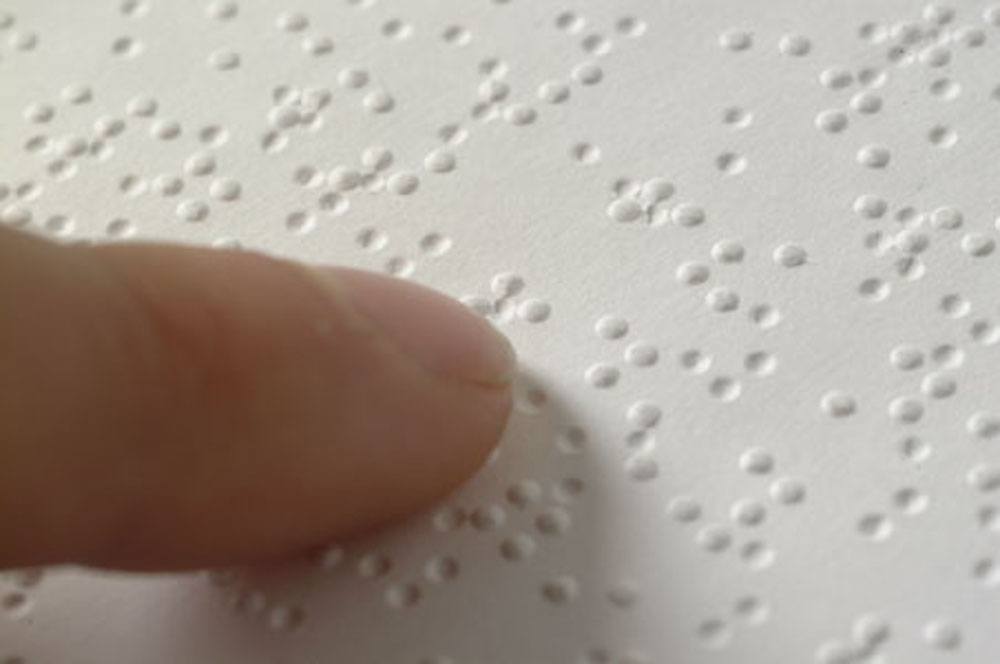










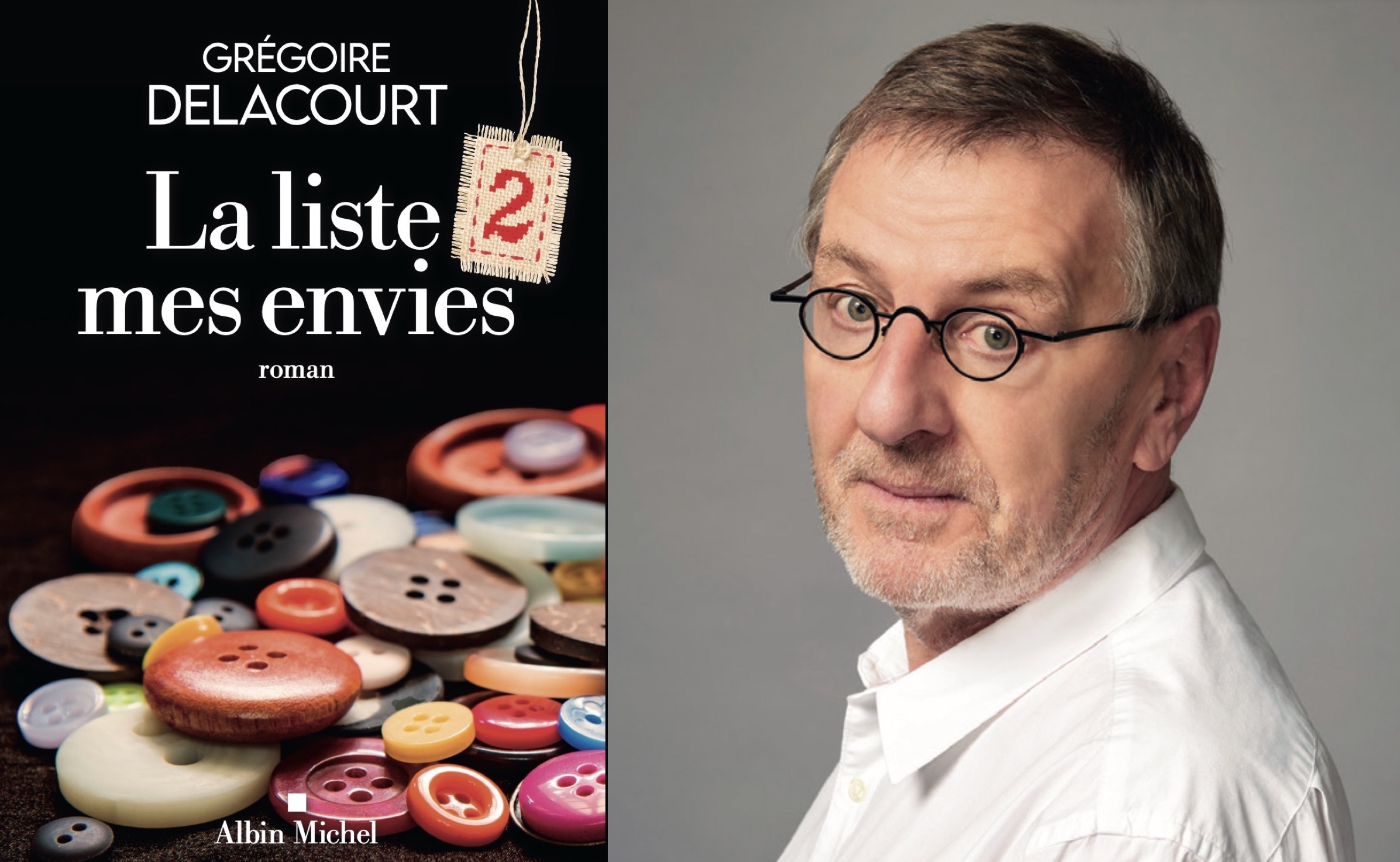









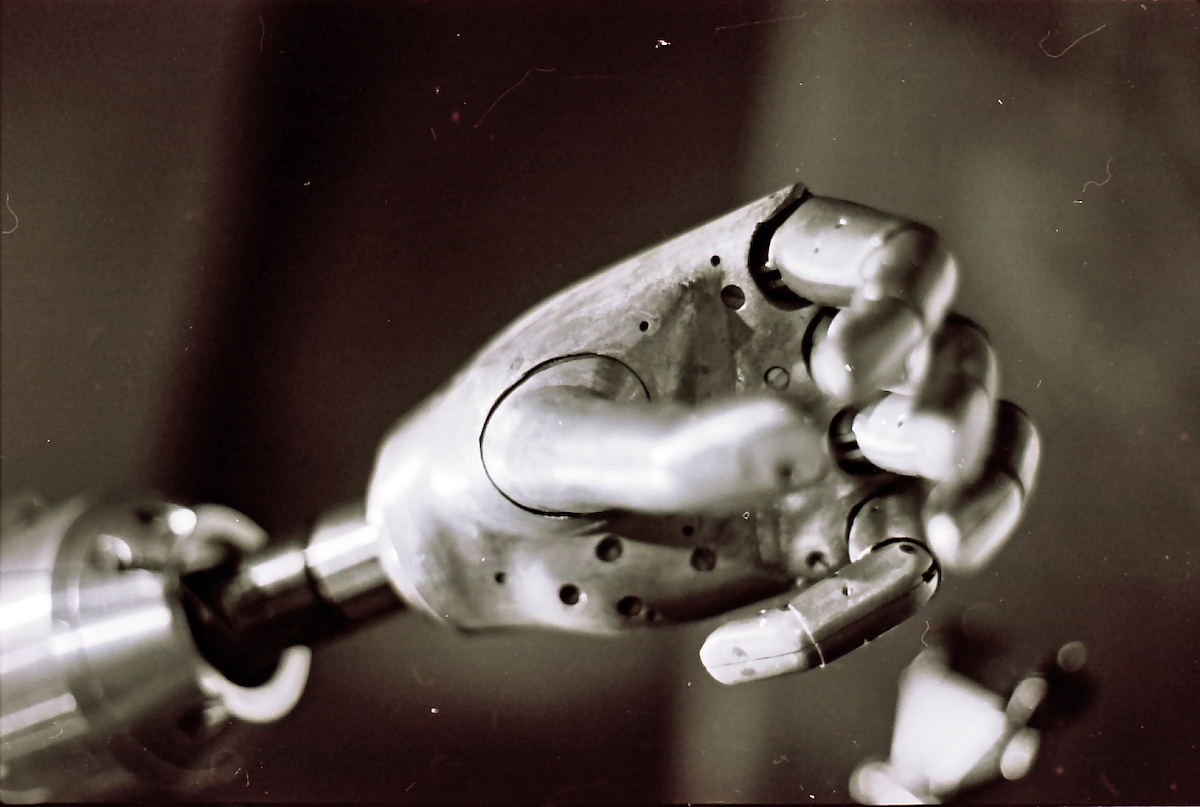













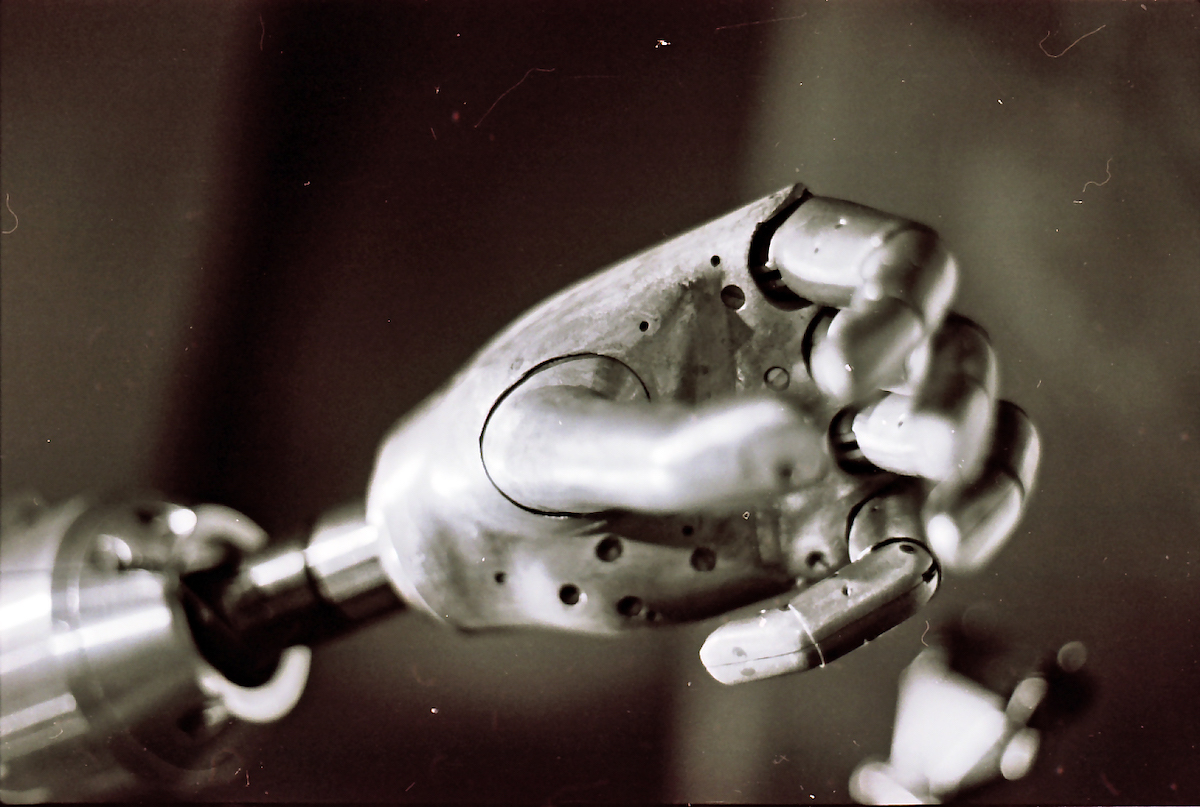
Commenter cet article