“De quelle couleur sont les mots ?”, Cécile Racine
Dans le cadre de son action « De l’écriture à la promotion », la Fondation pour l’Écrit avait offert à 10 jeunes auteur.e.s suisses romand.e.s de pouvoir bénéficier d’un accompagnement spécifique. Le programme a permis à ces jeunes talents de profiter d’un éclairage sur le milieu du livre. Aujourd’hui, ActuaLitté publie le texte, presque rimbaldien, de Cécile Racine.
Le 06/11/2017 à 11:26 par Auteur invité
Publié le :
06/11/2017 à 11:26

L’écriture a d’abord été blanche, mais pas propre, couleur plâtre si vous voulez. L’existence est pleine de vide et enfant j’avais l’habitude de m’ennuyer beaucoup, je voyais l’écriture comme un mortier blanchâtre, épais et poisseux, qui comblait les espaces morts. J’occupais les fenêtres, assises sur le rebord, je regardais le spectacle du mouvement derrière la vitre, de préférence dans le silence d’un appartement désert. Il pleuvait les meilleures journées et j’étais toute justifiée de me livrer à l’ennui.
C’était au tout début de l’existence, quand je n’allais pas encore à l’école, et j’écrivais dans ma tête pour offrir à mon texte un décor visuel, ou peut-être parce que je ne savais pas me servir d’un stylo. Le rêve a été ma première forme d’écriture.
Plus tard j’ai appris à écrire et l’écriture est devenue bleue, couleur de cartouches d’encre qu’on aide un peu à exploser, par curiosité, et qui tachent le coton de la trousse quand on y range la plume et son capuchon désunis. J’étais très étourdie et impatiente, j’ai toujours sali mes compositions et usé mes buvards, j’en retirais à vrai dire une certaine fierté, y voyant l’expression de ma fibre artistique.
En même temps que j’apprenais à conserver la pensée, j’accédais aux mots au travers de la lecture. L’initiation a commencé par les panneaux de circulation, parce que mes grands-parents habitent loin et que j’allais les voir souvent, ça faisait beaucoup d’écriteaux sur la route. Je me suis d’abord nourrie de noms de lieux, j’apprenais l’espace et la matérialité, j’enfermais mes rêveries dans des mots bleus barbouillés, sur des pages de cahier où il fallait tracer une marge. J’ai appris à tracer mon nom, six lettres en tout, sans savoir que c’était un point de non-retour au-delà duquel j’étais tenue d’exister. C’est drôle, le poids que ça pèse, six lettres bleues sur une feuille blanche.
Encore un peu et j’ai finalement dépassé le stade de la signalisation routière pour accéder au livre, cartonné, illustré, raccourci, simplifié, adapté, puis juste livre. Ça n’a jamais été une relation saine, d’entente cordiale, plutôt une fringale d’après l’orage, quand la fatigue et l’eau qui goutte sur la nuque, j’aurais voulu lire tous les livres et qu’on me dise que je n’y arriverais pas renforçait ma détermination à atteindre mon but.
Quelque chose comme un grain d’esprit de contradiction. Je voyais la lecture comme un projet en cour, j’avais hâte de finir pour enfin savoir. L’écriture est devenue noire, noir des caractères imprimés que je dévalais de page en page, mais aussi noir d’un vide spatial : j’avais complètement cessé d’écrire.
À l’école, je gribouillais complaisamment – et encore, très mal, me faisant souvent reprendre pour des lettres bancales –, mais je n’avais pas le temps pour ces pliages de soie chinoise à mes heures libres, il fallait lire. J’empilais les ouvrages encore inexplorés à côté de mon lit, rassurée lorsque la pile haute vacillait au point de parfois s’effondrer, inquiète de nouveaux combustibles quand les quelques exemplaires superposés ne pouvaient même plus se faire mal en tombant.
J’avais de grandes difficultés à m’endormir le soir, peut-être parce que je passais mes journées à lire et que ma nature d’enfant se rappelait à moi en remplissant mes couvertures de fourmis. Je n’étais pas fatiguée et j’avais la bougeotte, il me fallait de longues heures pour m’endormir et le comble, c’est que j’avais peur du noir. L’écriture est devenue jaune, comme une bougie, pour échapper au noir en le tartinant de lumière, boucher ces longues heures d’attentes où la journée était déjà finie, mais pendant lesquelles je restais bloquée dans un espace-temps qui ne peut pas exister parce qu’il appartient au sommeil qui est atemporel.
CQFD, mais ça me faisait une belle jambe à l’époque de mes insomnies. Pour entretenir la flamme, j’inventais des contes du soir que je me racontais les yeux fermés parce que le noir est moins dense sous les paupières. J’étais remplie de terreur face aux ombres qui rampaient dans ma chambre, mes histoires étaient donc particulièrement douces et lumineuses, parfois courageuses les soirs de bravade. J’y tenais évidemment un premier rôle glorieux qui me servait de coquille pour surnager dans les eaux troubles que fait monter la nuit.
J’ai fait mes plus beaux cauchemars dans ces années-là et il a fallu des trésors d’imagination pour cicatriser toutes blessures que laissent les griffes de la nuit avant que ne s’y engouffre la frousse. Certaines nuits je n’étais pas assez rapide et il fallait allumer la lumière quelques heures pour calmer les battements de mon cœur. En grandissant, je ne me l’autorisais qu’en de très rares occasions, avec une sévérité toute pleine de principes et de radicalisme qui marque les dernières coudées de l’enfance. Il est vrai que j’en avais de moins en moins besoin, parce que les histoires devenaient bonnes.
L’avènement du kitsch a eu lieu en même temps que les premiers poils, c’était le début de la grande époque, celle d’une écriture d’excès bicolores, rose et or. Le rose est venu avec les premiers rêves érotiques, les contes du soir sont devenus rares, remplacés par des chroniques obscènes, outrageusement naïves, quelque chose comme la sexualité des tortues, je rêvais les cuisses ouvertes.
L’or était autrement honteux et tabou, j’avais des projets de succès que je taisais même au silence, la nuit devenait alliée, seul instant où je n’avais pas à me voir avouer mes penchants glorieux. Je me voyais écrivain, mais là n’étais pas le problème, j’y ajoutais une arrogance timide, qui quémandait sa place au soleil avec juste trop peu d’assurance et pas assez de modestie pour m’en faire honte.
Le jour où j’ai eu mes règles, j’en ai parlé à ma mère, en revanche je n’ai jamais rien dit à personne sur mes projets d’avenir, me permettant néanmoins de feuilleter le dictionnaire en m’arrêtant de longs instants sur les noms propres qui me fascinaient. Je mesurais le nombre de lignes qu’ils avaient pu obtenir contre toute une vie d’existence et je faisais des projets, au mieux une demi-page comme Hugo, au moins quelques lignes comme Colette. C’était une époque de calculs sans cesse recommencés, je préparais mon saut et j’avais presque aussi peur de le tenter que de le rater.
À vrai dire, aujourd’hui, je ne sais toujours pas trop si j’ai sauté, si c’est le cas rien de cassé, mais on s’imagine toujours des choses, peut-être que ce n’était qu’un pas de plus vers un quelque part, ou un ailleurs. J’ai recommencé à écrire le jour où j’ai cessé de rêver, les insomnies du soir ont disparu, je m’endors comme je me couche : sur le ventre et tout de suite.
Reprendre n’a pas été facile, j’ai tenté un retour au bleu stylos billes, réessayé le noir en tapant à la machine ou à l’ordinateur, j’étais confrontée à toutes les questions d’identité que pose l’acte d’écriture : fumer, boire, planer ? Il aurait fallu trouver quelqu’un à aimer éperdument, ou peut-être que quelque chose aurait suffi. L’écriture est peu à peu devenue verte, quand j’en ai rencontré d’autres. Vert d’envie peut-être au début, parce que beaucoup écrivaient mieux que moi, vert nouveau aussi, parce que je découvrais un monde que je connaissais vide et qui se révélait surpeuplé.
Écrire, encore, aussi, quoi de plus ? J’ai beaucoup écrit sans rien achever à force de biffer, jeter, dire non, entendre non. J’apprenais à écrire sans jamais pouvoir admettre que ce n’était pas un don inné, né avec moi, constitutif du moi, simplement présent. Période destructrice, douloureuse, le creux de la vague, instant où on ne croit plus.
Je ne sais toujours pas de quelle couleur doit être l’écriture, ni si mon écriture doit être, si elle pouvait être nécessaires à d’autres que moi et étayer une tour de livres au pied d’un lit d’adolescent.
Elle existe comme un enfant surprise, je ne pourrais pas la chasser, la laisser seule, me laisser vide. Il faut probablement en faire un métier pour qu’elle fasse moins mal, qu’elle devienne moins vindicative, moins méchante, c’est peut-être ça être écrivain, se défendre contre l’écriture, s’inventer des armes et des dragons de papier pour lui faire peur, qu’elle se taise, qu’elle se terre. C’est un métier, peut-être, dans lequel il faut s’engager à reculons pour ne pas voir ce qui vous attend.
Cécile Racine a publié Points de Suture aux éditions de l’Hèbe en novembre 2016. Elle a été lauréate du Prix Interrégional Jeunes Auteurs 2016 avec L’omelette au poisson.




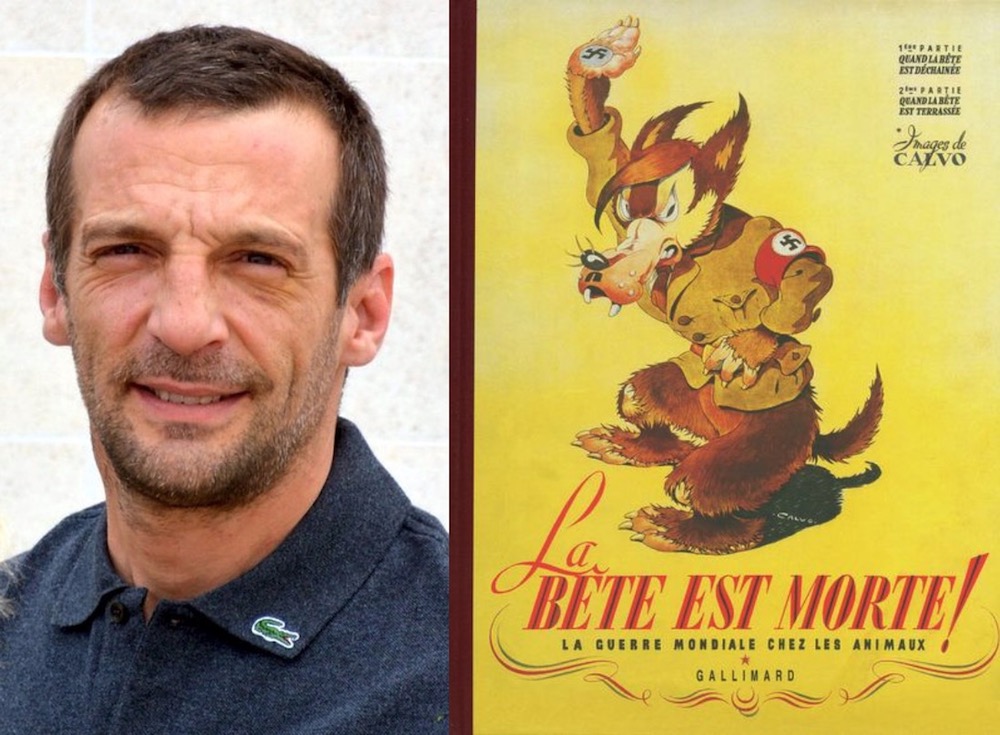

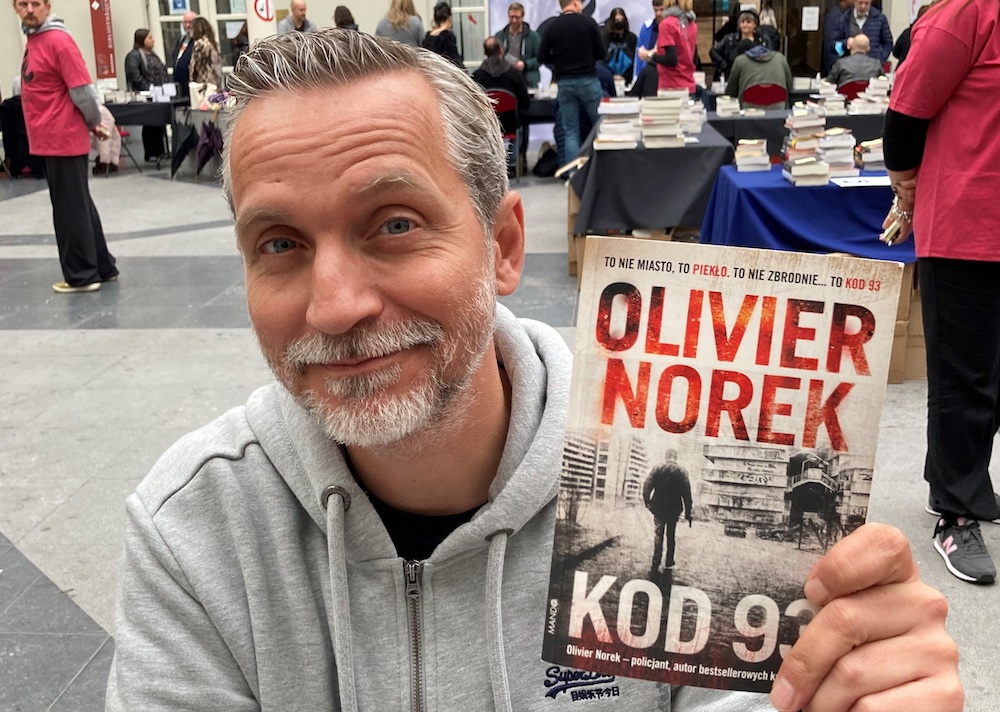


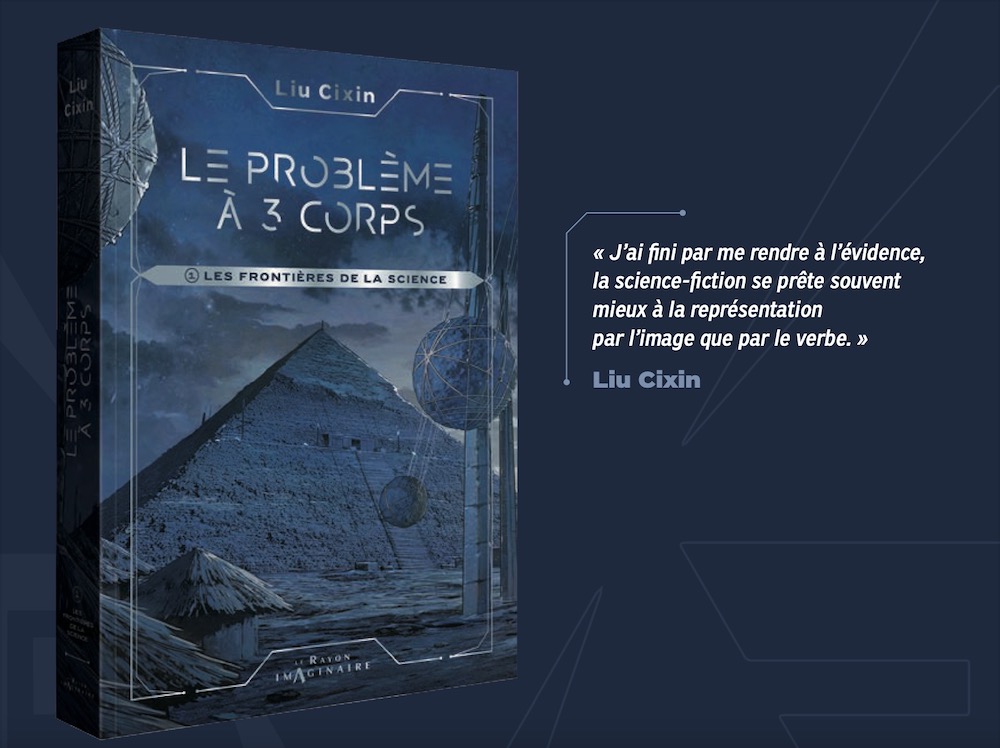



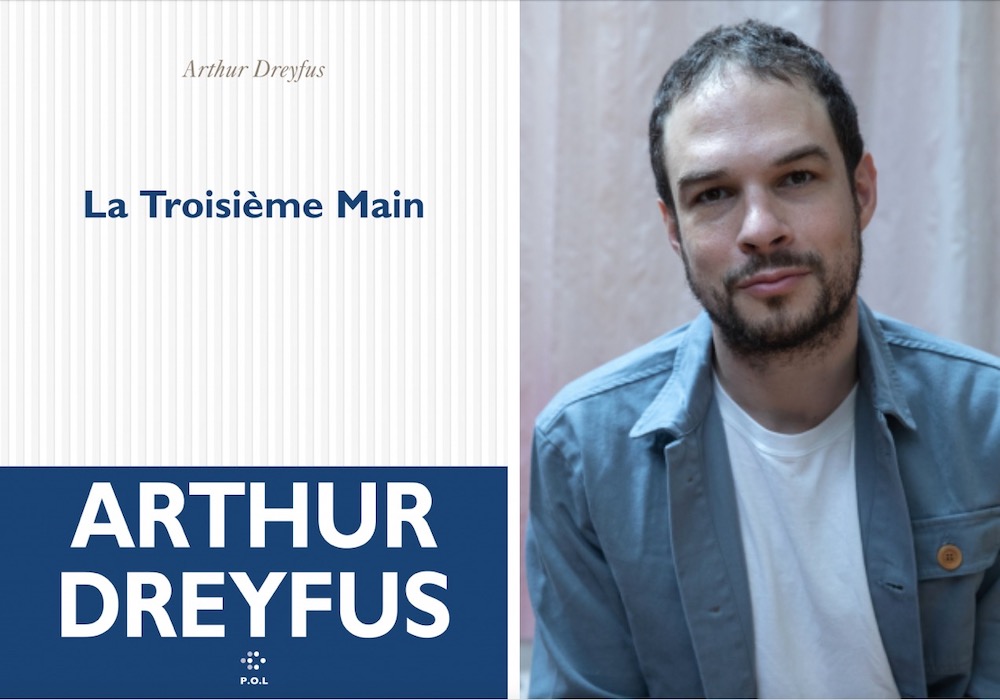
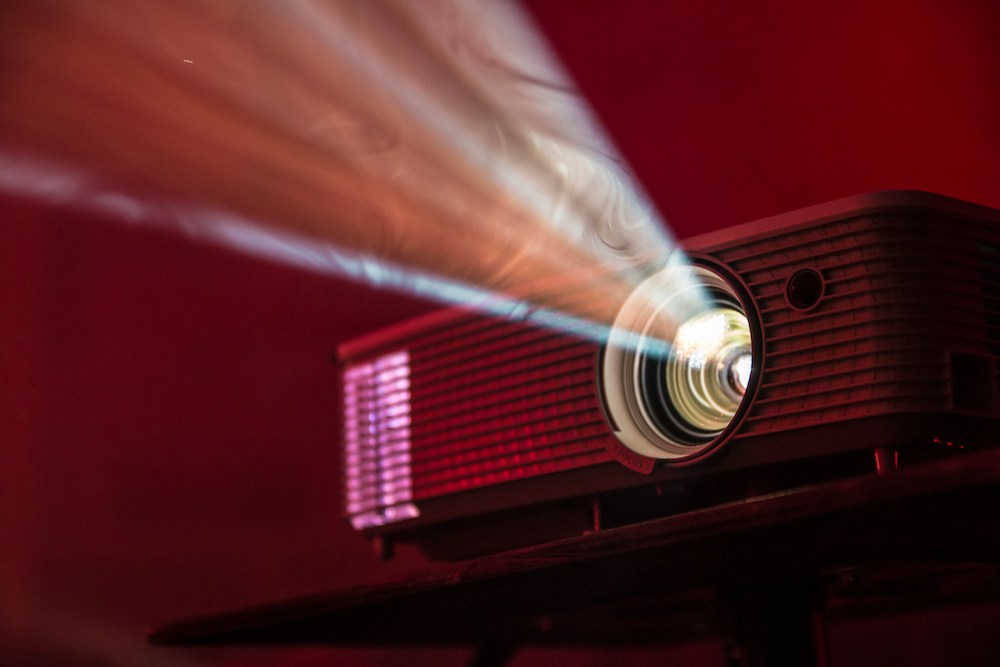



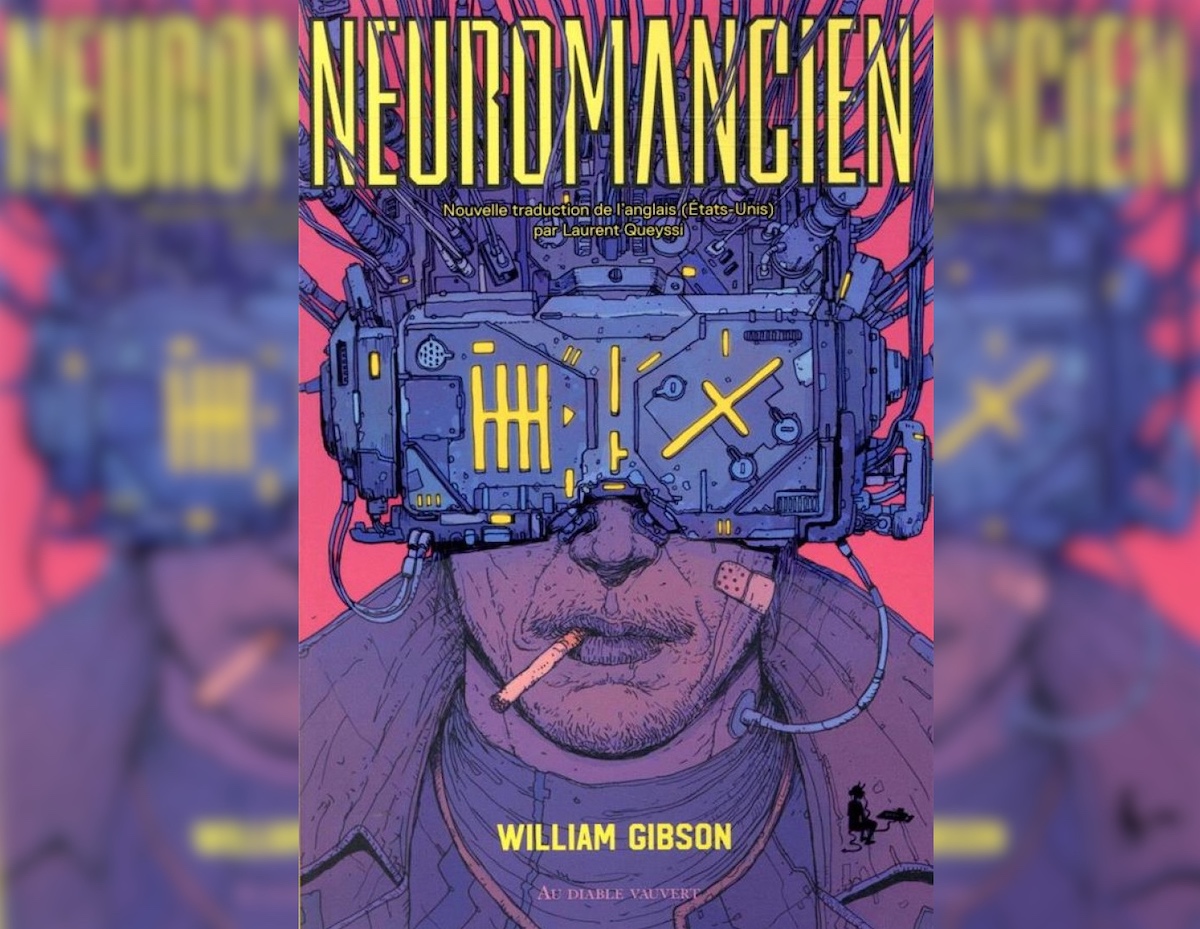





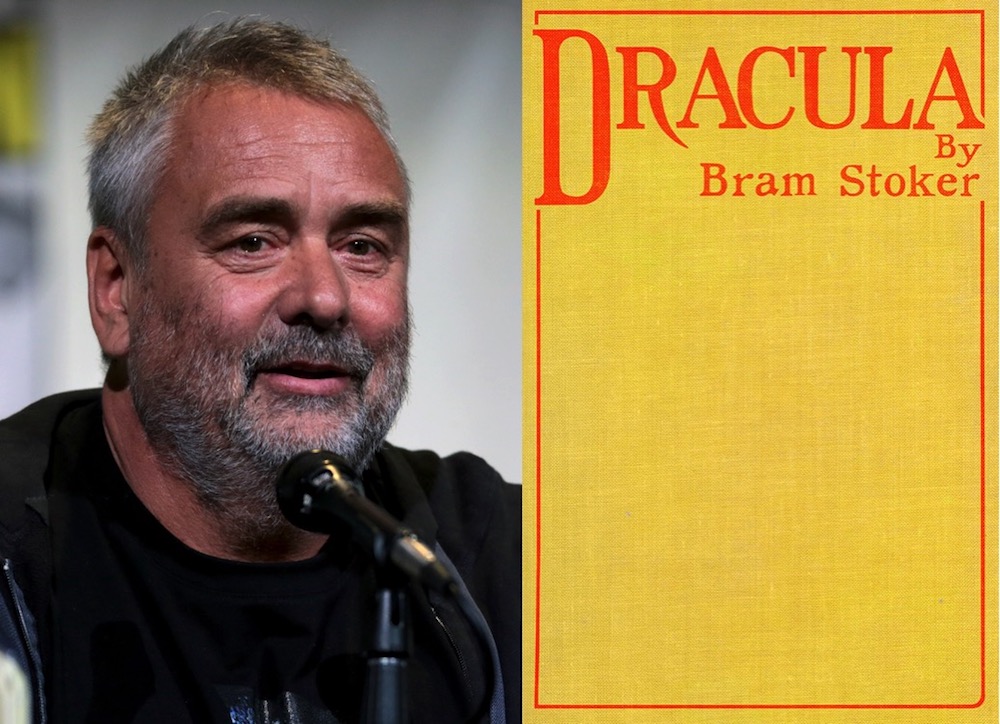


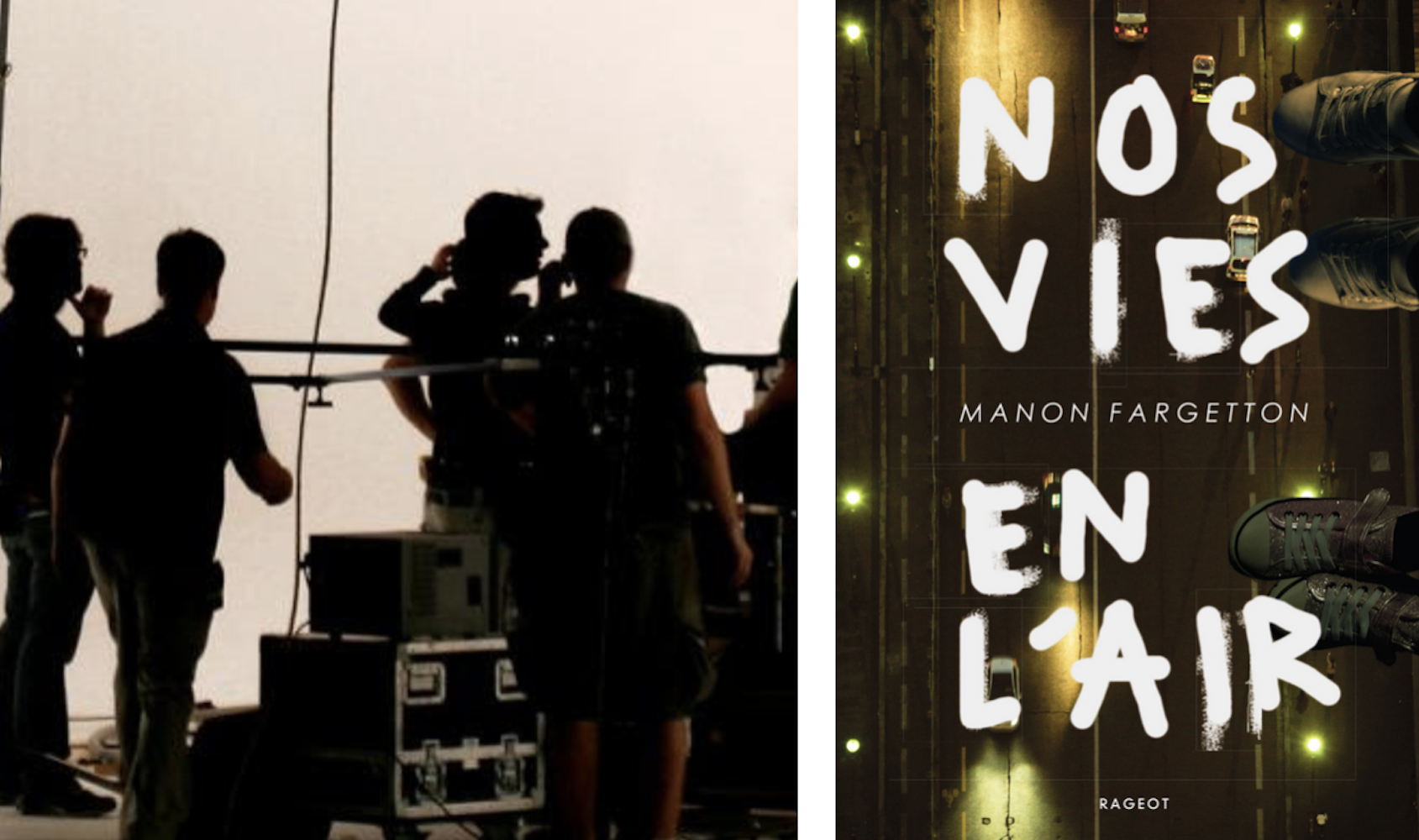


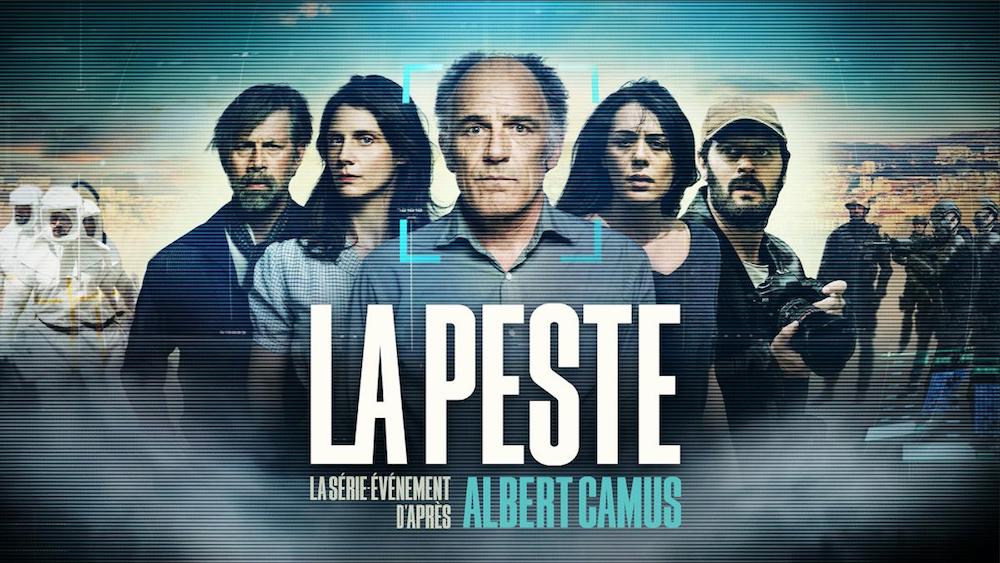












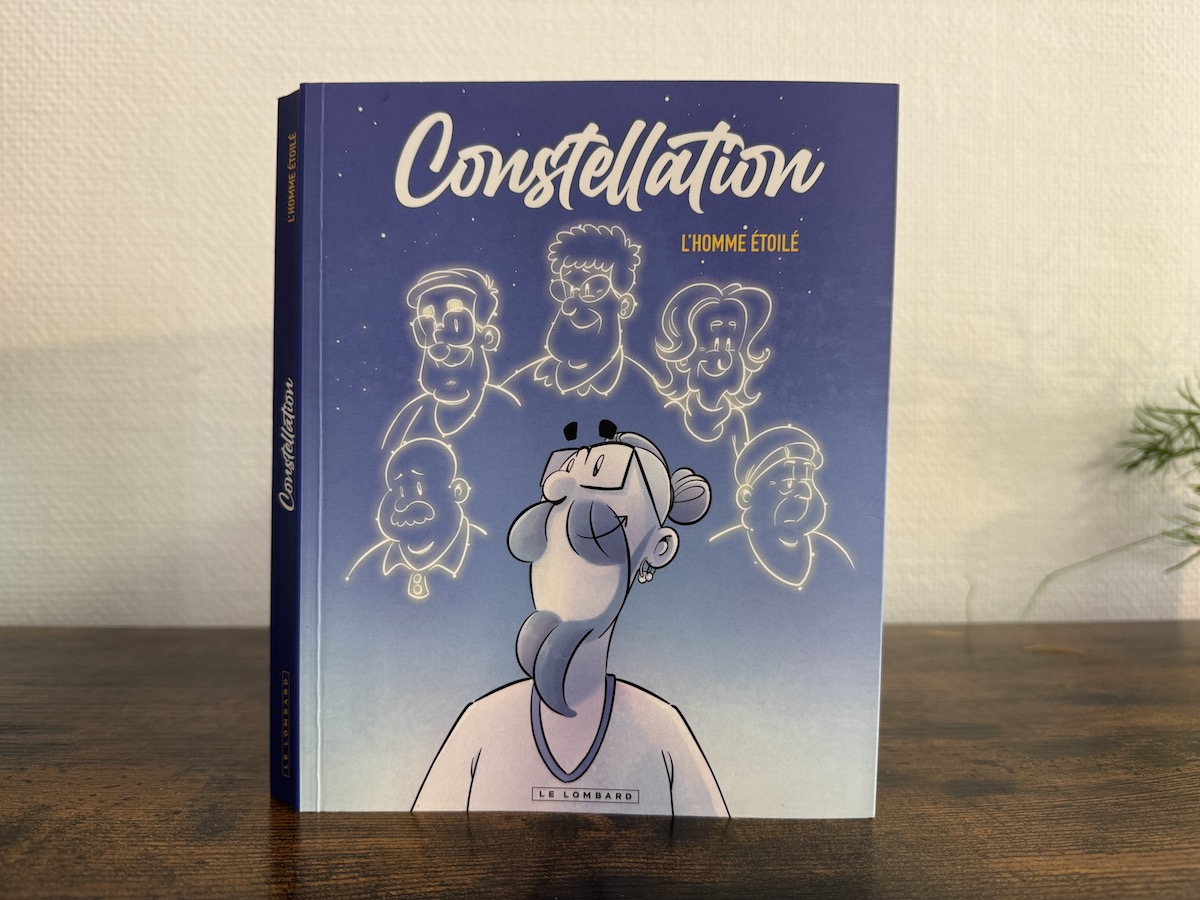


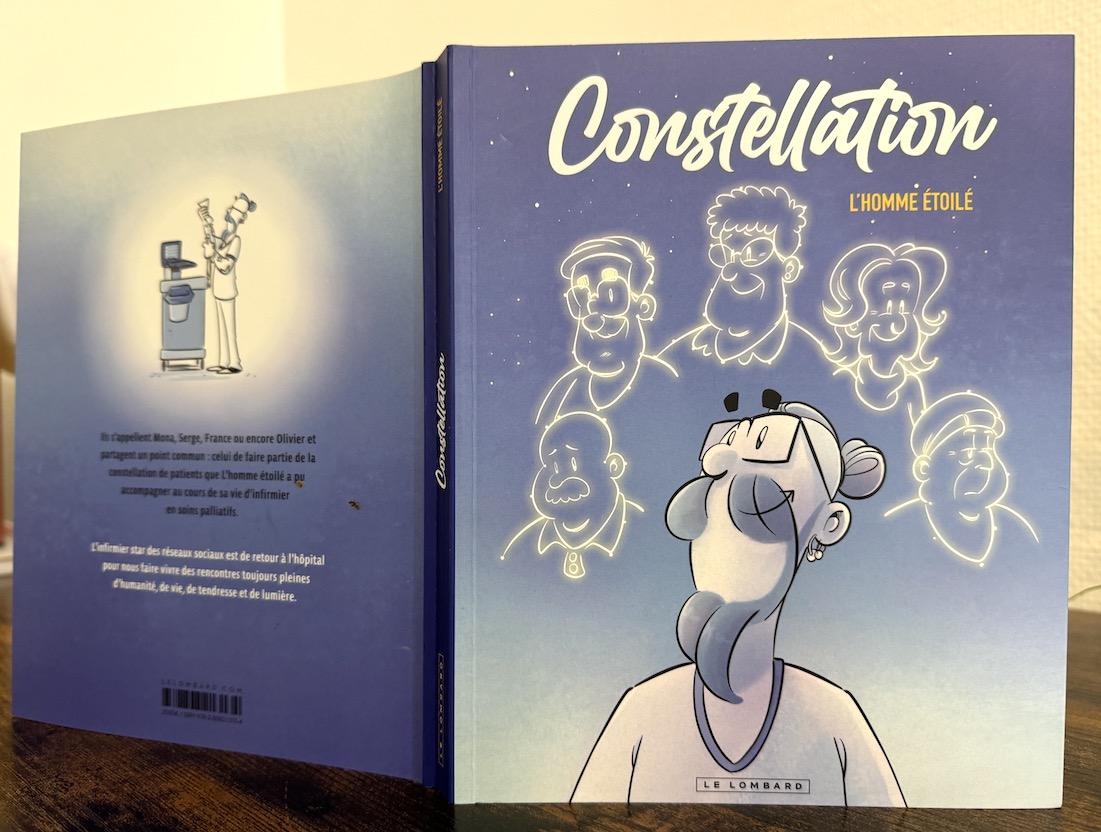



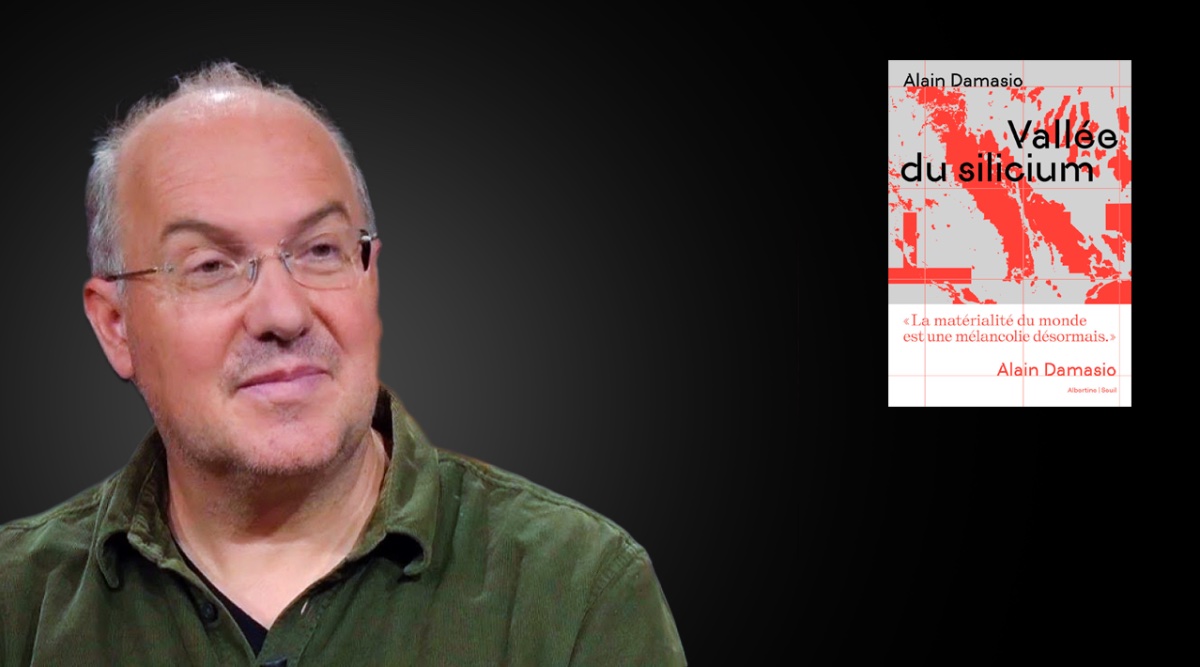







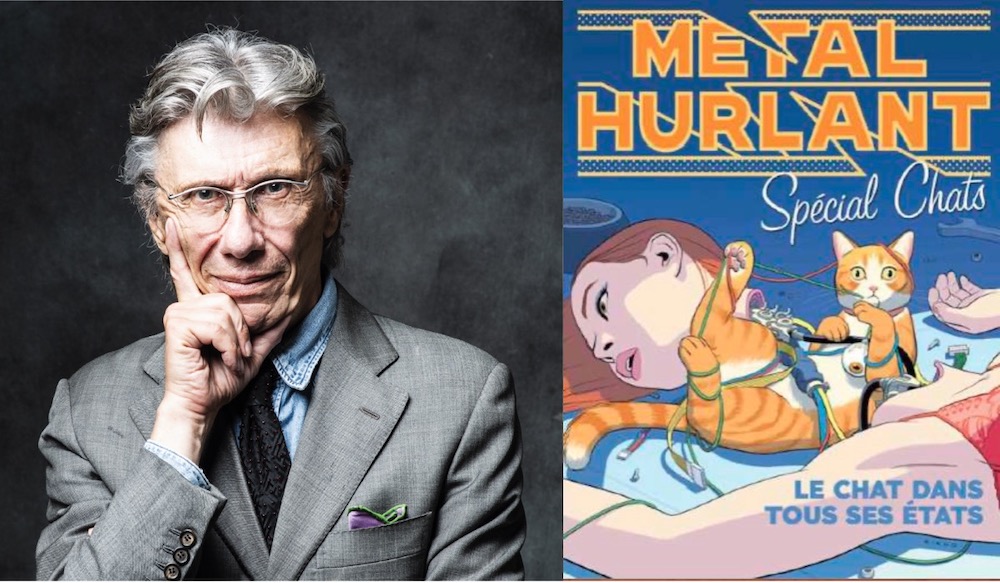















Commenter cet article