Notes de voyage de L. Jouannaud - "Pilote de guerre" d'Antoine Saint-Exupéry
En Arménie, 5 éditeurs publient Le Petit Prince (et ça reste un best-seller)
Le 19/11/2017 à 09:00 par Les ensablés
Publié le :
19/11/2017 à 09:00
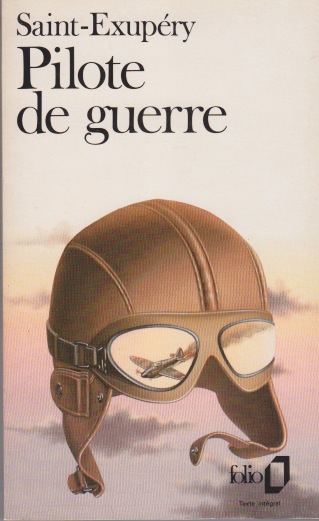
Antoine de Saint-Exupéry, après la défaite, a rejoint les USA en passant par l’Algérie puis le Portugal : il y arrive le 31 décembre 1940. Il quittera les USA pour l’Afrique du Nord le 13 avril 1943 et reprendra du service contre l’Allemagne nazie. La mission de reconnaissance du 31 juillet 1944 sur la région d’Annecy, à partir de la Corse, lui sera fatale : l’aviateur disparaît en Méditerranée. Il a publié deux livres pendant son séjour aux États-Unis : Pilote de guerre en février 1942 (parution en France en décembre 1942) et Le Petit Prince en avril 1943 (parution en France en 1946). On connaît bien Le Petit Prince, on ne parle pas souvent Pilote de guerre.
Par Laurent Jouannaud
Saint-Exupéry n’est pas un soldat de métier. Pilote dans l’aviation civile, mobilisé à la déclaration de guerre de 1939, il a demandé à piloter des avions militaires. Malgré son âge et une condition physique diminuée par trois accidents graves, il est intégré à une escadrille. Les 28 courts chapitres de Pilote de guerre racontent le vol de reconnaissance sur Arras du 23 mai 1940. Saint-Exupéry, avec un mitrailleur et un observateur, doit survoler la région et ramener des informations sur les forces allemandes qui s’y trouvent. C’est une mission inutile et dangereuse, explique Saint-Exupéry dès les premières pages, et « ces ordres sont absurdes ».
Cette mission est inutile parce que la guerre est perdue : les forces blindées allemandes sont entrées en France sans difficulté et occupent les points stratégiques. « On ne tiendra aucun compte de nos renseignements. Nous ne pourrons pas les transmettre. Les routes seront embouteillées. Les téléphones seront en panne. L’état-major aura déménagé d’urgence. » « Elles sont futiles, les missions exigées de nous. Chaque jour plus futiles. Plus sanglantes et plus futiles. »
C’est la débâcle : « Il est une immense forêt qui brûle, et quelques verres d’eau à sacrifier pour l’éteindre : on les sacrifiera. » Cette mission est dangereuse parce que les avions français ont des défauts graves et que l’ennemi a une chasse performante. L’avion de Saint-Exupéry ne vole en sécurité qu’à 10 000 mètres : l’approvisionnement en oxygène est alors défectueux et les manettes de direction gèlent. Mais il ne peut relever des informations qu’à une altitude beaucoup plus basse, ce qui en fait une proie facile. Ceux qui partent savent qu’ils vont probablement mourir.
Nous sommes dans l’avion de Saint-Exupéry, le 23 mai 1940, en pleine action : « — Paré, Dutertre ? – Paré. - Paré, le mitrailleur ? –Paré. - Alors on y va. » Il décolle. Il n’y aura pas de suspense : on sait que l’aviateur est revenu de sa mission puisqu’il la raconte. L’auteur renonce aux effets, à la mise en scène, à l’héroïsation : tel n’est pas l’esprit du texte. Et là n’est pas l’essentiel. Il y a tout de même deux temps forts, quand l’avion est pris en chasse, mais réussit à regagner de l’altitude et quand, en rase-mottes, l’avion est canardé par la défense anti-aérienne : « Quelle survie puis-je espérer ? Dix secondes ? Vingt secondes ? »
L’avion est touché : « Réservoirs d’huile, réservoirs d’essence, tout est crevé. » Mais les trois hommes sont indemnes, ils rentreront, ils seront en retard pour le repas du soir au mess. Ils seront accueillis dans le silence de la pudeur, et dans l’amour : « De nos missions, nous rentrons prêts pour une récompense au goût inconnu, qui est simplement l’amour. Nous n’y reconnaissons pas l’amour. L’amour auquel nous songeons est d’un pathétique plus tumultueux. Mais il s’agit, ici, de l’amour véritable : un réseau de liens qui fait devenir. » Il avait déjà connu cette expérience avec l’Aéropostale et ses amis Mermoz, Henri Guillaumet, Marcel Reine. C’est pour la revivre qu’il revolera en 1944.
L’essentiel du récit, et les pages les plus nombreuses, ce sont les réflexions de Saint-Exupéry sur l’état des choses. Ces réflexions à chaud sont plus des réactions et des intuitions que des assertions mûrement pesées. Un homme, dont l’intelligence, l’intégrité, le courage, l’anti-antisémitisme et le patriotisme sont indéniables, essaie de comprendre comment ce grand drame, la défaite, a pu se produire si vite, si complètement. Il se demande ce qu’il aurait fallu faire, ce qu’il faudra faire : il hésite à trancher, certaines formulations en contredisent d’autres. [NdR : Dans Pilote de guerre, Saint-Exupéry évoque le pilote Israël, disparu en mission, « l’un des plus courageux camarades du groupe », et son ami l’écrivain Léon Werth, juif, pacifiste convaincu. Évoquer ces deux noms, après la publication des scélérates lois antisémites de Vichy, c’était prendre position.]
Du haut des airs, il voit les Français fuir en masse dans des conditions de fortune. La France du Nord part se réfugier dans le Sud. « Je survole donc des routes noires de l’interminable sirop qui n’en finit plus de couler. On évacue, dit-on, les populations. Ce n’est déjà plus vrai. Elles s’évacuent d’elles-mêmes. Il est une contagion démente dans cet exode. Car où vont-ils ces vagabonds ? » Cette fuite est absurde : « Où vont-ils ? Ils ne savent pas ! Ils marchent vers des escales fantômes, car à peine cette caravane aborde-t-elle une oasis que déjà il n’y a plus d’oasis. Chaque oasis craque à son tour et se déverse dans la caravane. » « Ils se mettent en marche vers le Sud, comme s’il était, là-bas, des logements et des aliments, comme s’il était, là-bas, des tendresses pour les accueillir. »
Un lieutenant d’artillerie veut mettre en place une batterie qui deviendrait la cible de l’aviation ennemie : la foule de fuyards l’en empêche par crainte de la riposte. Un camion militaire remonte vers le Nord, les mères veulent l’utiliser pour fuir plus vite vers le Sud. Que faire ? Les soldats rejoignent les fuyards, font monter les enfants et une femme qui accouche : « Ces soldats ignorent, dans la peine qu’ils se donnent, s’ils sont des héros ou s’ils sont passibles du conseil de guerre. Ils ne s’étonneraient guère d’être décorés. Ni d’être alignés contre un mur avec douze balles dans le crâne. » « La guerre est détraquée ». Les fugitifs veulent la paix. Ils l’auront : ce sera l’armistice vite conclu par Pétain avec l’ennemi.
L’armistice ? Pétain ? De Gaulle ou Giraud ? Résister ? Collaborer ? Rester ou fuir ? Se cacher ? Quitter Paris ou rester à Paris ? Jouer double jeu ? On en discute toujours aujourd’hui. Mon cher Hervé, en littérature et au cinéma, la Seconde Guerre mondiale n’est pas encore terminée. C’est notre guerre de Troie, elle fournira encore longtemps du matériau pour mainte Iliade et mainte Odyssée. [NdR Les deux grands prix de la rentrée 2017, le Goncourt et le Renaudot, ont couronné un roman racontant les prodromes de la guerre et un autre racontant une de ses innombrables séquelles.]
En tout cas, les aviateurs obéissent aux ordres. Saint-Exupéry obéit aux ordres. Des ordres absurdes et inutiles ? « Rien ne sert à rien. » « Aucun sacrifice jamais, nulle part, n’est susceptible de ralentir l’avance allemande. » Certes, mais ce n’est pas aux pilotes de juger de la situation. Ou plus exactement, le pilote sait que son jugement personnel doit céder devant les ordres de ses supérieurs. Il faut effectuer la mission qui vous est imposée. D’ailleurs, dans cette escadrille, tous les pilotes sont volontaires : « Volontaires ? Nous sommes tous, toujours, volontaires pour toutes les missions. »
Aucun ne se dérobe à la mort. Le courage et l’héroïsme sont ici décrits avec sobriété, sans pathos. Pourquoi cet héroïsme ? « Ainsi, nous, du Groupe 2/33, pourquoi acceptons-nous encore de mourir ? » Il vient plusieurs réponses : « Je crois très simplement que ceux qui sont morts servent de caution aux autres. » La France joue le jeu : « C’est pour jouer le jeu que nos hommes meurent. » Ce quasi-suicide doit contribuer à « éviter la honte » : la honte de la défaite. Il y a la solidarité du groupe. Gagner le respect d’hommes comme Gavoille, Israël, Alias, Hochedé, cela a un prix : « J’étais des leurs », « ce droit-là s’achète très cher ». Il y a la conscience claire que le sacrifice, même inutile, aura sa dynamique : « Je sais bien que pour créer l’arbre on condamne une graine à pourrir. Le premier acte de résistance, s’il survient trop tard, est toujours perdant. Mais il est éveil de la résistance. Un arbre peut-être sortira de lui comme d’une graine. » Et il y a l’amour du pays : « Je suis de France. »
Saint-Exupéry est déjà un écrivain célèbre (Prix Fémina en 1931 et Grand Prix du roman de l’Académie française en 1939), il a des relations. Il pourrait être affecté à l’arrière dans un bureau, sans passer pour autant pour un planqué. Mais Saint-Ex veut agir : il ne confond pas classer des documents, faire des conférences, écrire des livres, et risquer sa vie à l’avant. L’action implique un risque réel. Saint-Exupéry se méfie des intellectuels et des bavards. Il oppose les mots à l’être, et on peut être certain qu’il mépriserait notre société du spectacle : « Le métier de témoin m’a toujours fait horreur. Que suis-je, si je ne participe pas ? J’ai besoin, pour être, de participer. » Voir, regarder, raconter, écrire, ce n’est pas vraiment participer : « Un Être n’est pas de l’empire du langage, mais de celui des actes. »
Quel sera l’avenir ? Saint-Exupéry termine son livre par une grande méditation sur l’essence de la civilisation. Il utilise en partie le matériau qui constitue Citadelle, livre posthume et inachevé. Saint-Exupéry estime que l’Intelligence a tué l’Esprit. Il oppose l’Homme à l’Individu : « L’Humanisme s’est donné pour mission exclusive d’éclairer et de perpétuer la primauté de l’Homme sur l’individu. » Mais, dit-il, l’Humanisme moderne a rabaissé l’Égalité à l’identité, la Liberté à la licence et la Charité à la pitié. Saint-Exupéry aime l’image de la cathédrale où chaque pierre joue un rôle, où chaque pierre supporte l’édifice entier, où le tas de pierres se transcende.
Le mot Dieu apparaît, Saint-Exupéry retrouve la religion : « Chacun est seul responsable de tous. Je comprends pour la première fois l’un des mystères de la religion dont est sortie la civilisation que je revendique comme mienne : porter les péchés des hommes... Et chacun porte tous les péchés de tous les hommes. » Mais les totalitarismes eux aussi veulent que l’individu se dépasse dans la collectivité : Saint-Exupéry cherche donc à distinguer Communauté et État… Il cherche des solutions à des questions toujours ouvertes. Certaines formules semblent faites pour aujourd’hui : « Nous avons failli crever en France de l’intelligence sans substance. » Mais j’imagine que Saint-Exupéry avait des doutes en écrivant Pilote de guerre, car tout artiste a du mal à rester dans le rang. Il écrit en effet : « Je combattrai pour l’Homme. Contre ses ennemis. Mais aussi contre moi-même. »
Le Petit Prince a éclipsé Pilote de guerre. Comment peut-on écrire en si peu d’intervalle ce récit de guerre et ce conte poétique ? On imagine mal le petit prince au volant d’un avion ! De fait, les deux œuvres ne vont pas dans le même sens. Si je me souviens bien, le petit prince ne se sent responsable que de la rose qu’il a laissée sur son étoile. Il a visité d’autres astéroïdes habités par des individus bien médiocres et il n’a pas l’intention de voir en eux les pierres d’un ensemble.
À la fin, il veut rentrer chez lui, car la Terre ne l’intéresse guère. Il veut bien se faire des amis, mais seulement ceux qu’il s’est choisis, comme le renard ou l’auteur. Il n’a pas l’idée de former une cathédrale où chacun aurait à sa place et son rôle ! Le succès du Petit Prince, c’est que son héros fragile est individualiste et indépendant. Pilote de guerre prêchait la responsabilité de tous pour tous, mais c’est l’égoïsme tranquille du petit prince blond et innocent qui a séduit le monde entier : « Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince, afin de se souvenir. » Nous avons préféré l’Individu à l’Homme, et il doit y avoir quelques bonnes raisons pour cela. Droits de l’Individu ou Droits de l’Homme ? Saint-Exupéry est encore d’actualité.

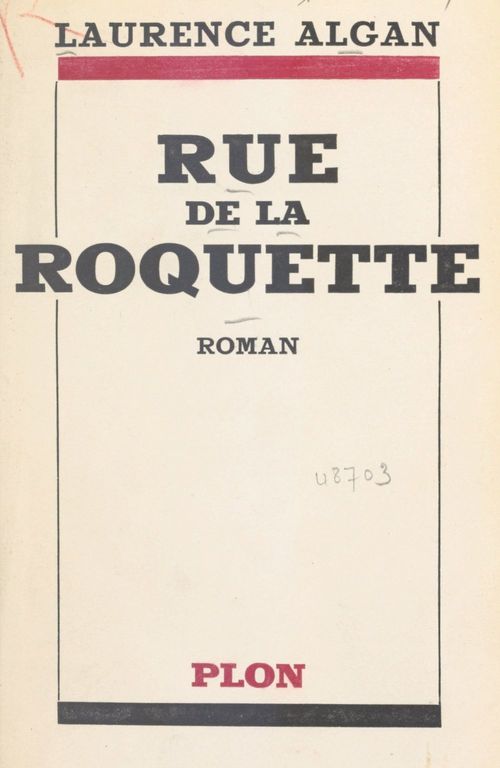
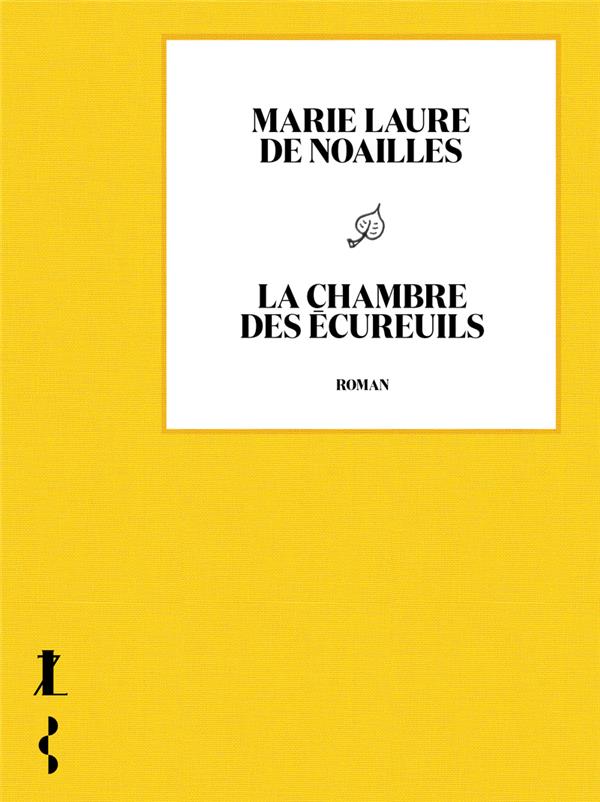
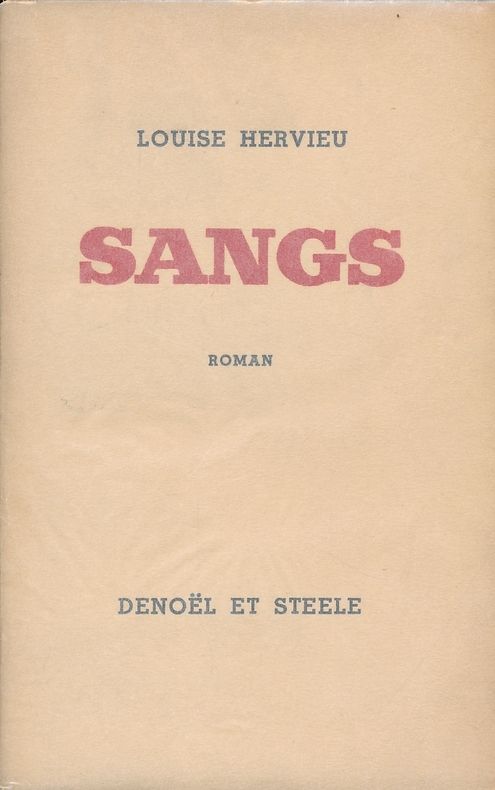
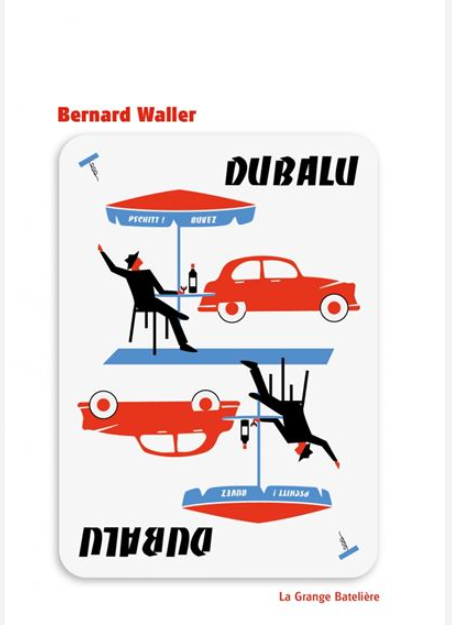
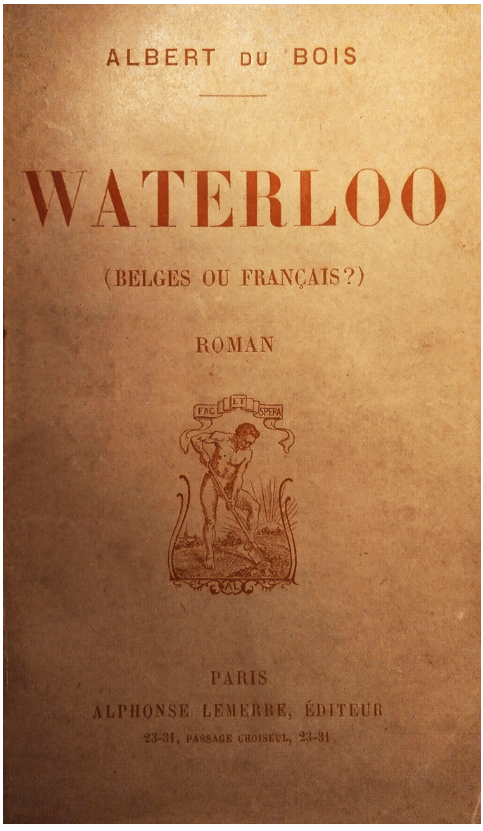
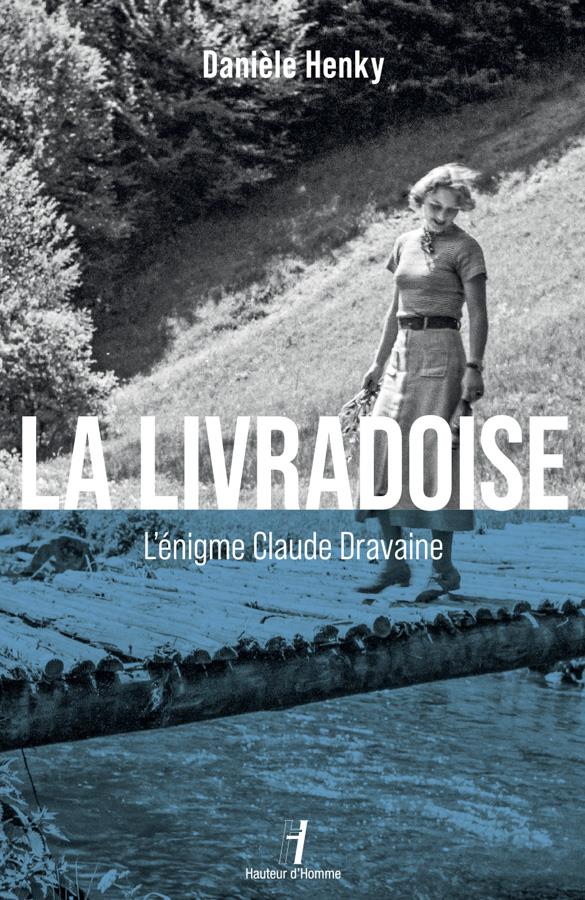
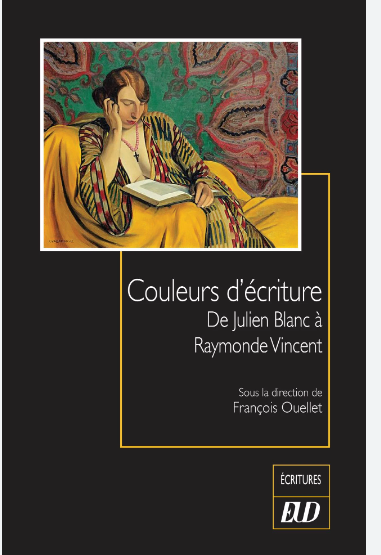
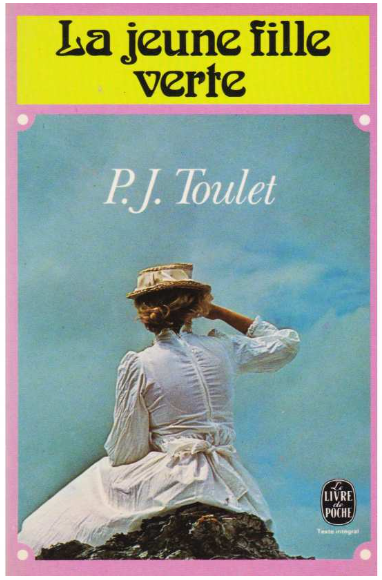
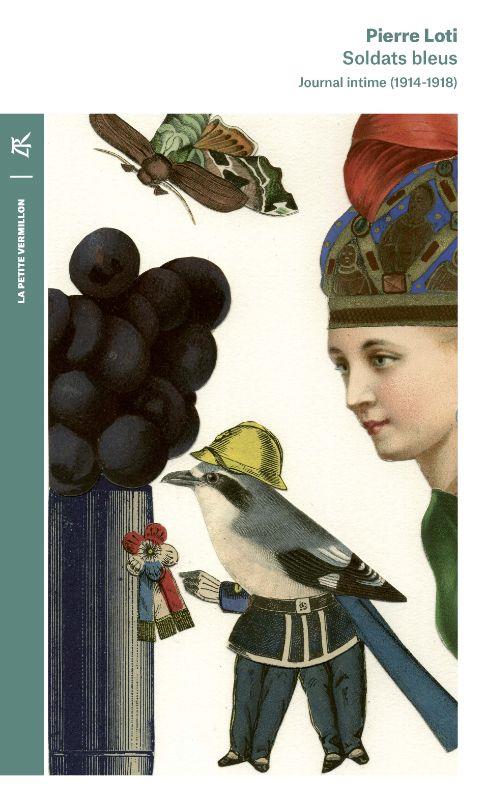
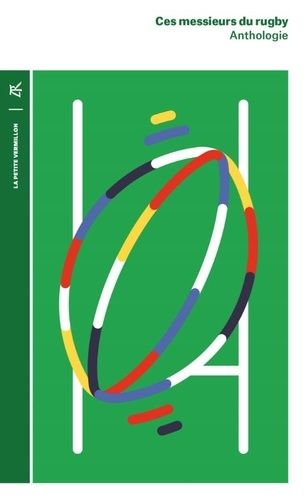
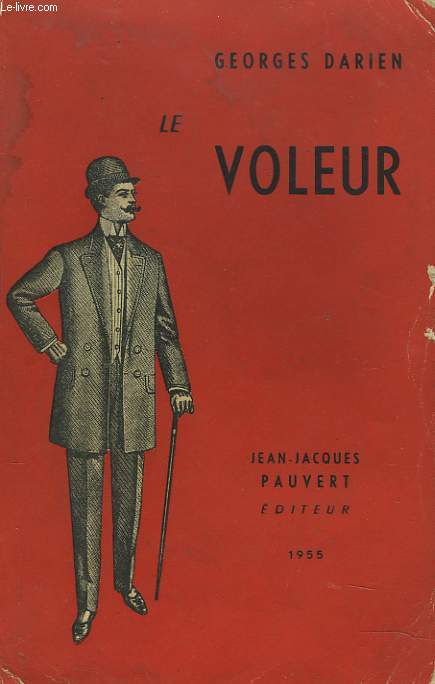
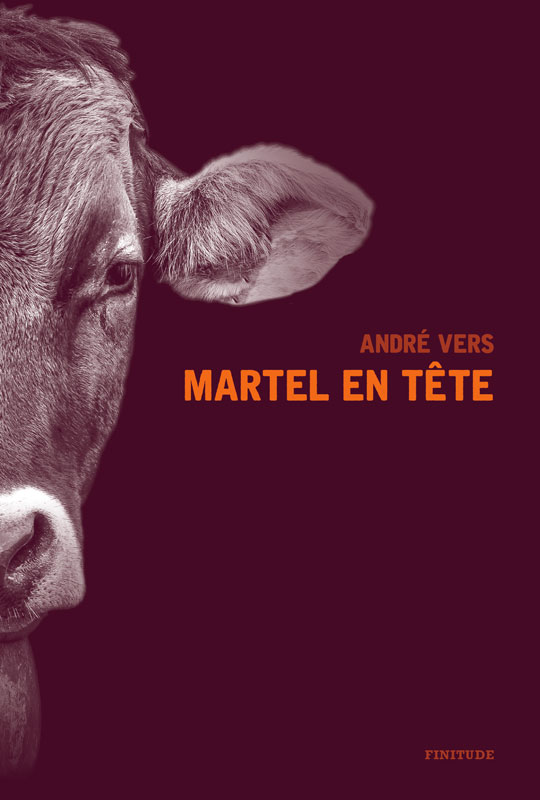

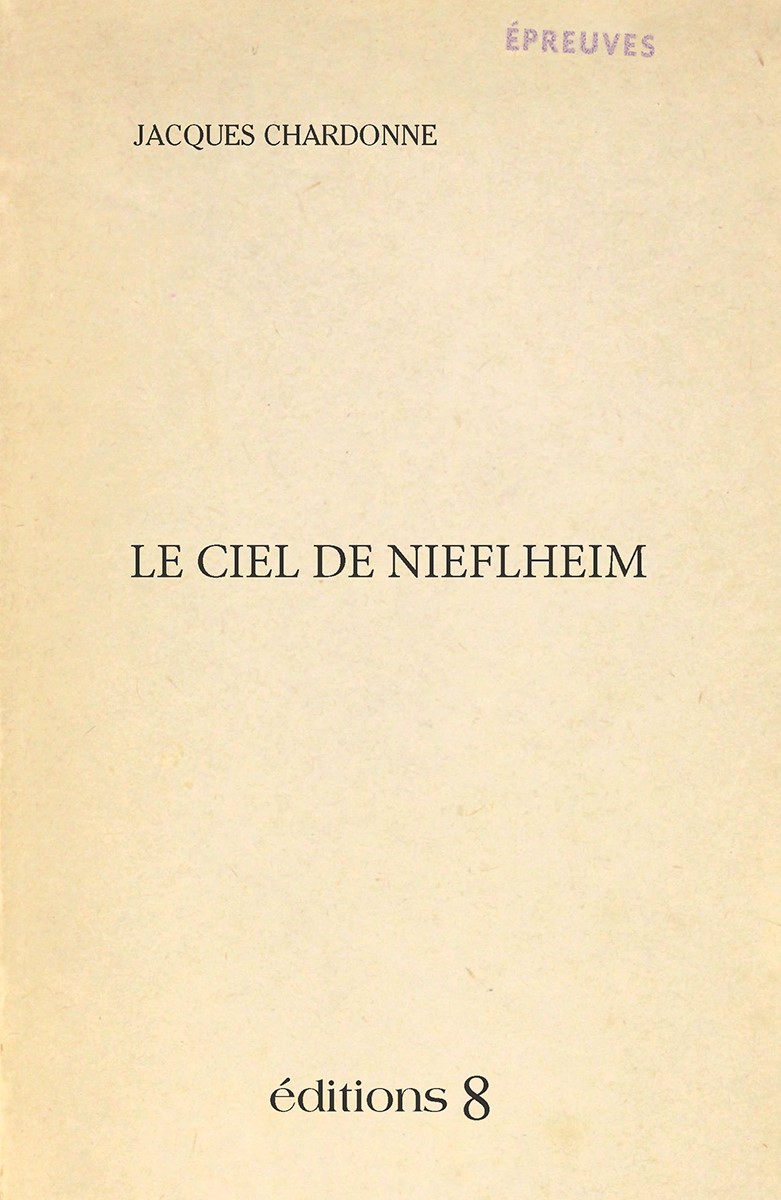
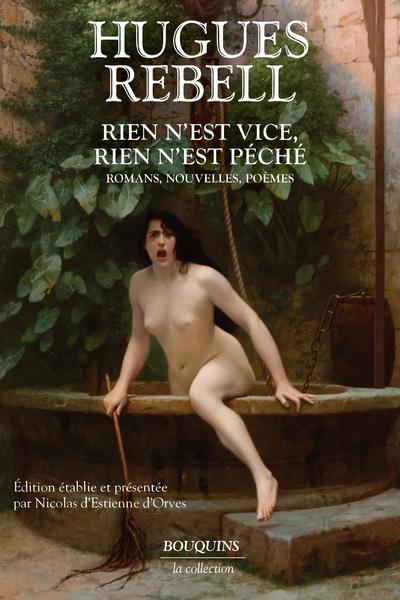
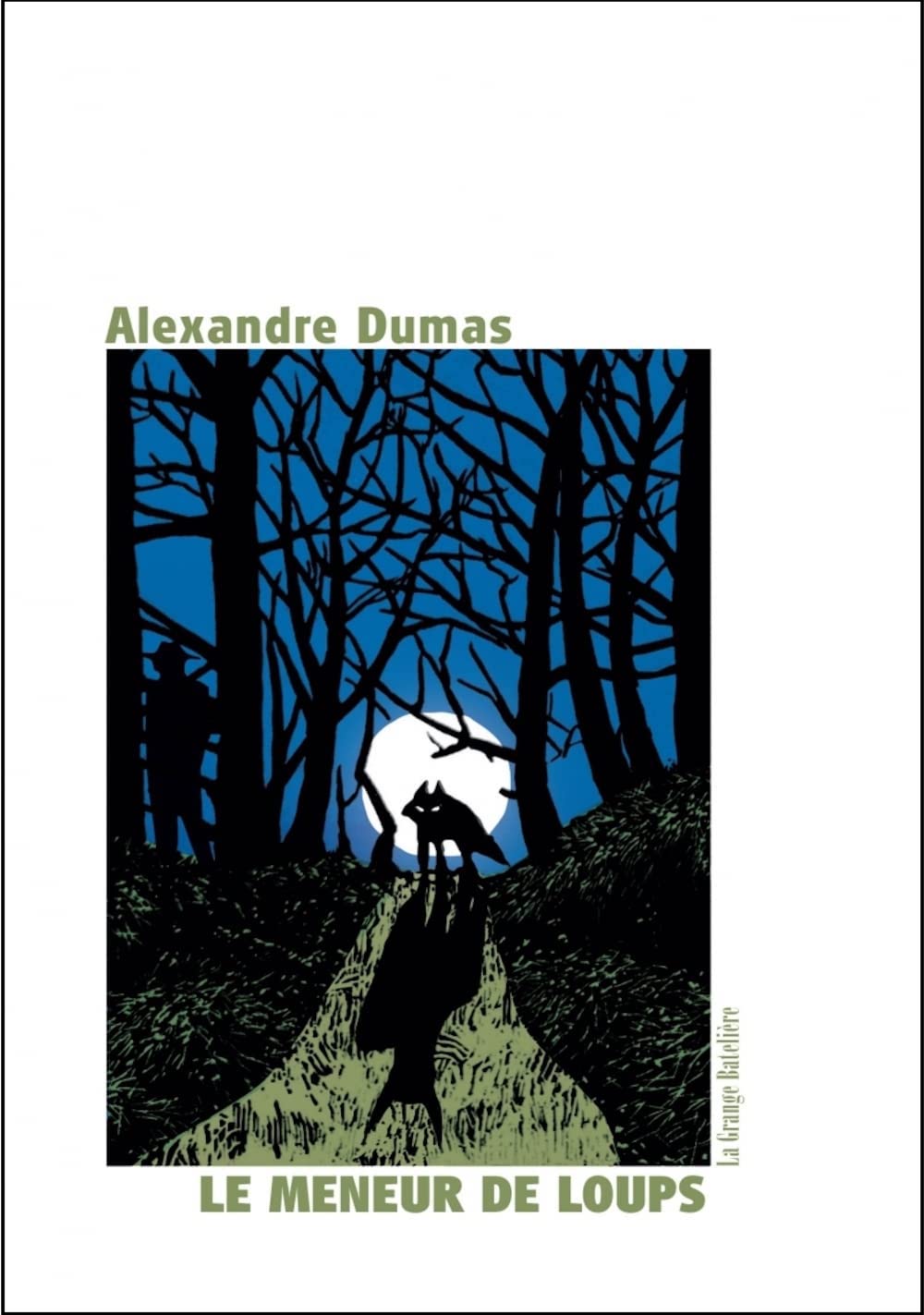
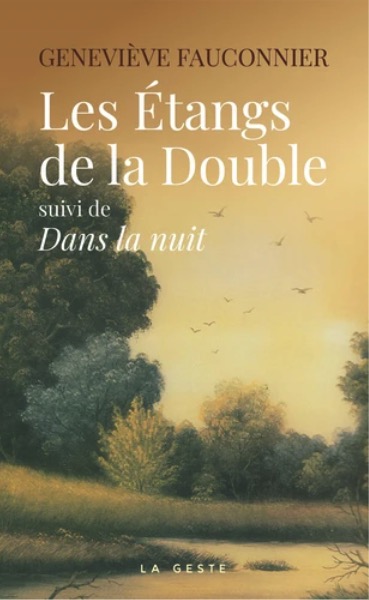
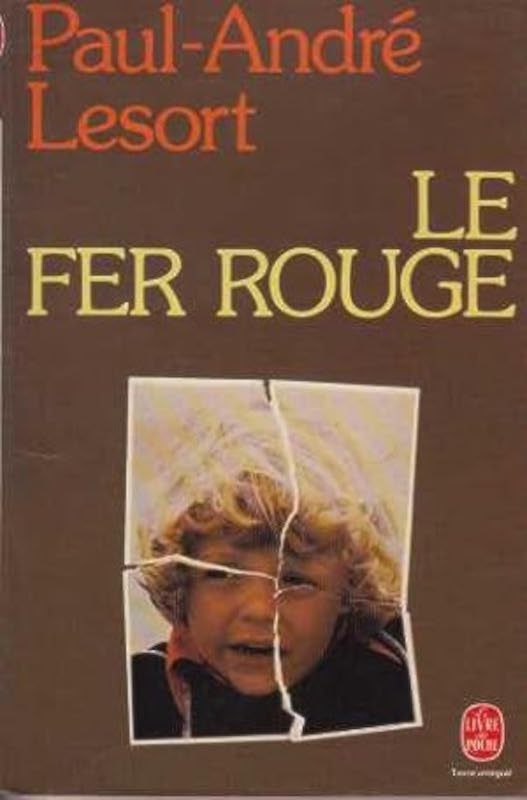

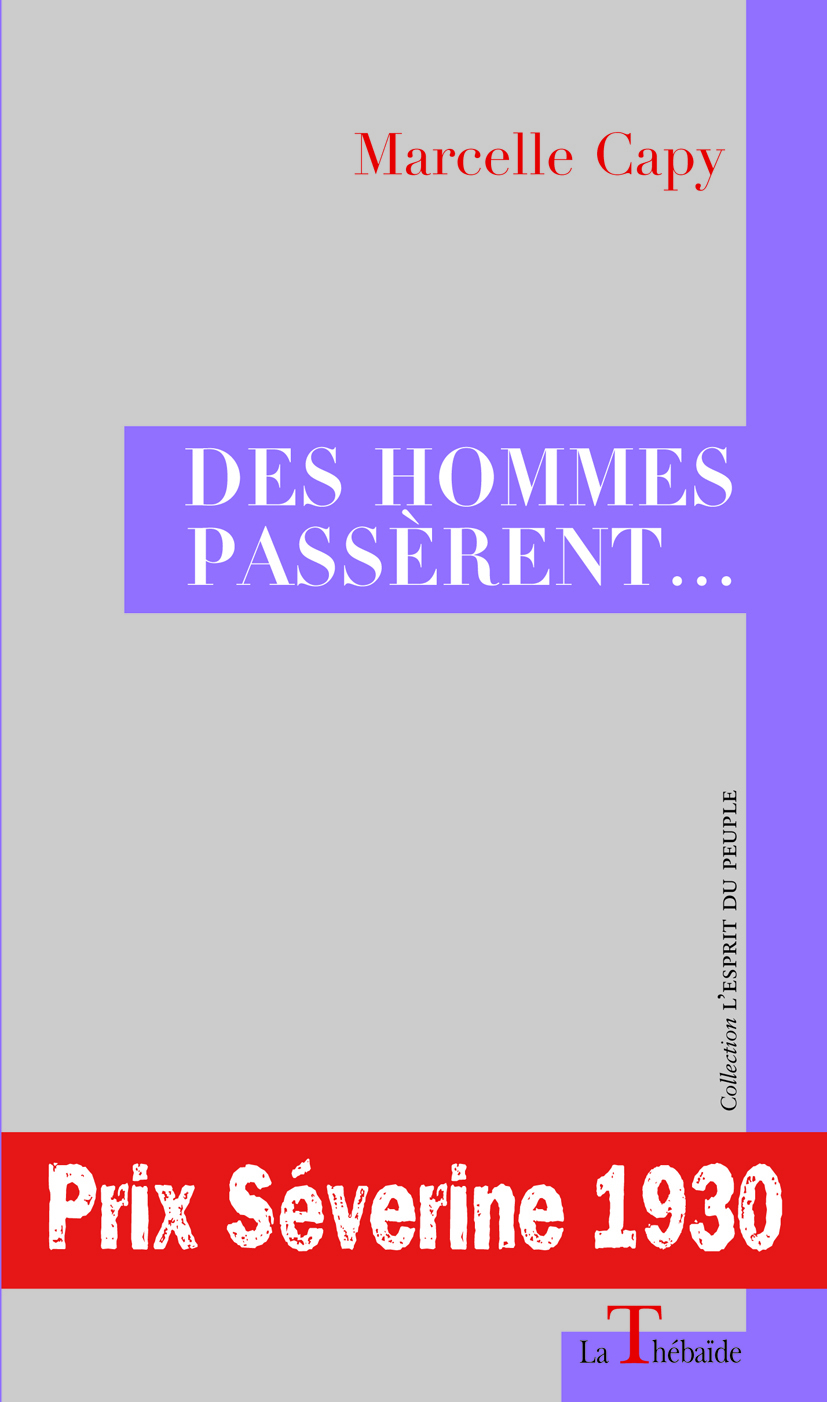
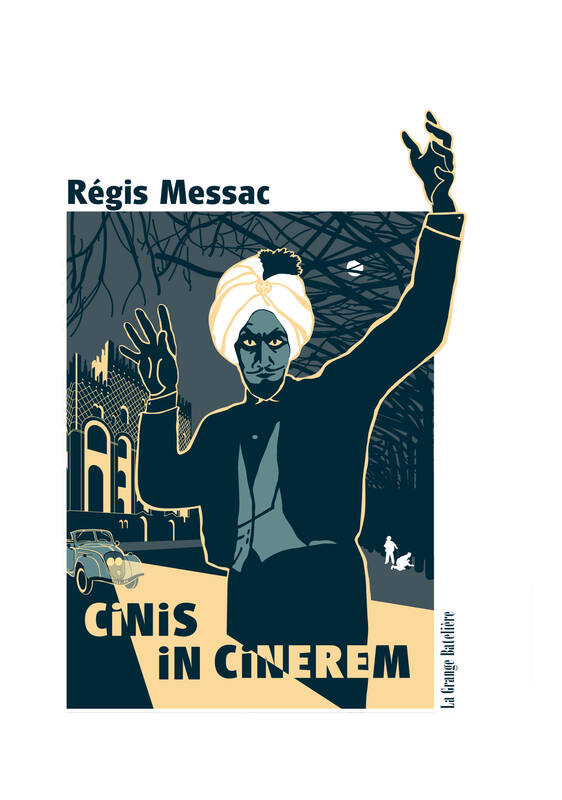
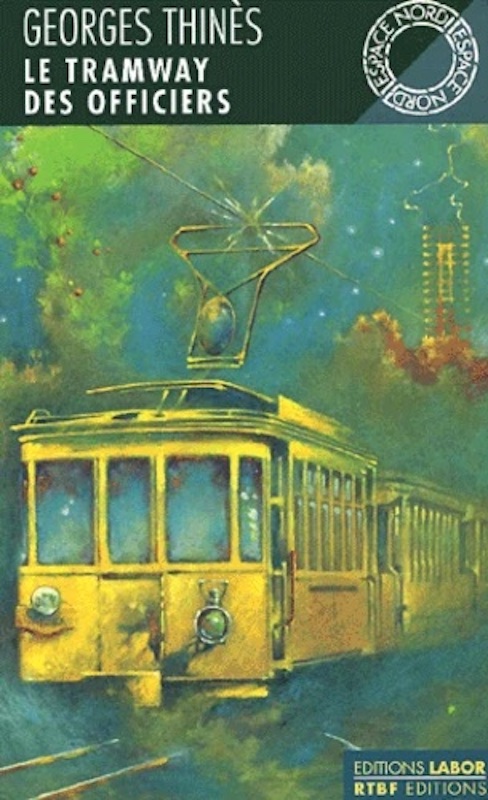
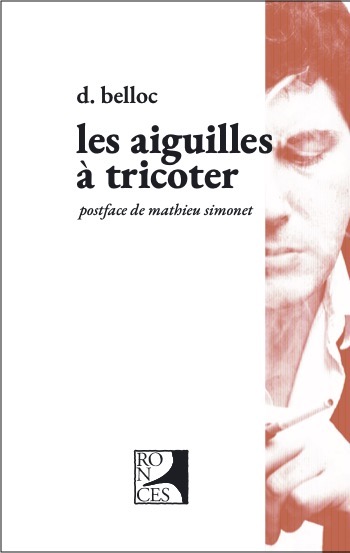
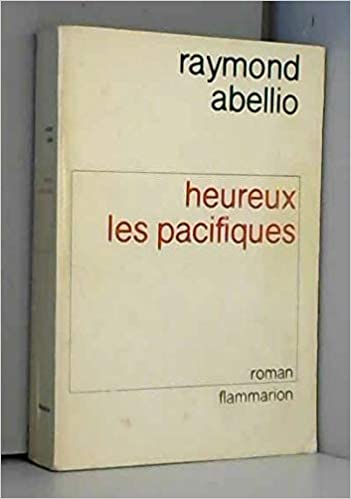
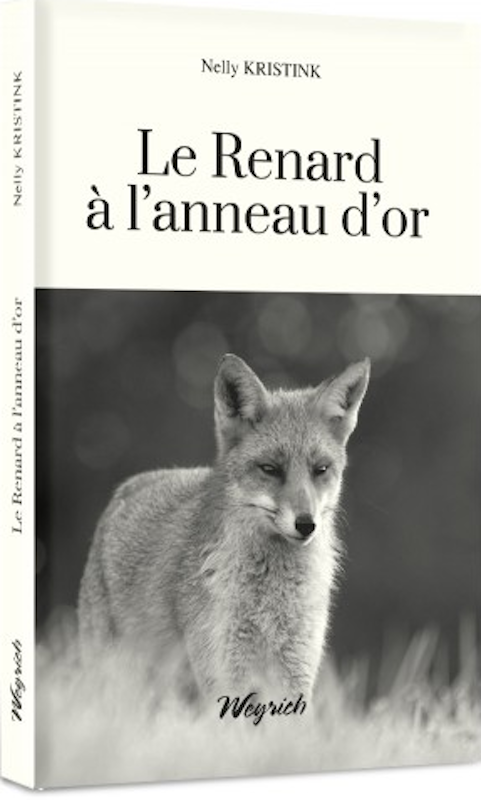
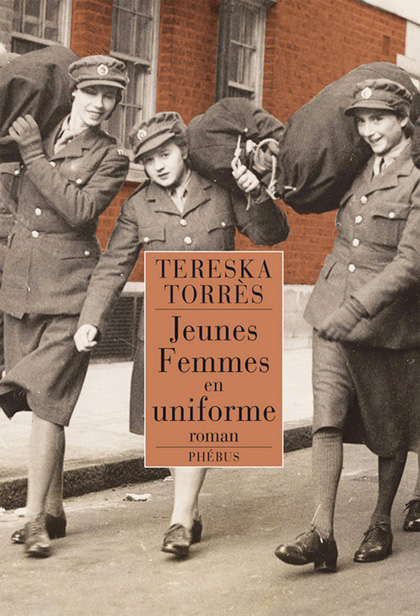
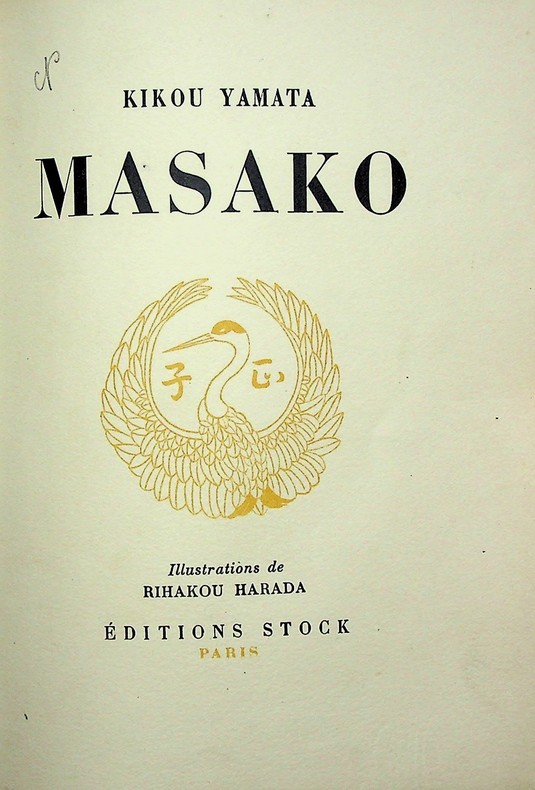
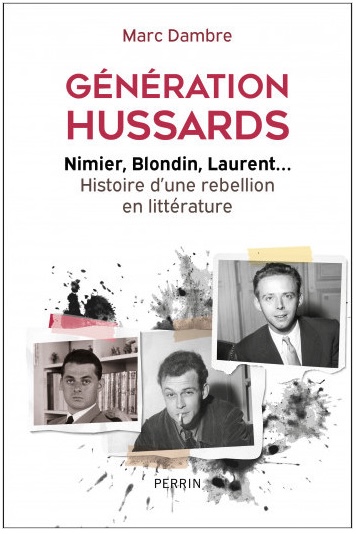
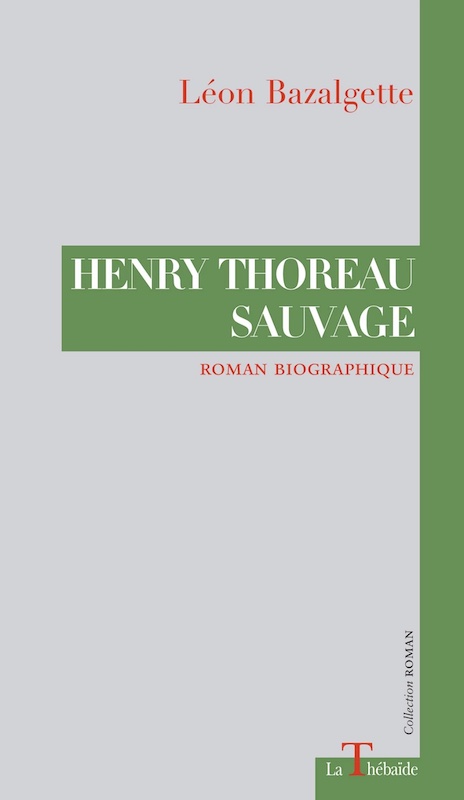
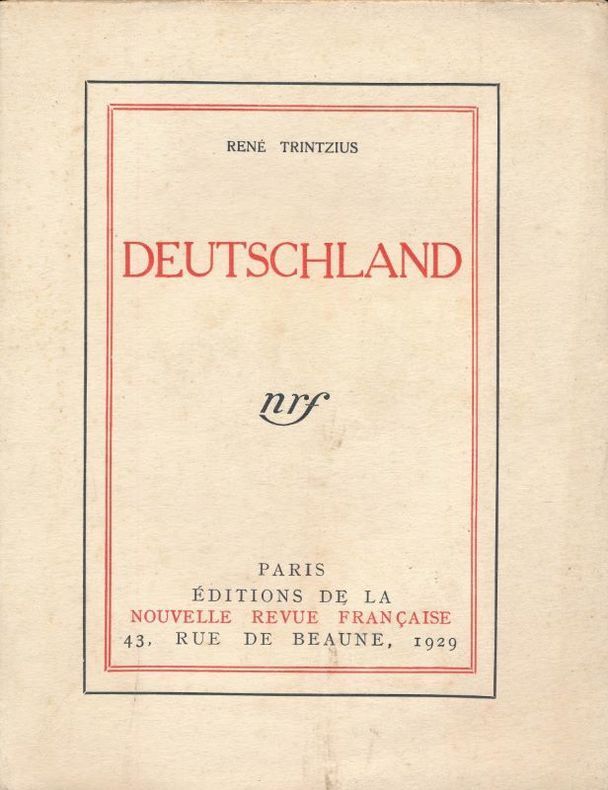
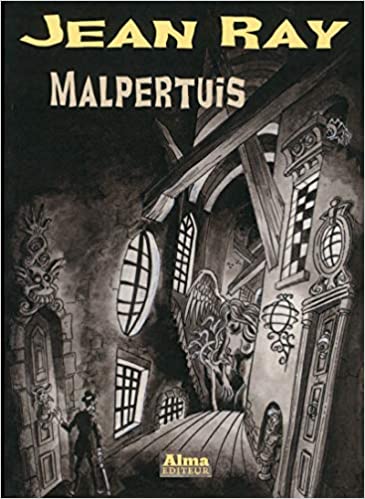
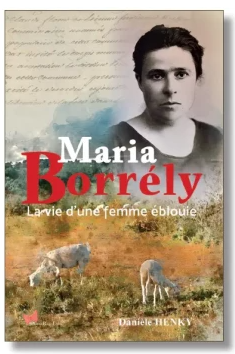
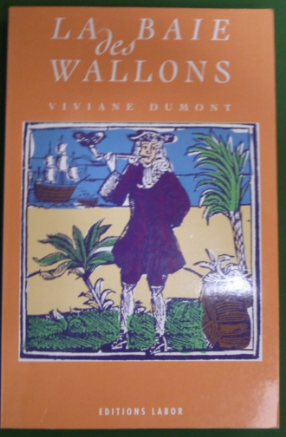
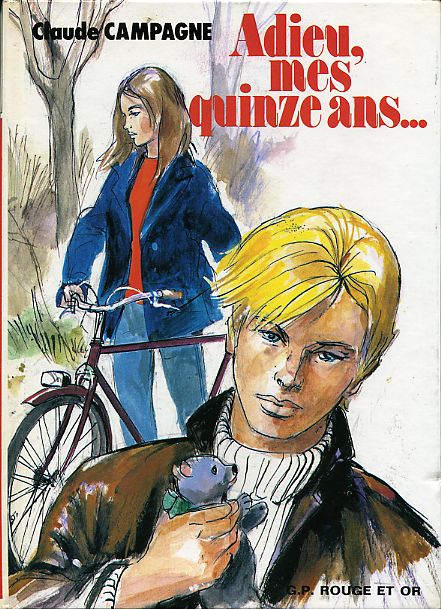
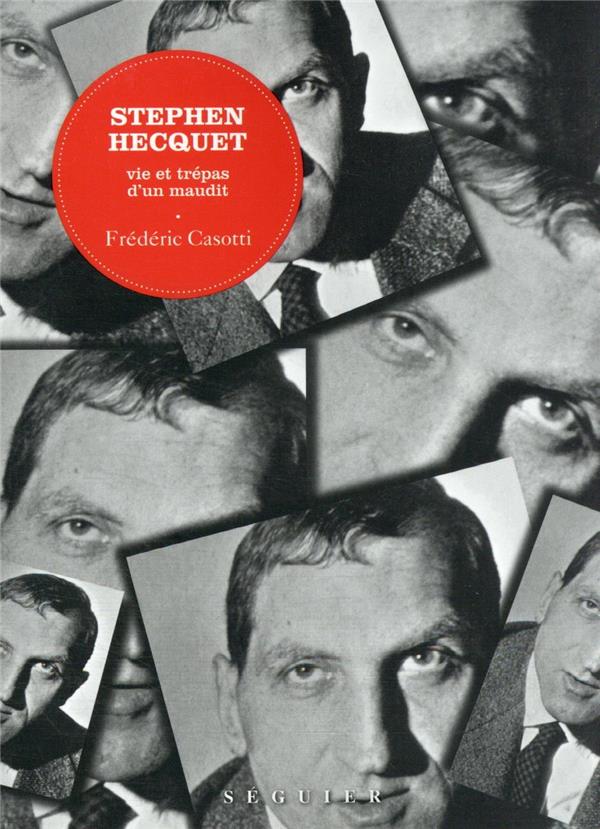
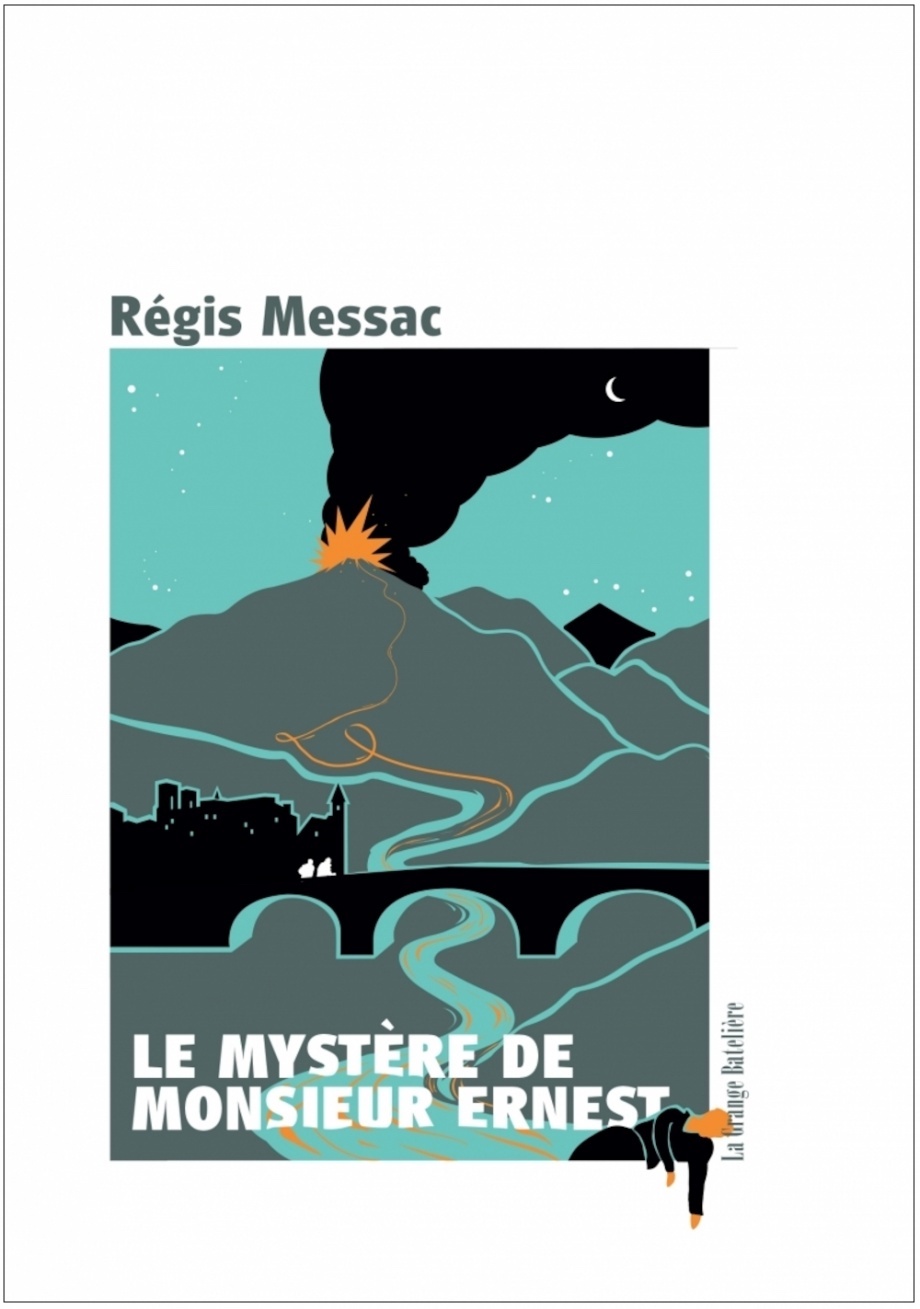


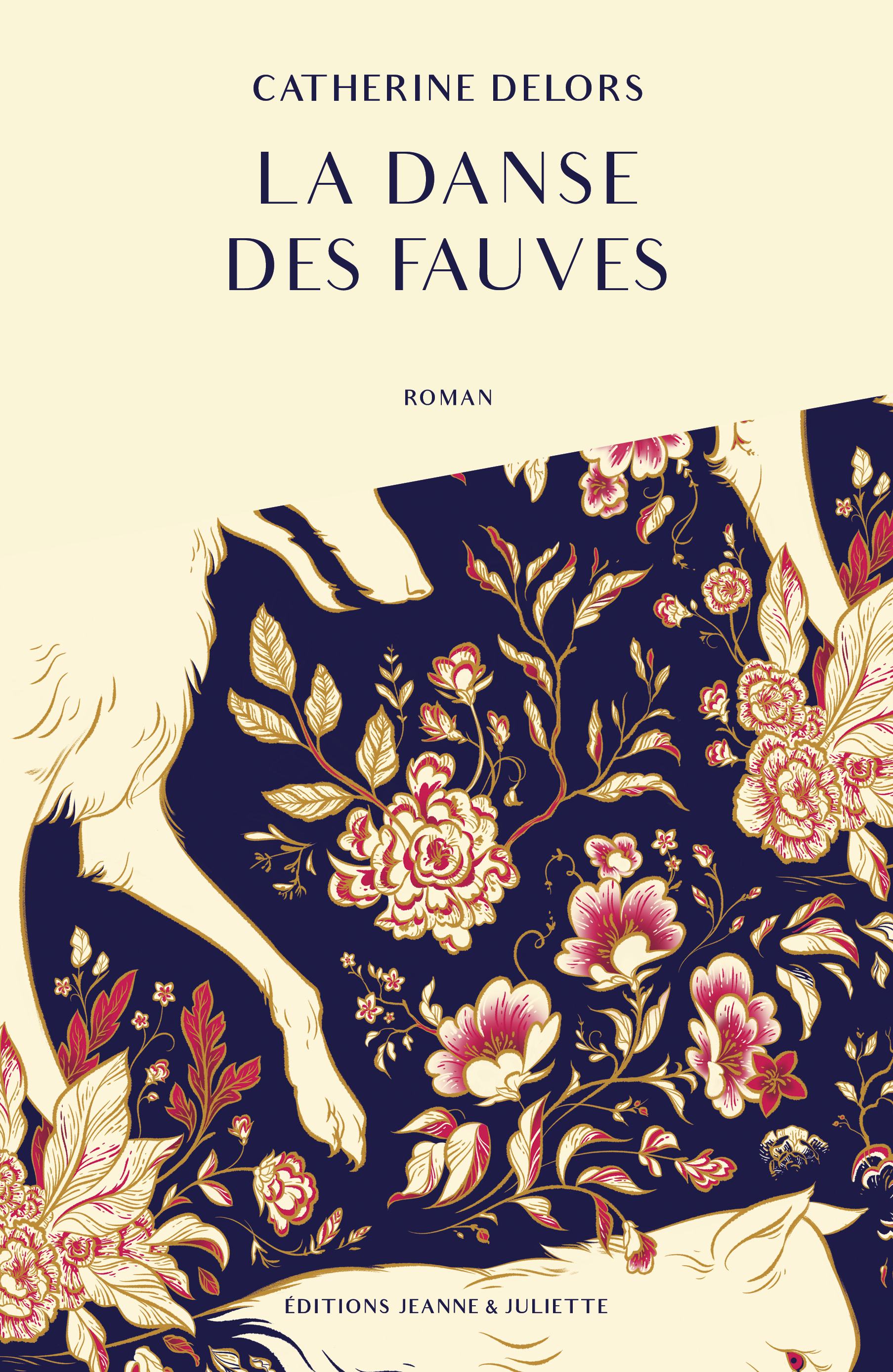
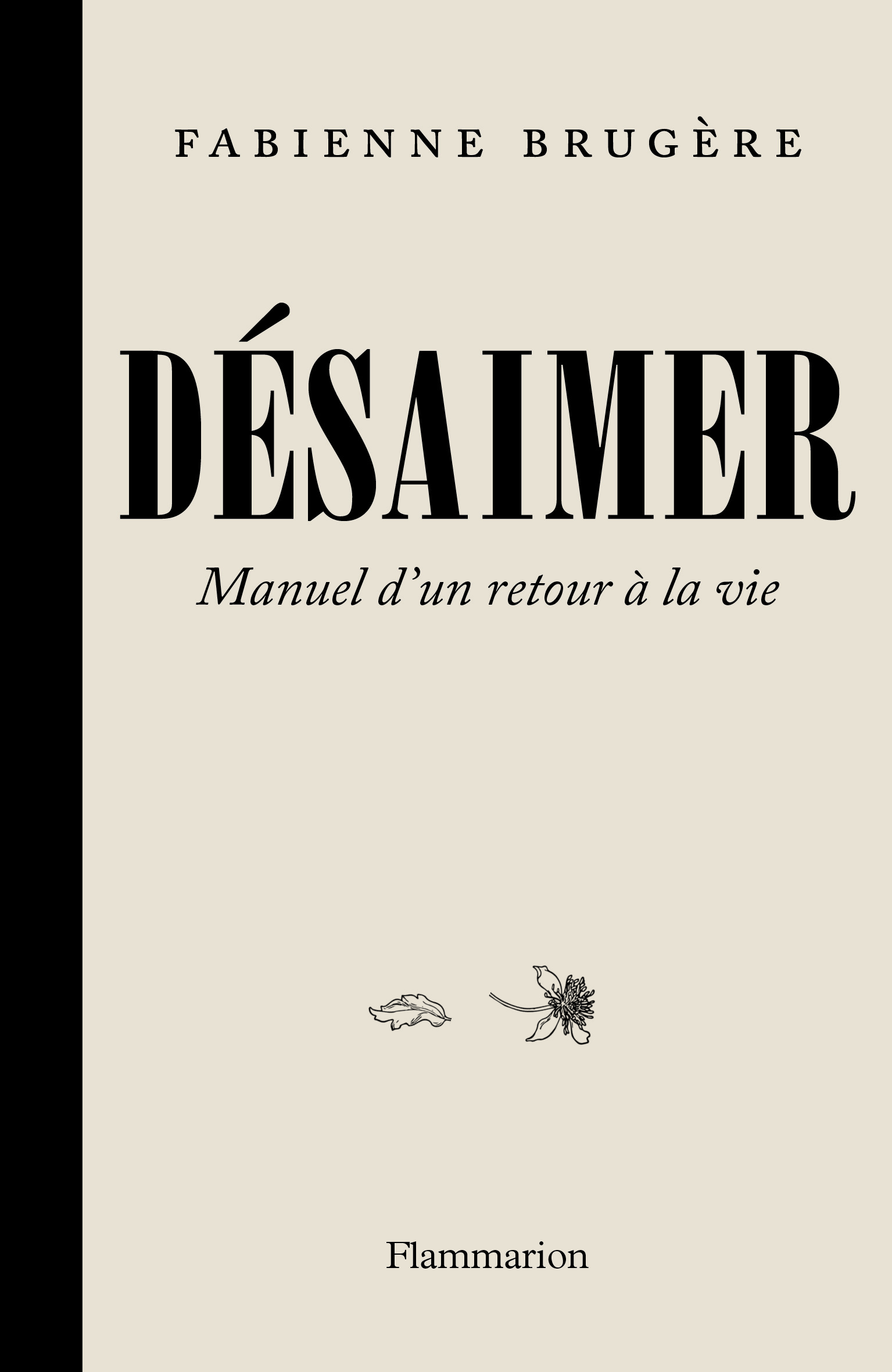
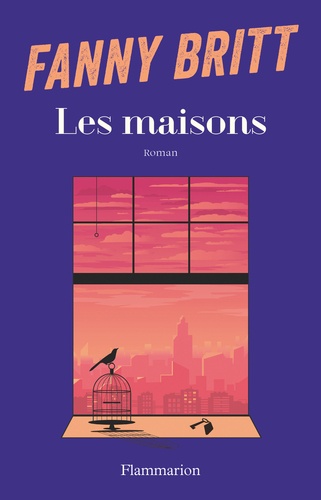
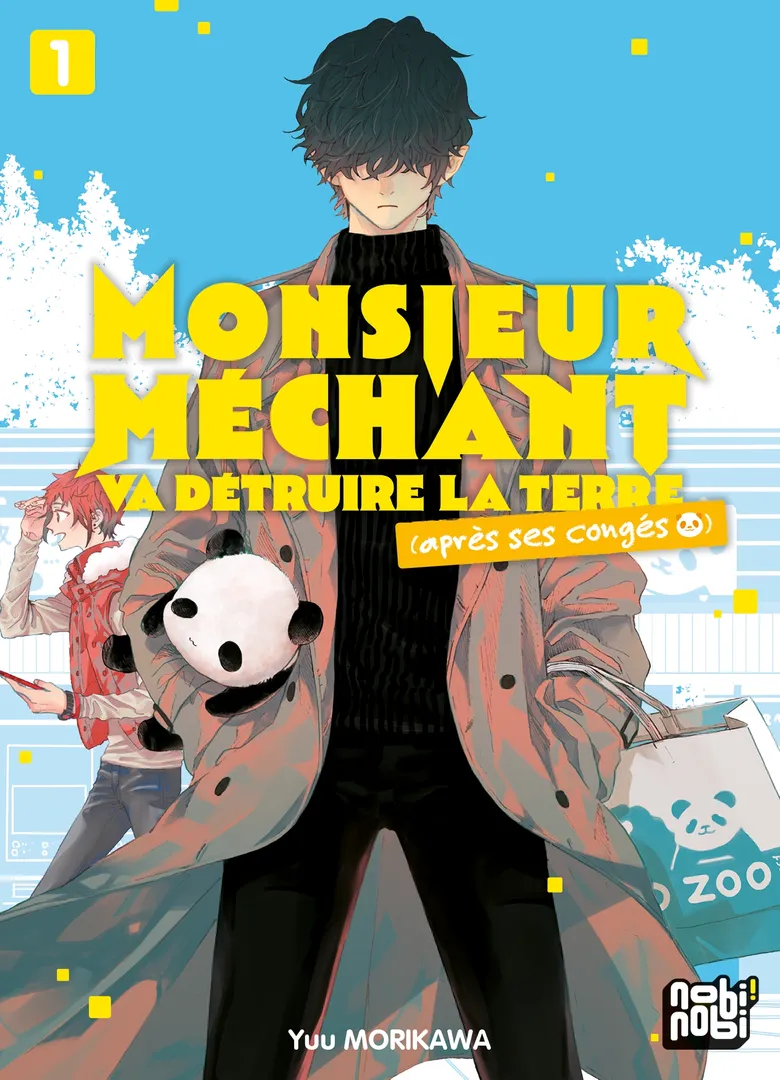

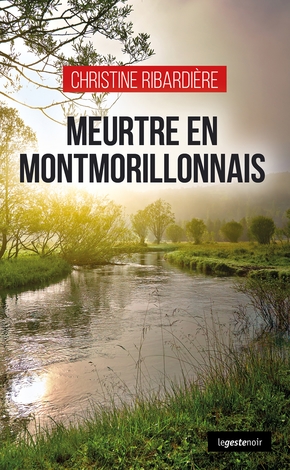
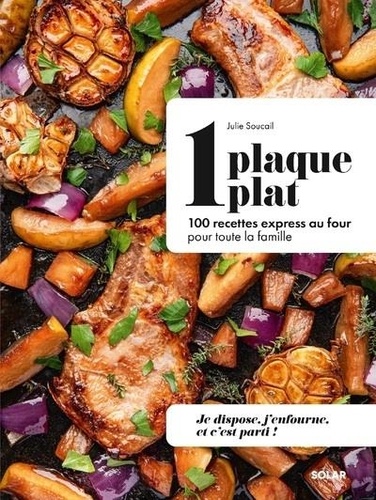
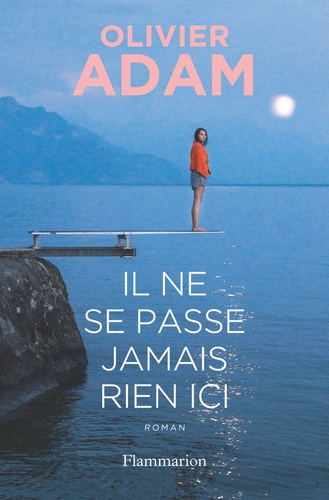
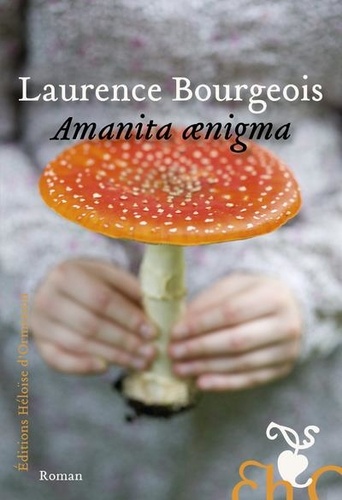
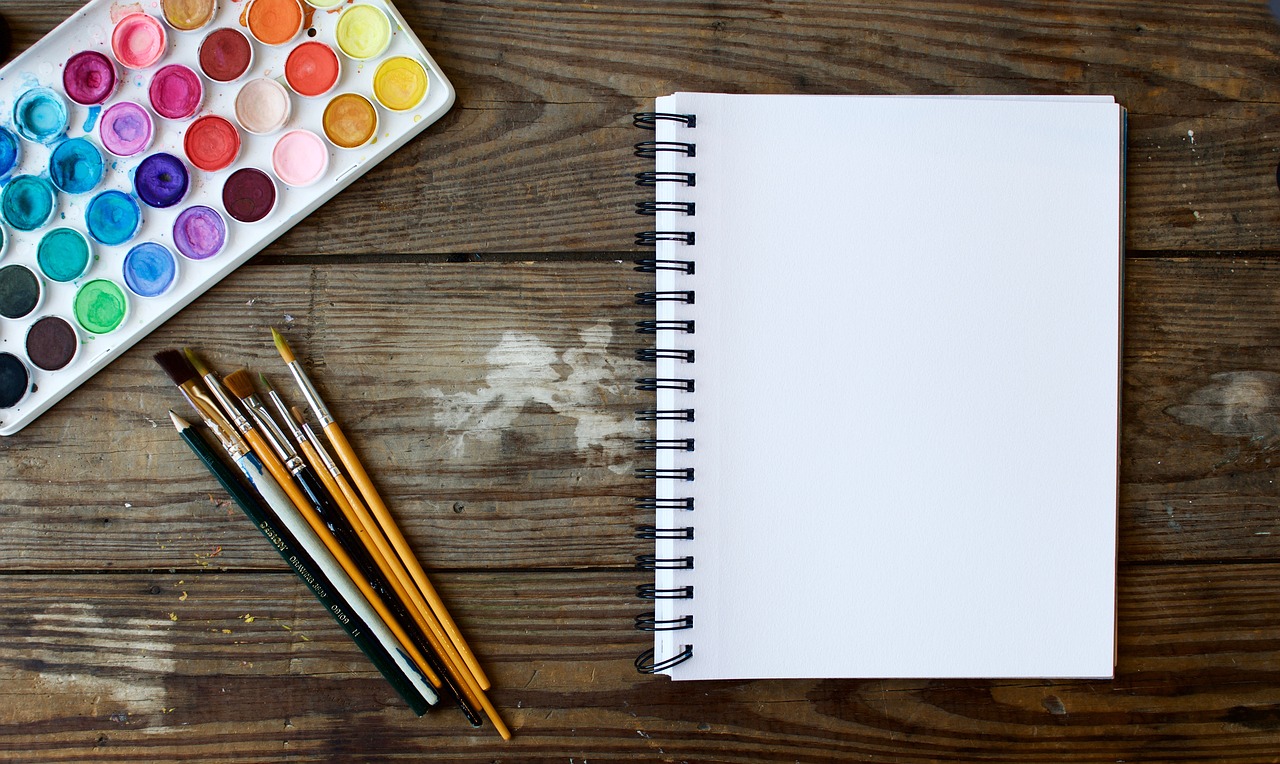
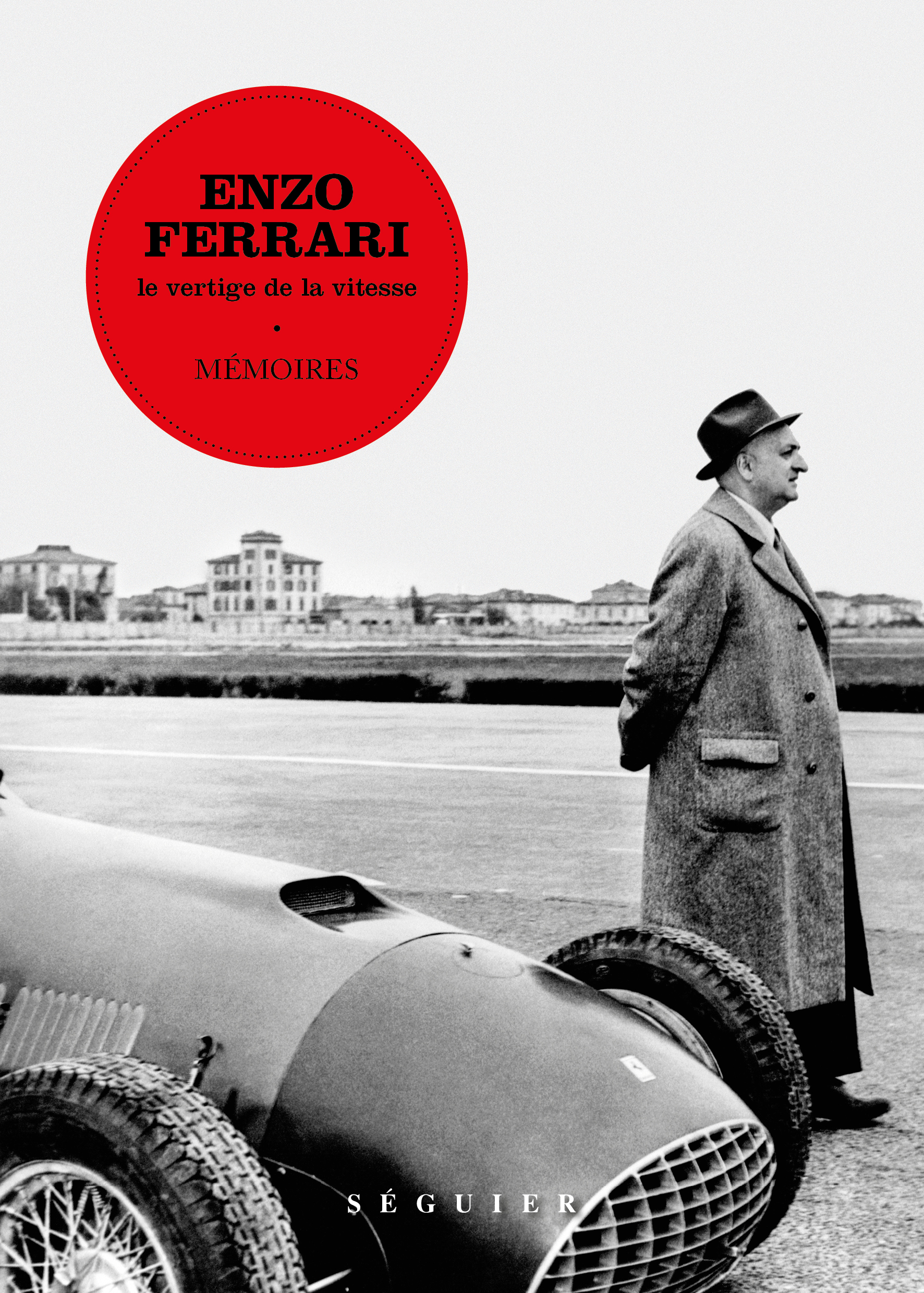
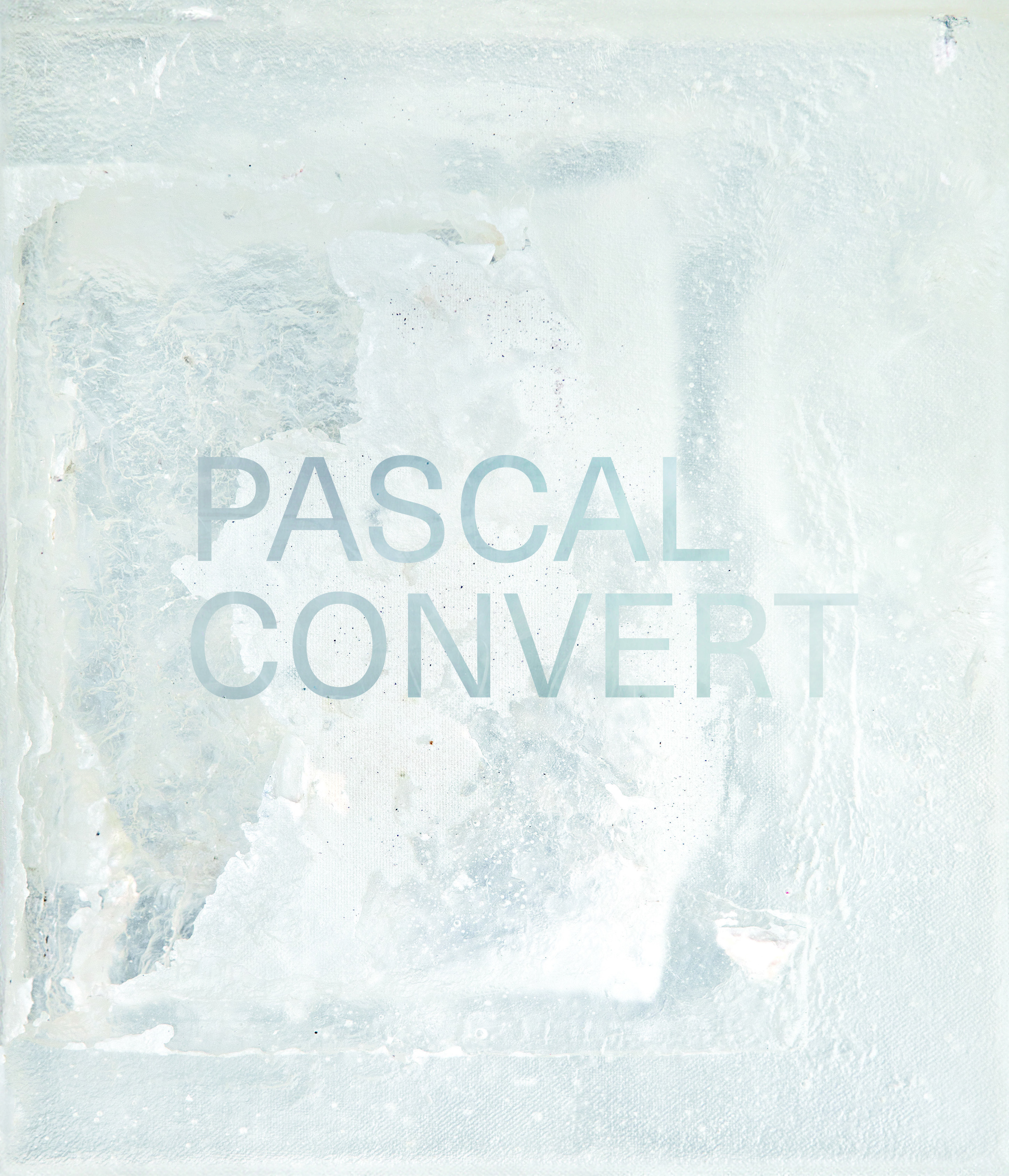
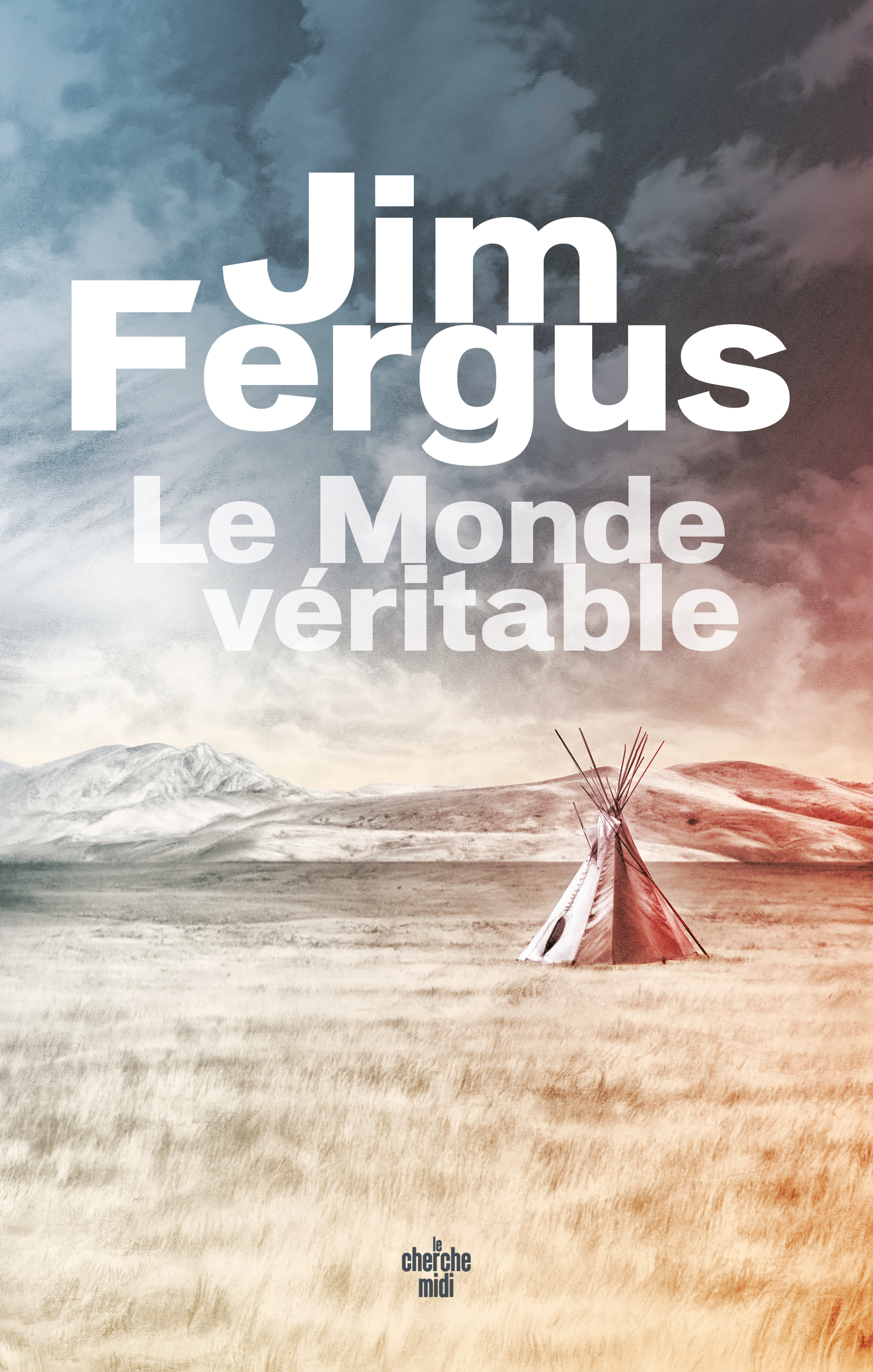
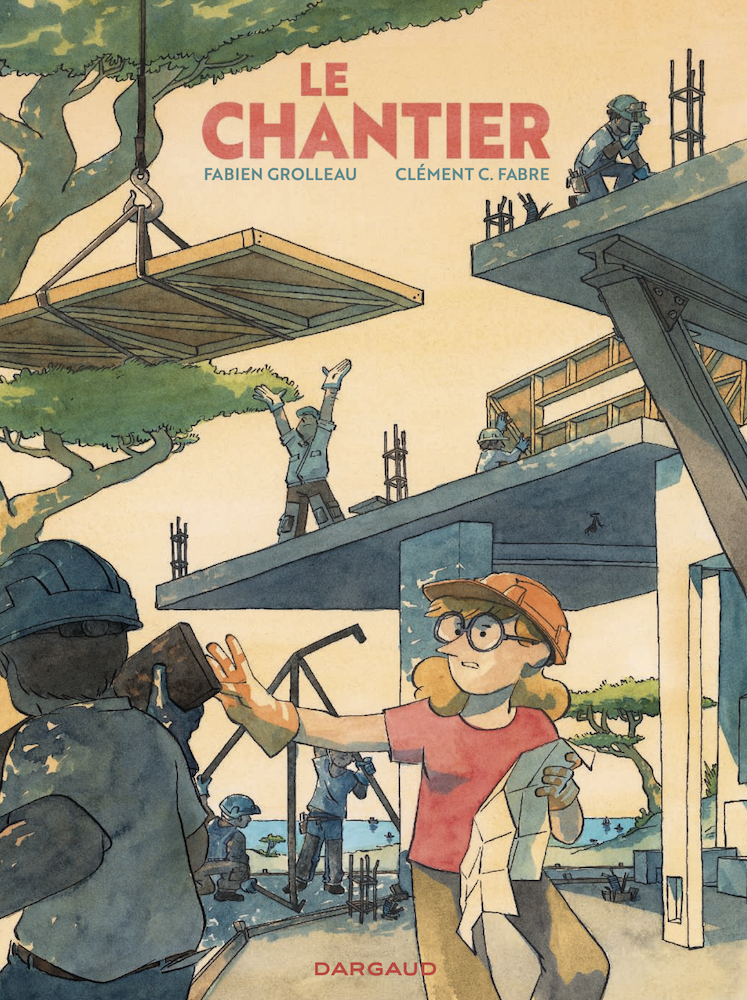
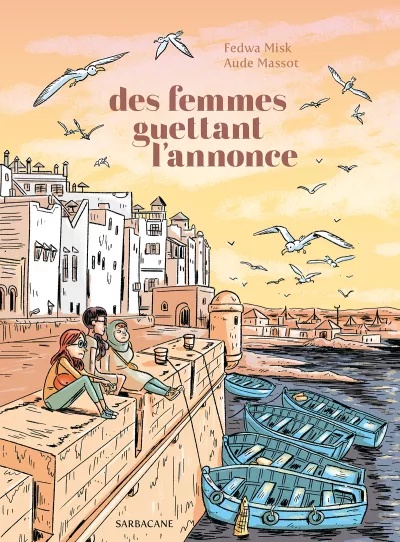

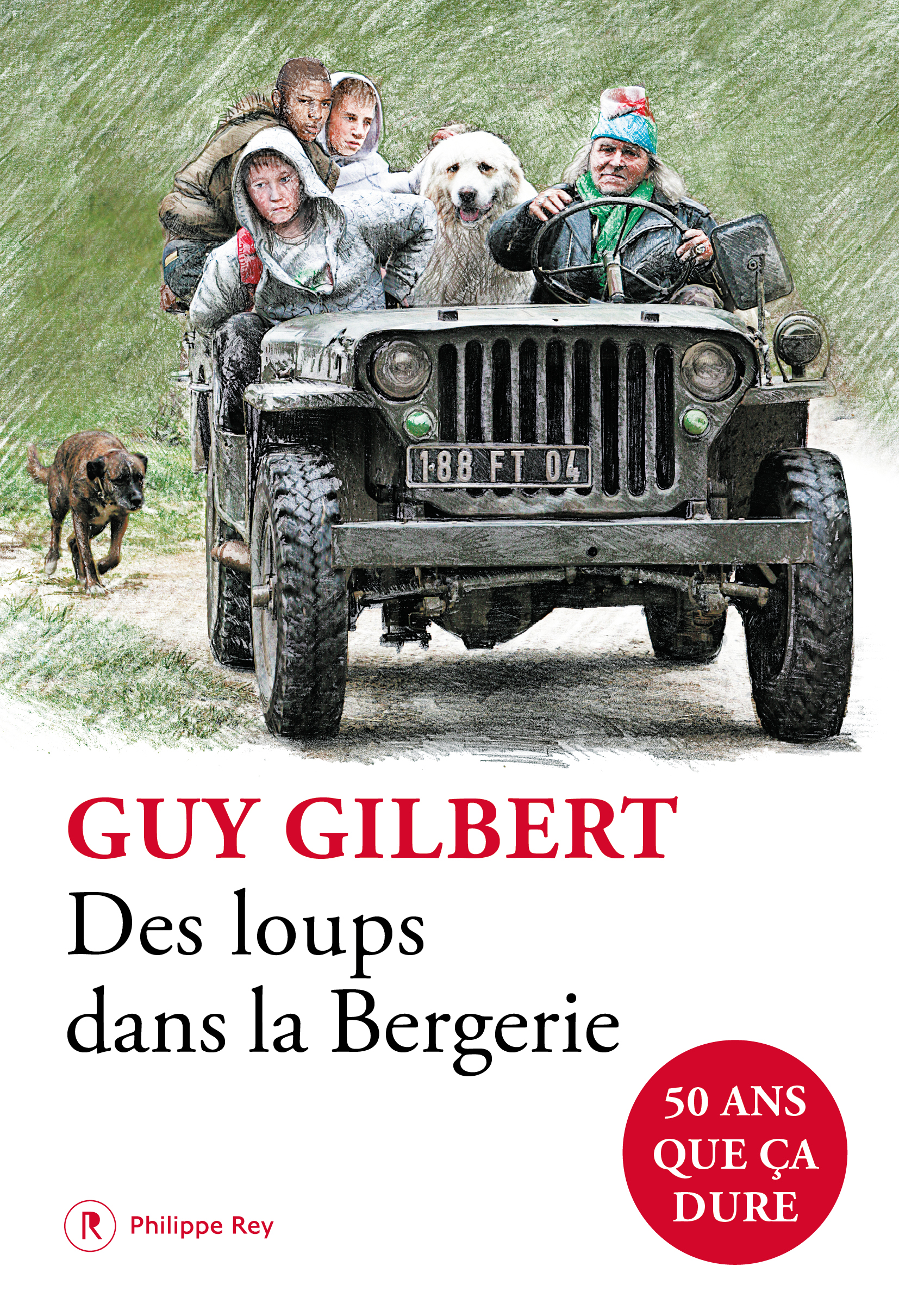
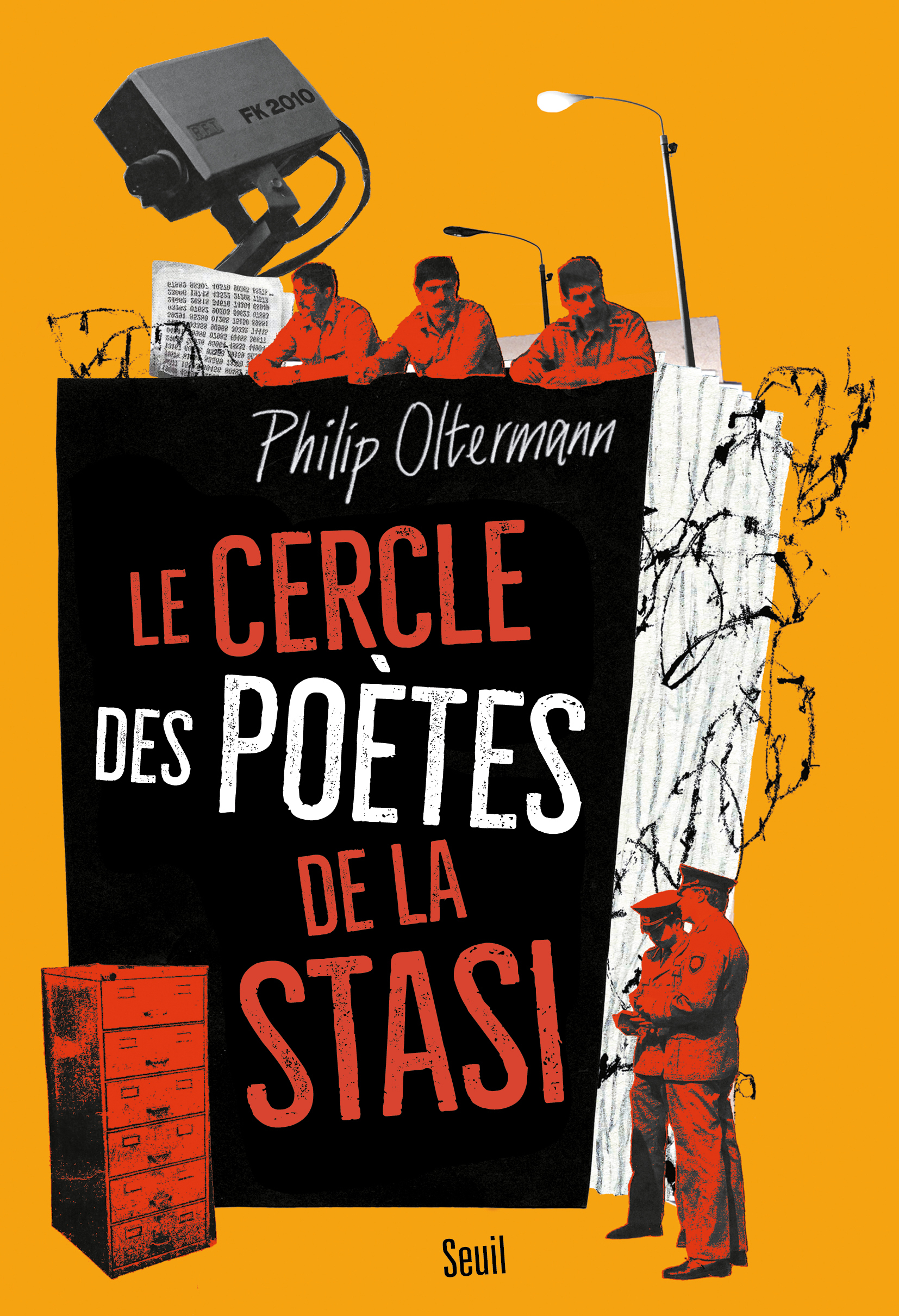
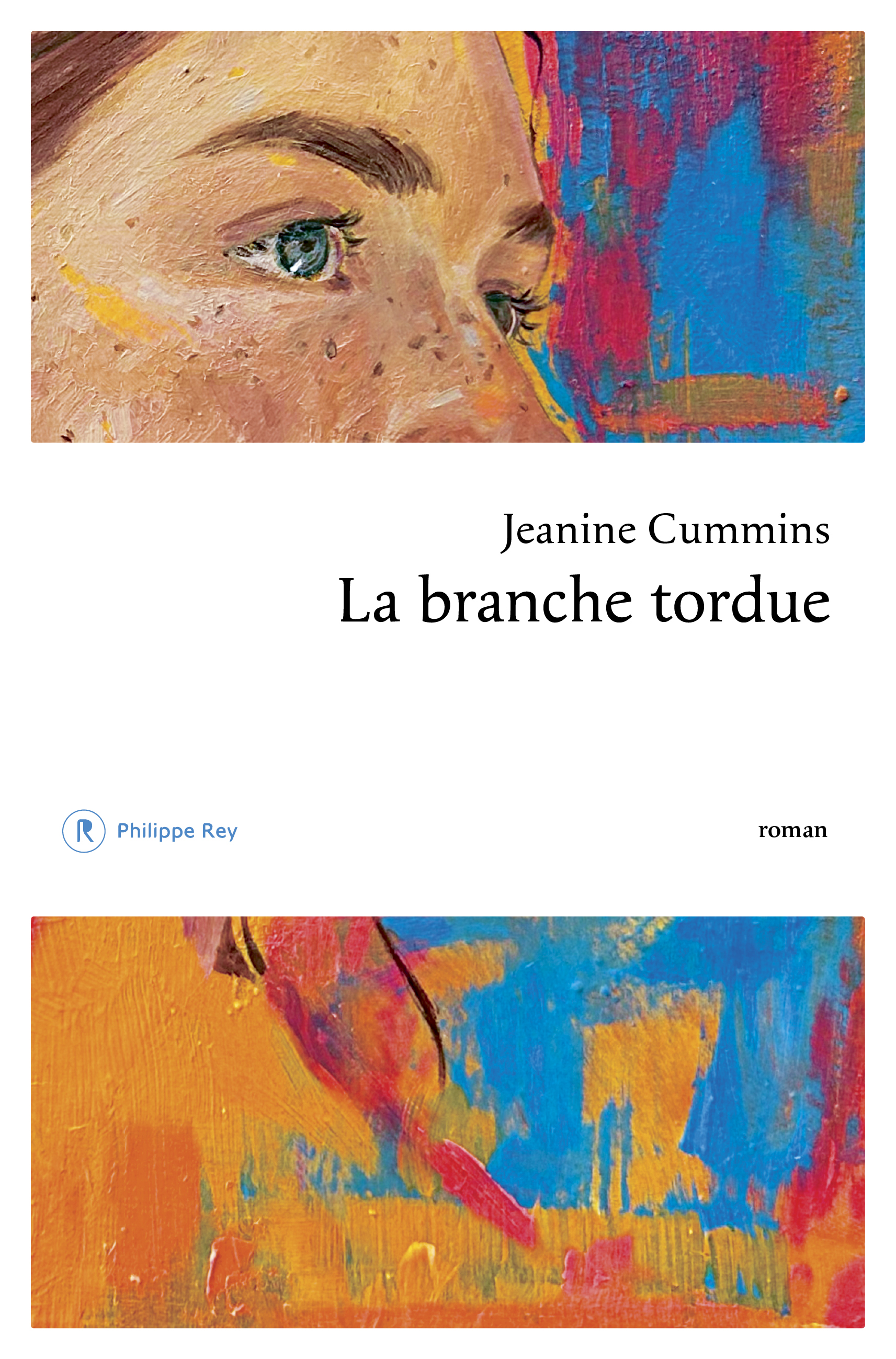
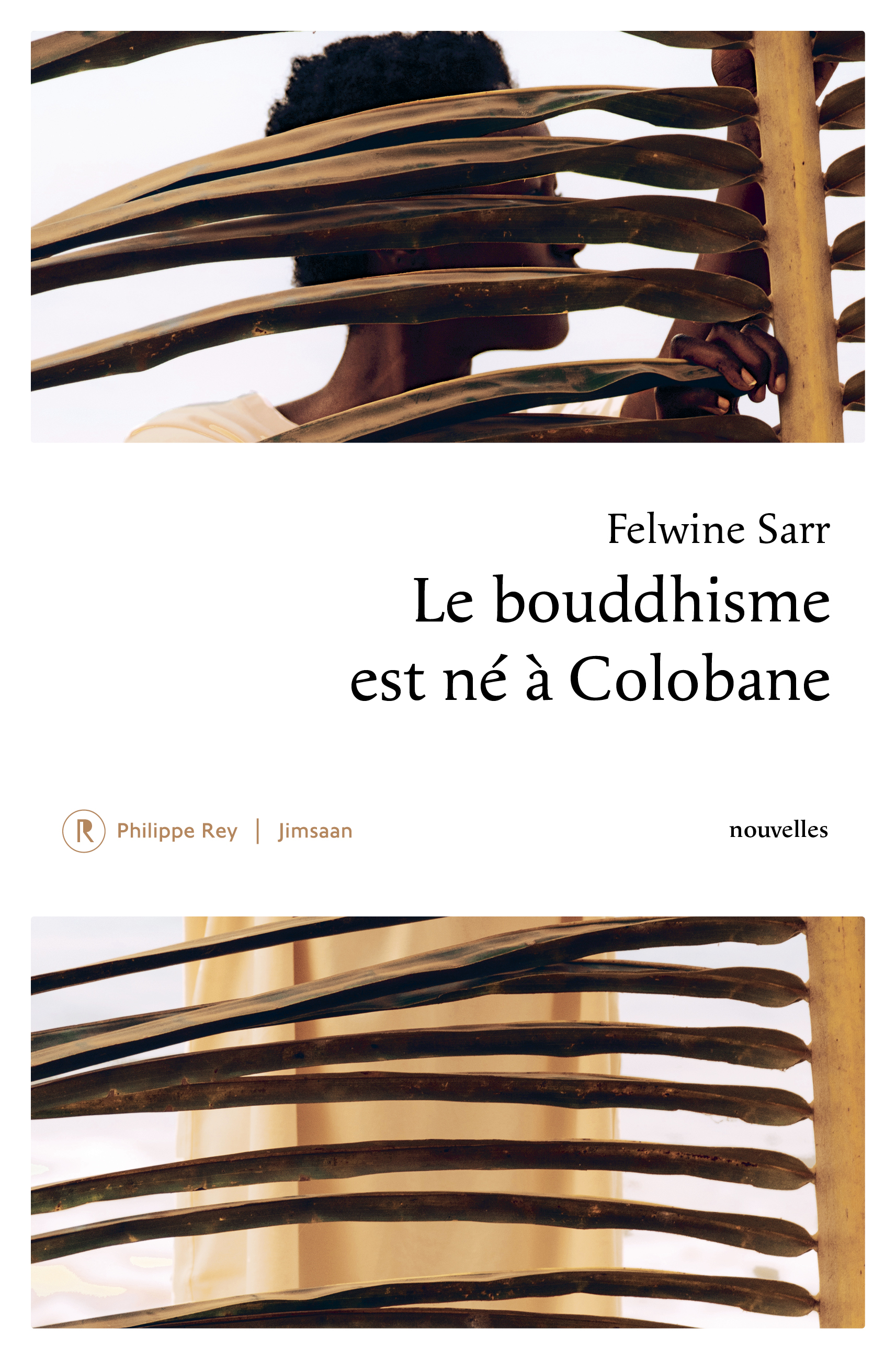
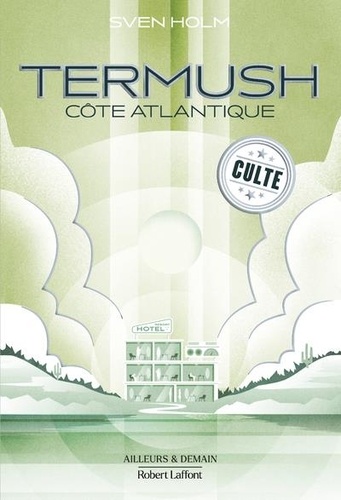
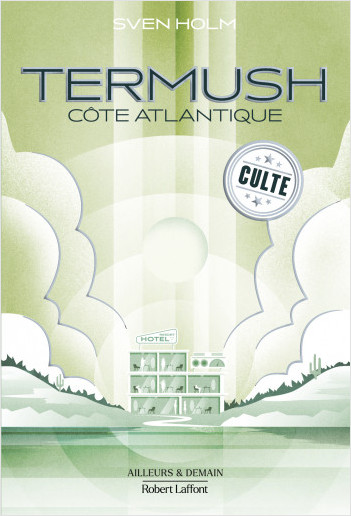
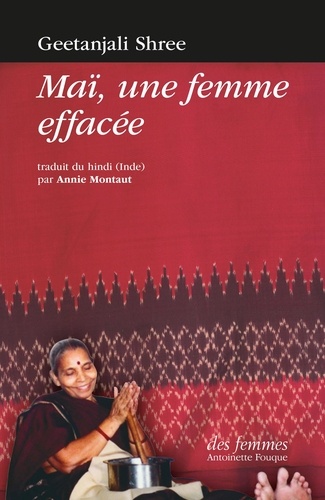

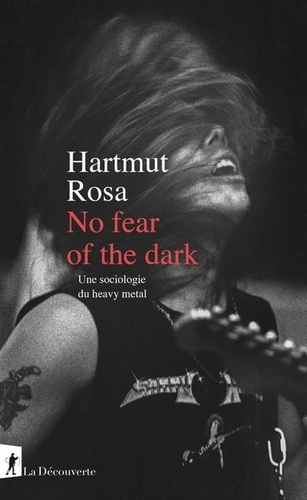
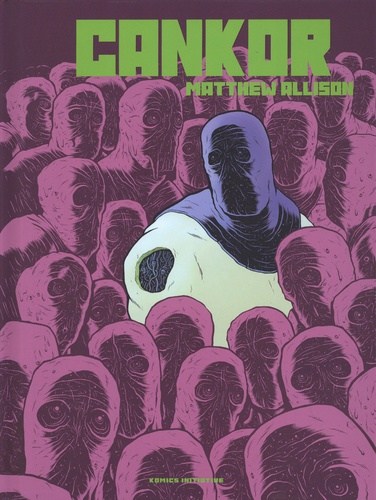
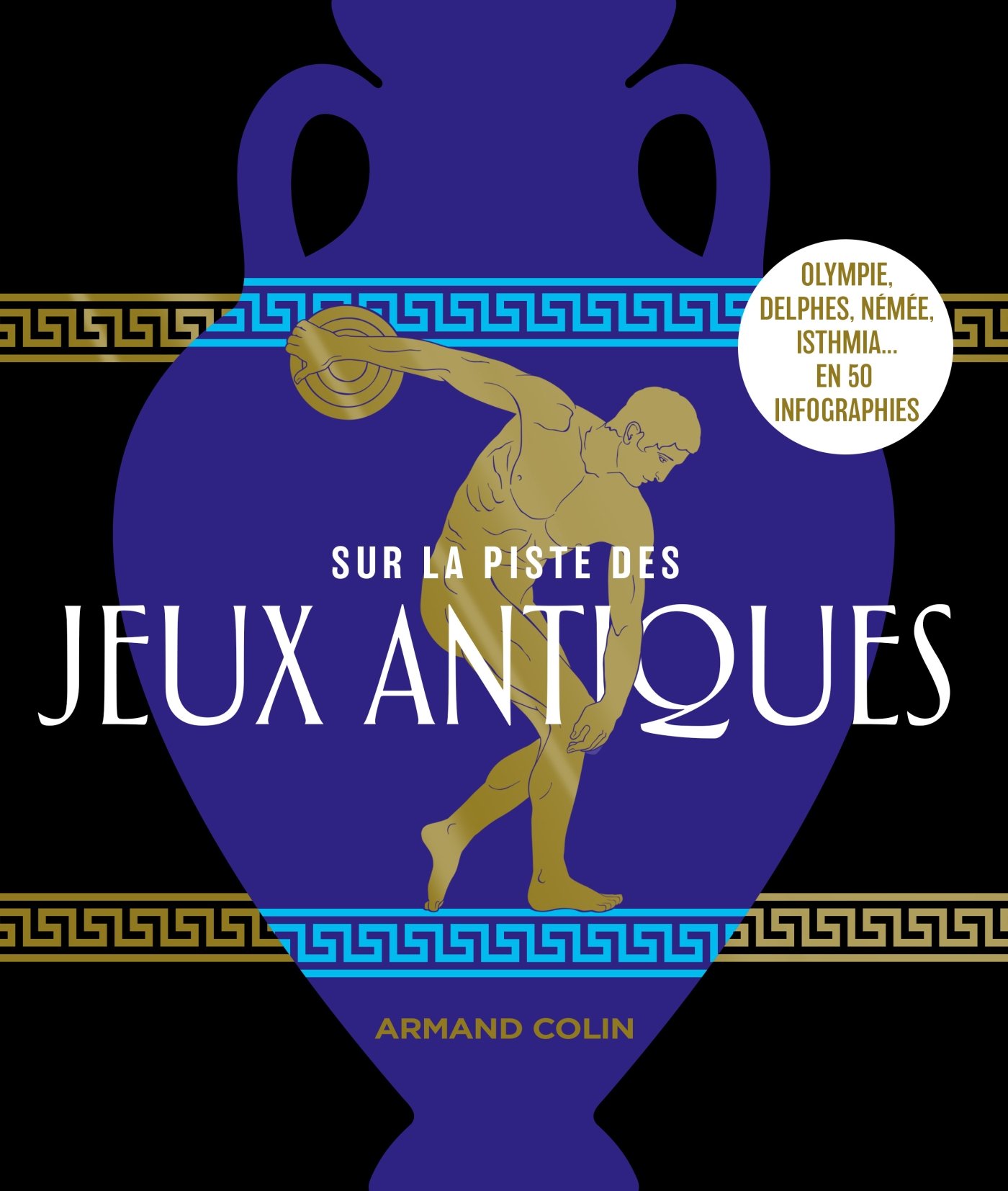
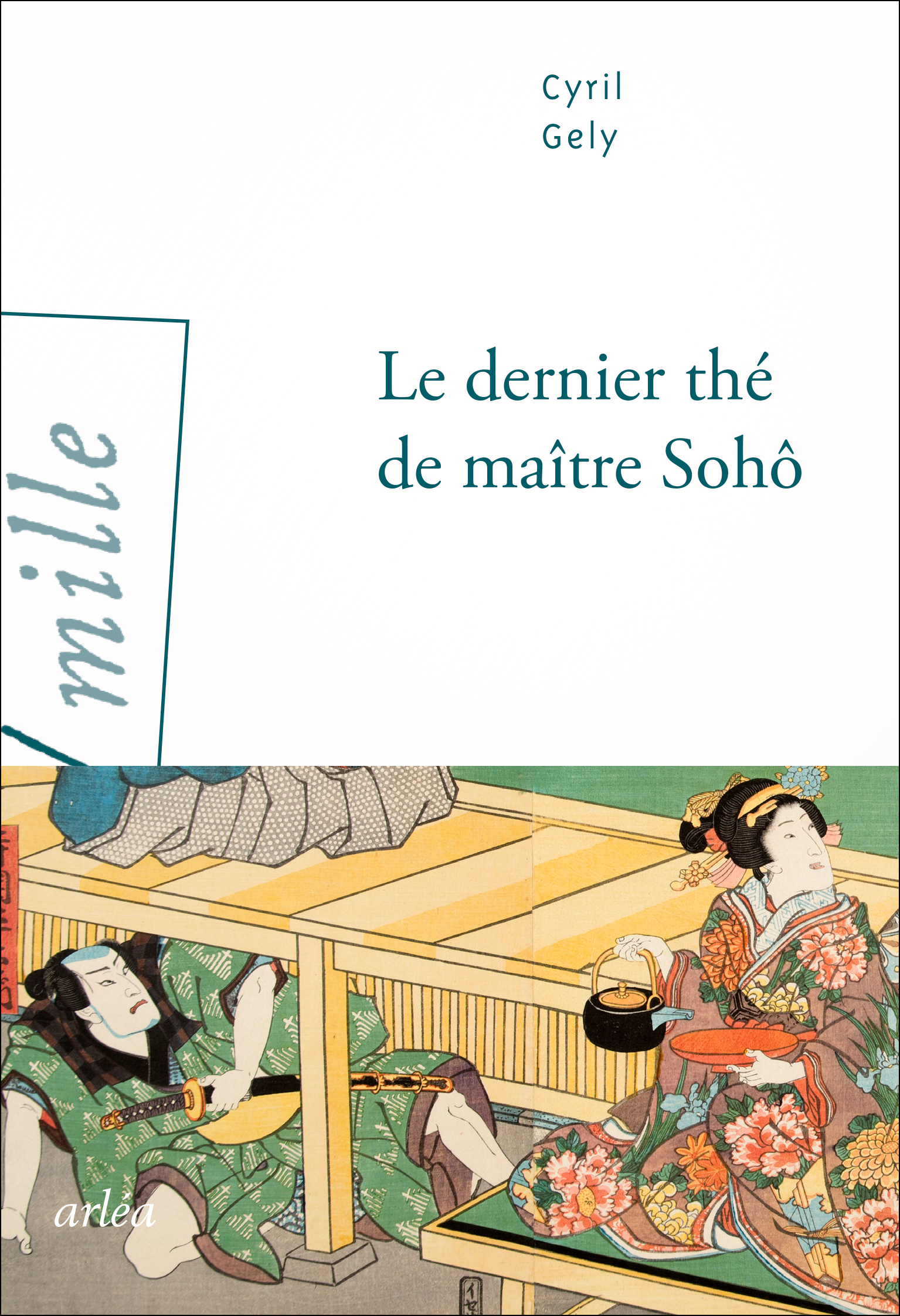
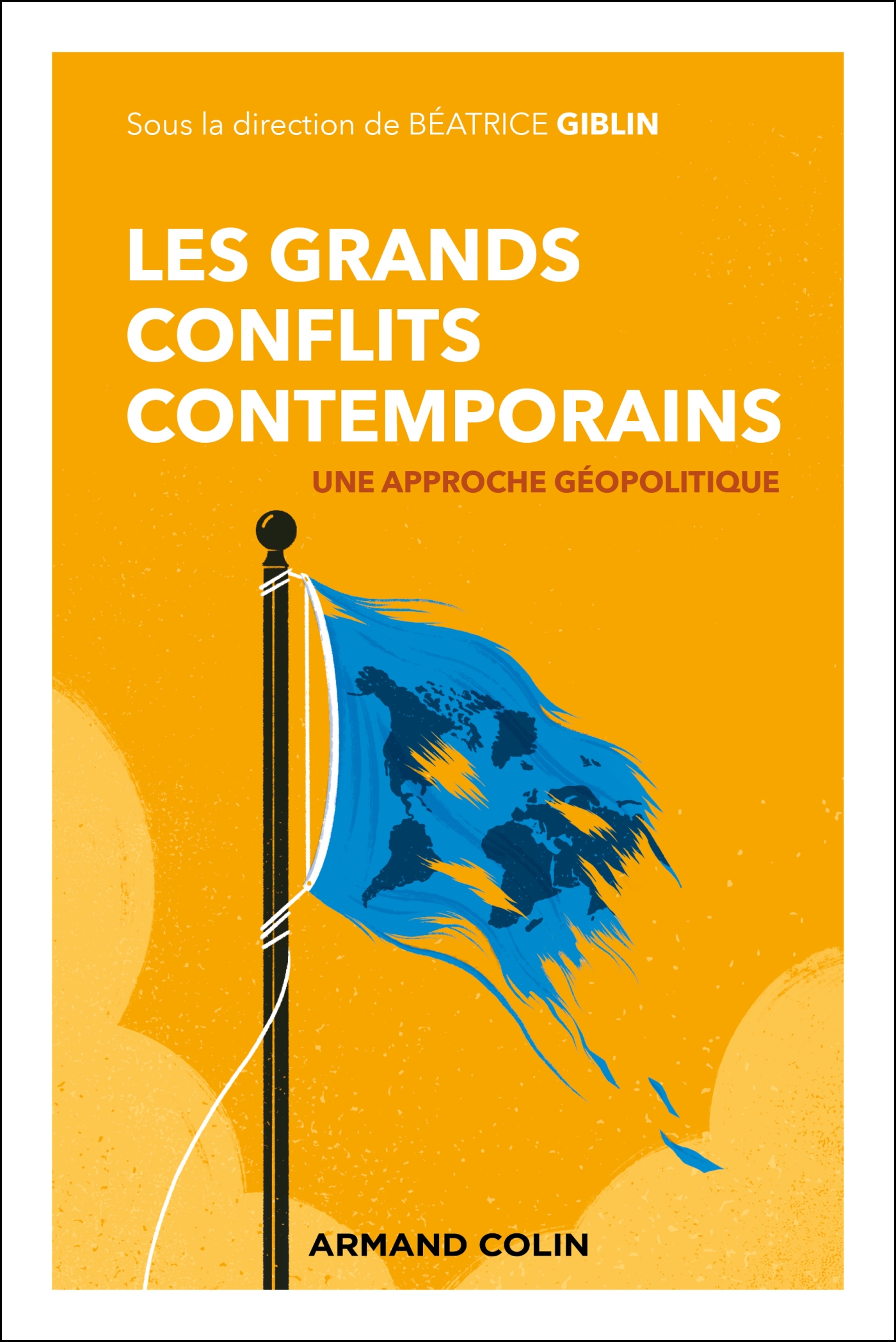

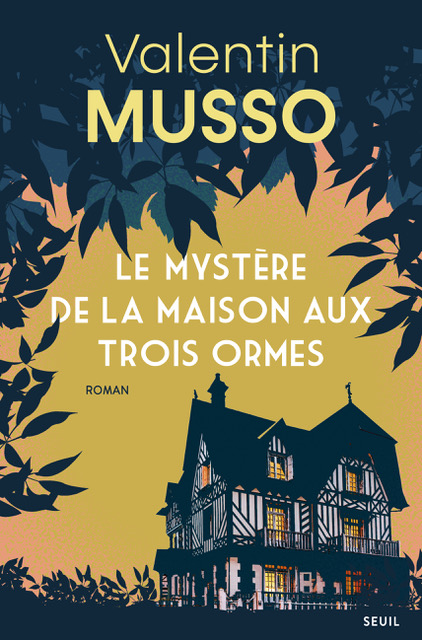
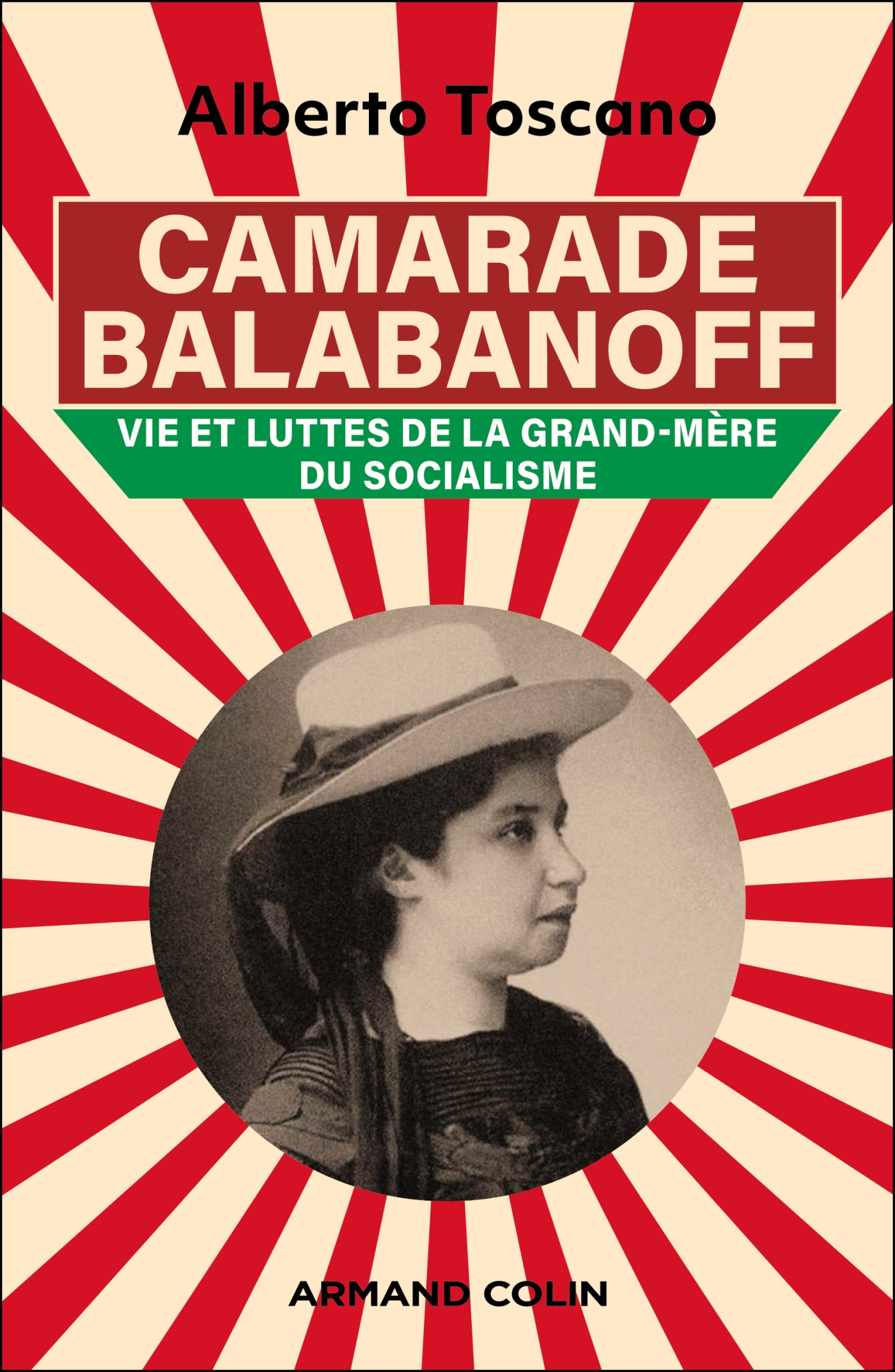
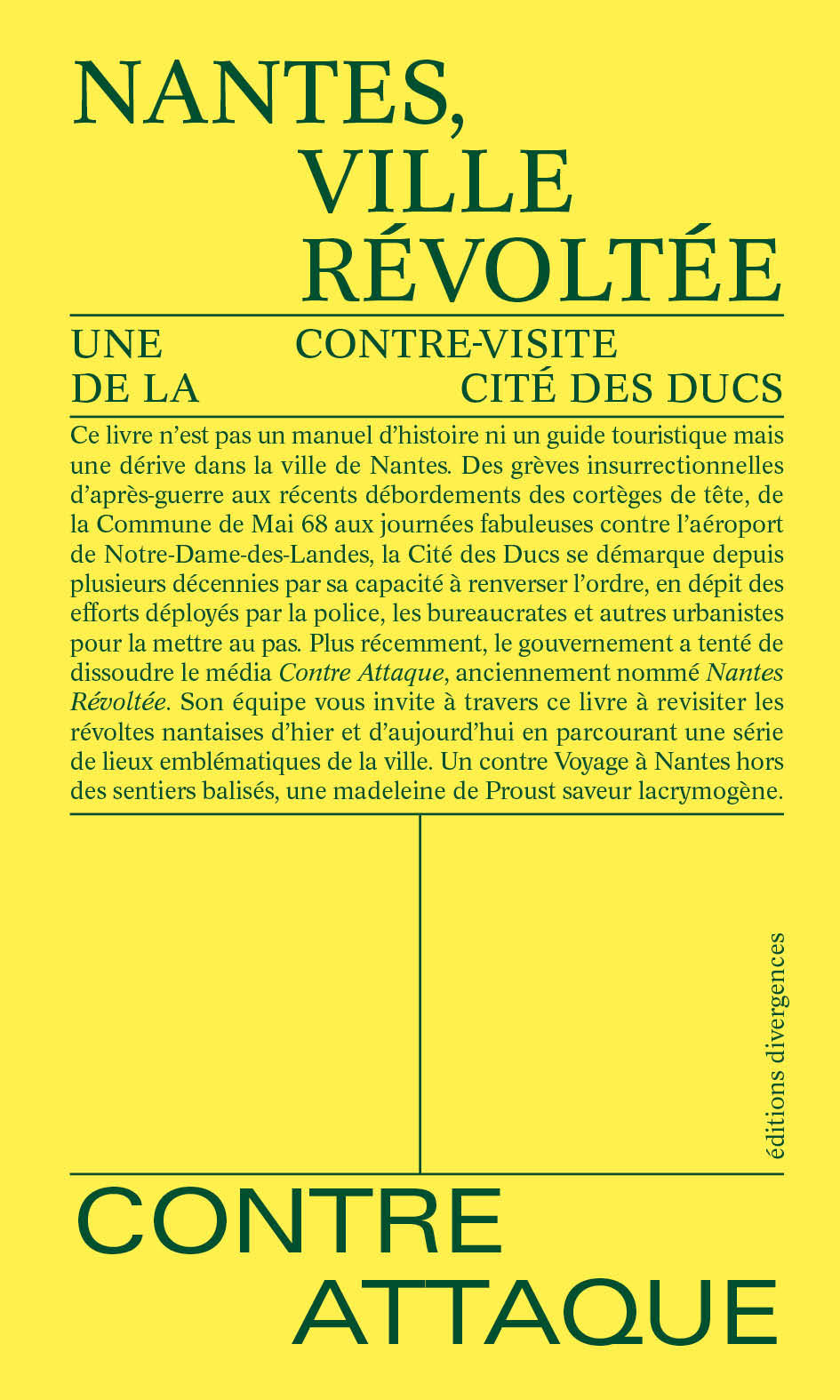
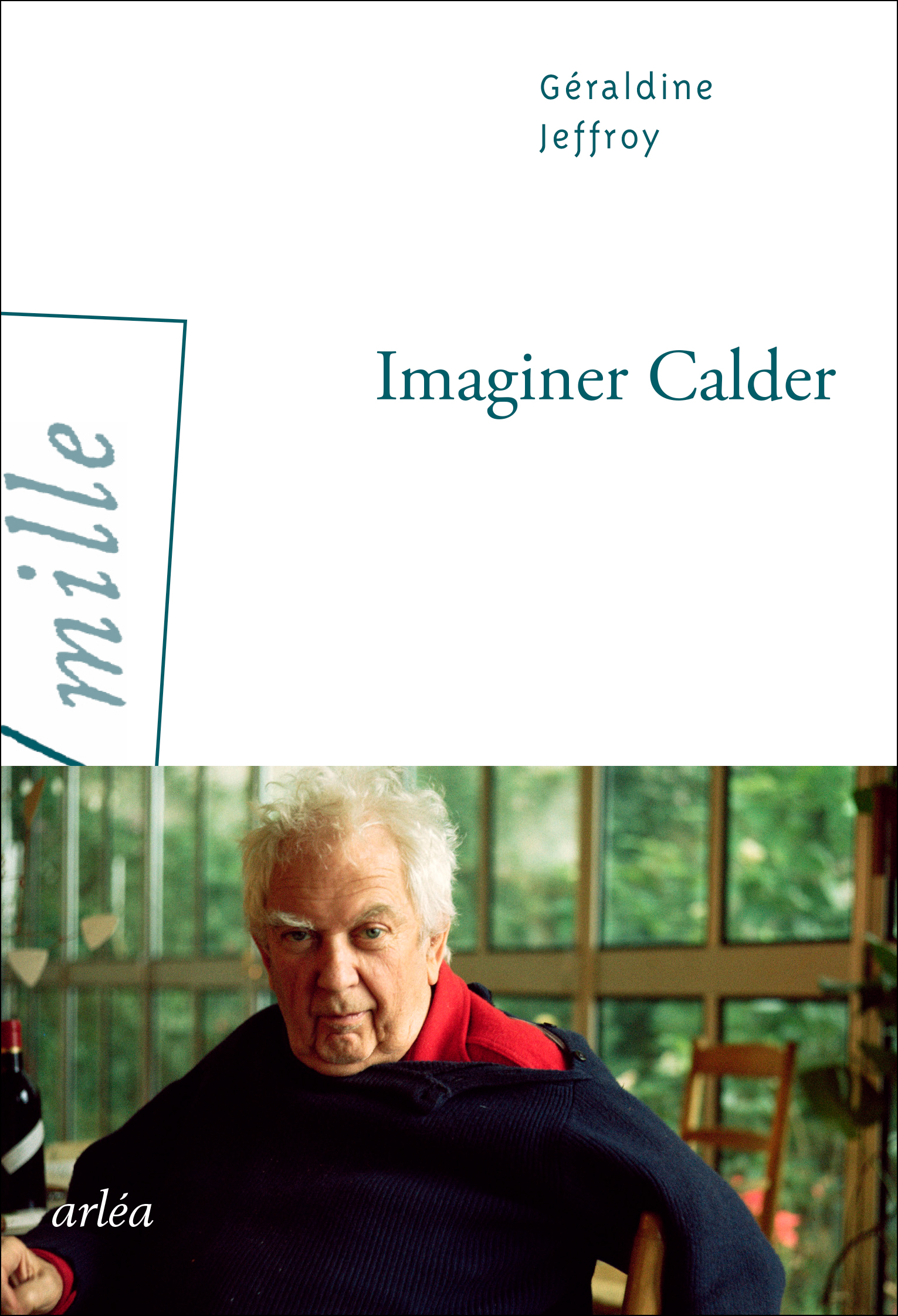
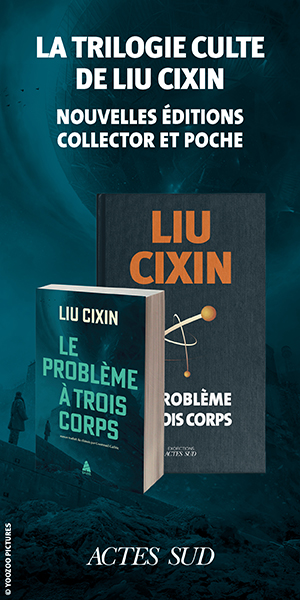

Commenter cet article