Les Ensablés - “Vie d’Adrien Zograffi” de Panaït Istrati (1884-1935)
Lecteur, si tu n’as pas encore pas lu Panaït Istrati, ses œuvres t’attendent en trois gros volumes valant leur pesant d’or chez Libretto. À lire au petit bonheur des temps libres, mais impérativement. Istrati, ce n’est pas banal. Il y a dans toutes ces pages, écrites avec ferveur, l’empreinte du vrai écrivain, dont l’oubli dans les méandres ingrats de la mémoire littéraire ne saurait masquer la grandeur de l’écriture.
Le 26/11/2017 à 09:00 par Les ensablés
Publié le :
26/11/2017 à 09:00
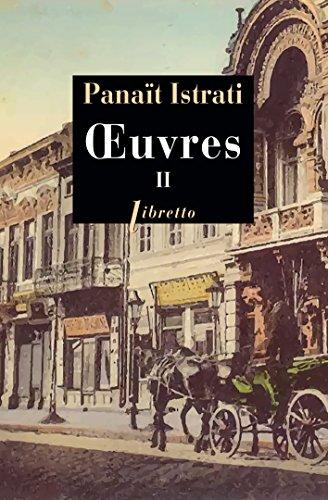
Par François Ouellet
Istrati est né en Roumanie, dans un quartier misérable de la petite ville portuaire de Braïla. L’école l’ennuie. Pour vivre, il fait mille métiers. Mais il n’aime que voyager (l’Égypte, la Grèce, l’Asie mineure, l’Europe), rêver, déambuler, s’instruire, se promener au bras de la liberté qu’il doit défendre contre la pauvreté, contre la société qui normalise les comportements, contre les pleurs d’une mère veuve et besogneuse qui voudrait voir son fils se ranger et gagner convenablement sa vie. Istrati ne se plaît que parmi les vagabonds, les exclus, les marginaux, les apatrides. Dès qu’il peut, il lit passionnément les littératures russe et française.
À trente ans, il apprend le français, langue dans laquelle il va bientôt écrire ses livres, puis s’installe en France, pays qui à ses yeux représente le mieux la liberté d’être et de dire, et cet humanisme que, à la veille de la guerre, il a trouvé dans un roman qu’il met au-dessus de tous les autres, Jean-Christophe de Romain Rolland. S’il devient écrivain, c’est à Rolland qu’il le doit, lequel l’encourage vivement à écrire et publie le premier récit d’Istrati dans Europe en 1923, année de la création de la revue.
Le nom d’Istrati s’impose d’emblée. Dorénavant il publie annuellement aux éditions Rieder (près d’une vingtaine de livres en une douzaine d’années), débouché naturel d’Europe. Compagnon de route du Parti communiste, il est invité à découvrir la Russie, qu’il parcourt entre octobre 1927 et février 1929. Alors que les autorités ne lui montrent que ce qu’elles veulent bien, Istrati préfère aller au-devant des gens, les écouter, entrer « en communion » avec eux, selon son expression. « Je n’ai pas glissé en touriste, dira-t-il. De son séjour, Istrati ramène toutefois un essai incendiaire, premier volume de la trilogie Vers l’autre flamme (les deux autres étant écrits par Victor Serge et Boris Souvarine) publié en 1929, dans lequel la charge contre le Parti est impitoyable. Il écrit, par exemple, que la classe au nom de laquelle parle le communisme ne fait que justifier le crime, qu’elle est, en cela, comparable à la classe qu’elle dénonce : « Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle brasse les mêmes envies et les mêmes appétits que l’autre classe. Si elle est broyée et non la broyeuse, ce n’est pas à quelque pureté d’âme qu’elle le doit, mais à son impossibilité de s’emparer de la machine qui broie. M’accusera-t-on de traîtrise pour avoir affirmé cela ? » La réponse ne se fera pas attendre. Traité de vendu, il perdra tous ses appuis, ses amis, et se retirera dans son pays natal pour y écrire intensément et y mourir tranquillement quelques années plus tard.
Soigné pour la tuberculose dans un monastère des Carpates moldaves, Istrati y rédige, entre 1932 et 1935, les quatre volumes à très forte valeur autobiographique du cycle « Vie d’Adrien Zograffi » (disponible dans le tome 2 des Œuvres d’Istrati chez Libretto), l’alter ego de l’écrivain. L’écrivain respire difficilement, passe l’essentiel de ses journées au lit, bref sait très bien que son temps est compté. « Cependant, je ne peux mourir ! La partie la plus sérieuse, la plus honnête de mon œuvre, est toujours dans mon ventre », s’écrie-t-il alors. Il a raison. Si l’œuvre des débuts, qui avait révélé un extraordinaire don de conteur, visait à distraire (un peu comme dans Les Mille et une nuits, dont on retrouve un peu l’atmosphère et la technique des récits emboîtés), il entend maintenant instruire, dégager le sens de sa vie aventureuse, depuis son engagement socialiste, au début du siècle, jusqu’à son départ pour Paris à la veille de la guerre.
Le premier livre, La Maison Thüringer, nous le montre à dix-neuf ans, dans les premières années du vingtième siècle, alors qu’il est domestique chez de grands armateurs, les frères Thüringer. Ses patrons sont des hommes bons et compréhensifs, mais que la grève des ouvriers menace de ruiner. Insurgé contre l’exploitation ouvrière, Adrien milite au sein du syndicat socialiste et publie une suite d’articles qui ont un important retentissement. La chute des armateurs le laisse néanmoins malheureux, car il a compris que la méchanceté et la bonté des hommes ne sont pas affaire de classe sociale, qu’on ne peut juger sans discernement, que toute classe victorieuse créera inévitablement de nouvelles injustices, qu’il y aura toujours des hommes pour en exploiter d’autres, peu importe les convictions idéologiques des uns et des autres.
Dorénavant méfiant des pensées dogmatiques, Adrien fait de la loi du cœur et de la justice l’étalon de son humanisme. « Mon cœur, pensait-il, n’est pas sensible rien qu’à la souffrance de telle ou telle couche sociale, mais à tout ce qui souffre sur la terre, jusqu’aux bêtes. On ne me sortira plus de là. C’est inutile. » C’est ainsi que La Maison Thüringer peut être lu comme un roman de formation, mais où les idées tiennent la route seulement si elles sont justifiables du mouvement du cœur et de la solidarité humaine, plus grande que la solidarité de classe. Les aventures d’Adrien dans les autres volumes du cycle romanesque, et qui ne font que refléter l’expérience d’Istrati, au fil de ses déplacements, des hommes et de la vie, de la misère qui l’accable et des amitiés qu’il a nouées, reconduiront nécessairement cette profession de foi. Sans doute, aussi, est-ce par cette adhésion convaincue à des principes de cœur et hostile à toute forme de compromis, et par conséquent incompatible avec le dérèglement des passions humaines, qu’Istrati habitera, toute sa vie, la posture du révolté, du rêveur, du marginal errant, de l’individualiste qui, tout en refusant le mode de vie de la société bourgeoise, choisit l’indépendance contre les règles collectives du Parti et pousse la liberté jusqu’à l’anarchie.
Les trois autres « romans » du cycle sont la suite chronologique du premier. Le Bureau de placement réunit Adrien, devenu peintre en bâtiment, et un groupe d’employés indigents, dont le travail ne permet « ni de vivre ni de mourir », selon une belle formule. Ils survivent donc tant bien que mal, ne se nourrissant pas tous les jours, dormant à même le mobilier de la salle de travail. Dans une pièce annexe se trouve un atelier qui, le soir, se transforme en « foyer socialiste », où se regroupent les petites fripouilles, les anarchistes et autres ennemis du capitalisme. C’est le roman de la misère la plus noire, où seuls l’amour, quand il n’humilie pas, et les discussions animées éclairent les visages. Mais par rapport à la question sociale des militants du Parti, la morale de justice d’Adrien est une mystique de la générosité et de la solidarité. Sa conception des choses est ici mieux argumentée que dans le volume précédent. Pour Adrien, il y a une morale du pauvre qui prime sur la pauvreté dans laquelle se trouve celui-ci.
« J’ai vu comment le riche peut devenir pauvre, ce qui n’est pas grave. Mais si le pauvre peut et veut s’enrichir […] la question change. Cela veut dire qu’il n’y a pas une morale de classes. Et moi, c’est la morale du pauvre qui m’intéresse, non point sa situation forcée. Car on aura beau supprimer les classes, il s’y trouvera toujours une place meilleure qu’une autre et, si le prolétaire d’aujourd’hui n’a pas une conscience qui soit une véritable morale de classe, la lutte pour la vie facile et l’injustice resteront les mêmes, en dépit du chambardement social. Alors, il faudra tout recommencer. Voilà comment je pense. »
Les deux derniers volumes ont pour titre Méditerranée (lever du soleil) et Méditerranée (coucher du soleil) et couvrent six année de voyages (de 1907 à 1913) en Égypte, au Liban ou en Syrie. Ils n’ont pas l’unité des livres précédents, et donc cet esprit romanesque que peut prendre la narration de la vie de l’auteur ; les ouvrages méditerranéens sont plutôt des récits composés d’épisodes de la vie d’Istrati, où le bonheur du vagabondage est en harmonie avec l’idéal de la liberté qui l’anime, malgré les périodes de cafard et de découragement. À la fin du cycle, le suicide de son meilleur ami, Mikhaïl, constitue un tournant pour lui.
Si Istrati lui a consacré tout un volume dans le deuxième cycle de ses aventures (« La Jeunesse d’Adrien Zograffi »), ce personnage est cependant relativement peu présent dans les derniers livres en regard de l’importance qu’il lui accorde quant à la direction de sa vie et au développement de ses sentiments. « Avec la disparition de Mikhaïl disparurent également mes moyens d’aimer un homme comme on aime un dieu. » Sans doute la mort de Mikhaïl, en 1912, marque-t-elle la fin d’une époque et prépare-t-elle Istrati à réorienter sa vie. Entretemps, les nouvelles méditerranéennes qu’il a publiées dans des revues lui ont ouvert des portes. Au Parti, on souhaite sa collaboration, mais l’expérience tourne court. C’est sur son départ pour Paris, à l’hiver 1913, que se termine « Vie d’Adien Zograffi ». On connaît la suite : l’errance pendant la guerre, le désespoir, la naissance de l’écrivain. Et pas n’importe quel écrivain.
François Ouellet - novembre 2017
Panaït Istrati – Œuvres – Collection Libretto – Editions Phébus
Tome 1 - 9782369141693 - 15.80 € / Tome 2 - 9782369141709 - 15.80 € / Tome 3 – 9782369141716 – 15.80€
Oeuvres. Tome 1
Paru le 05/03/2015
797 pages
Libretto
15,80 €
Oeuvres. Tome 2
Paru le 05/03/2015
680 pages
Libretto
15,80 €
Oeuvres. Tome 3
Paru le 05/03/2015
732 pages
Libretto
15,80 €




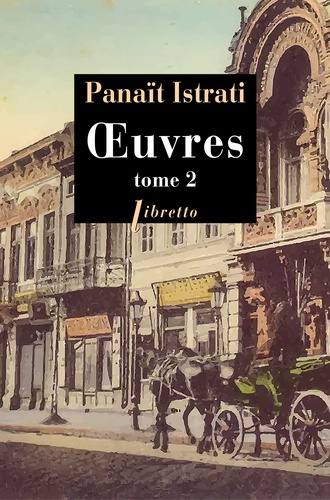
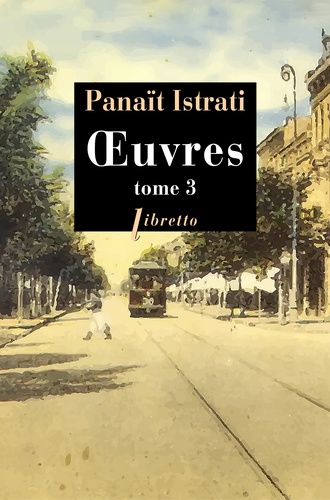
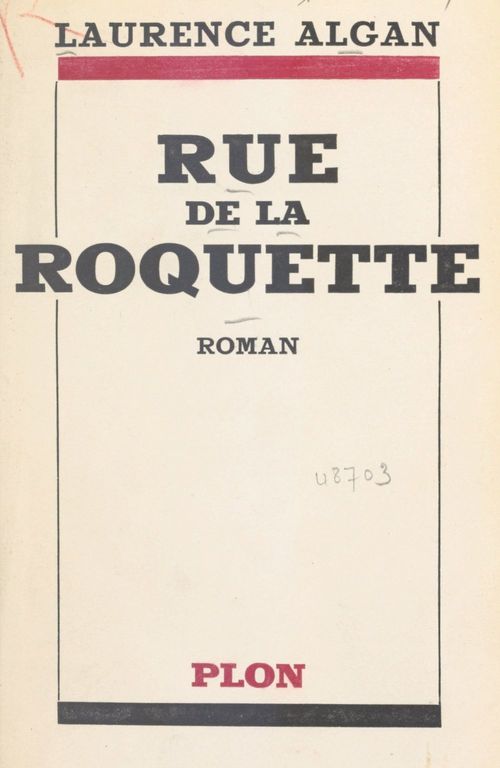
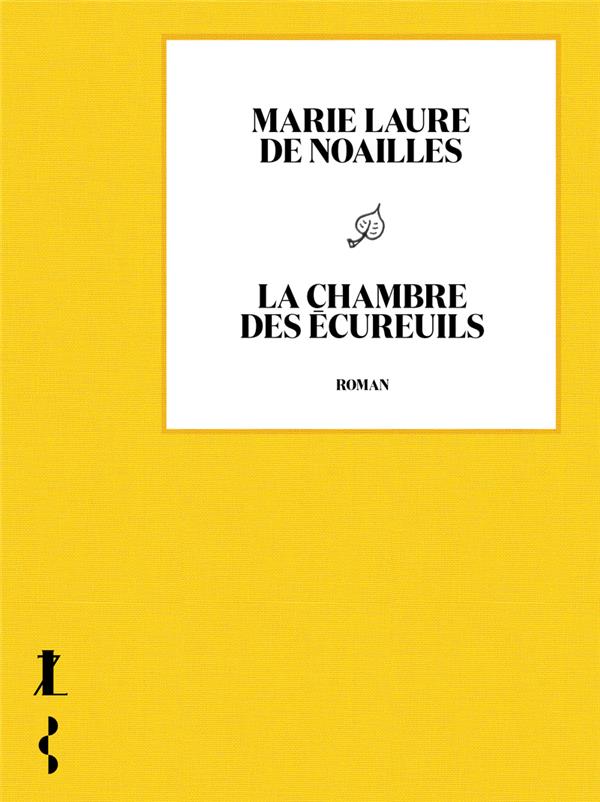
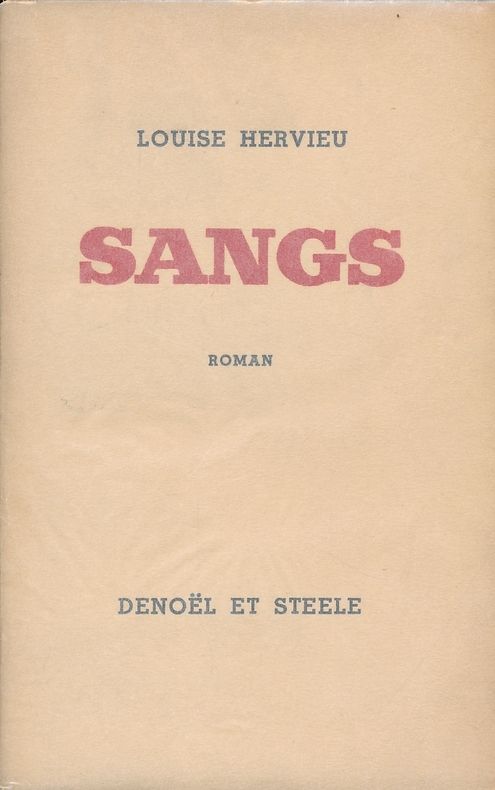
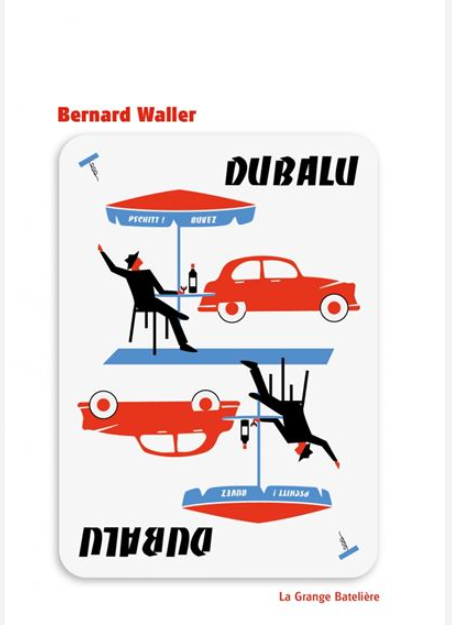
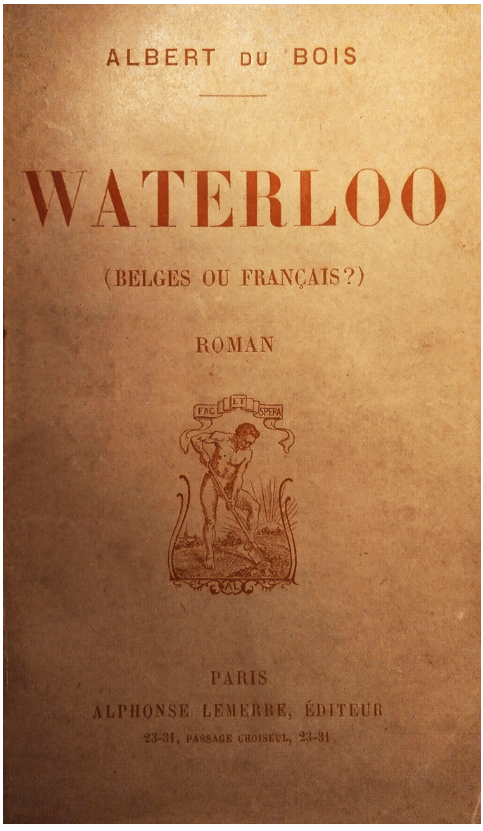
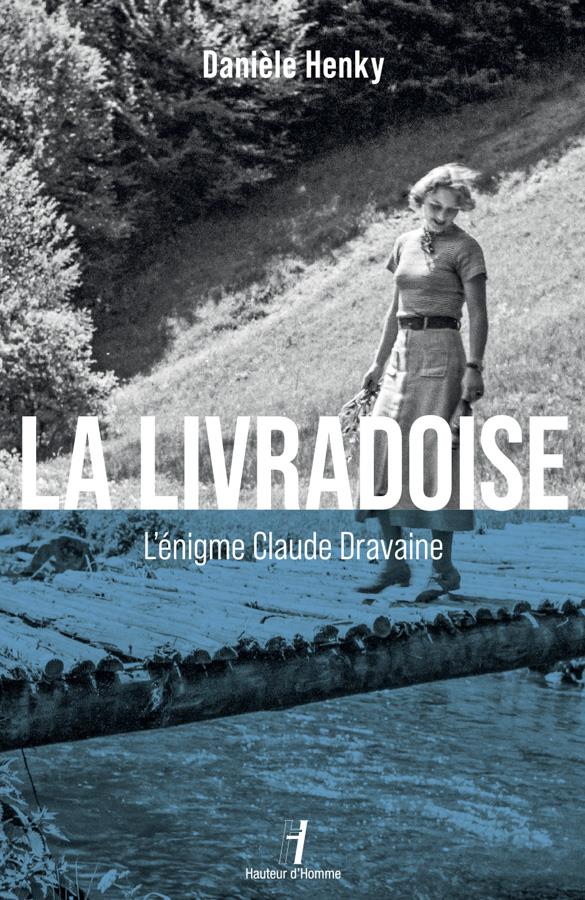
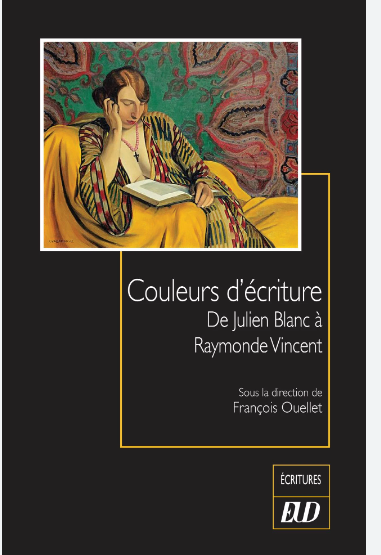
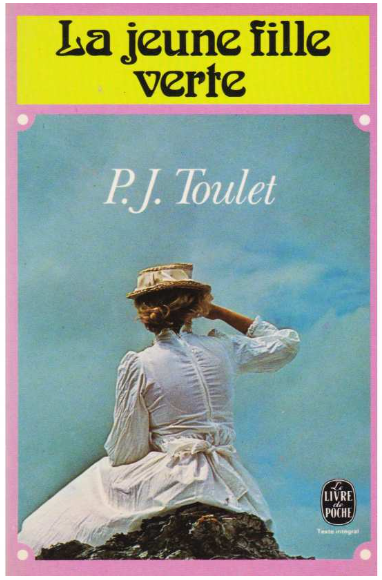
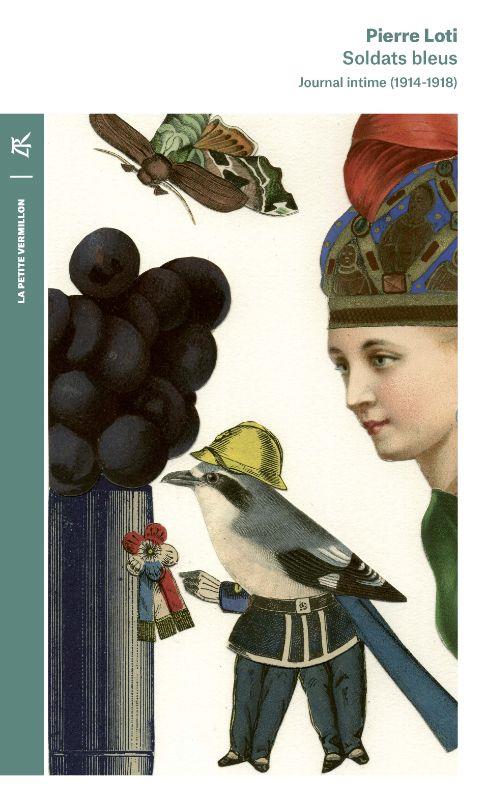
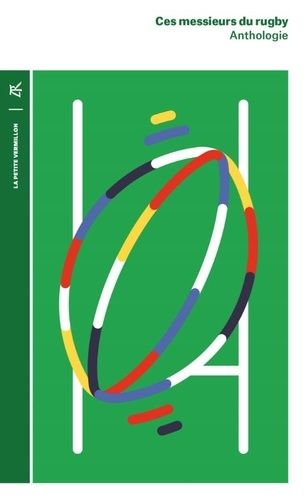
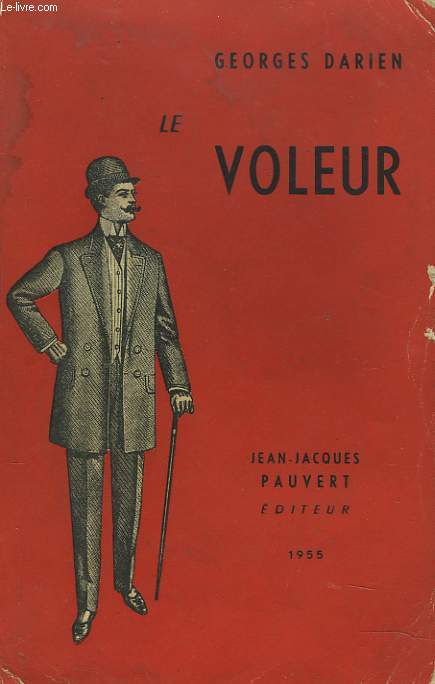
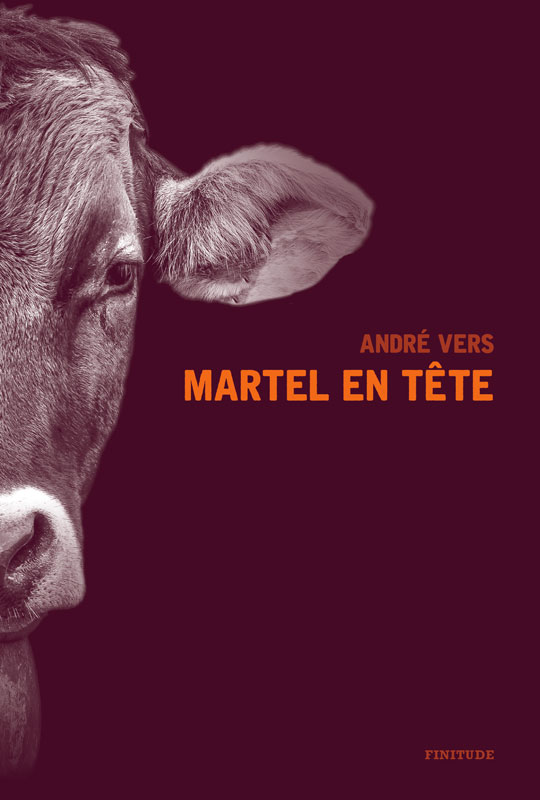

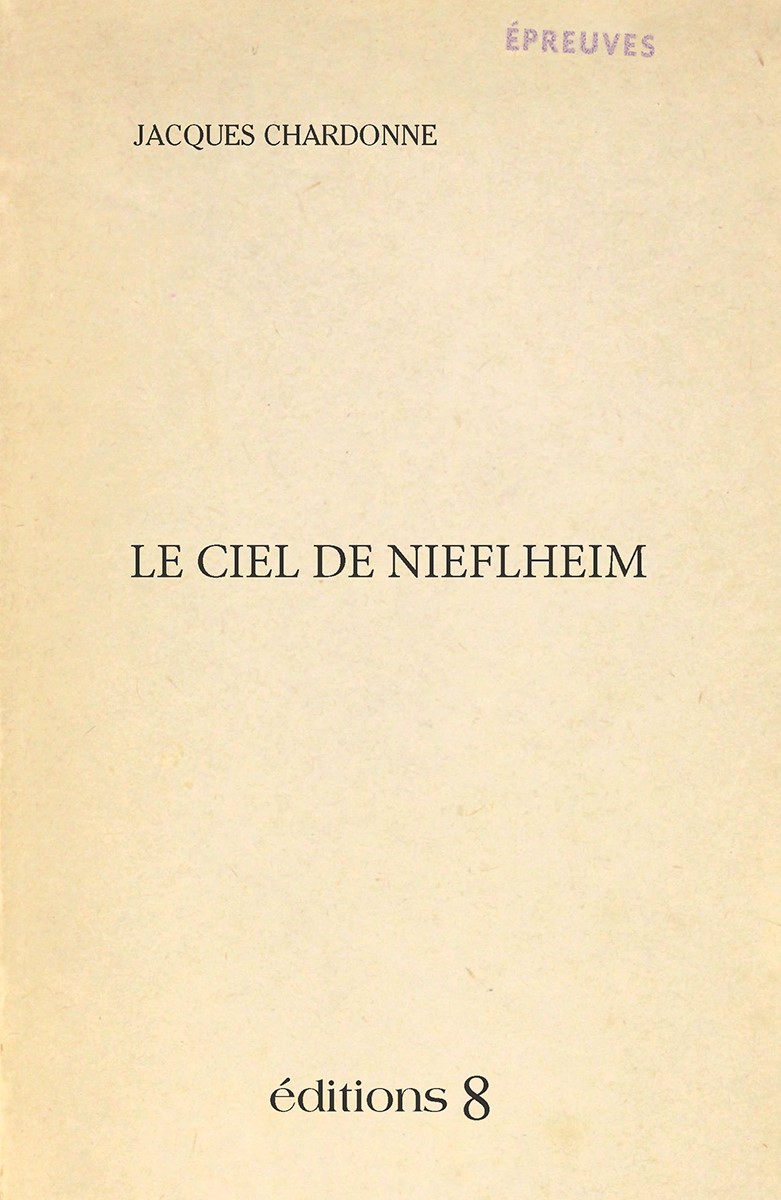
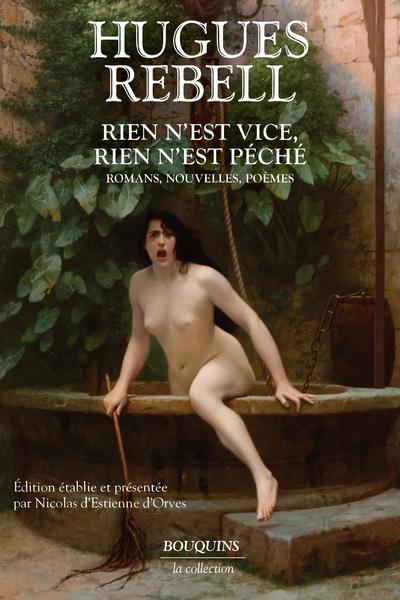
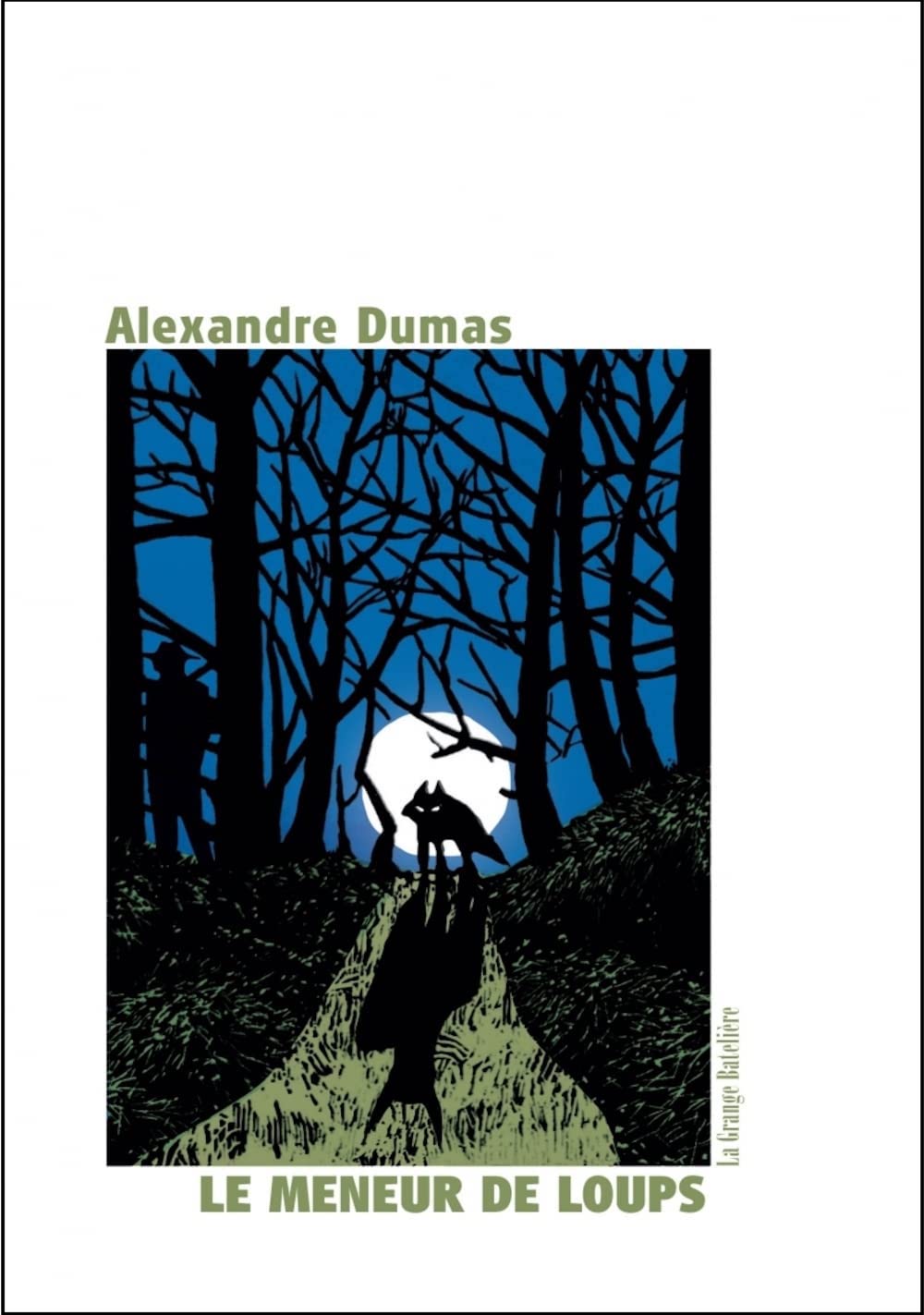
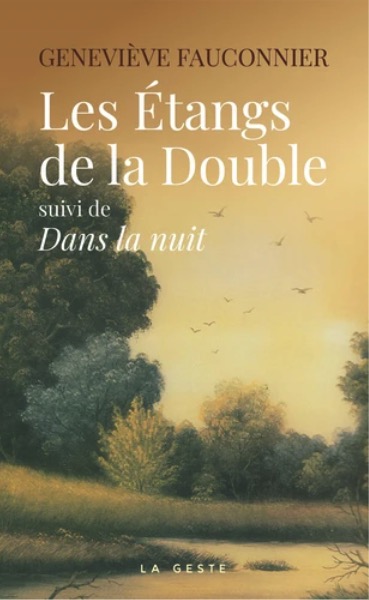
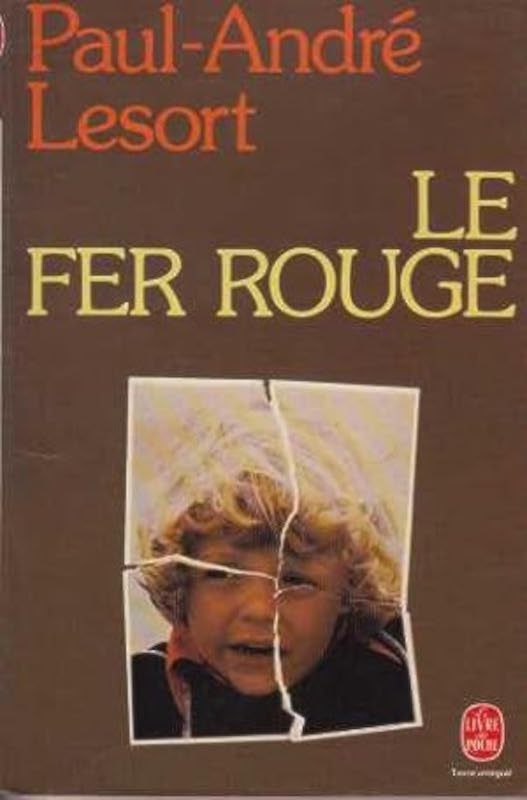

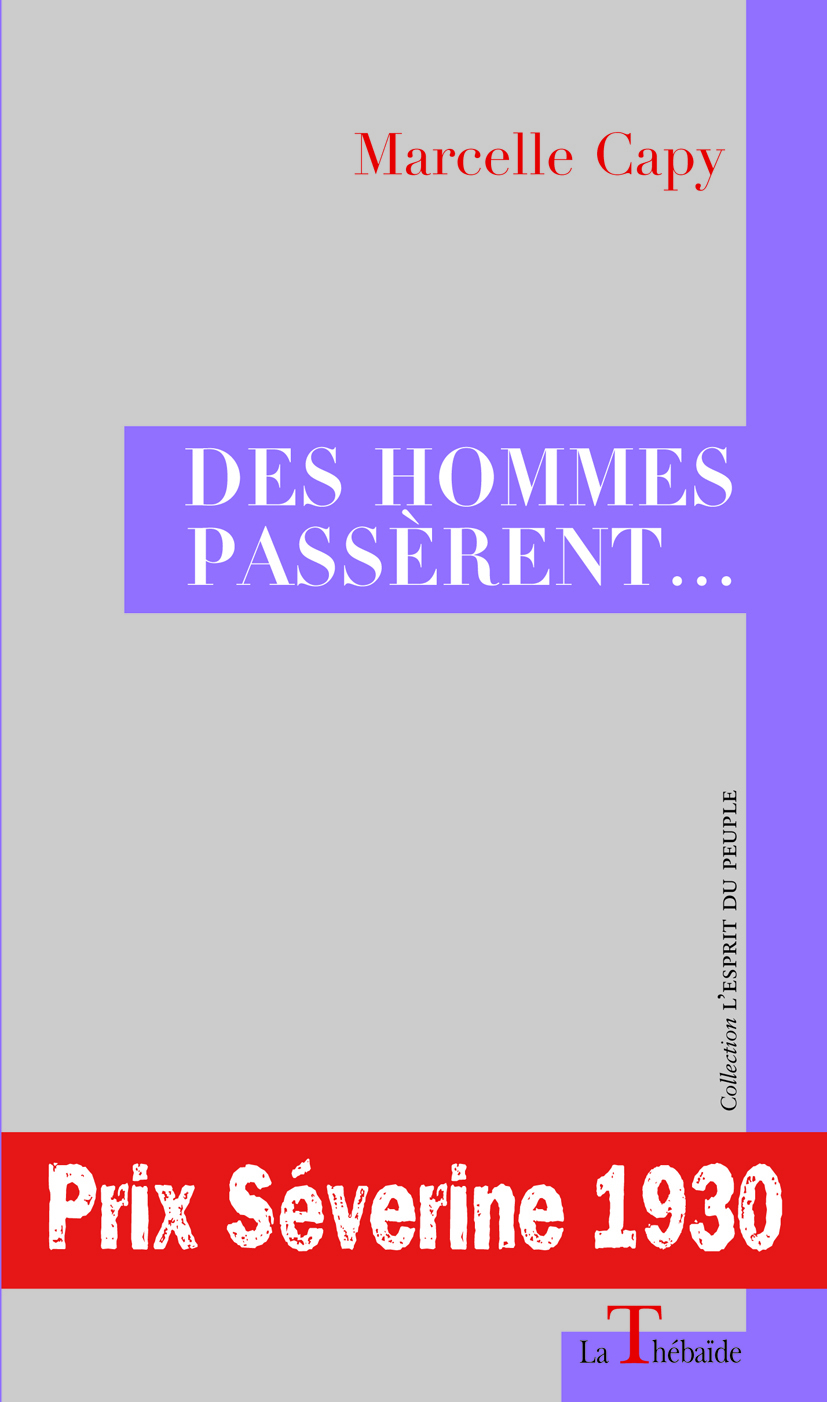
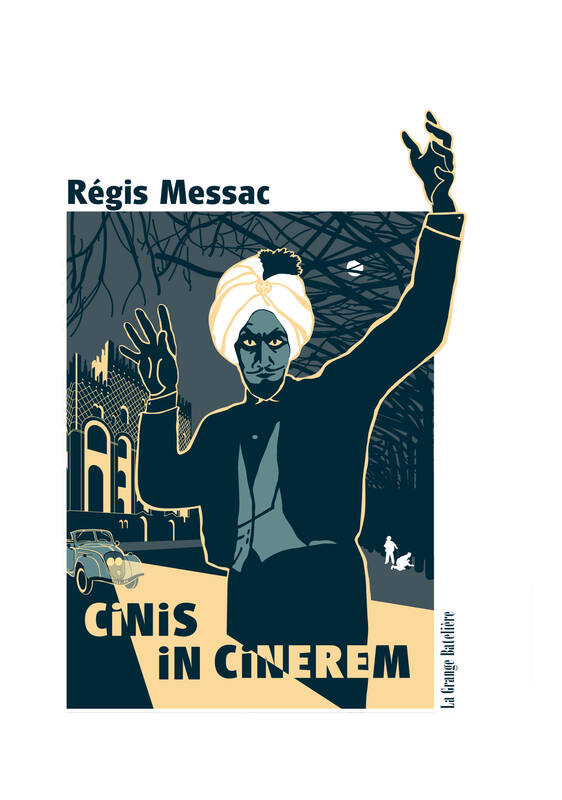
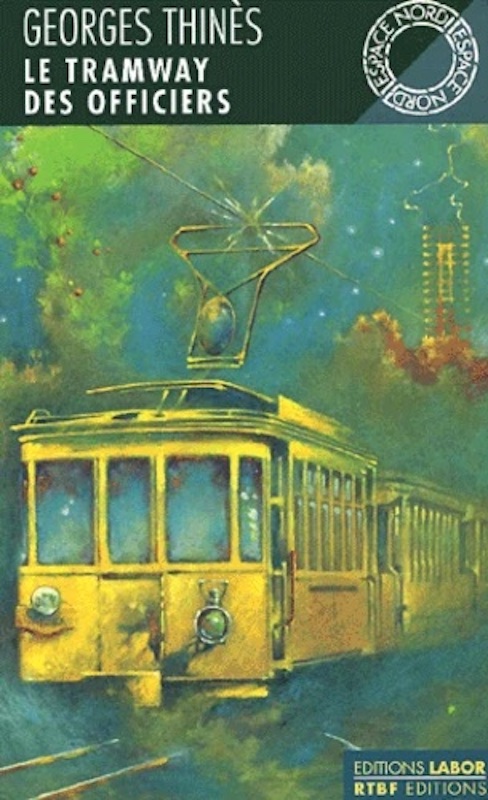
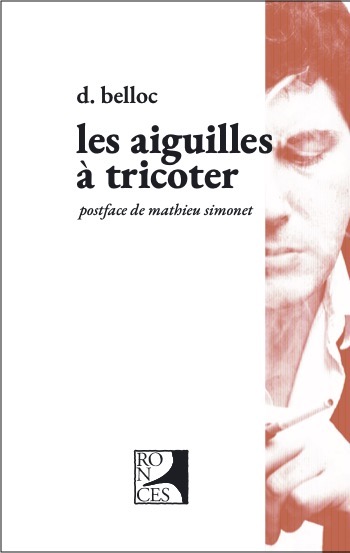
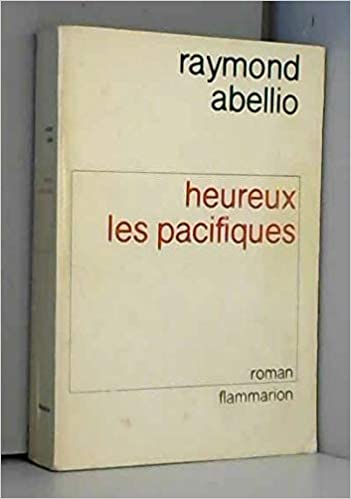
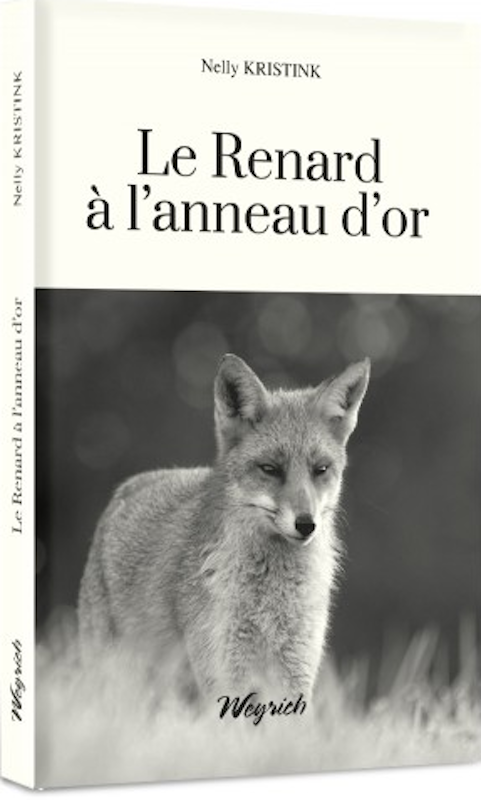
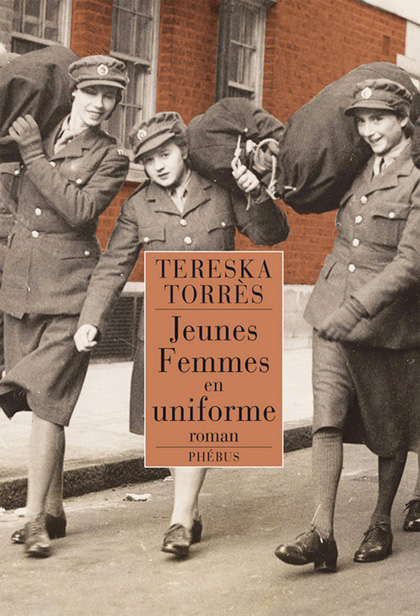
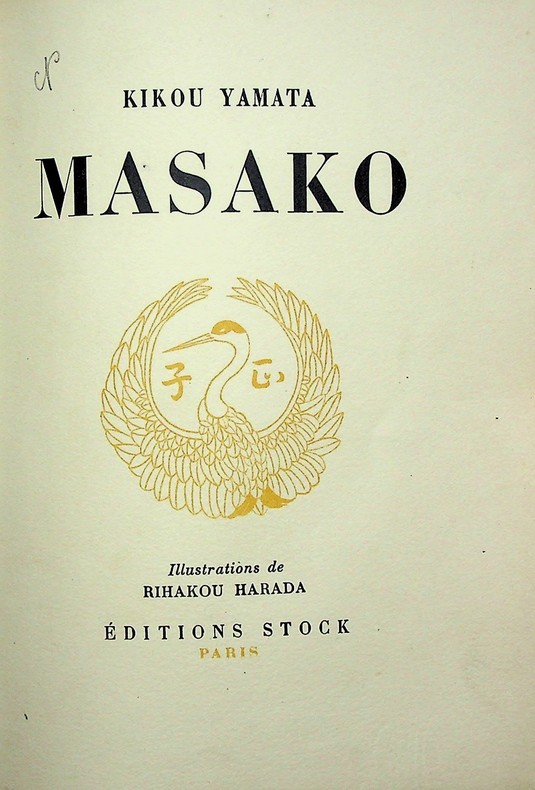
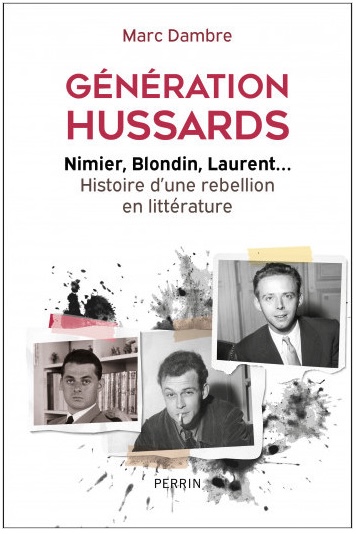
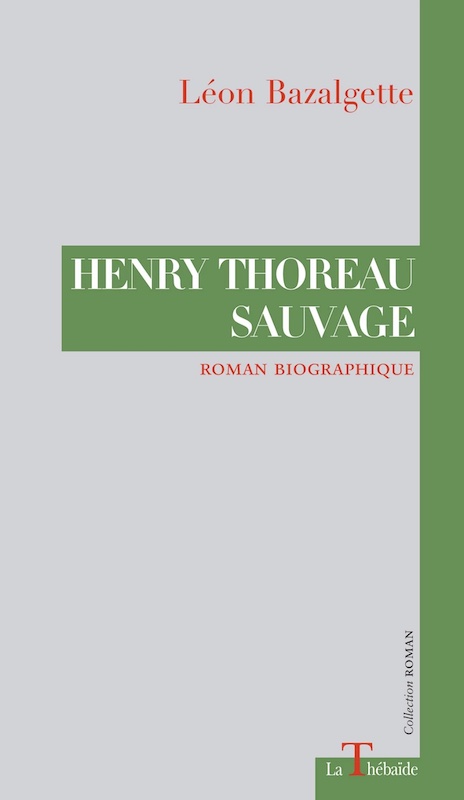
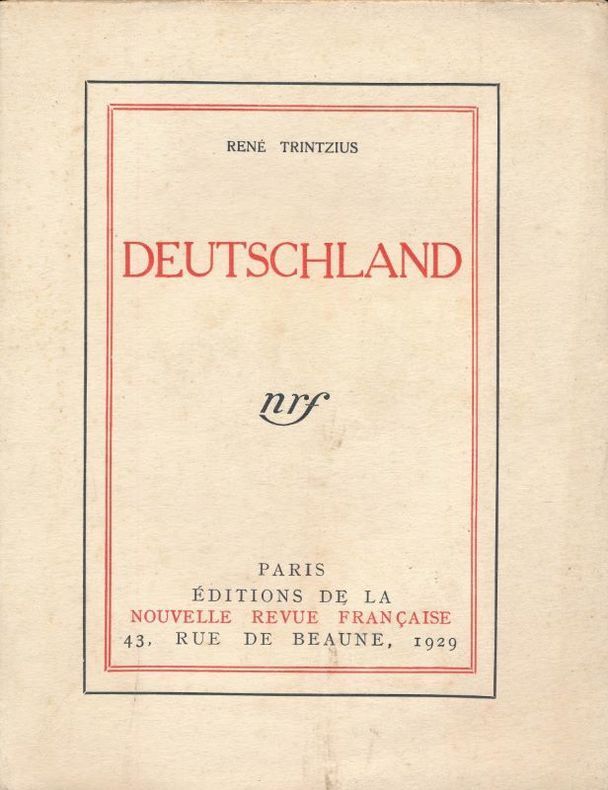
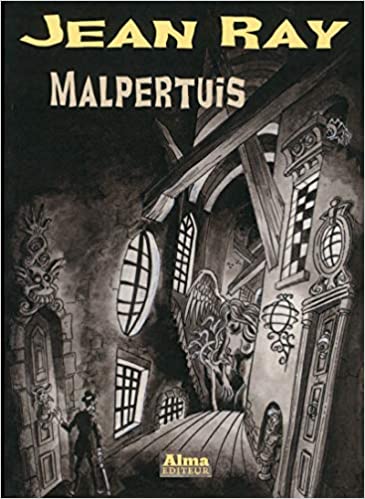
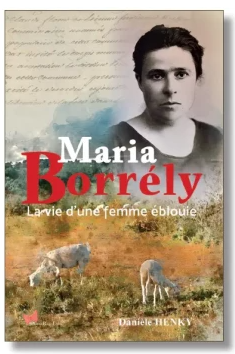
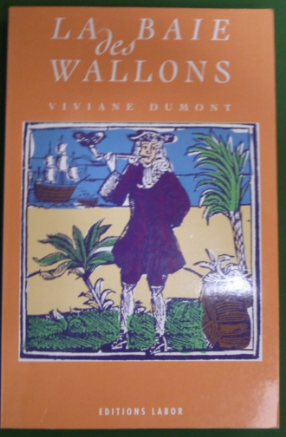
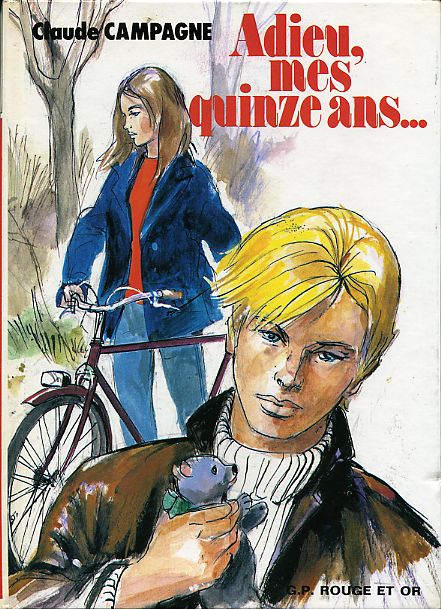
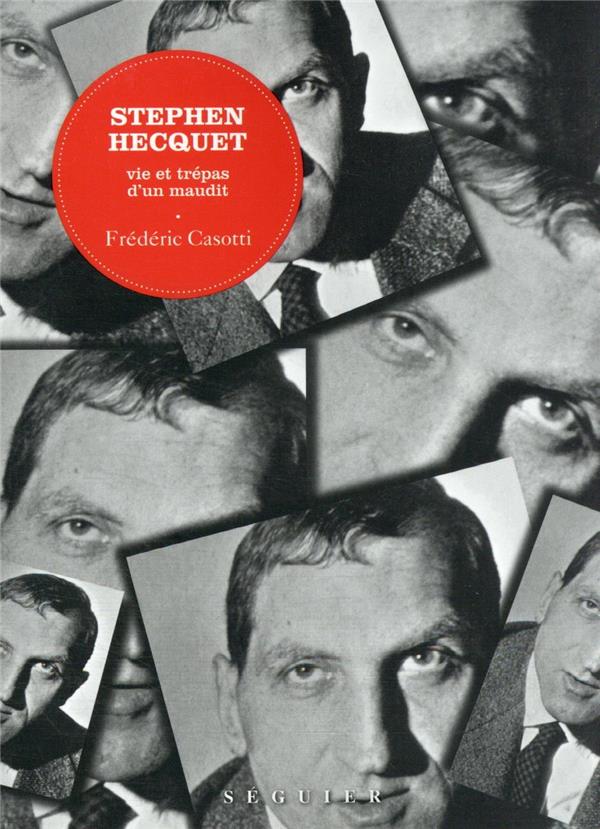
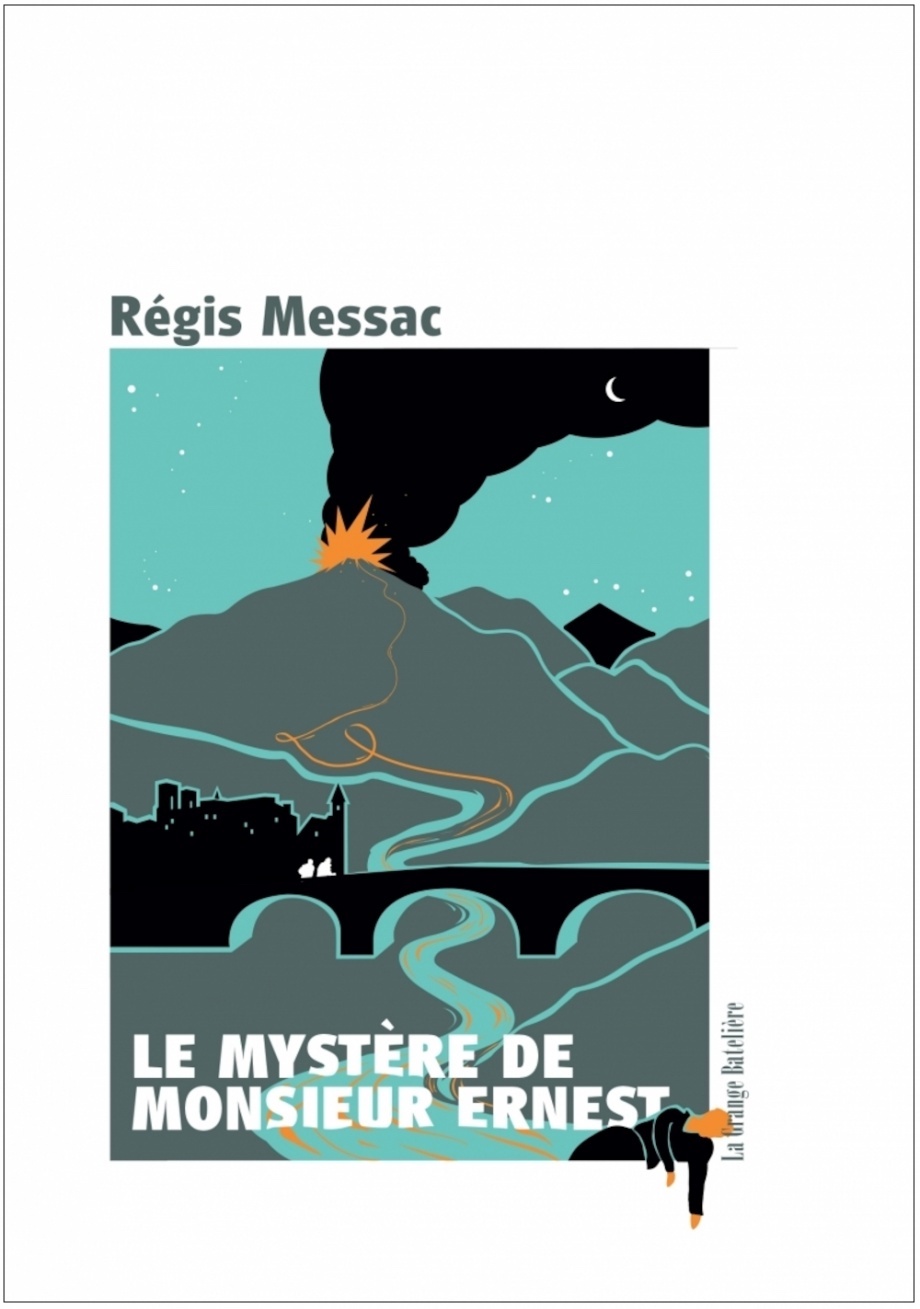

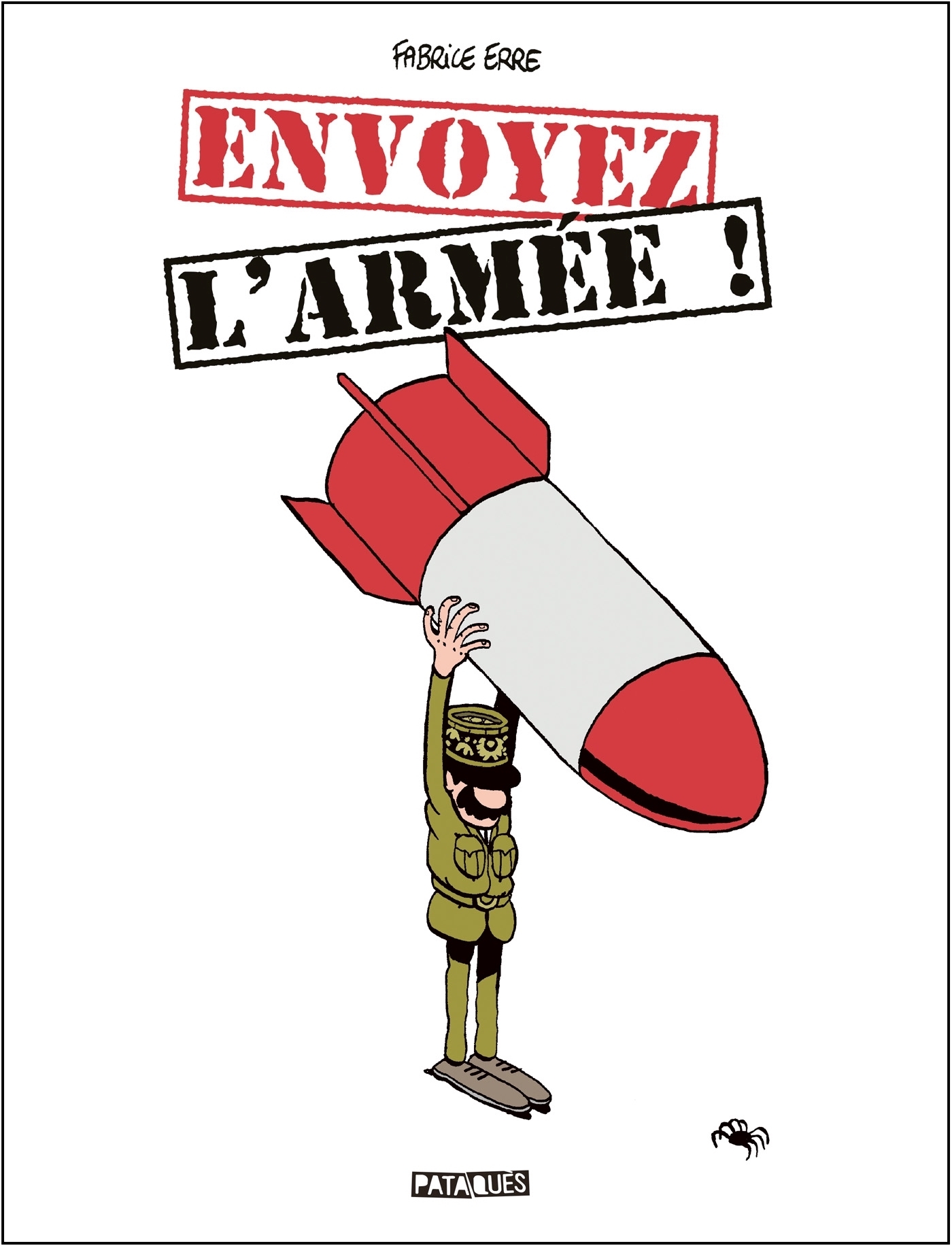
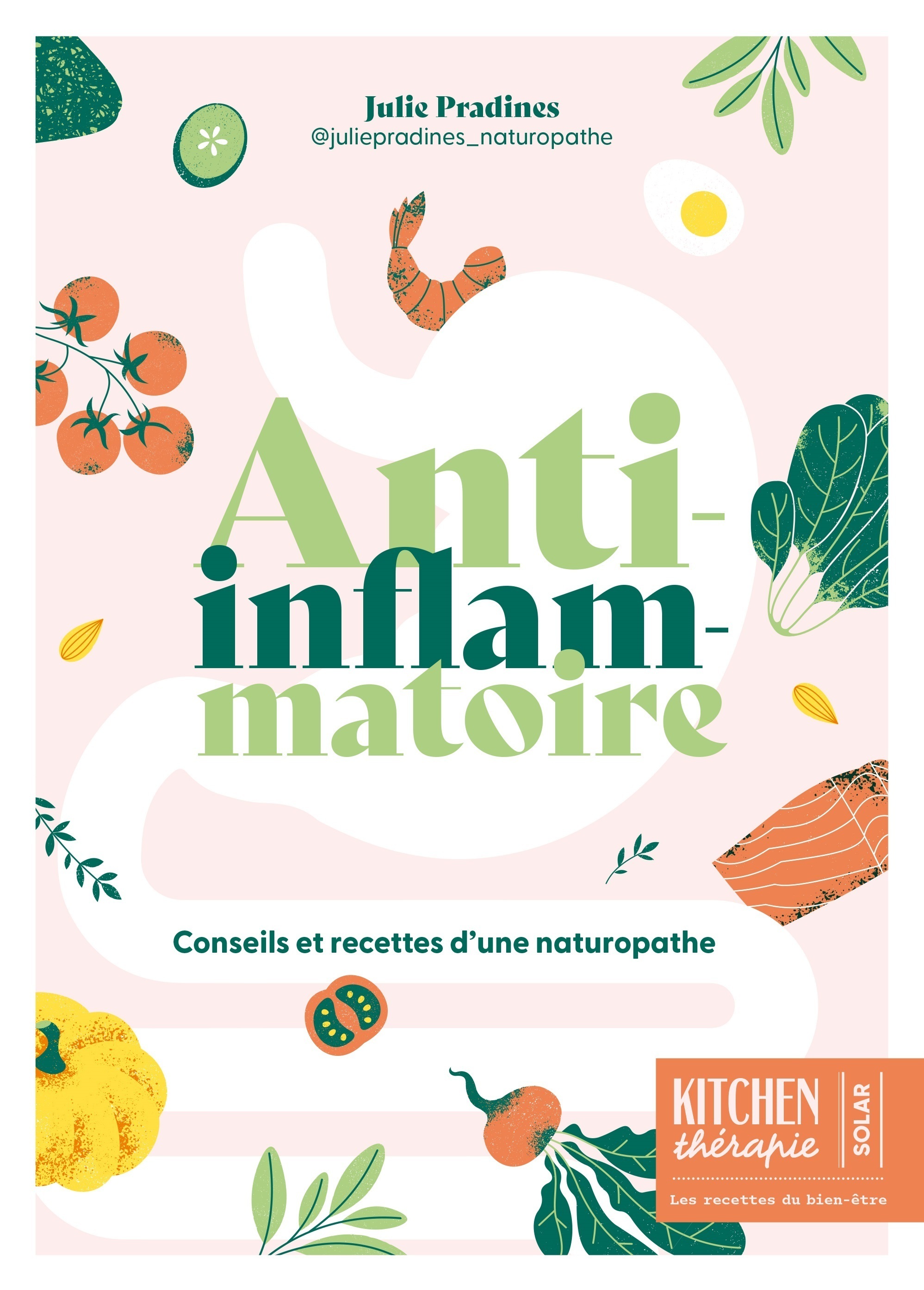
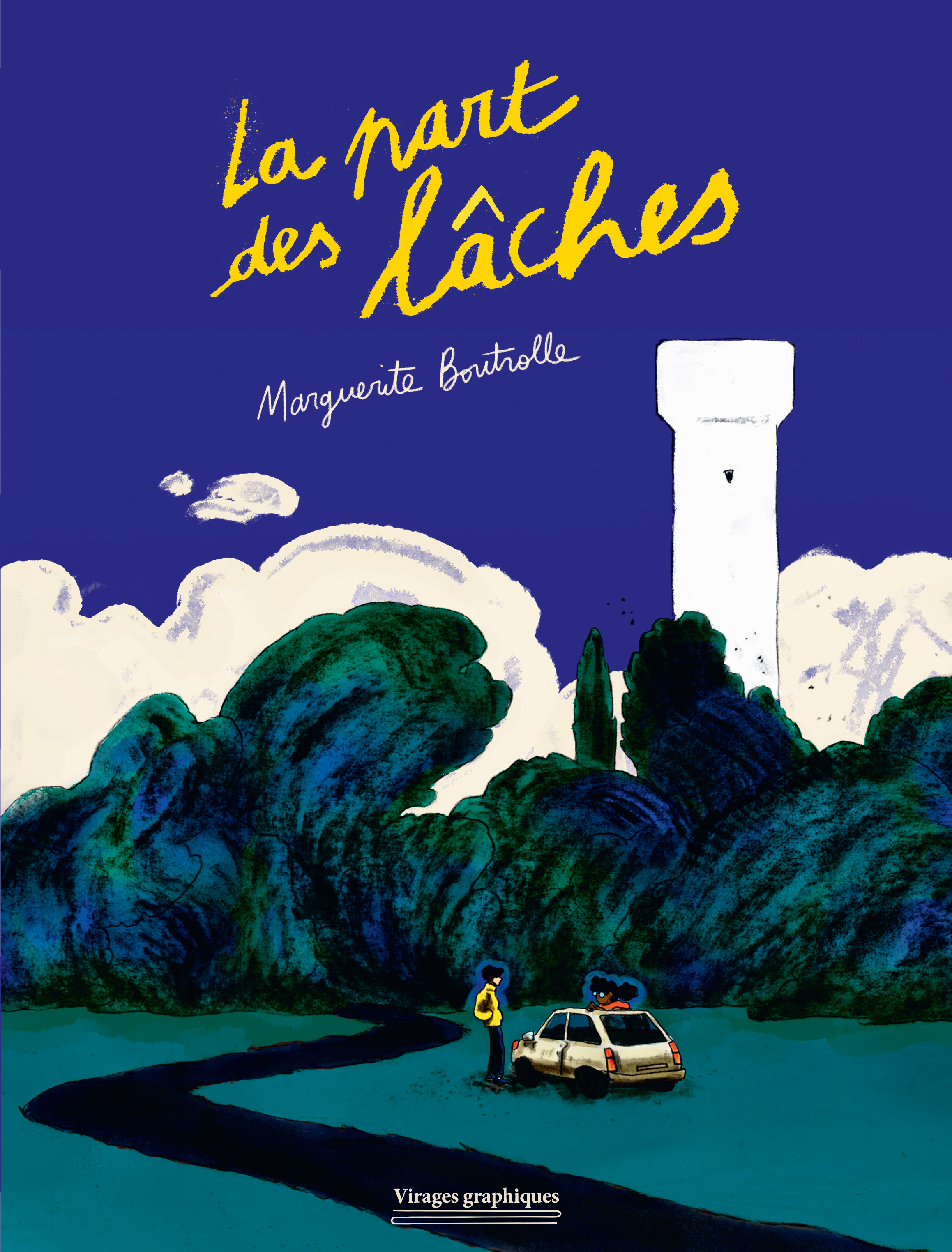

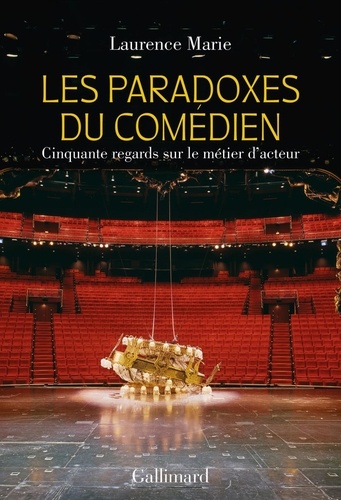
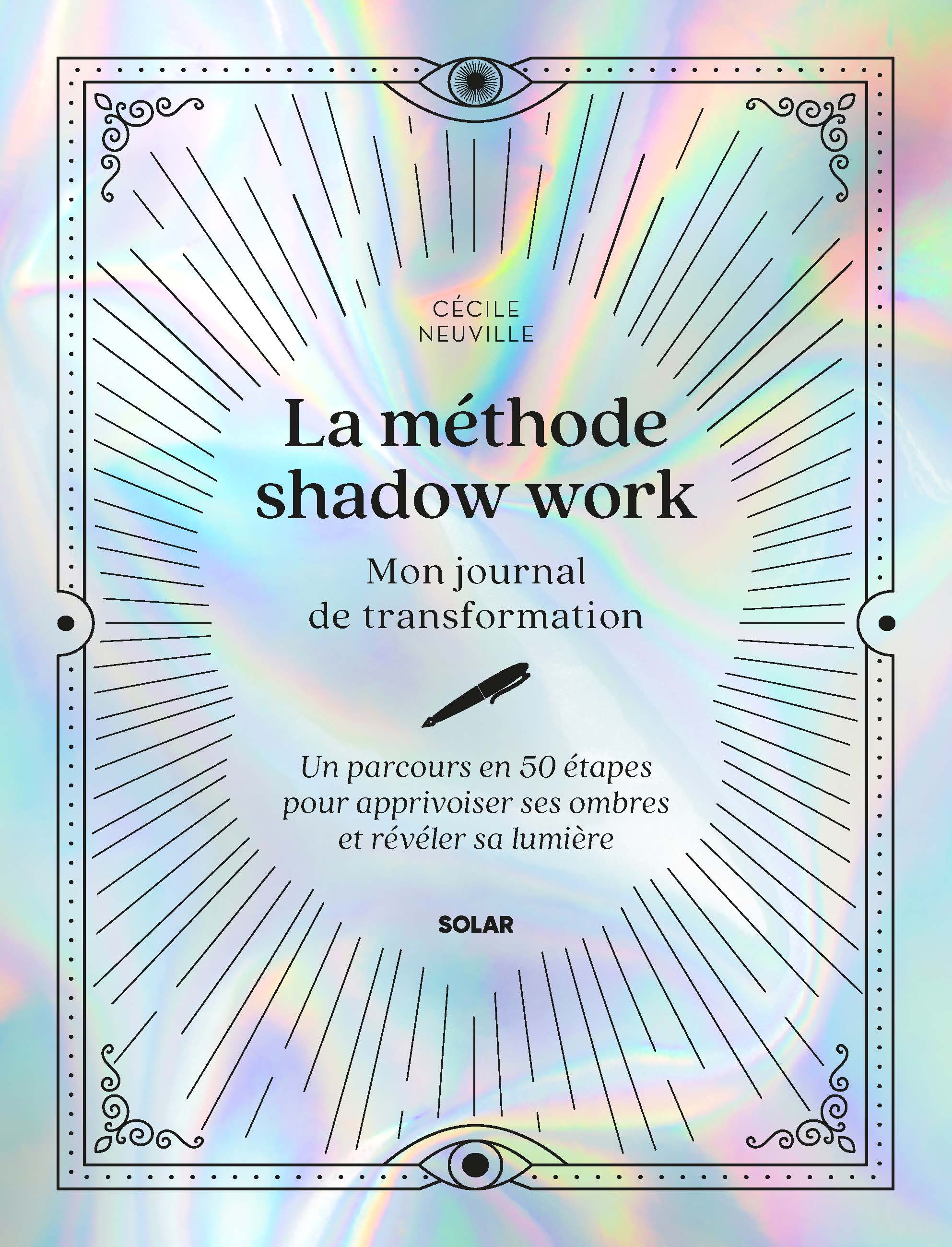
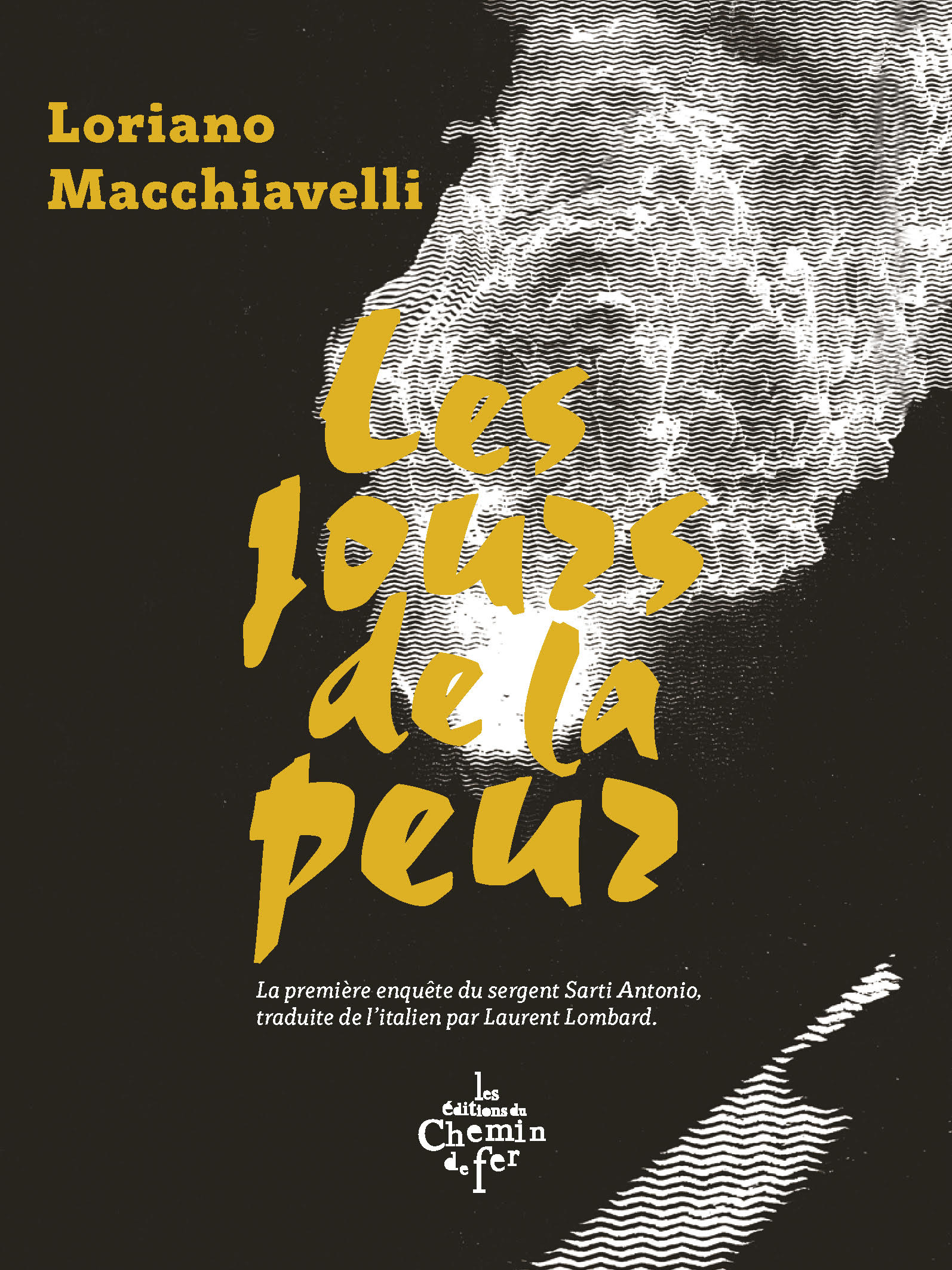
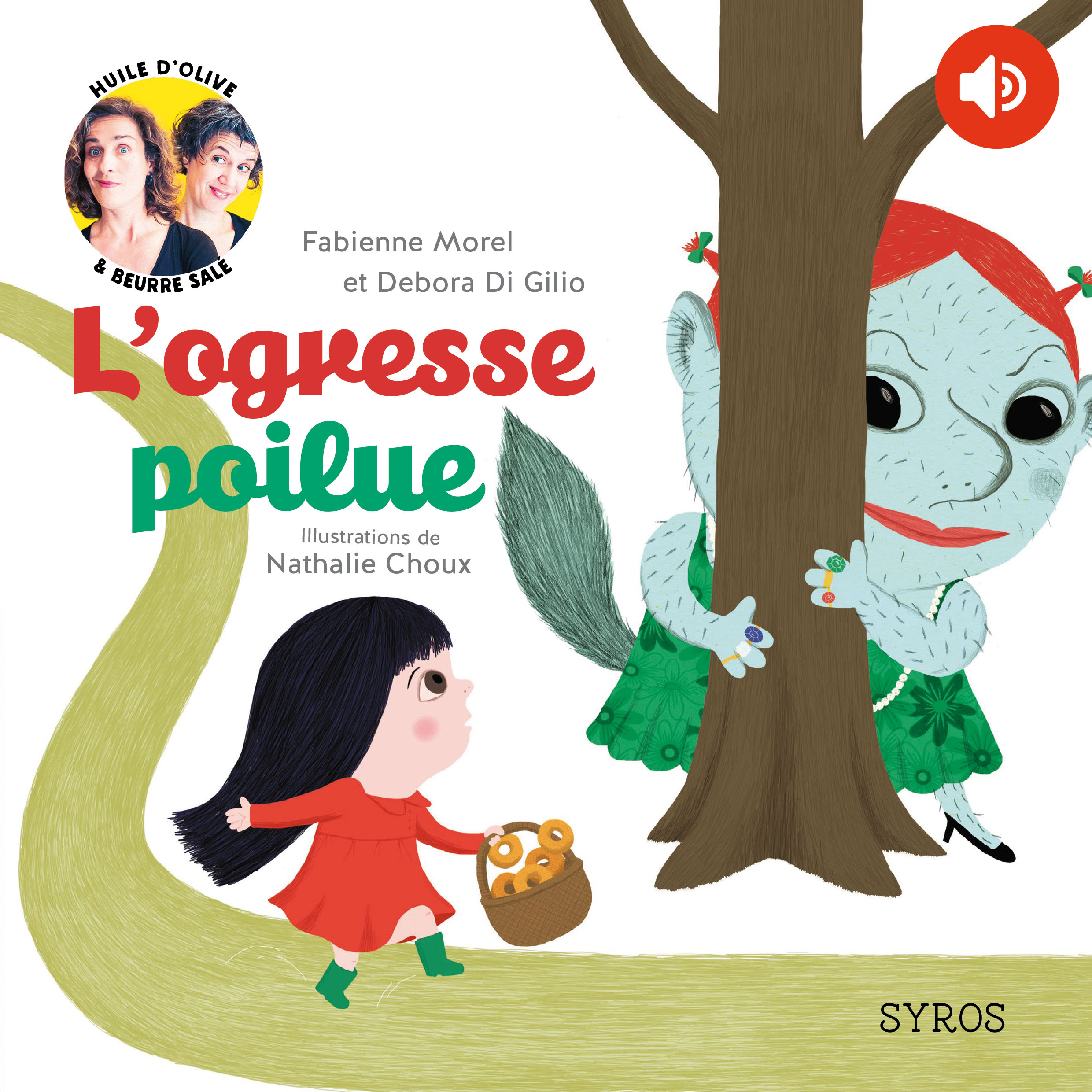
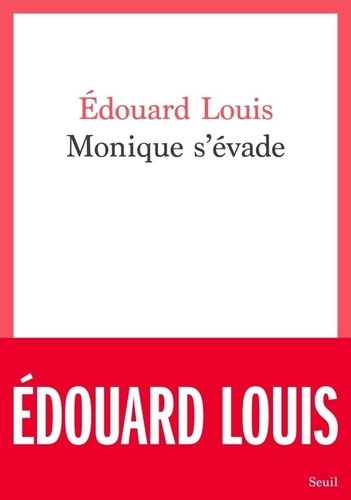
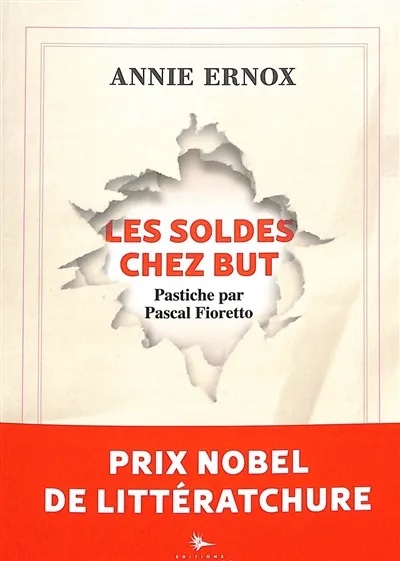
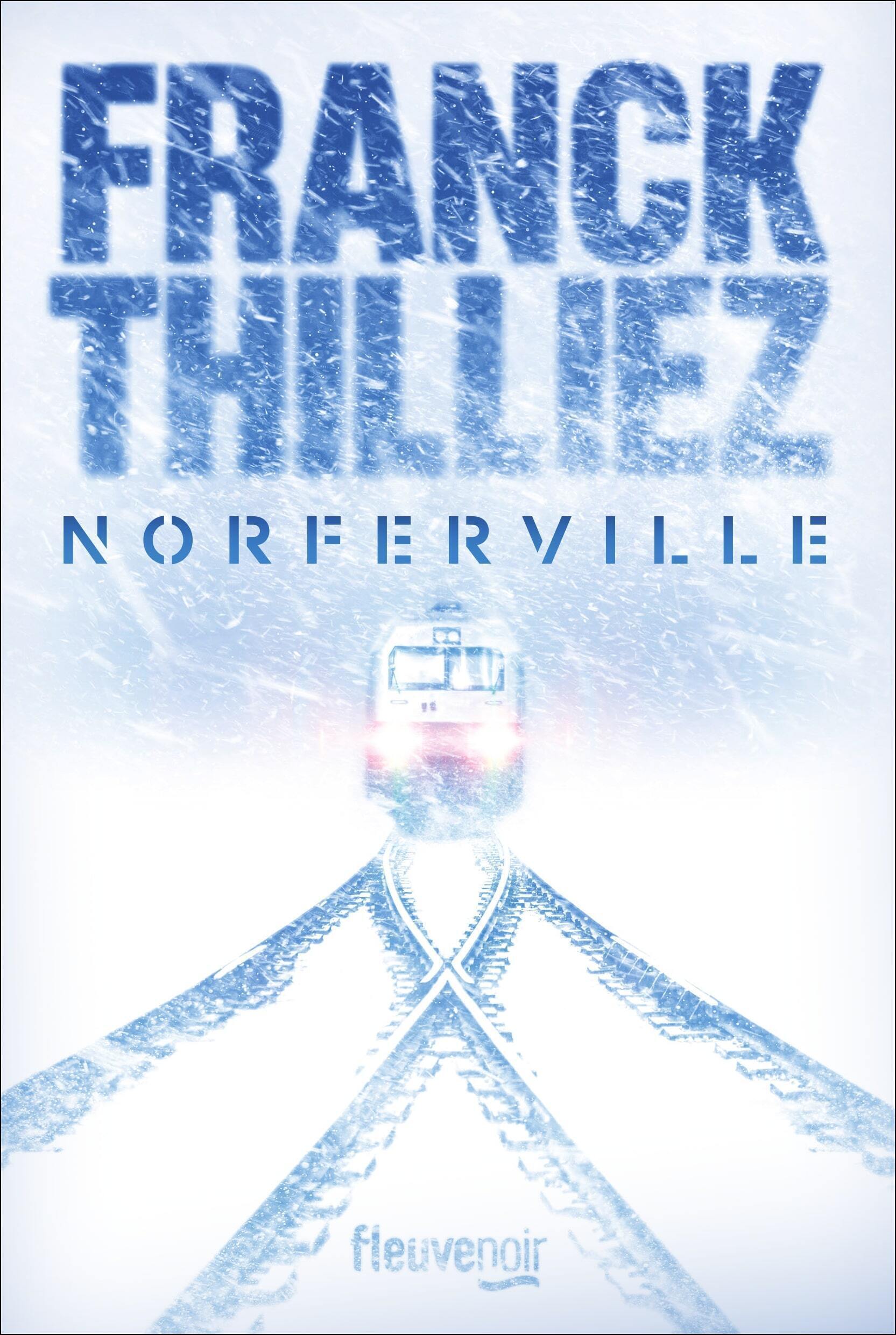
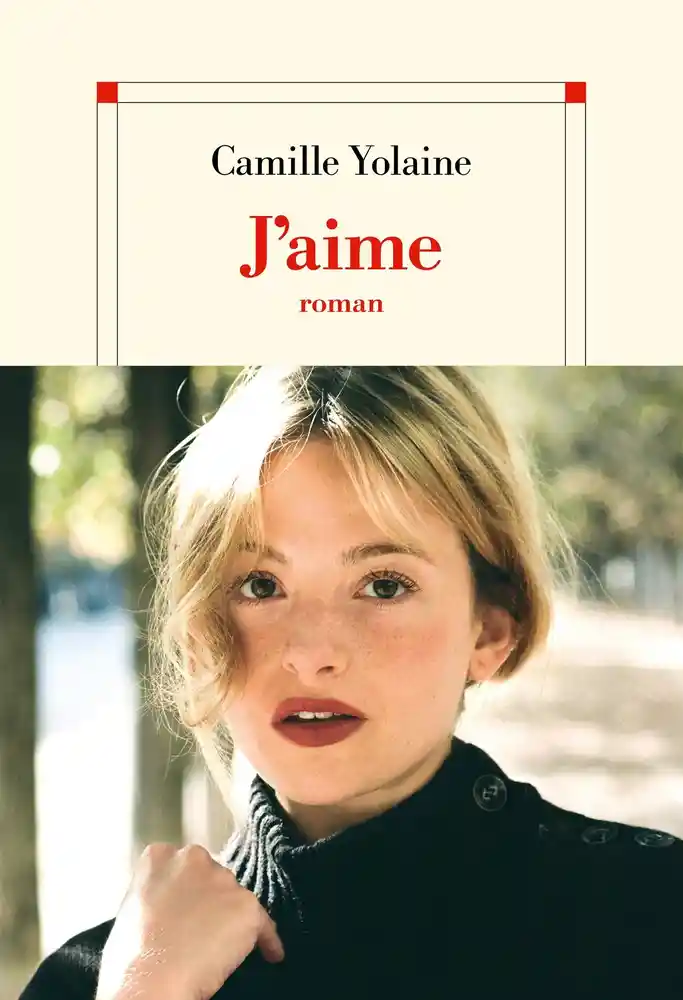
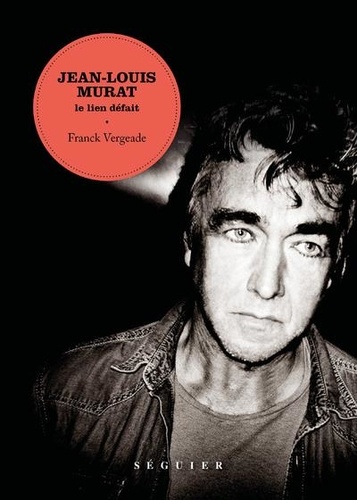
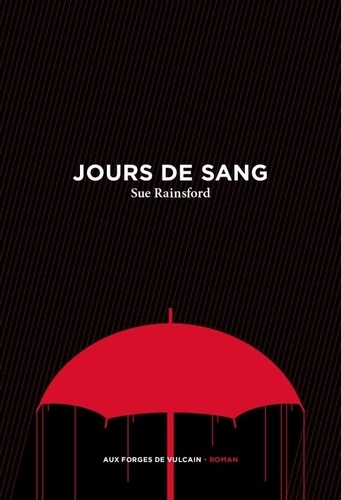
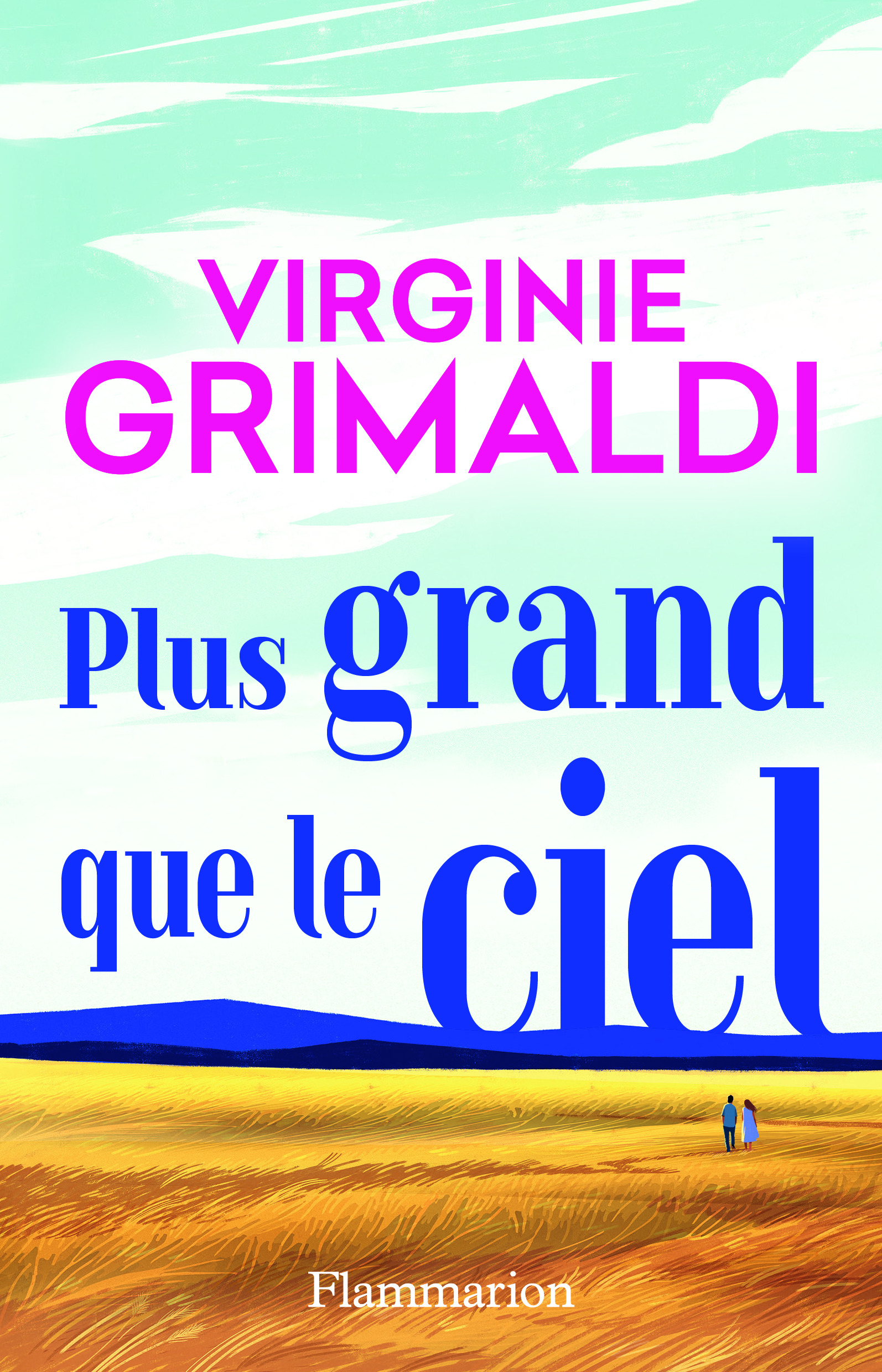
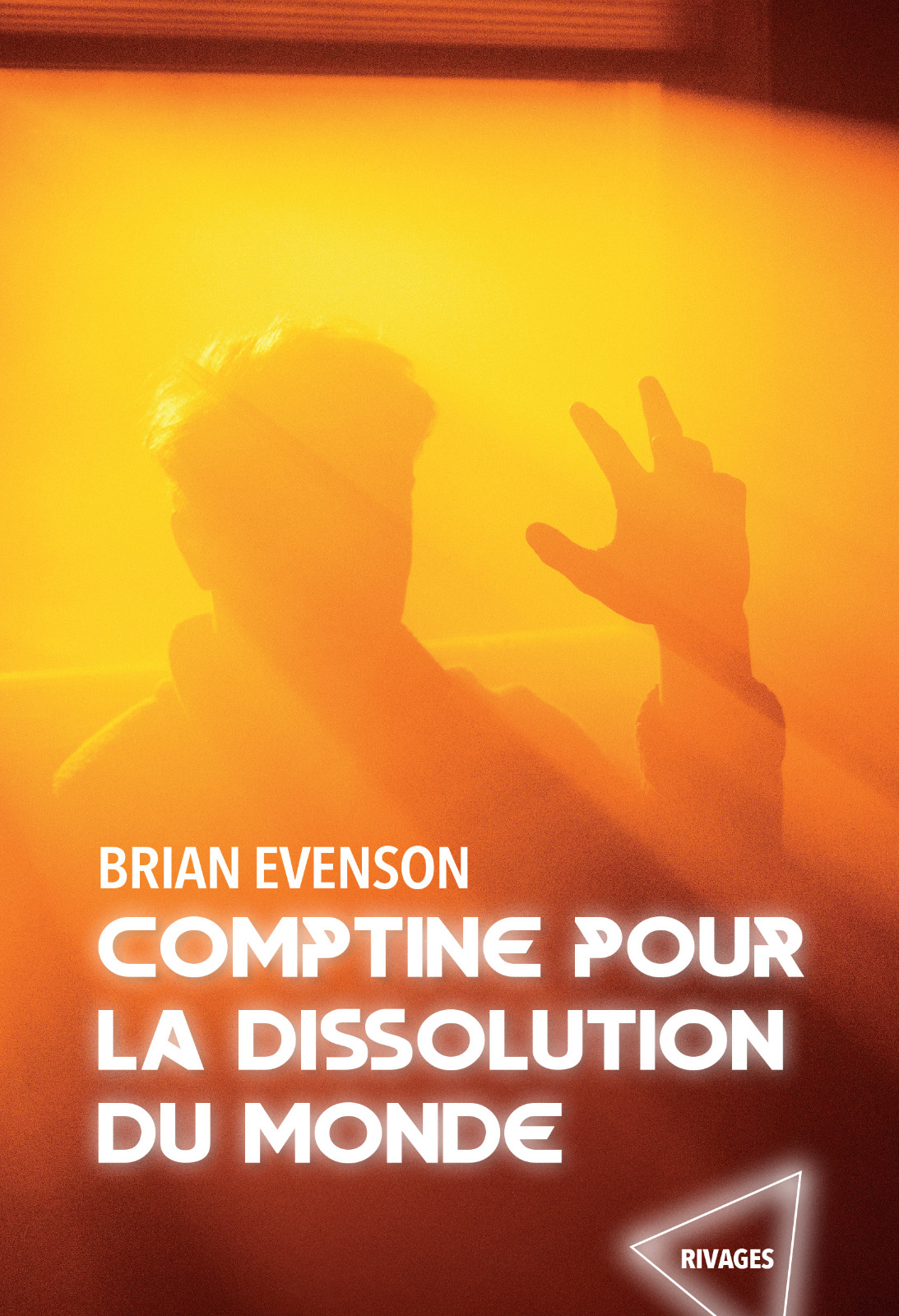
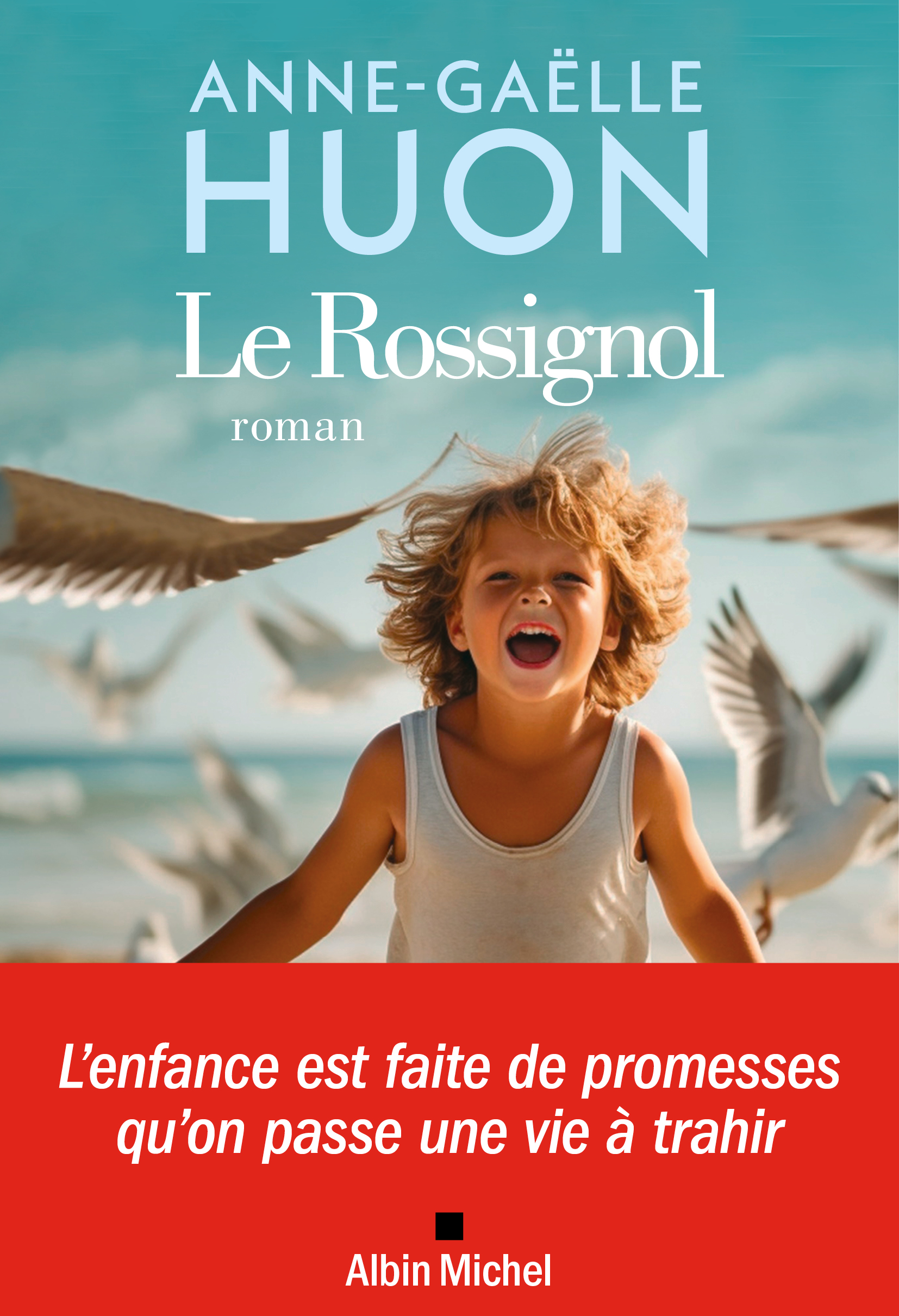
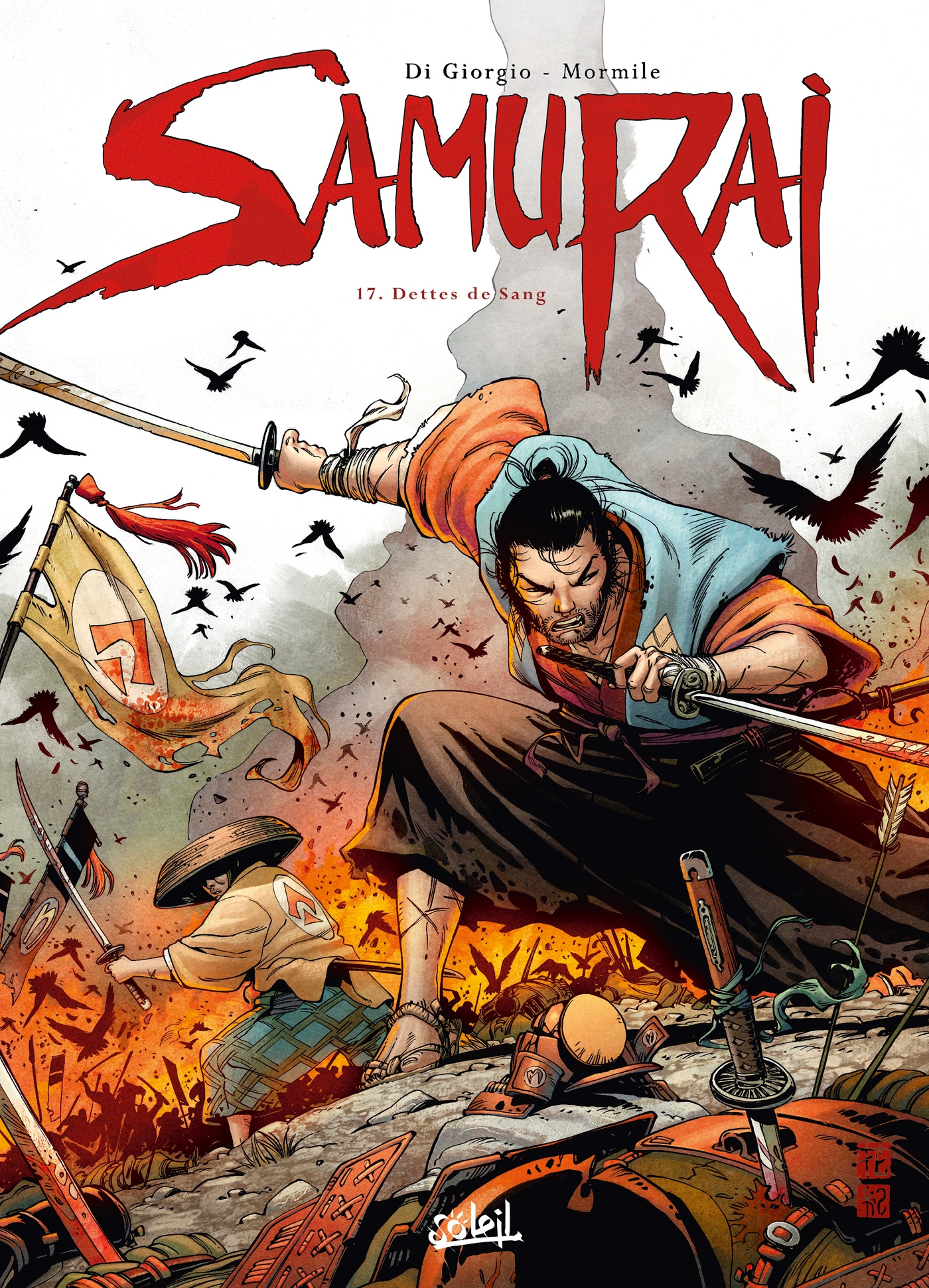


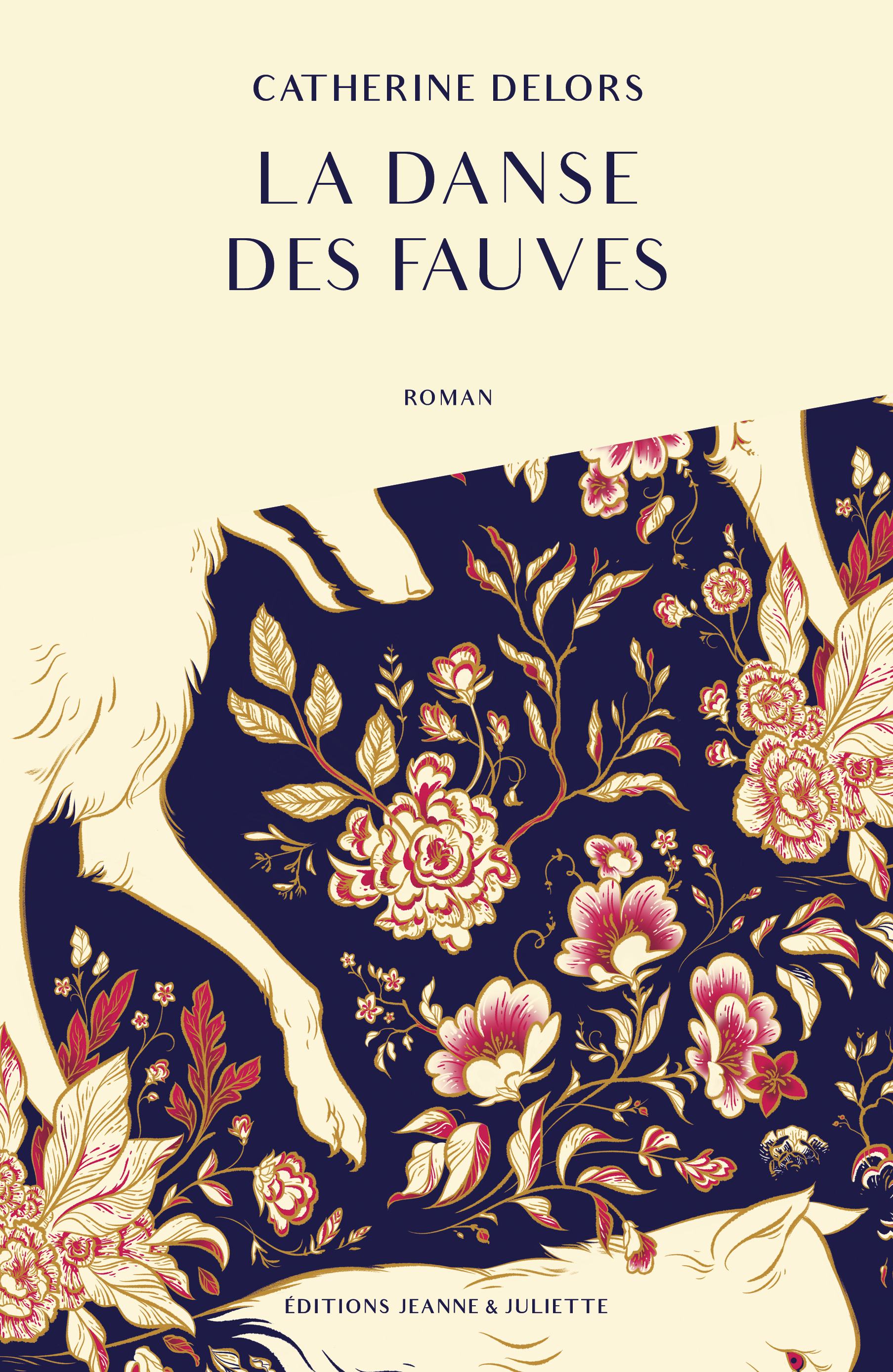
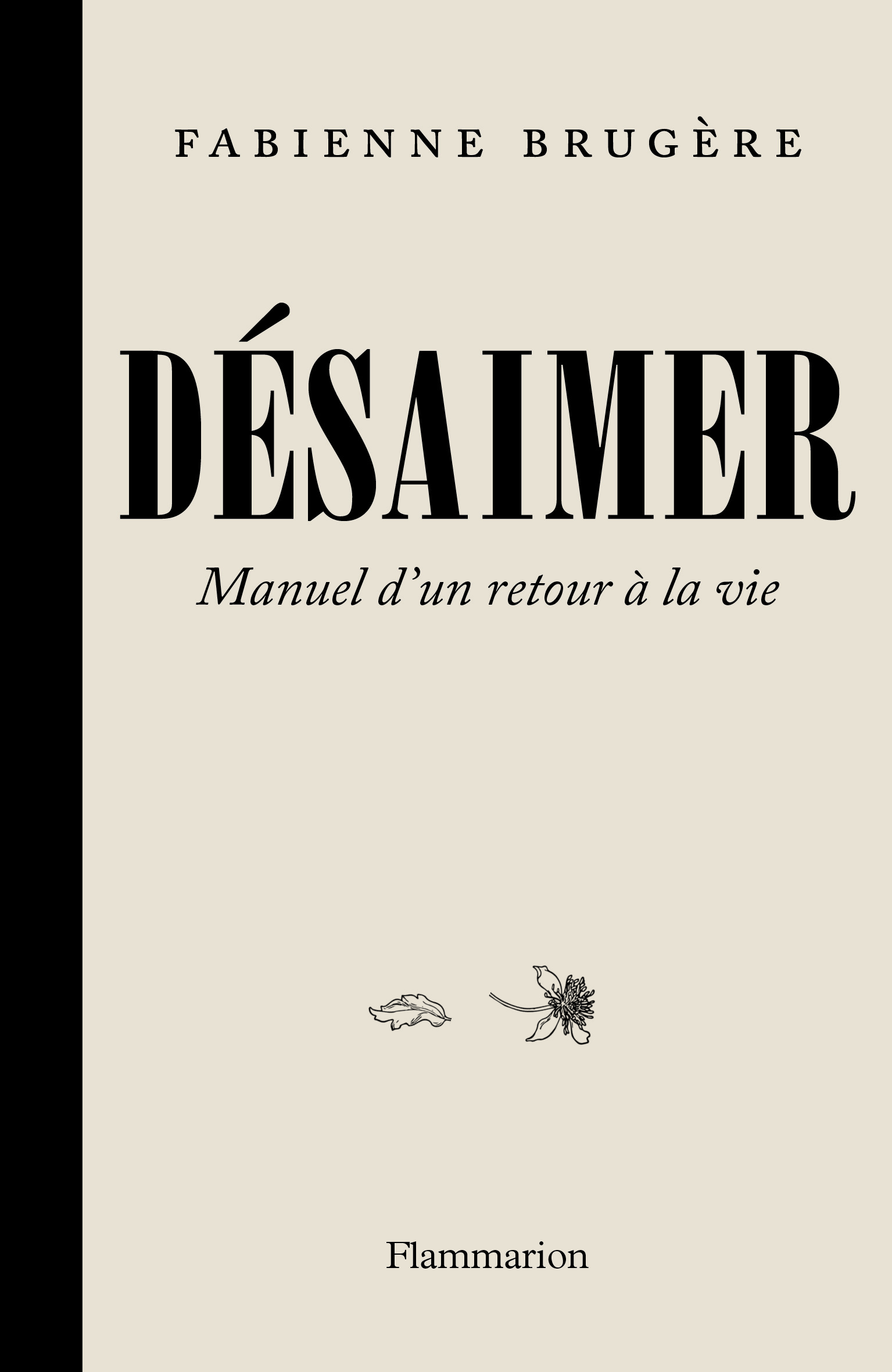
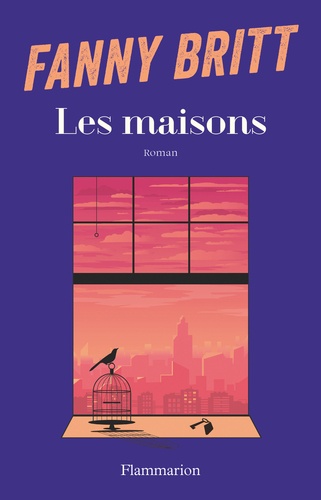
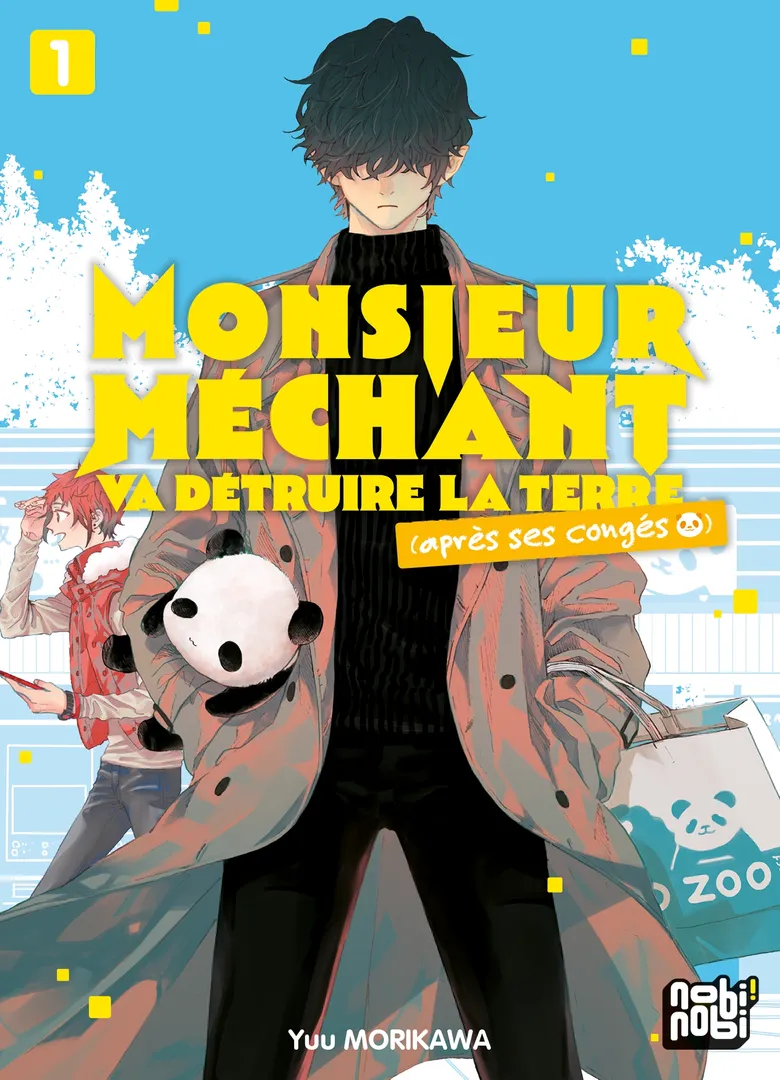

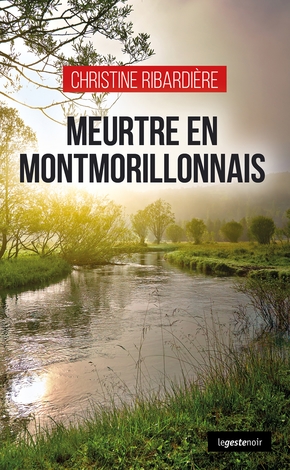
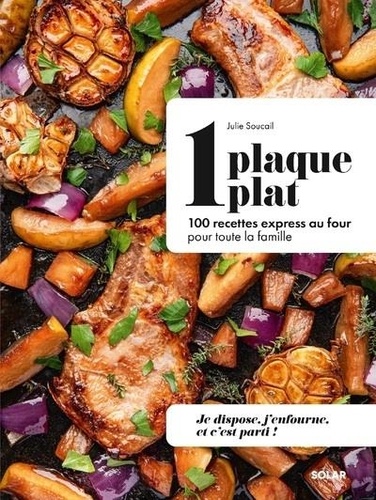
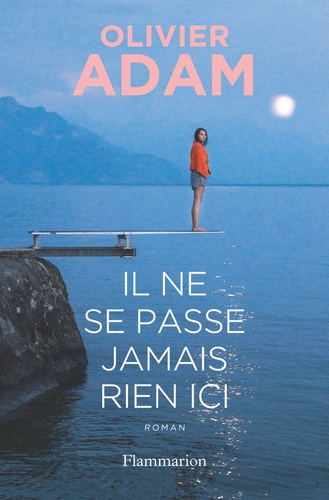
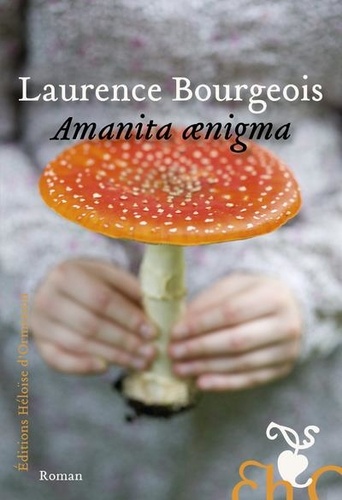
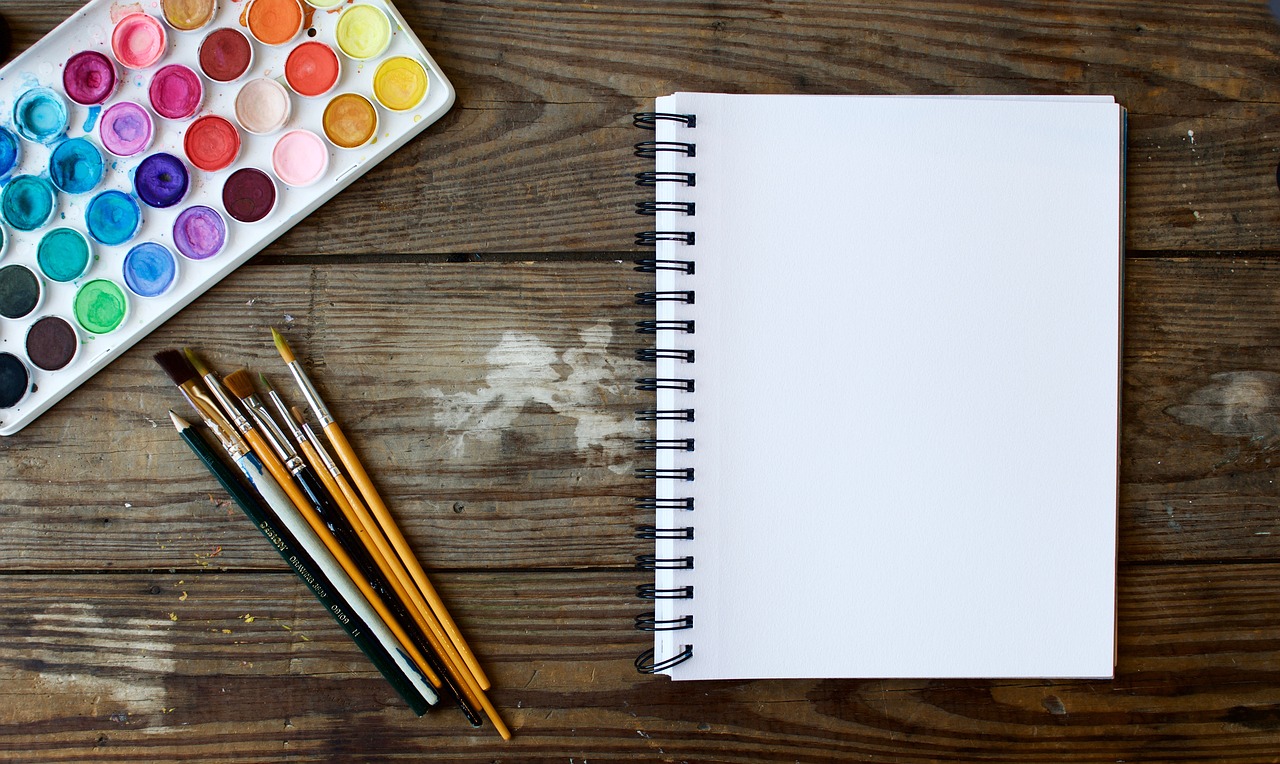
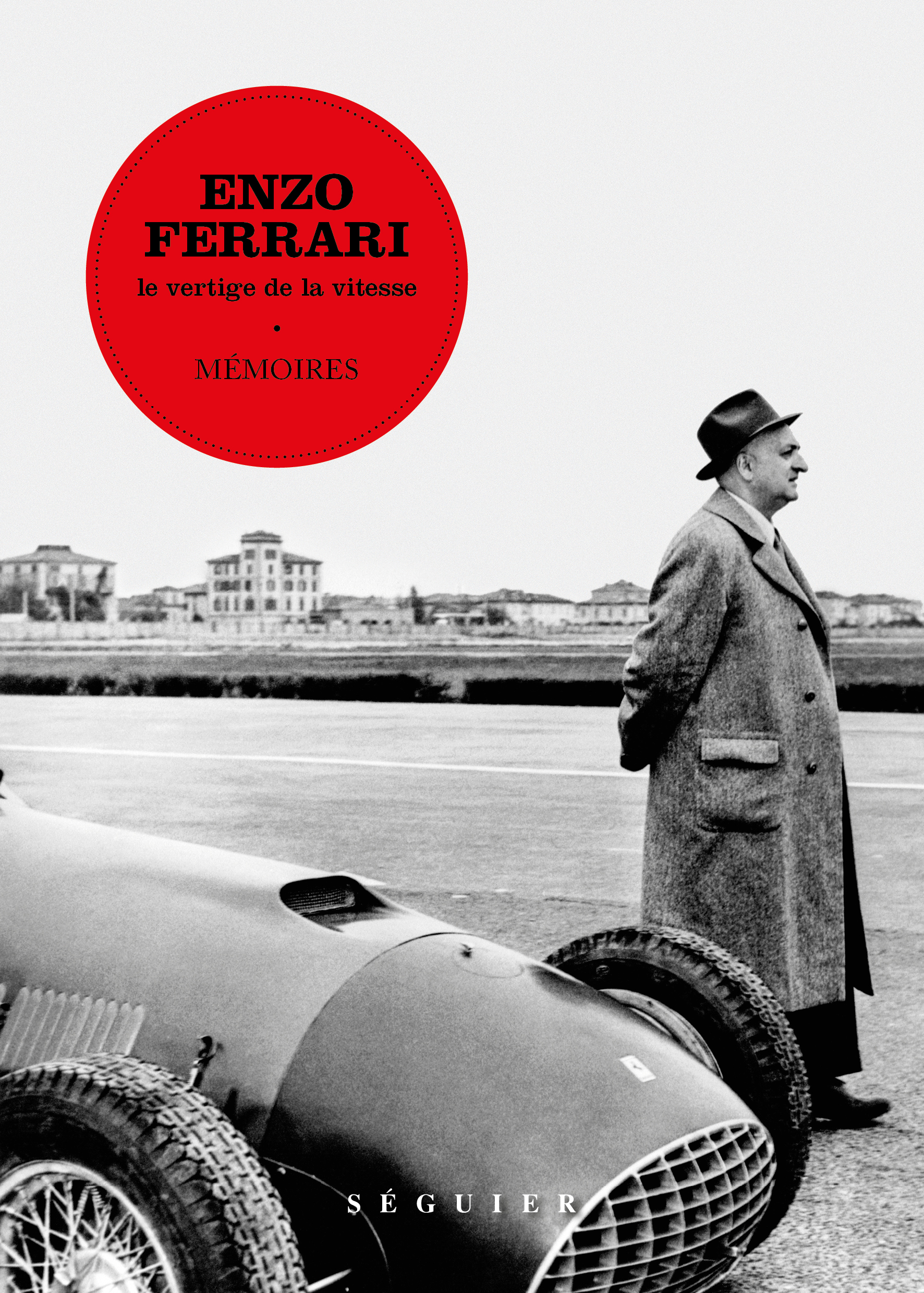
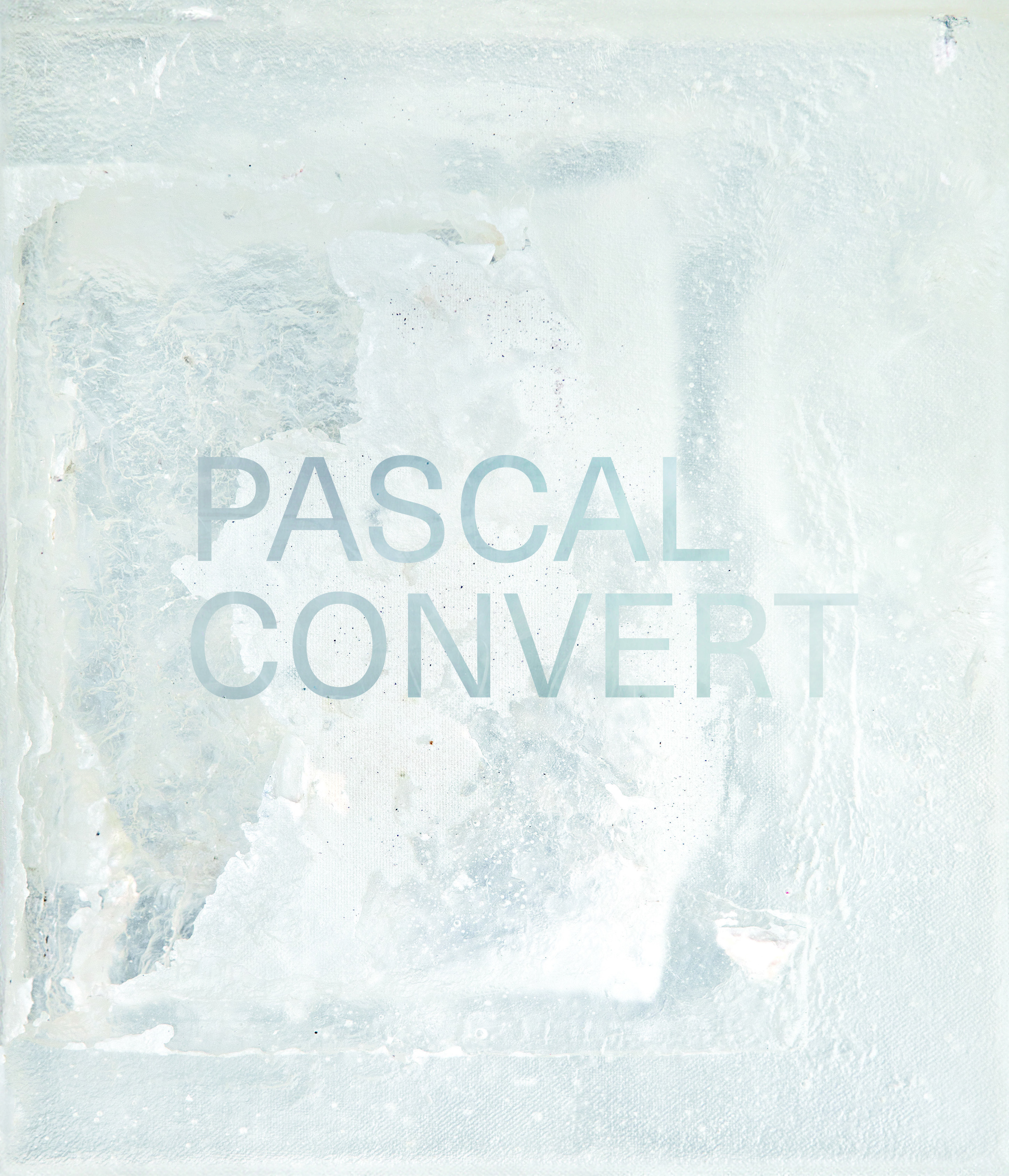
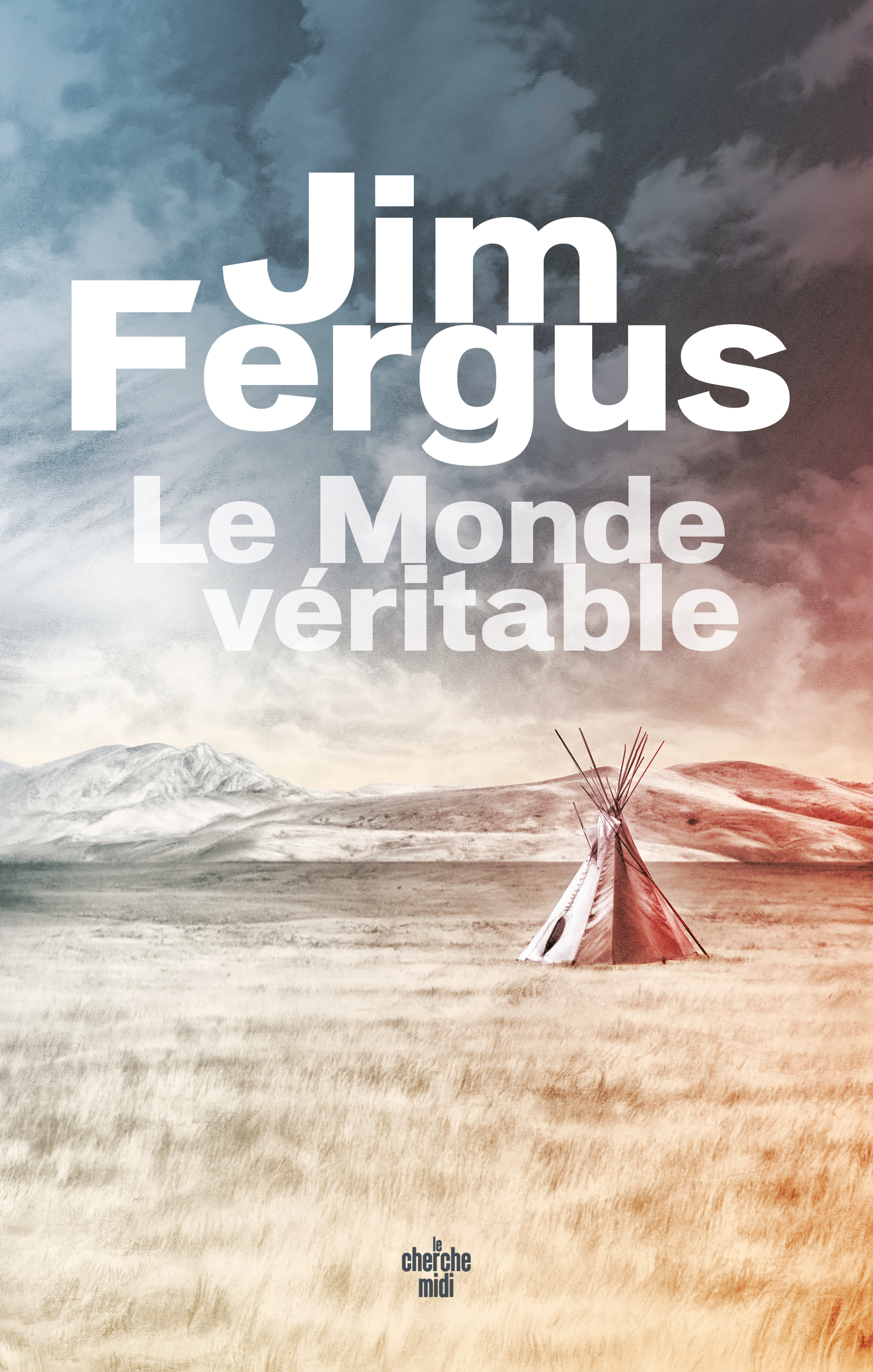
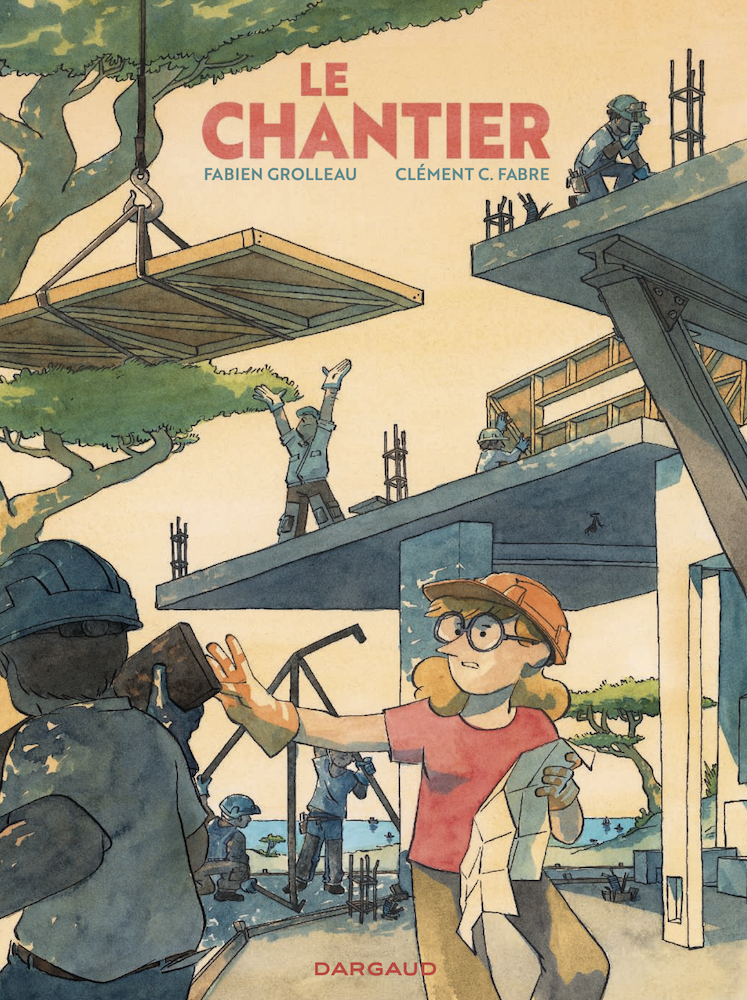
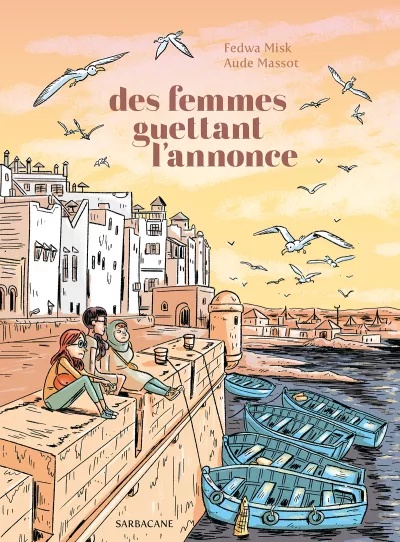
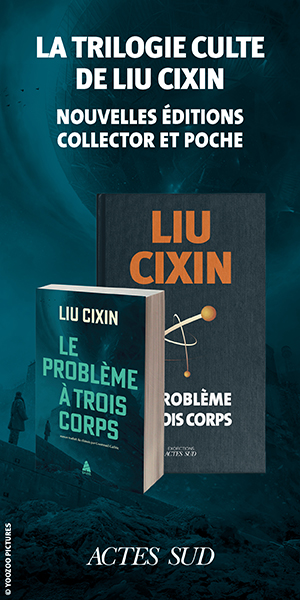
Commenter cet article