Les Ensablés – “Beautés de la Provence” de Jean-Louis Vaudoyer
C’est le temps des vacances. Paris se vide. Il faut partir aussi, et nous avons choisi de suivre Jean-Louis Vaudoyer (1883-1963), l’auteur des Beautés de la Provence (1926). Voici donc une carte postale un peu paresseuse qui nous rappellera « avec ses plus amicaux souvenirs littéraires, Jean-Louis Vaudoyer ».
Le 29/07/2018 à 09:00 par Les ensablés
1 Réactions | 1 Partages
Publié le :
29/07/2018 à 09:00
1
Commentaires
1
Partages
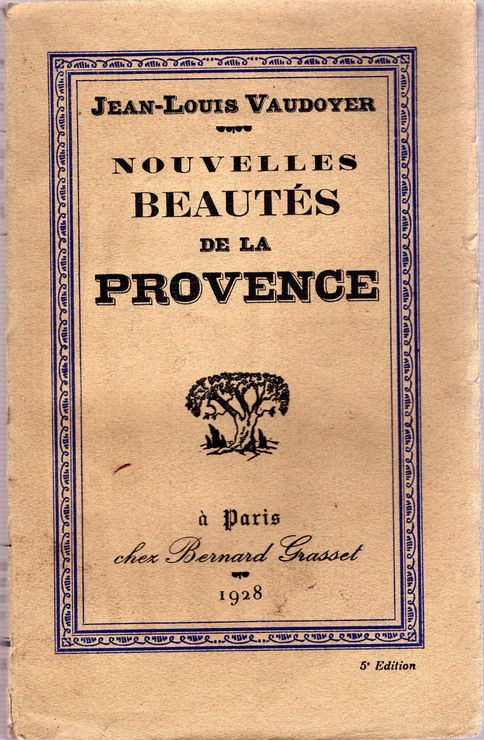
Par Antoine Cardinale
Nous aurions vingt ans, ce serait l’été de 1926, et ce romancier et poète, cet élégant critique d’art de quarante-trois ans, ami de Marcel Proust et de Jean Giraudoux, nous serait le guide que nous n’avons jamais eu, et que pourtant tout jeune homme qui aime l’art et ignore la vie devrait avoir : érudit, voluptueux, instruit de tout, amusé par un rien, avec des habitudes de gaieté, mélancolique mais rarement et avec discrétion, il incarne comme le dit Roger Martin du Gard «l’honnête homme, le Français classique ».
Ce que je vous invite à visiter au moyen de cette longue carte postale, ce sont moins des monuments, des œuvres d’art ou des paysages que le goût d’une époque –si le goût d’une époque se peut visiter- dont Jean-Louis Vaudoyer fut un des éducateurs les plus éminents : romancier à succès, critique à l’Echo de Paris et de cent revues et gazettes, conservateur du musée Carnavalet et administrateur de la Comédie française.
On prend vers le soir le chemin de la gare de Lyon : la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, me dit-il, lui fait profiter d’un « titre de parcours », je crois que nous en profiterons aussi. Où est notre voiture ? « Viens avec moi » nous dit-il dans sa préface : suivons-le, les vacances commencent enfin !
On s’est endormi, bercé par le roulis et au matin dans notre couchette, à travers l’intervalle des rideaux de laine brune, le soleil pose une lame chauffée à blanc sur notre visage : nous sommes arrivés ! Le soleil qui claque comme un coup de feu, cette détonation silencieuse de la lumière, c’est Marseille, c’est Saint-Charles ! Certes la Nationale 8 aurait pu nous y conduire, puisque les Citröen et autres Panhard-Levasseur ont porté l’automobile à un point de vitesse qui ne sera pas dépassé mais, nous dit Vaudoyer « si tu peux, arrive à Marseille en bateau ; le mieux serait de revenir de la Chine, des Indes ou d’Alger. Les îles sont devant toi, Ratonneau et Pomègues, tu verrais de loin les monts de l’Estaque, les monts de l’Etoile. Enchante tes yeux de la seule mer bleue ».
Bien sûr ce sont des solutions modernes car aux siècles anciens, « la route reine c’était la route du Rhône, grand chemin d’eau et de soleil » du temps que les routes étaient peu sûres : on arrivait à Aix comme on rejoint un port après un voyage aux Barbaresques ; Marseille n’était plus loin.
Car si, sur de nombreux points, et dans l’esprit même, les chroniques des Beautés de la Provence ont beaucoup à voir avec le Journal de Montaigne ou celui du président de Brosses, les choses modernes, l’électricité, la radiophonie, l’automobile et les aéroplanes, s’y mêlent aux choses anciennes : un sarcophage au relief tout arrondi par l’usure, une colonne de brèche africaine ou une tapisserie des Gobelins ; et tout cela sur une mode fantastique et poétique, comme les elfes et les fées de la Nuit d’été qui rentrent dans les maisons et les étables et posent des perles surle front des vaches et glissent des grenouilles dans le lit des jeunes filles .
Assis à l’ombre d’une terrasse, après un riche repas : « des olives à la jeune chair, le tulle d’une omelette légère, le velours du bœuf en daube, des artichauts à la barigoule, des confitures de coing, arrosé d’un agile et chaud petit blanc des Mées et d’un Chateauneuf du Pape couché dans le bourdaloue d’osier », parlons un peu avec notre guide de notre plan de voyage.
Comme Napoléon déployait devant son frère Lucien la carte du monde en lui lançant « Choisis parmi les royaumes du monde », peut-être me dira-t-il « Choisis toutes les étapes, je te dirai toutes les particularités, tous les secrets de ce beau pays ». S’il me le demande, alors nous irons aux Lecques souvent, dans une évocation qu’embrume peut-être un peu « un vin blanc de Cassis aux vertus sournoises » puisque de là, il voit de La Ciotat et l’envers, Ceyreste et l’endroit, le Bec de l’Aigle ; il sera peu utile d’aller au-delà de Toulon, puisque cet au-delà appartient davantage à l’héritage italien de la France qu’à l’ancienne Provence.
Il faudra à toute force aller en Avignon, où comme André Hallays, il maudit cette manie des architectes des Monuments historiques de refaire des créneaux et des machicoulis partout où se retrouve un mur ancien ; à Montpellier, Arles et à Nîmes bien sûr. Et il ne faudra pas manquer d’aller aux Saintes-Maries. Je lui demanderai aussi de me mener vers le Lubéron « déchu mais non point mort » et sa litanie de villages, Gordes, Oppèdes, Apt et Ménerbes ; vers toutes les belles fontaines de ce pays sans eaux : celles d’Aix bien sûr, mais aussi celles de Salon, de Toulon, de Signes ou de Méounes –Avignon qui n’en a pas, ayant, fons purissima, le Rhône. Il nous tiendra à l’écart, autant qu’il sera possible de « ceshordes qui s’abattent, flairent et passent ; n’étant pas dignes de rien voir ».
Mais surtout, comment rêver compagnon plus averti, plus sensible ? Visitons avec lui l’ancien évêché de Carpentras, et observons comment sa science saute toujours sur l’imagination de situations romanesques :
Sous ces beaux plafonds encore très Louis XIII, les frises sont profusément peuplées de déesses et de nymphes aux épaules rondes, aux rondes poitrines : de dieux et de héros qui font glorieusement bomber leurs pectoraux. L’ensemble a la sensualité à demi romanesque, à demi cérémonieuse que les artistes français apprirent des Carrache et du Bernin. De qui sont ces excellentes peintures ? On les donne naturellement à Nicolas Mignard. On lui donne dans le Midi, tout ce qui a été peint au XVIIème siècle (comme on donne à Puget tout ce qui a été sculpté). Personne, à notre connaissance, n’a étudié ces gaies décorations profanes qui dans le Comtat et en Provence, ornent beaucoup d’édifices publics ou privés. Proposons ce sujet à un jeune clerc de l’Ecole du Louvre. Quelle chance pour lui : quitter quelques mois les brouillards de la Seine pour aller vivre sous le plus beau ciel de France ! Il irait à Aix ; il irait à Marignane. Il obtiendrait d’être introduit dans maint hôtel, pavillon et château…
Car jamais Vaudoyer ne se prit pour un prophète, et jamais sa fierté ne le rangea au rang de guide d’excursion. Il ne tient pas à dicter, à nous obliger à voir la Provence comme il la voit. Il a un art particulier, qui met énormément de distance dans sa conversation. Vermeer nous oblige à voir Delft telle qu’il le voit, et c’est Châteaubriand qui aujourd’hui encore nous dicte Rome ; Vaudoyer ne nous imposera pas sa Provence, comme si une tristesse infinie, un voile de mélancolie, doux et trouble comme une brume de chaleur, venait, à son esprit même, en rendre vagues les contours, changeantes et incertaines les couleurs. Devait-il à sa mère, Geneviève Bréton, qui fut la fiancée de Henri Regnault, ce peintre qui portait les plus riches promesses, et dont elle dut reconnaître le cadavre sur le champ de bataille à Buzenval, ce deuil qui par éclipses, vient jeter une nuit tragique sur les paysages provençaux ? Il y a une vérité de la vie spirituelle dans laquelle nous ne rentrerons pas, que nous ne connaitrons pas chez celui qui prit pour devise « Rêver sa vie, vivre ses rêves ».
La Provence et les Comtats, en romancier né, il nous la fait voir, dans une charmante et savante série de cartes postales, à travers les personnages les plus fantastiques qu’on puisse voir : monsieur de Savine, qui fut évêque constitutionnel de Viviers, promenant entre deux orgies une statue de la Vierge coiffée du bonnet phrygien au son de la carmagnole mais terminant sa vie comme un saint, emmuré volontaire quasiment, dans une oraison perpétuelle ; Joseph Bonaventure Laurens, le félibre sentimental, érudit musical, parmi les premiers à ressusciter Jean-Sébastien Bach, peintre à ses heures et à plein temps coureur de jolies filles – un pistachié en somme, ce personnage de la crèche provencale, valet de ferme, rusé gourmand, un peu fripon, mais sachant donner à pleines mains ; aux Saintes-Maries de la Mer, Joseph d’Arbaud qui maintint, face à l’oubli, le flambeau du félibrige.
Car Jean-Louis Vaudoyer a, lui aussi, ses ensablés : Paul Arène, auteur de Jean-des-Figues, grand homme en son pays dont cinquante ans plus tard, à Sisteron, personne ne savait plus indiquer la maison ; à Arles, le déplorable Cyrille, chrétien des premiers jours et dont le zèle transforma la plus belle ville grecque de la Gaule, mamillaria Arleas, en un champ de ruines , dont on désensablera quatorze siècles plus tard, Vaudoyer nous le raconte, cette Venus que Girardon n’a pas respecté, et que vous pouvez voir au Louvre ; ensablé aussi, Evariste de Valernes, le seul élève de Degas, lequel ému par la misère dans laquelle le Contadin était tombé, lui rendit visite : pour l’aider, le peintre que tout Paris s’arrachait emmena une toile et la voulut vendre : à Carpentras personne n’en voulut ! et Degas en fut quitte pour donner trois mille francs en espèces au pauvre Evariste.
Personnages extravagants, ils sont la face malheureuse de l’Art que Vaudoyer, ce jeune homme trop heureux -c’est son père qui le dit- a dépeint avec une prédilection teintée d’un sombre repentir. Ce sont des personnages qui ont poussé jusqu’au bout de leurs forces, pas assez grandes, sur des routes qui étaient trop longues, l’idéal de leur art. Vaudoyer les regarde avec amitié mais ne les rejoint pas, il s’en tient prudemment comme à distance et pour cela trouve dans un sensualisme sans détour un anesthésiant quotidien.
Car ce sceptique, dont la seule religion fut l’Art, est aussi un voluptueux auquel rien n’échappe, ni de jolies épaules, la molle courbe d’un sein, ni la pétulance d’un regard, l’accord miraculeux d’un pied et d’une jambe, ni
….ces bras nus si émouvants / Avec leur duvet d’or et cette veine bleue
Il les aime toutes il me semble, maigres fées ou grosses filles à chignon, Sybilles de carrefour aux grands corps complaisants, cette Anglaise à la peau mate et rose, ou cette noire Bohémienne dans l’église des Saintes-Maries. L’instant d’une imagination chaude qui vous monte à la tête, le temps d’un bal au Jazz Printania, à la sortie des bureaux ou à la table d’un café, elles deviennent tour à tour les Isolde, Nausicaa ou Myriam, Artemis, Manon ou Carmen du voyageur : « Les trésors les plus sûrs sont ceux qu’on peut toucher » écrit il, sage épicurien, dans un charmant poème à Fragonard : et il est vrai que souvent les pages des Beautés ressemblent à un carnet de croquis de Fragonard ou de Hubert. Le trait est rapide, la couleur vite et bien suggéré, le détail est parfois risqué, mais on n’y voit jamais que de la lumière et à pleine coupe, la Beauté.
Et il y a aussi, plus gravement, dans un moment qui touche au secret d’une blessure, celle qu’il ne vit « que du train, lorsqu’il attendit cinq minutes, un soir de juin », sœur de celle que vit et aima Marcel Proust, remontant le train, en route pour Balbec. L’amour, qui ne se peut voir que de loin, immobile point terrestre que la vie qui passe n’attendra pas, rejoint l’essence de l’Art : on le voit, on l’admire dans les musées ou dans l’architecture, dans l’éblouissement d’une partition : on ne l’atteint jamais, il est une nostalgie absolue ; il ne s’enfuit ni ne se cache ; c’est nous qui passons.
Comme les grands artistes de la Renaissance qui s’intitulaient volontiers architecte, peintre et sculpteur, de même est-il poète, critique et romancier, et il en parle avec une égale puissance les trois langues ; mais je donnerai ma préférence pour le poète. Il fut le poignant biographe de Jenny, l’héroïne poignante de La grenade entr’ouverte de Théodore Aubanel
sa raubo de lano/Coulor de la miougrano/Eme soun front tant lisc et si grands iue tant beu
sa robe de laine, couleur de grenade/avec son front uni et ses grands yeux si beaux : ce sont les meilleures pages des Beautés. Il fut l’ami aussi de Paul-Jean Toulet, qui nous plonge comme lui dans une matérialité qui flotte dans la magie du souvenir, nous ressaisit et nous abandonne dans une pirouette :
Entre sa nuque et son bonnet / Frise une boucle blonde / Mais elle plonge ; disparaît / Te voici seul au monde
Léger, Jean-Louis Vaudoyer ? qui ne peut méditer et pleurer en lisant les vers qu’il écrivit avec tant de gravité à la mort de son ami Paul Drouot
Ami, je songe aux vers que tu n’écriras pas
Aux livres émouvants, aux magiques mirages
Aux beaux, mystérieux et tendres personnages
Qui sans avoir vécu partagent ton trépas.
Ils sont morts avec toi. Je pensais les voir naître,
Les écouter venir du fonds de ton esprit
Comme l’aube qui sort du sein noir de la nuit.
Car cet esthète a fait la guerre ; engagé volontaire, il accepte le grade, médiocre, la boue, la gale et les bombardements. Il y acceptera surtout l’humanité, qui est au cœur de la beauté puisque l’artiste y habite. Il n’en parle pas, écrivit peu sur le sujet et indirectement. Et qu’il y ait un avant et un après de la guerre, peut-être est-ce une explication de cette personnalité où l’on sent que le passé et le présent ne sont pas cousus ensemble, comme si la main invisible de la douleur en avait déchiré les lais de souvenirs, si bien qu’ils ne se chevauchent ni ne se recoupent plus, flottant au tourbillon du regret.
Dans cet âme d’artiste, était creusé un grand froid de glace qu’il fallait bien qu’il réchauffât souvent au soleil de Provence ; ce feu des cinq cent pages des Beautés, emportons le, serrons-le au fond de notre bagage.Il n’est pas certain que ayons jamais besoin d’autre chose.
Antoine Cardinale

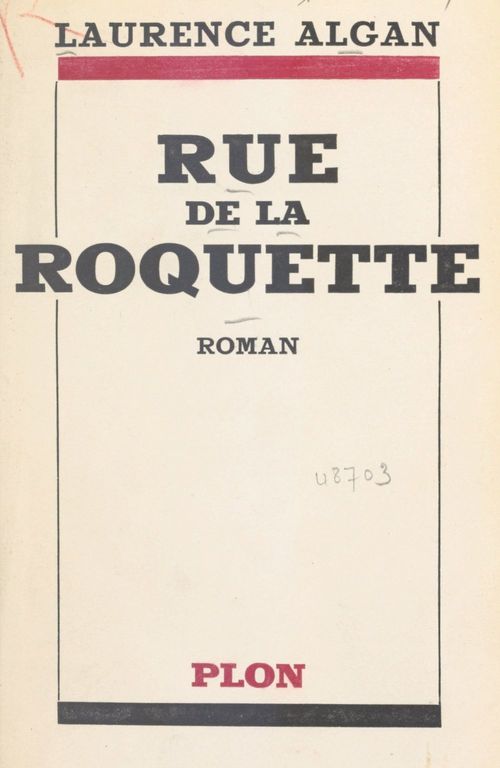
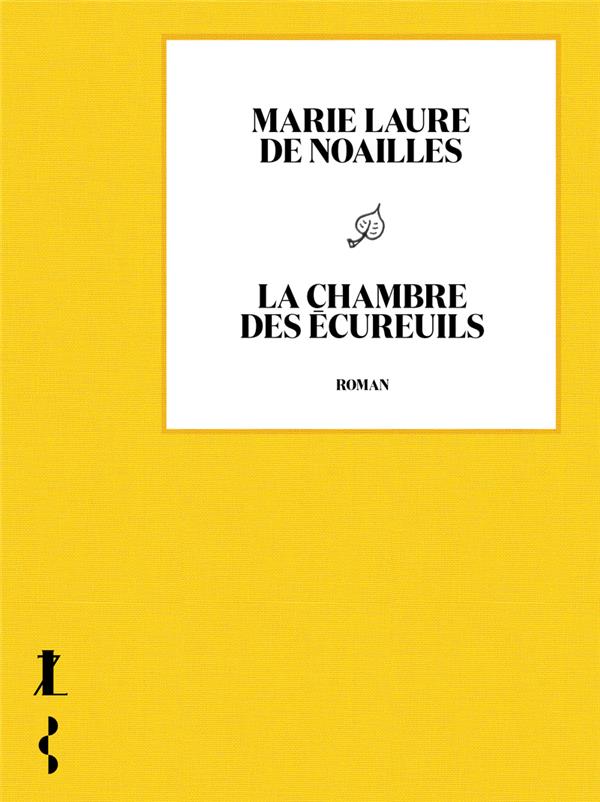
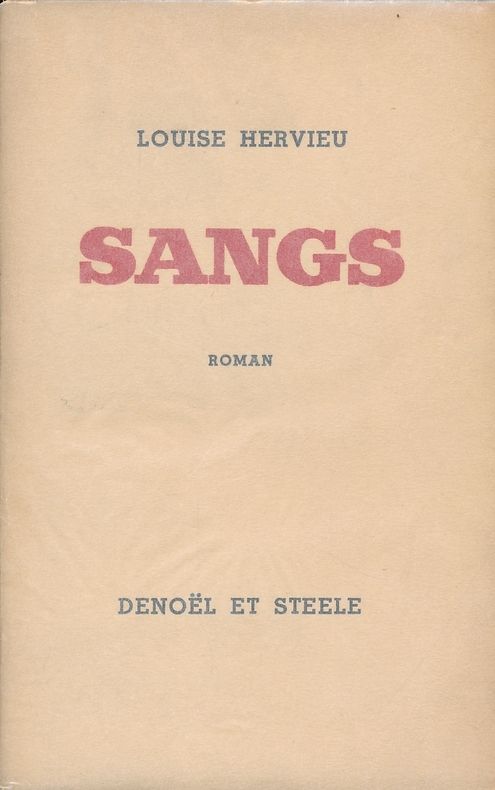
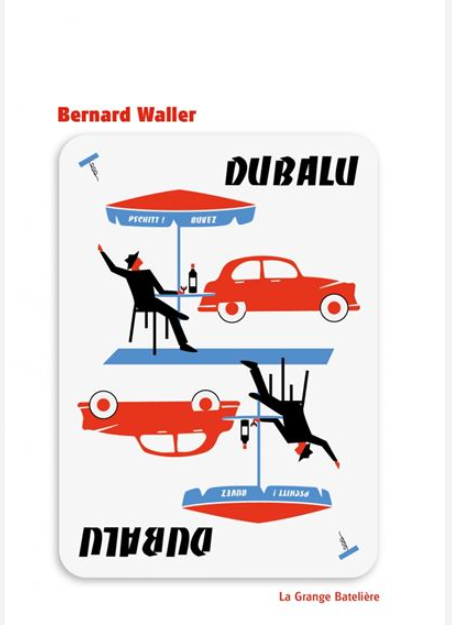
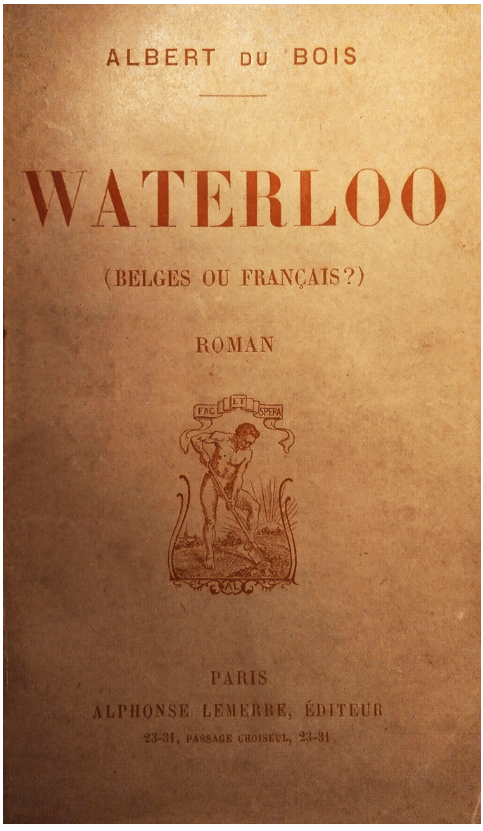

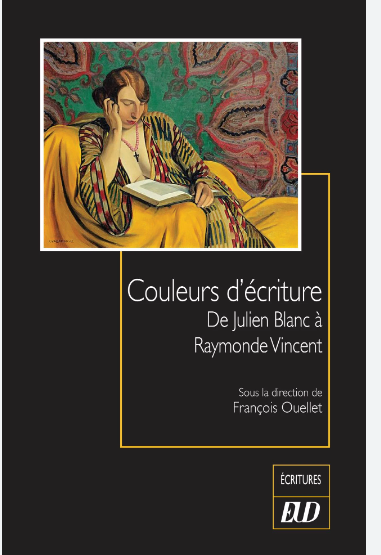
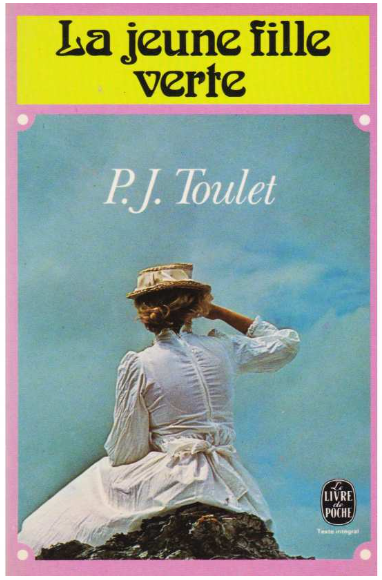
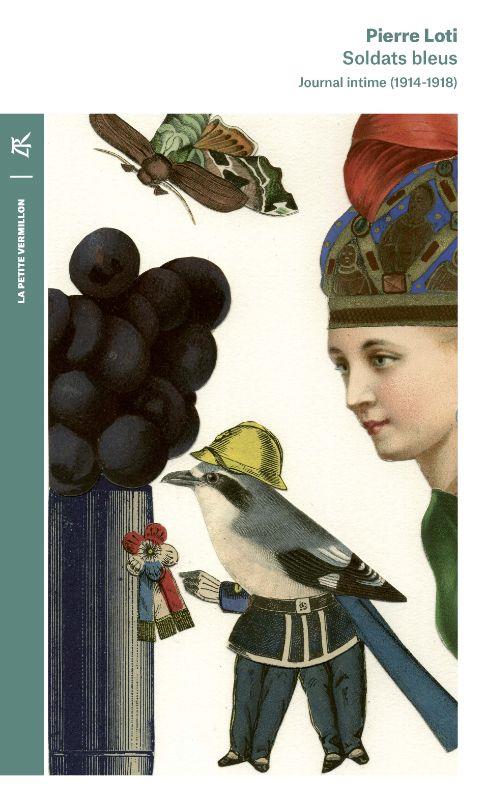
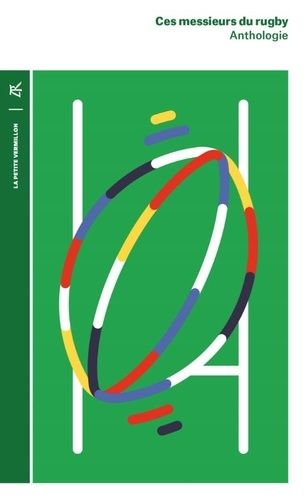
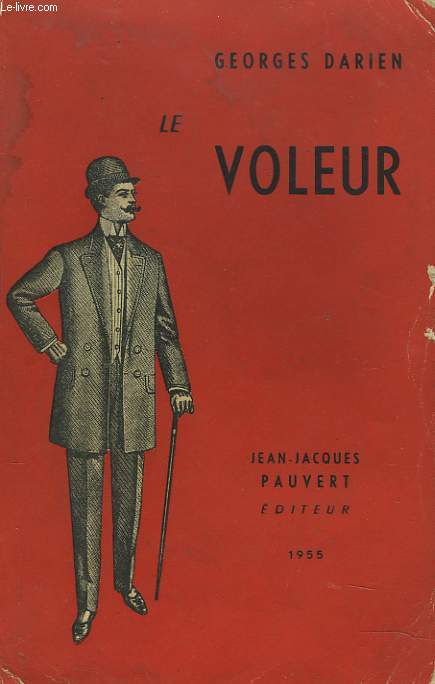
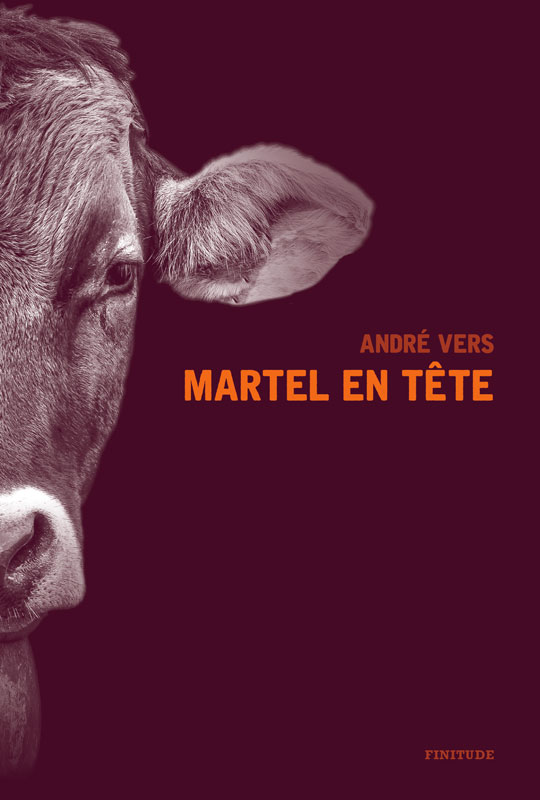

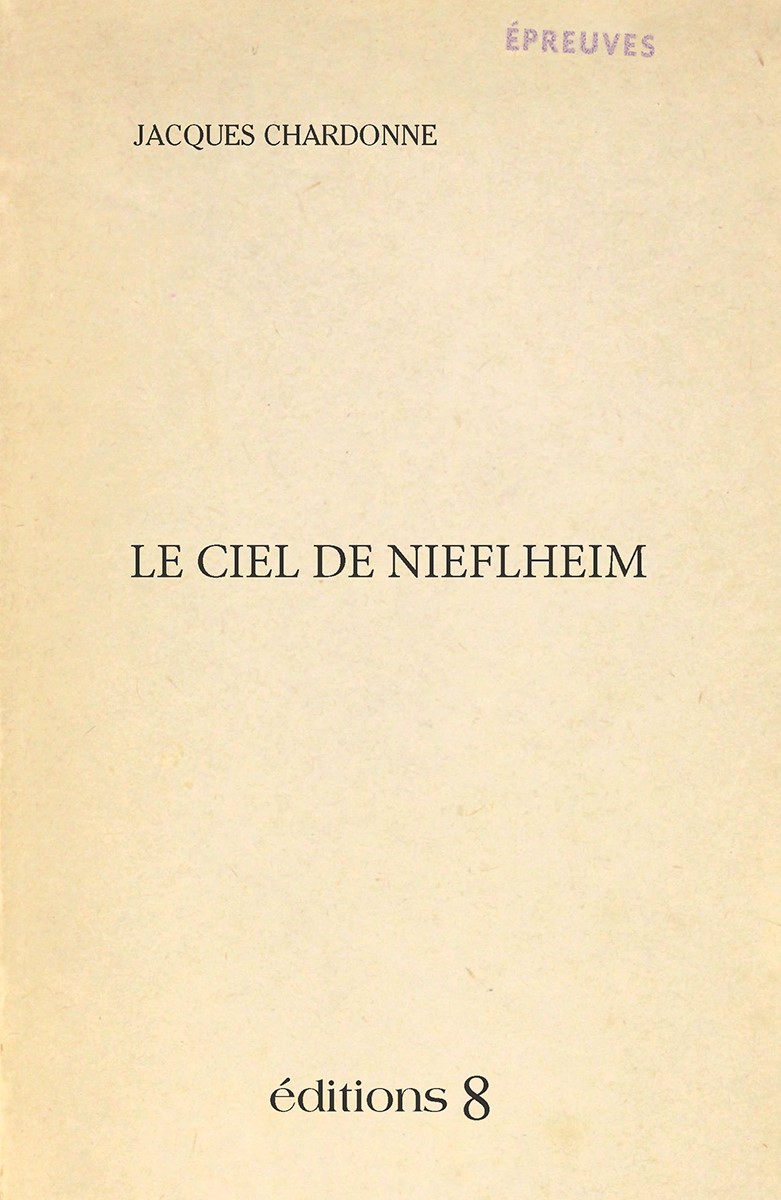
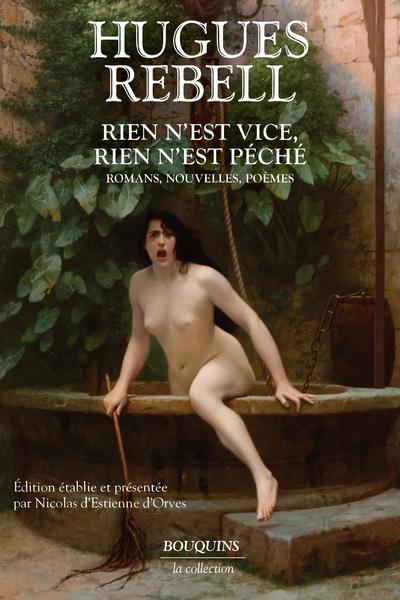
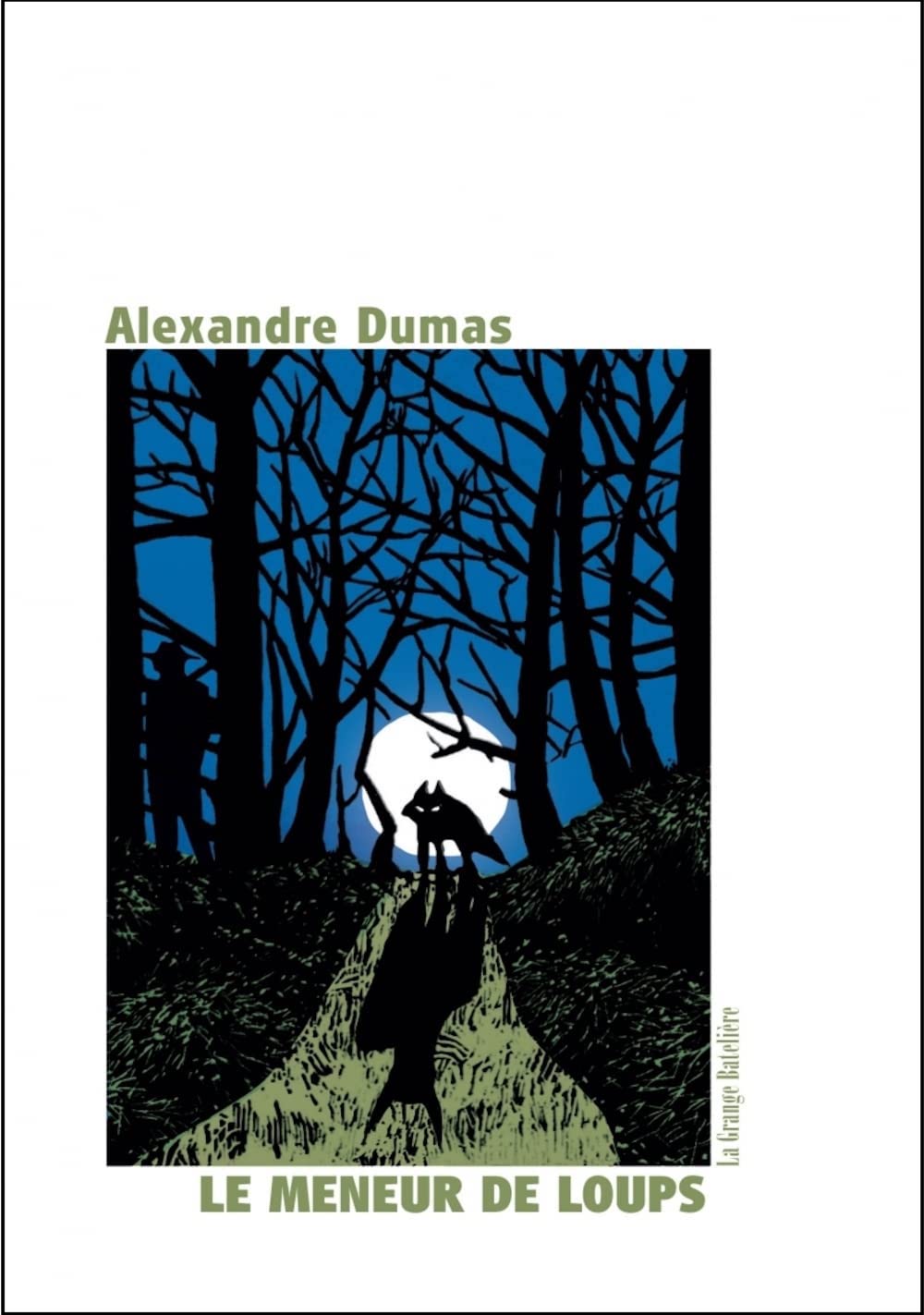

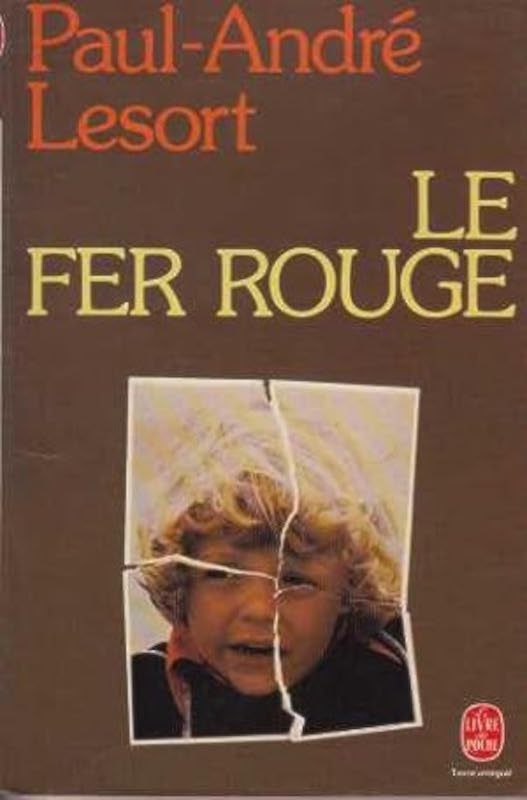


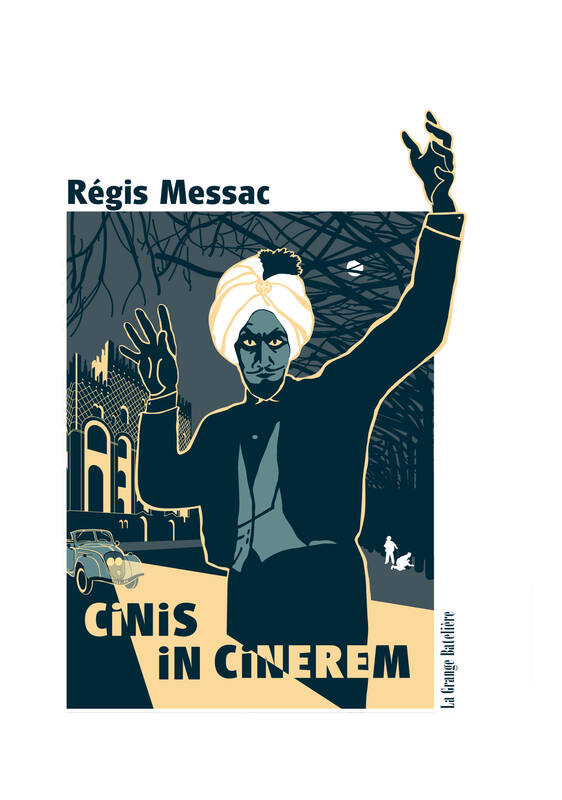

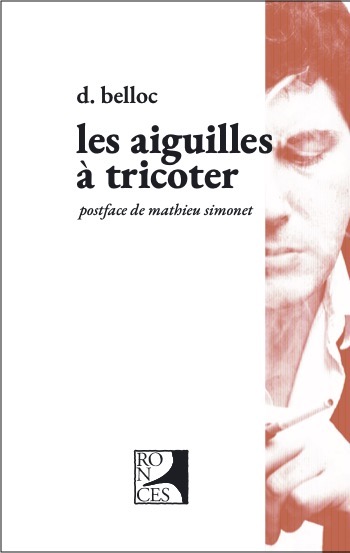
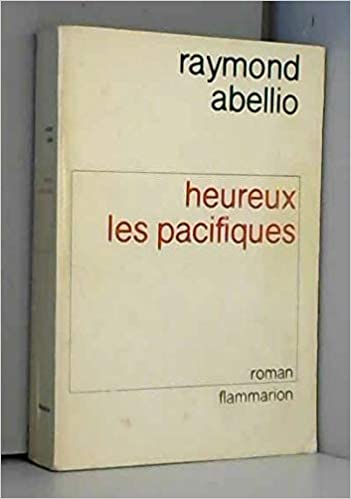
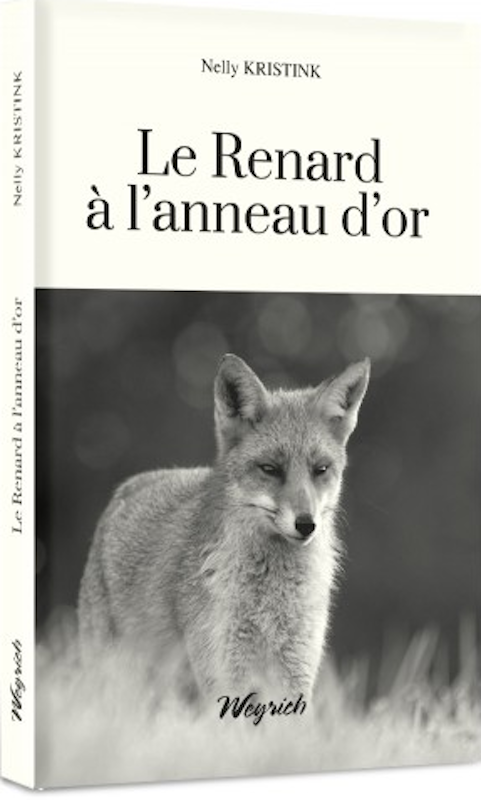
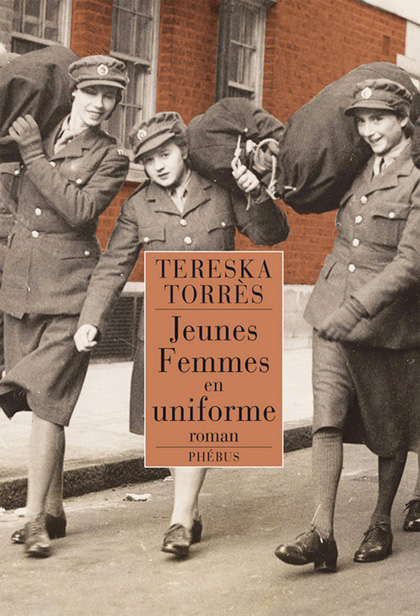
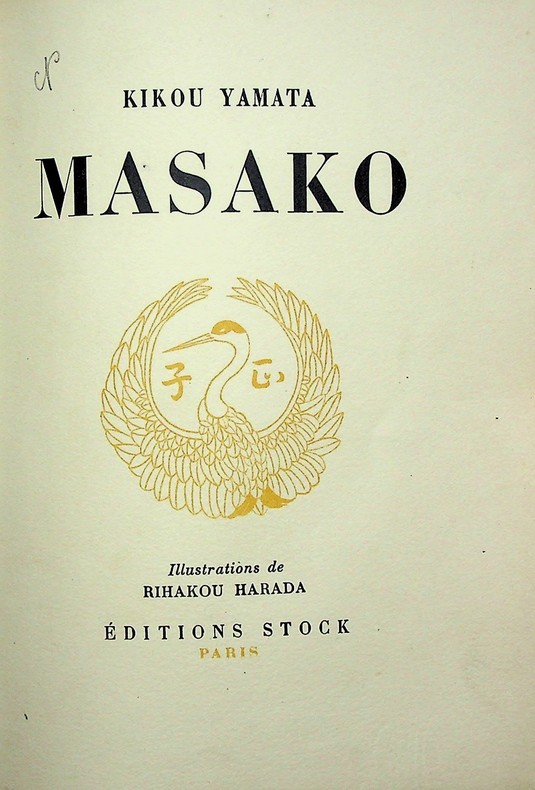
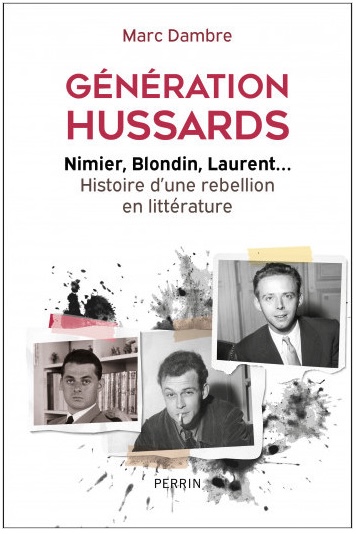
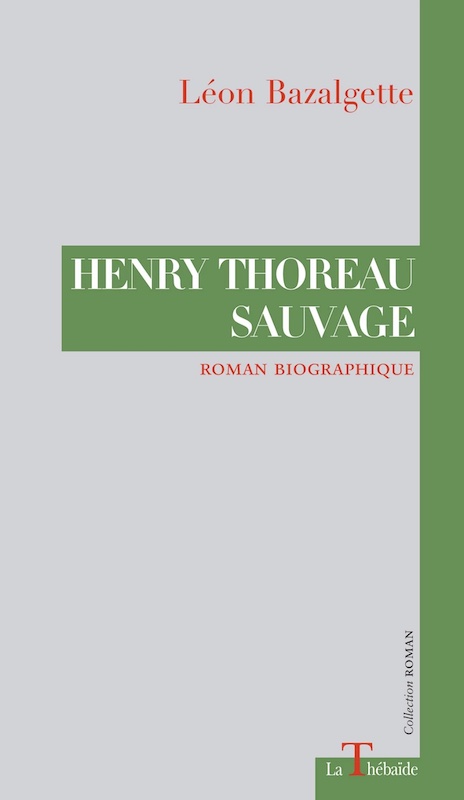

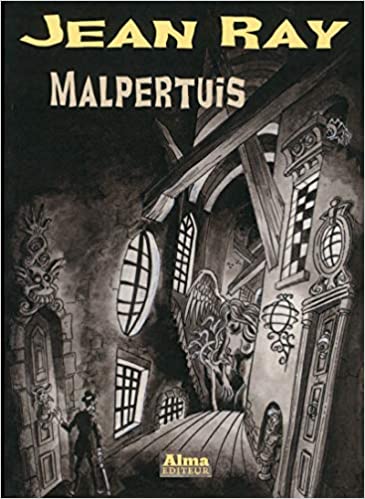
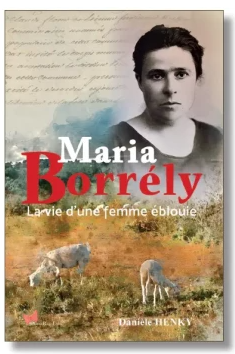
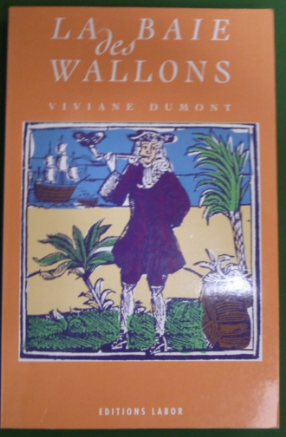

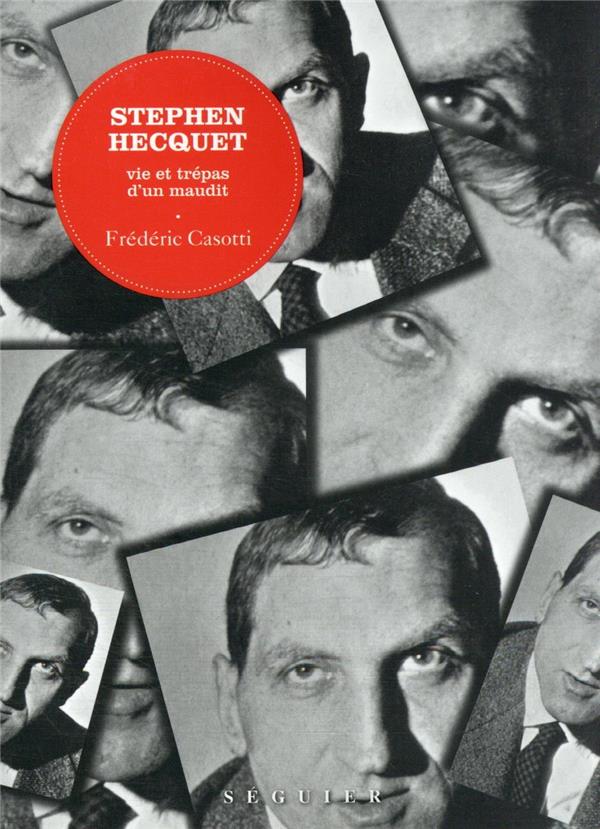

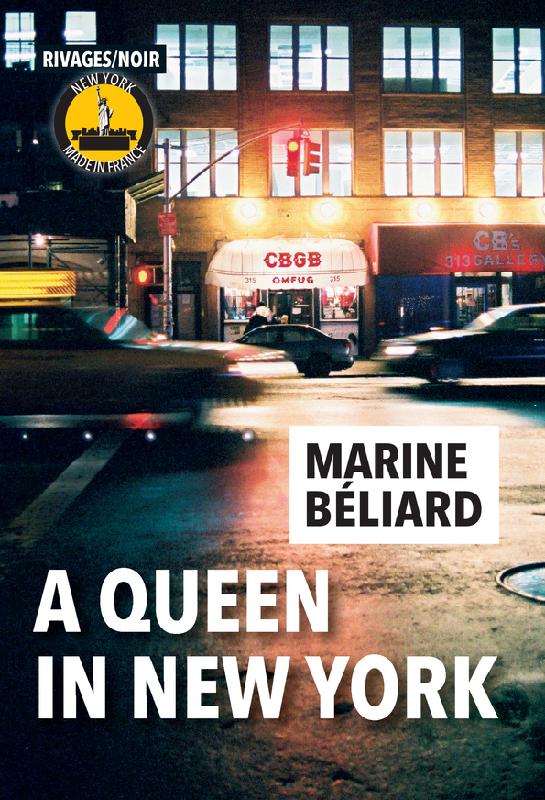



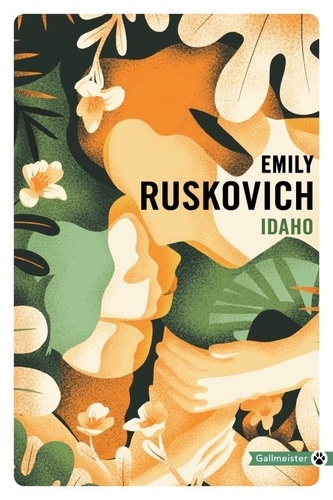
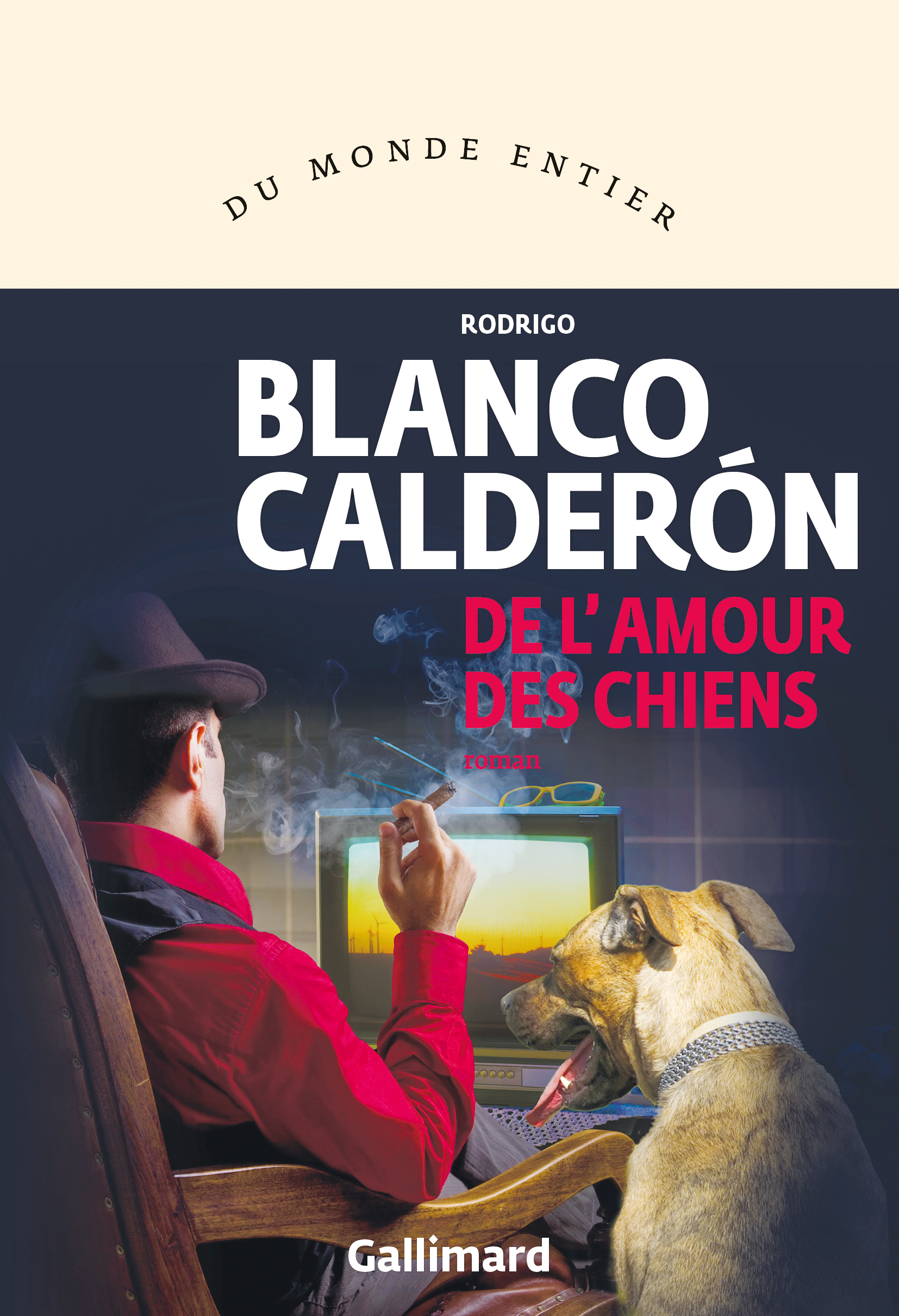





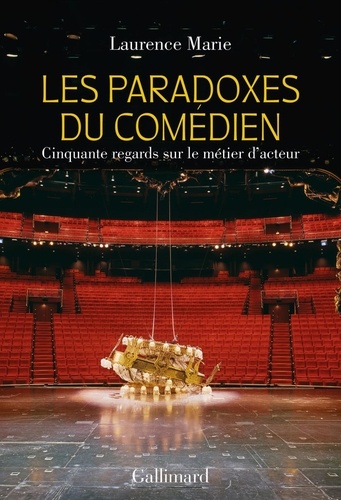
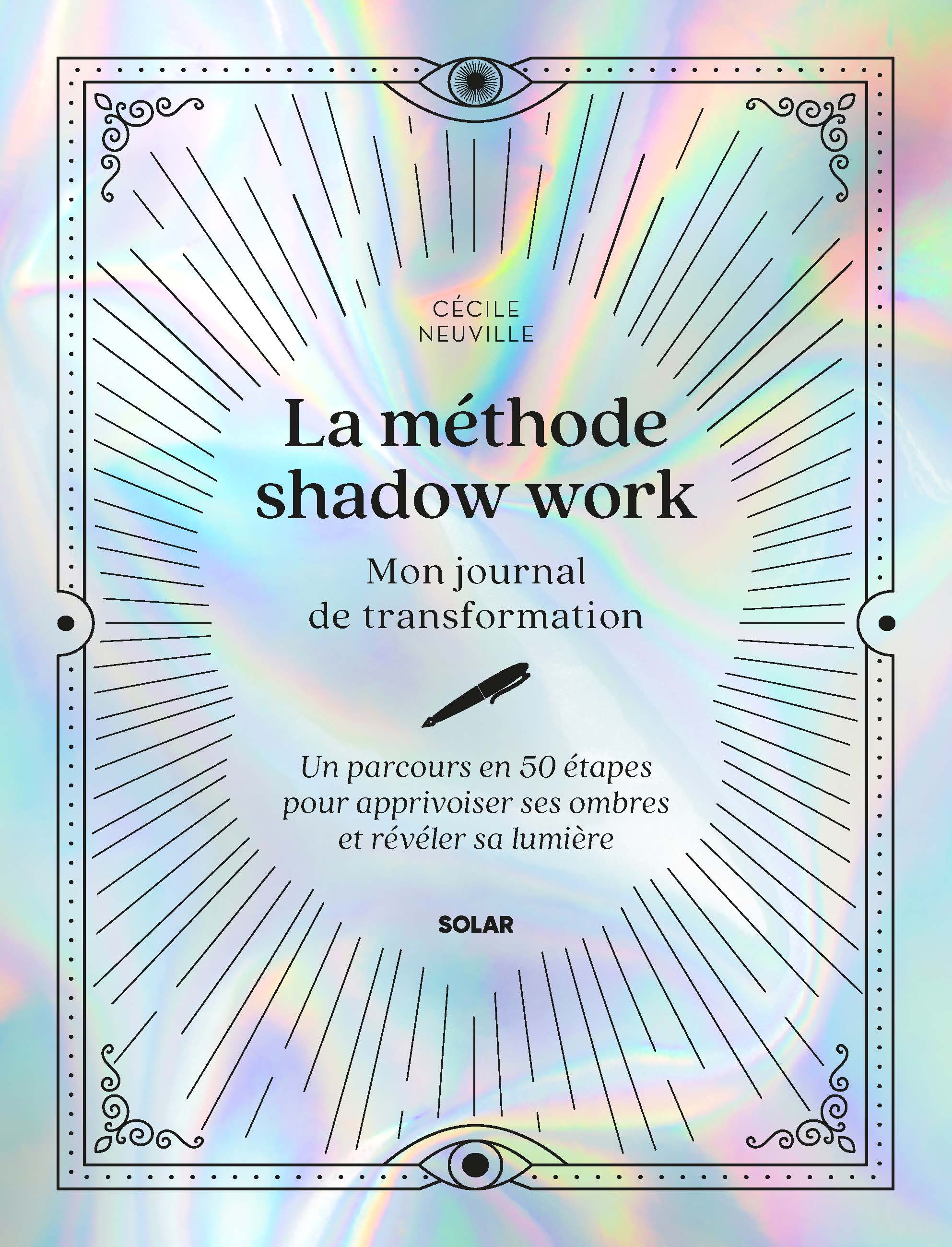


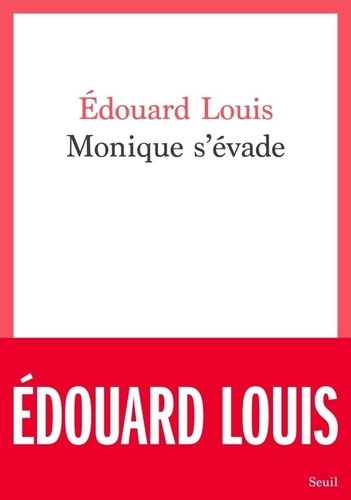
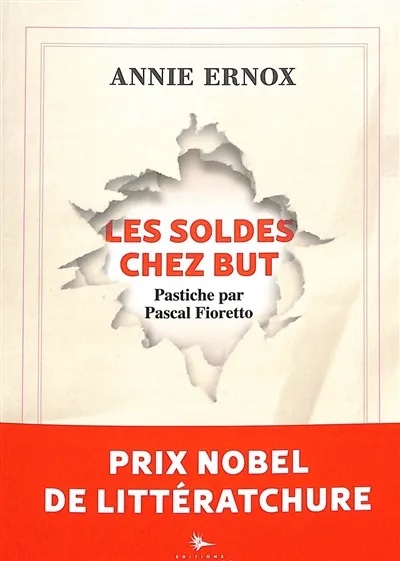
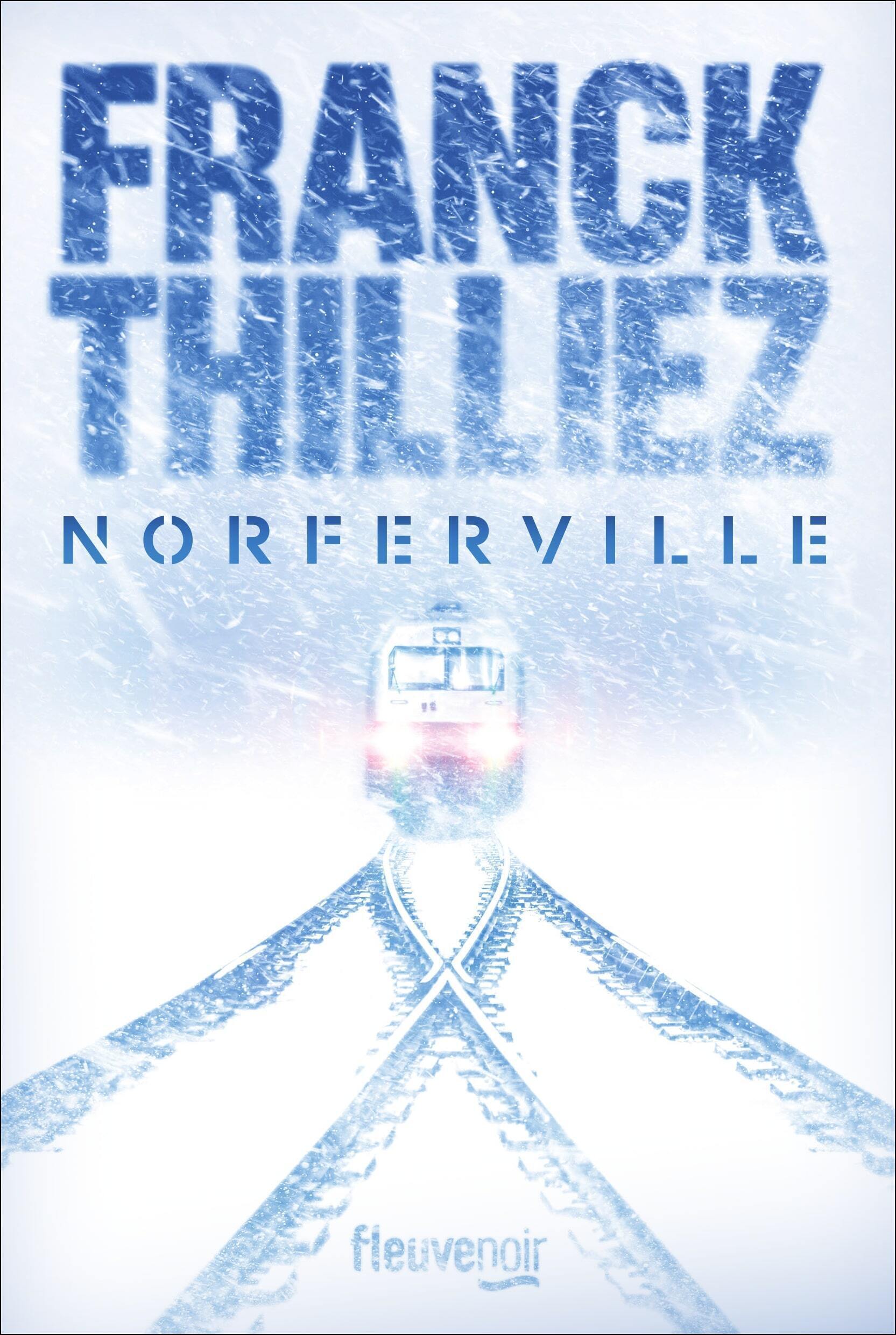
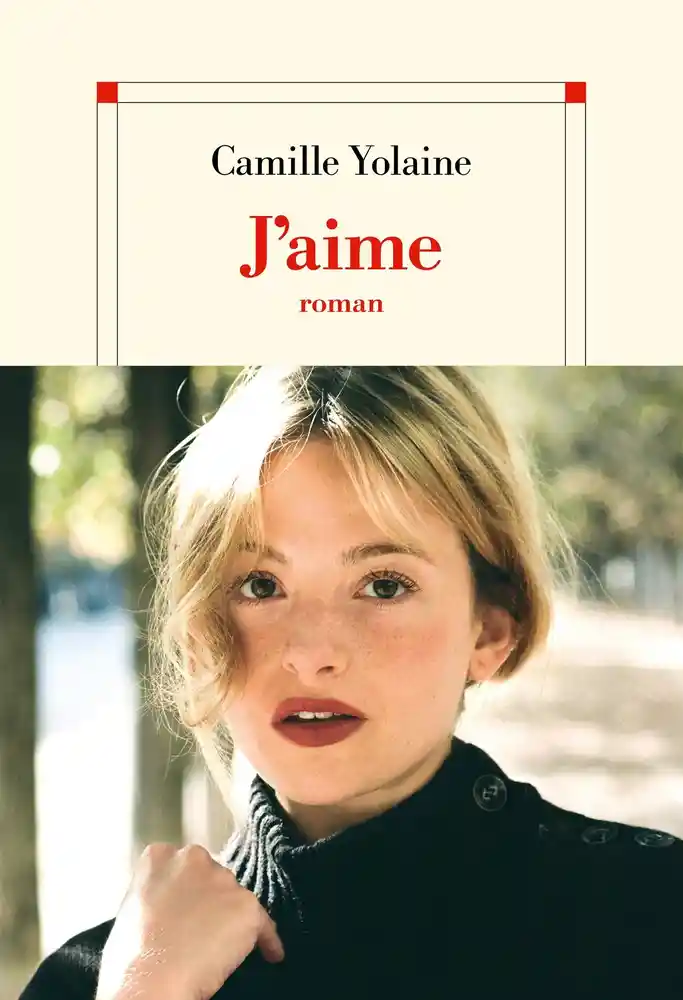
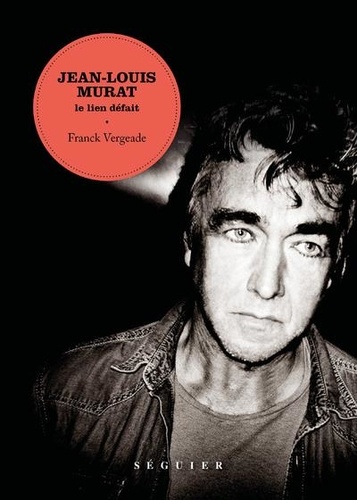
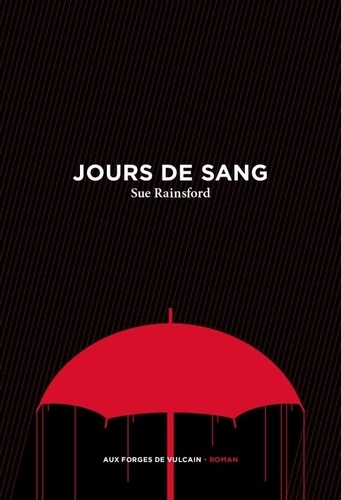







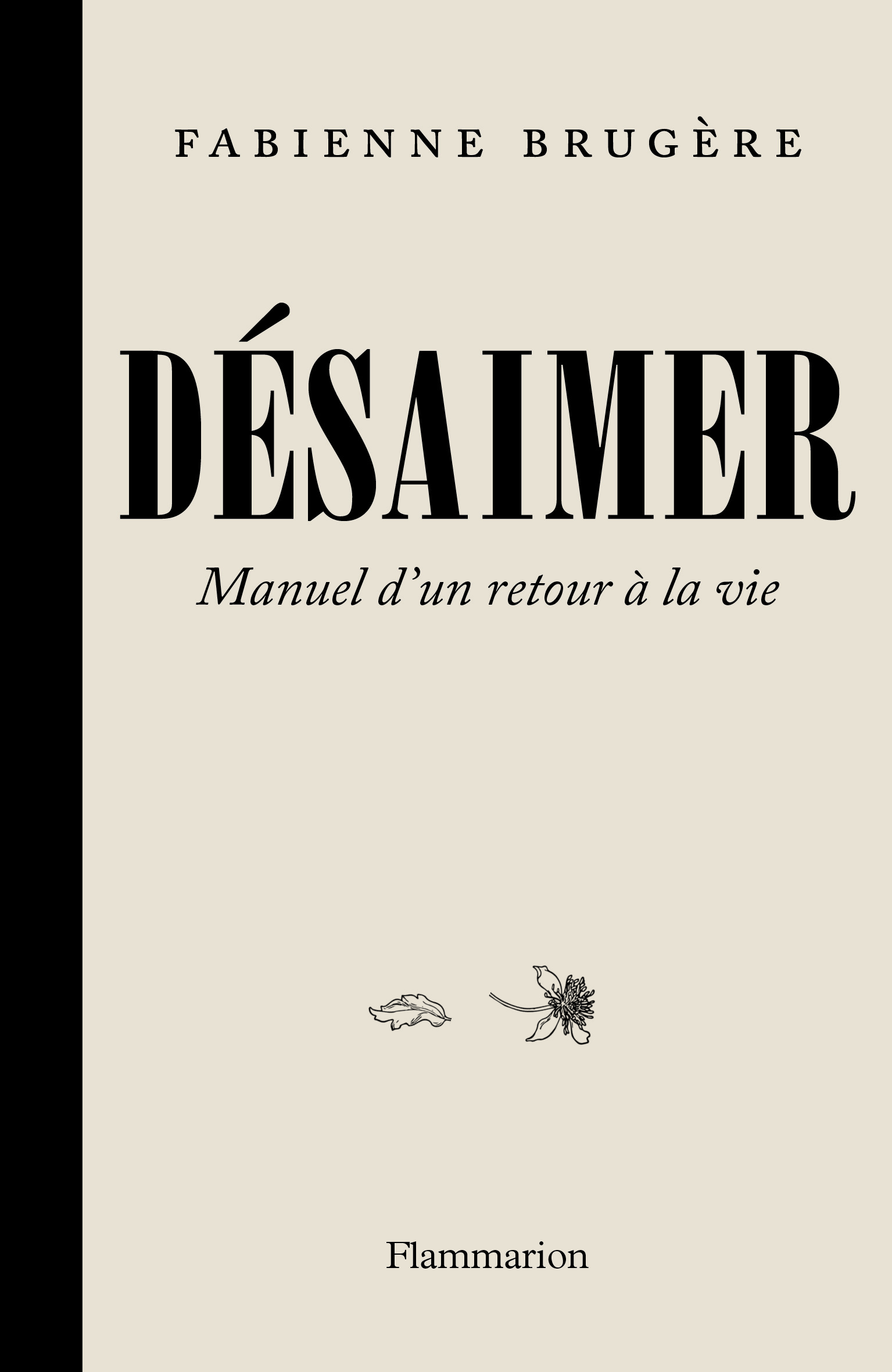
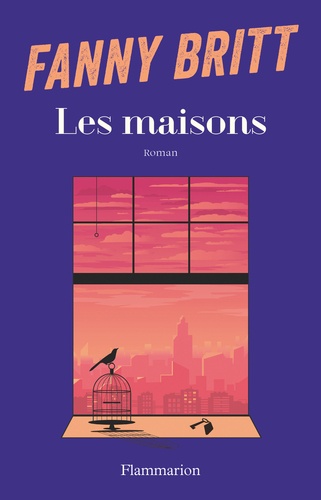



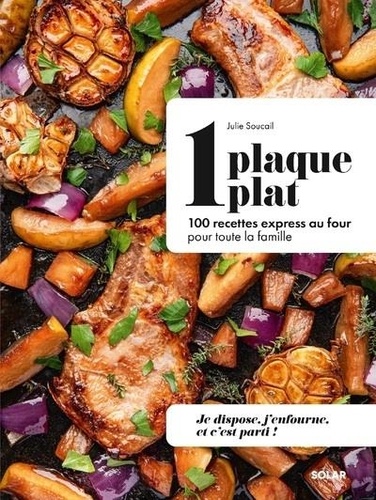
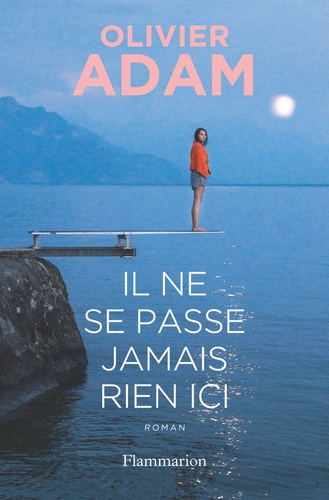
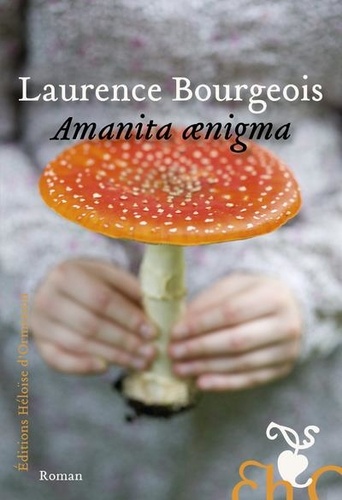


1 Commentaire
Christine Belcikowski
02/08/2018 à 08:23
Magnifique !