Les Ensablés – “Rome et ses vieilles églises” (1942) de Emile Mâle
Le passant désoeuvré de Rome, en ce matin de mai 1924, pouvait observer, sortant du palais Farnese, le Diario Romano à la main, un homme distingué d’un âge certain, avec un air d’autorité et un grand allant dans sa marche, mis à la mode des années d’avant la guerre avec son complet de drap bleu et son chapeau melon, traversant le cortile dessiné par Antonio da Sangallo après avoir salué fort civilement le concierge.
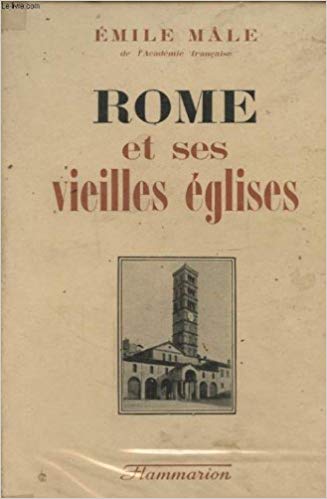
« E l’ambasciatore di Francia ? « demande notre passant à la petite marchande qui va vendre de bon matin ses bouquets au marché du Campo de Fiori : « Certo no ! e il dottor Mâle ! un grande professore delle cose antique ! e a Roma piu cristiano non c’è ! » Et la petite marchande de fleurs a certes bien dit, mais nous allons essayer dans cette chronique de lui en apprendre davantage.
Car ce qu’ignore la petite marchande de fleurs, c’est qu’Emile Mâle, il grande professore delle cose antique, n’est pas venu à Rome dans ses fonctions de directeur de l’Ecole de Rome avec un grand enthousiasme. Il eut en effet le déplaisir d’apprendre sa nomination en ouvrant son journal ! Il eut beau supplier à Poincaré, président du conseil, qu’on le laissât finir en paix le dernier livre de son grand ouvrage, l’Art religieux et qu’on le maintînt dans son poste de professeur à la Sorbonne, Poincaré se montra inflexible en lui persuadant qu’il était le seul à pouvoir succéder à monseigneur Duchesne sans diminuer le prestige de cette fonction.
Il le reconnaîtra plus tard, c’est pourtant à Rome qu’il lui fallait finir son livre, L’art religieux après le Concile de Trente, et qu’il eût été téméraire de le faire loin de cette ville. C’est en effet à la bibliothèque du Collège romain qu’il trouvera le livre-clef de ce temps troublé : l’Iconologia de Cesare Ripa. En l’étudiant, nous dit-il, « les faits se groupaient, les chapitres se dessinaient les uns après les autres, et il me semblait que mon livre se faisait tout seul. » Ce livre ensablé, qui est aujourd’hui dans toutes les bibliographies, nous en devons la redécouverte à Emile Mâle.
C’était alors un palais bien peu logeable que le palais Farnese : le concierge lui-même n’en possèdait pas toutes les clefs ; les salons cyclopéens succédaient à d’étroites guardarobbe, à des stanze à la destination mystérieuse, à d’incompréhensibles entresols tels des chambres scellées de la mémoire, perchés au bout d’escaliers comme on en voit dans les Prisons, à d’innombrables salotti, librarie, mezzanine et jusqu’à la légendaire loggia dessinée par Giacomo della Porta. Au temps révolu de la grandeur des Farnese, le plus beau palais de Rome était un palais asphyxié, rétréci par son contenu de tableaux, de meubles, de collections d’antiques et de bibliothèques fabuleuses. Mais vidé de tout son mobilier, lorsqu’il devint le siège de l’ambassade de France en 1874, il prit alors l’apparence d’un labyrinthe démeublé, la topographie d’un foyer déshabité et la poésie d’un palais de courants d’air : dans ce deuxième étage où Emile Mâle installe sa famille, sa fille se souvient avec émotion « d’immenses couloirs, idéales pistes de trottinette, et des inscriptions mystérieuses au beau fronton des portes.»(1)
Le nouveau directeur déploie les qualités d’un gestionnaire attentif à des tâches qui dévorent le temps qu’il pourrait réserver au travail de l’historien : chantiers incessants qui veulent l’œil du maître ; inflation qui dévore les traitements des membres de l’Ecole, et dont les difficultés économiques lui tombent sur le cœur ; pour ne rien dire des innombrables réceptions au protocole tyrannique. Mais malgré ces obligations pesantes, jamais on ne surprend un mécontentement qui puisse déflorer en lui le bonheur d’être, avec les siens, au cœur de la cité du passé restauré.
Cinq années après son retour en France, c’est en 1942, dans des jours de tristesse, retiré dans la solitude où vont finir les existences prophétiques, qu’il publie Rome et ses vieilles églises, certain cependant que des temps meilleurs étaient en réserve. Mais les pages de ce livre savant et poétique, l’écrivain nous le confesse, furent écrites à Rome dans ces années heureuses où il put examiner tout à loisir les monuments qu’il décrit. Le livre débute par une introduction, Rome et la campagne romaine, qui est naturellement promise à l’anthologie des écrivains français, à côté des grandes pages du XIXème siècle, selon l’expression d’André Chastel.
Comme il est désespérant de faire court : de cette introduction on voudrait citer les vingt pages qui la composent sans en retrancher une ligne. Mais consentons !
Il faut monter au Janicule vers le soir pour contempler Rome. De la terrasse de San Pietro in Montorio on l’a presqu’entière sous les yeux et elle charme d’abord par ses belles lignes et sa couleur fauve. Comme au temps des Césars, des jardins magnifiques la couronne d’une sombre verdure. Martial, qui la décrivait de l’endroit où nous sommes, croirait encore la reconnaître : seuls les dômes l’étonneraient, car aux nombreux temples ont succédé d’innombrables églises. Au moment où le soleil va disparaître la ville se transfigure ; c’est alors qu’elle se revêt toute entière d’or rose, minutes merveilleuses que Claude Lorrain a fixées pour nous. Des montagnes lointaines d’un bleu sombre ou d’un bleu aérien, suivant les heures du jour, dessinent à l’horizon un demi-cercle majestueux.
C’est du Janicule qu’il faut voir la ville, mais c’est du Monte Cavo qu’il faut découvrir le vaste champ clos où Rome joua sa vie pendant les premiers siècles de son histoire. L’horizon est splendide. Il s’étend bien au-delà de l’Etrurie méridionale, jusqu’aux Monts Ciminiens, vaporisés dans l’éther, limite redoutable que longtemps les légions n’osèrent franchir…Une horreur sacrée s’empare de Virgile quand il nomme les divinités de ces âges lointains, quand il décrit les peuples de la vieille Italie : ceux de Preneste avec leurs casques à peaux de loups, ceux du Soracte et des Monts Ciminiens qui marchaient en chantant : les Hirpins, armés d’épées de bronze, et les Marses conduits par des prêtres charmeurs de serpents. Il croyait avoir atteint l’origine des âges.
Les églises de Rome
Combien d’églises dénombre-t-on à Rome ? Deux cent, trois cents cinquante ? Emile Mâle nous le dit dans le passage ci-dessus, elles sont innombrables ! et tout décompte paraît voué à l’échec. A Rome une église n’appartient pas à un seul temps : le Temps s’y dépose : un siècle a reconstruit ce que l’incendie ou l’inondation a pu détruire, mais le siècle suivant, dans un grand retour en arrière, revient à des solutions très anciennes –comme on le voit à Sainte-Marie Majeure dans laquelle les mosaïques de la basilique de Libère voisine avec les géniales « retouches » à l’antique que réalisa Fernandino Fuga au cœur du Siècle des Lumières- parfois comme à Saint-Clément, le Temps a empilé en couches régulières les styles et les époques, comme une ménagère empile ses draps, sans négliger de conserver par-dessous un autel de Mithra, ou comme à Saint-Barthélemy un puits sacré voué à Esculape. Car par-delà l’ère chrétienne, Emile Mâle ne manque pas de nous rappeler que les Romains –au moins sous la République- furent selon l’expression du poète grec les plus pieux des mortels : le sol même de la Ville était sacré et pour cette raison, la délimitation en était minutieuse ; le Tibre lui-même était une divinité dont les inondations étaient scrutées comme des oracles.
Il y a aussi les églises disparues, qui est un chapitre à faire et qui pourrait tenter un historien, à la condition qu’il sache sentir la poésie de cet inventaire : le vieux Saint-Pierre disparu avec ses deux absides qui voulaient répliquer la Panthéon d’Agrippa, ou la basilique de Maxence que Constantin acheva et qui la première porta témoignage de la religion nouvelle –et antiquum documentum novo cedat ritui- et dont les ruines formidables se voient encore près de Sainte Marie Romaine 2.
Ajoutons que c’est une chanson charmante que le nom des églises de Rome : elle mêle les curiosités de la toponymie, les grands témoignages de l’Histoire, les vieilles superstitions romaines et des souvenirs qui appartiennent à vous seulement. Saint Jean de Latran qui nous renvoie infiniment loin, à la noble famille des Laterani ; l’église des Quatre Saints Couronnés, dont on ne sait rien sinon qu’ils y eut là quatre martyrs militaires qui furent décollés ; Sainte Marie de l’Enfer, qui garde close ce que la vieille légende romaine donnait pour une des entrée de l’Enfer ; les églises que la piété populaire s’est plu à donner à deux saints à la fois : Vincent et Anastase, Cosme et Damien bien sûr, Boniface et Alexis, et tant d’autres ; les églises dédiées à Marie : il vous en vient dix à l’esprit, une rapide recension de Rome et ses vieilles églises vous en donne vingt ! Il y a celles dont l’histoire vous est obscure et que vous gardez pour votre prochain voyage à Rome afin d’en élucider l’histoire comme Saint Bernard des Thermes, San Lorenzo in Lucina, Saint Charles aux Quatre fontaines ; enfin les églises que ralliaient les pèlerins de toutes les nations : Saint Louis des Français, Saint André d’Ecosse, Saint Antoine des Portugais, ou Saint Nicolas des Lorrains que Claude Gellée n’eut garde d’oublier dans son testament.
Laissons Emile Mâle nous conduire dans la première d’entre elles. Sainte Sabine s’élevait en un temps où saint Augustin vivait encore. Cette basilique, pleine de la sagesse grecque, nous paraît être une œuvre du génie harmonieux de la Grèce, d’une perfection que porte ses vingt- quatre colonnes corinthiennes de marbre de Paros, cannelées et rudentés, d’une beauté qui n’a pas d’équivalent dans la Ville entière. Nous savons pourtant que Sainte-Sabine fut élevée dans ces années terribles qui suivirent le sac de Rome en 410.Ces « belles prêtresses des dieux converties à la religion nouvelle » viennent-elles du temple de Junon, ou d’un riche palais détruits par les Goths d’Alaric ? On ne le sait. Les archéologues nous apprennent en revanche qu’ici s’élevait une demeure qu’une chrétienne appelée Sabine offrit au culte de la communauté au temps des persécutions, titulus Sabinae ; pleine des souvenirs antiques, elle nous semble encore dans sa nouveauté. En ce temps-là, saint Augustin écrivait la Cité de Dieu, qui désignait à l’espoir des croyants une cité des âmes, inexpugnable et rempli des trésors de l’Esprit. Ceux qui construisirent Sainte Sabine n’avait pas renoncé tout à fait, il me semble, à recevoir ici-bas quelque chose qui ressemblât au silence et à la lumière céleste ; les lugubres dévastations des Barbares avait laissé intacte leur espoir. Comme on mesure ici combien l’art antique demeure l’accès libérateur à la clarté et au monde des formes pures ! Pourtant, l’emploi de l’arcade sur colonne dans la nef d’une part ; la porte de bois à deux battants d’autre part dont les bas-reliefs montrent des sculpteurs familiers de l’architecture syrienne et des thèmes du christianisme d’Orient : il faut décidément voir dans Sainte-Sabine un exemple remarquable de l’union du rythme de l’architecture classique et de la douceur sensuelle de l’Orient. Comme il est difficile d’imaginer, dans cette église qui respire la lumière et la sagesse gagné sur la folie d’un monde qui semblait toucher à sa fin, comme il est difficile d’imaginer qu’on crie ici, le Vendredi Saint, à l’heure où expire le Christ, comme dans toutes les églises de Rome, le glaçant Consummatum est !
Parmi les autres visites où nous entraîne l’auteur, j’aime particulièrement à le suivre à la chapelle de Sainte Pétronille. Cette sainte sortie de la légende chrétienne qui en fit la fille de Pierre ne trouve qu’une place modeste dans l’Art religieux après le Concile de Trente : une page à peine et toute dédiée à la description du tableau du Guerchin qui occupe à Saint-Pierre la chapelle dédiée à la sainte. Dans Rome, Emile Mâle en développe l’histoire qui vient recouvrir quinze siècles de l’histoire de la Ville en une sorte de panorama inoubliable : des premières persécutions jusqu’à la Pieta de Michel Ange en passant par le sacre de Charlemagne, des catacombes à l’ancienne basilique Saint-Pierre, il brosse une fresque où les plans de l’Histoire et ceux de la légende sont parfaitement tracés, justement délimités et également passionnants.
Ecoutons pour finir, le vieil historien s’émanciper un peu de la science et nous transporter en voyant –en poète- dans la ville d’Otton III, cet étrange empereur, jeune homme épris de la Grèce, au cœur de ce farouche Xème siècle où il semblait que jamais la lumière ne pût regagner sur la nuit de la civilisation.
Il y avait dans cette Rome une grandeur et une désolation que nous pouvons à peine imaginer. Qu’était la Rome de Chateaubriand auprès de celle-ci ? Les pèlerins y accouraient pour vénérer le tombeau des apôtres, mais ils étaient retenus par un enchantement. Ils avaient sous les yeux un spectacle inouï : des palais à moitié dépouillés de leur revêtement de marbre, des statues renversées, des villas patriciennes décorées de leur nymphées, dont les derniers restes ne disparurent qu’au XVIème siècle, des thermes gigantesques abritant encore sous leur voûtes leurs piscines taries, leurs cuves de porphyre et les divinités marines de leur mosaïque, la masse écrasante des cirques, des théâtres, des tombeaux impériaux, dont cinq siècles n’avaient pas encore triomphé, et ça et là, sur les collines, les restes des vieux bois sacrés au sombre feuillage. La Rome imaginaire de Hubert Robert, cette Rome de rêve, où un sphinx égyptien est couché auprès d’un portique aux colonnes bleuies par l’incendie, où de hautes voûtes laissent apercevoir au loin l’abside à caissons d’un temple dont les arbres disjoignent les pierres : c’est la Rome de Otton III.
« J’ai vu le rêve éternel ! »
Puisque nous avons aimé le guide, faisons connaissance avec lui et avec l’itinéraire intellectuel qui fut le sien. C’est à l’Ecole Normale que sa vocation d’historien se forme, au cœur de la capitale, « reste oublié du vieux Paris mystique, où les maisons religieuses étaient encore nombreuses » ; les maîtres se nomment Brunetière, Boissier, Monod, et au passage d’un professeur à l’allure modeste, les élèves murmurent « c’est monsieur Pasteur, il inventera bientôt le vaccin contre la rage ! ». La soif de savoir, un travail de tous les instants, mais jamais, sa correspondance en témoigne, de fièvre et de révolte : Georges Perrot qui vient de succéder à Fustel de Coulanges, suit avec attention cet élève qui promet d’être l’helléniste le plus doué de sa génération. Mais lentement, dans cette école que la République rend intolérante, qui congédie l’aumônier, transforme la chapelle en salle de billard, et dans laquelle Lucien Herr façonne déjà une génération de socialistes, Emile Mâle sent « la grandeur et la bienfaisance de cette religion qui n’a pas de commune mesure avec les autres » prenant conscience « qu’un grand fleuve de croyance millénaire a roulé son dernier flot » jusqu’à lui.
En 1886, les vacances venues, il prend le train pour la Provence : beauté monumentale des cyprès, bosquets de chênes verts comme des bois sacrés, rivages, inviolés alors, d’une mer au bleu tranchant qui porta toute l’histoire du monde : « Au flanc d’une colline, un champ d’oliviers apparut. Enfin je contemplais l’arbre de Minerve, que je voyais pour la première fois, et je compris que j’entrai dans le royaume de la beauté »
C’est au milieu des ruines que Rome laissa partout que le Moyen-Age va lentement entrer dans l’esprit de Emile Mâle : à Avignon, le Palais des Papes, à Arles, Saint-Trophime, puis passant en Italie, le Campo Santo à Pise et enfin à Florence : « Ce fut à Santa Maria Novella que je reçus le coup de foudre qui décida de ma vie et fit de moi non un historien de l’art grec, comme je l’avais cru, mais un historien de l’art du Moyen-Age : la chapelle des Espagnols, monde grave et profond, résumé grandiose de la chrétienté, me remplit d’admiration et d’étonnement ».Contemplant cette oeuvre triomphale dans laquelle tout cependant, cum pondere et mensura, est réglé par une pensée ordonnatrice et toute bienveillante à l’être humain.
Le voyage devait se continuer jusqu’à Rome : sur l’antique pavé, nous dit-il, il titube comme un homme ivre : « Je viens de réaliser le rêve éternel : j’ai vu Rome !» et le futur auteur du chef-d’œuvre sur lequel nous nous penchons aujourd’hui, se confie avec découragement : « Il n’y a plus à faire sur Rome une phrase qui n’ait été faite » !
Cet homme modeste ne se reconnut jamais d’autre mérite que « d’aller d’église en église, de monument en monument, en admirant et en essayant de comprendre ». Ce fut un singulier mérite que nul cependant ne se souciait d’émuler ! « Quand je parcourais la France au temps de ma jeunesse, j’allais d’église en église sans rencontrer un archéologue, un artiste ou même un voyageur ; je passais des heures à admirer sans que personne vînt jamais partager mon admiration. »
Son mérite pourtant dépasse infiniment ses pérégrinations de jeunesse : en 1895 il publie sa thèse sur l’Art Religieux au Moyen-Age et qu’il développera tout au long de sa vie, formant une suite formidable de quatre volumes qui contient une vie d’études. Son œuvre bouleversera les certitudes historiques, lui vaudra tous les honneurs académiques et lui créera aussi une sorte de culte entretenu par un cercle étroit des esprits les plus supérieurs de son époque.
Je ne voudrais pas laisser croire que Emile Mâle appartint entièrement à la Ville : il fut profondément de son pays, celui de Commentry où il naquit et celui de Monthieux, pays de son enfance, où il retourna dans sa vieillesse, au seuil de l’éternelle lumière. Car ainsi qu’il le dit dans ses souvenirs : « Lorsque je pense au printemps, ce ne sont pas les bords du lac de Nemi, ni les orangers de Sicile, mais le clos de Monthieux qui me revient à l’esprit ».
C’est là dans ce pays de sources vagabondes, aux traditions millénaires, au cœur de ce qui fut la Gaule, qu’il finit ses jours ; il nous a confié dans quelques vers ce que fut son attente : « Mon enfance est là, qui rêve sous un arbre / Et lorsque toute émue elle m’apercevra / En me tendant les bras elle me sourira »
S’il fallait trouver un saint patron aux historiens de l’art, c’est lui : cet homme d’une foi tranquille et profonde, se recommande par l’importance d’une œuvre qui donna à comprendre et pas seulement à admirer le Moyen-Age, ses édifices religieux et son iconographie. Un saint opère de miracles, il faut l’invoquer et il figure dans le calendrier, ce Diario romano qui dans la Ville vous indique le saint du jour, son histoire et ses miracles. La mémoire de Emile Mâle n’en demande pas tant ; il lui suffira que vous ouvriez un de ses livres « en admirant et en essayant de comprendre » avec, selon son exemple, cette tranquille confiance dans la force que la beauté donne à l’être humain.
1 Toutes les citations de la correspondance, des souvenirs d’Emile Mâle –longtemps inédits- et ceux de sa fille Gilberte Emile-Mâle ont été rassemblés dans Souvenirs et correspondances de jeunesse, CREE, 2001
2 Ce serait un autre chapitre intéressant, mais le temps a manqué à Emile Mâle : celui des églises de Constantin. Outre la basilique de Maxence, la liste comporte Saint-Jean de Latran, Sainte-Croix-de-Jérusalem, vouée au souvenir de sa mère, la basilique de Saint-Laurent, celle de Saint-Paul sur la route d’Ostie, ou Sainte-Constance sur la via Nomentana !
3 Heinrich Wölfflin, Réflexions sur l’histoire de l’art, Flammarion, 1982
4 Emile Mâle, Arts et artistes du Moyen Age, Préface, Colin, 1927

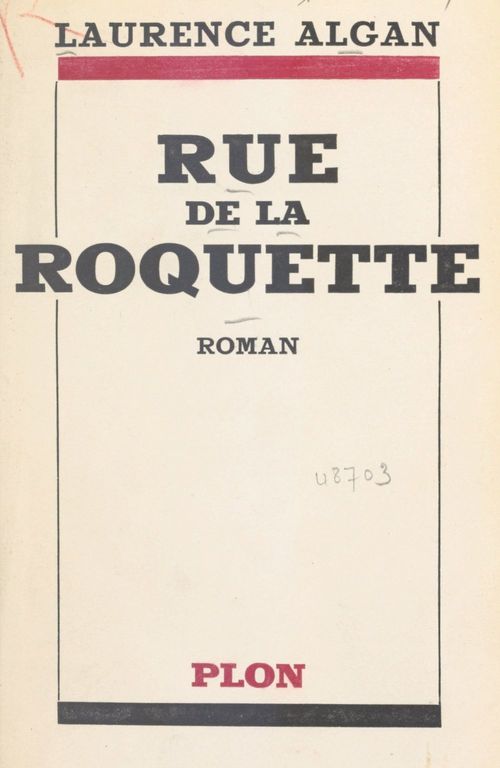
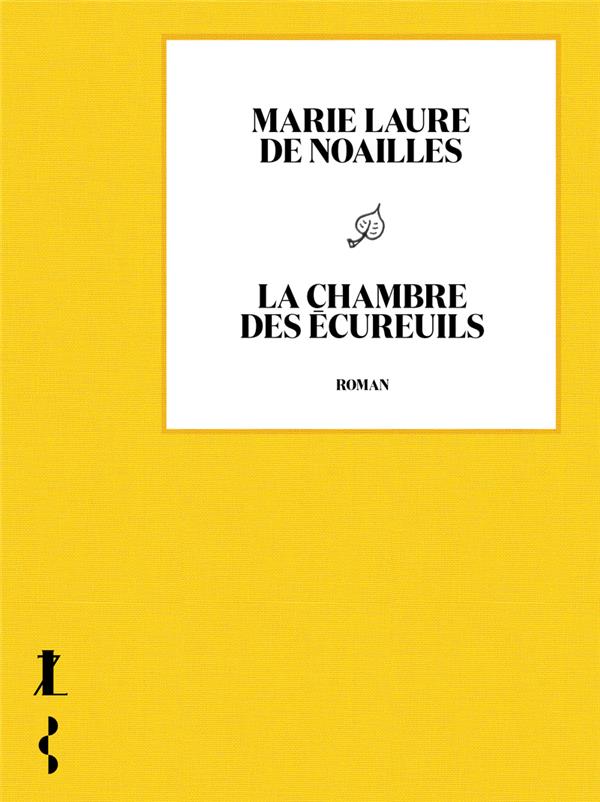
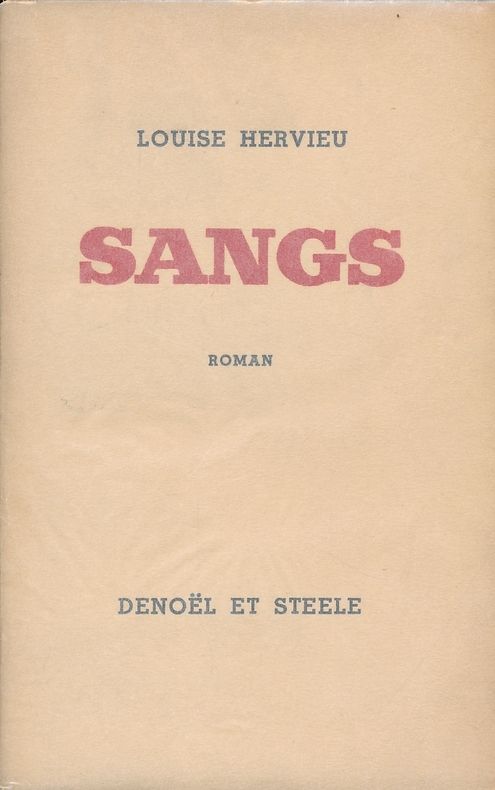
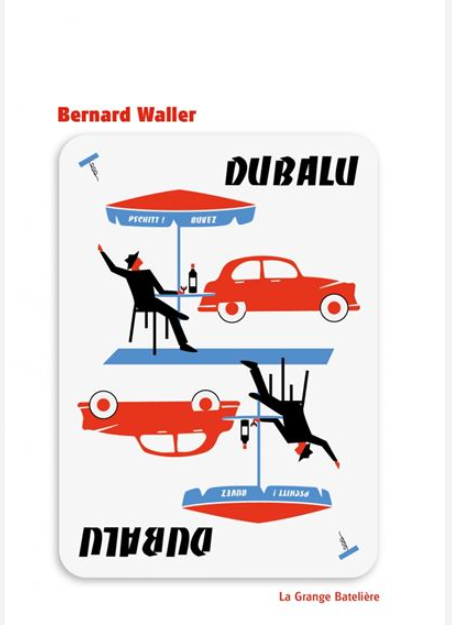
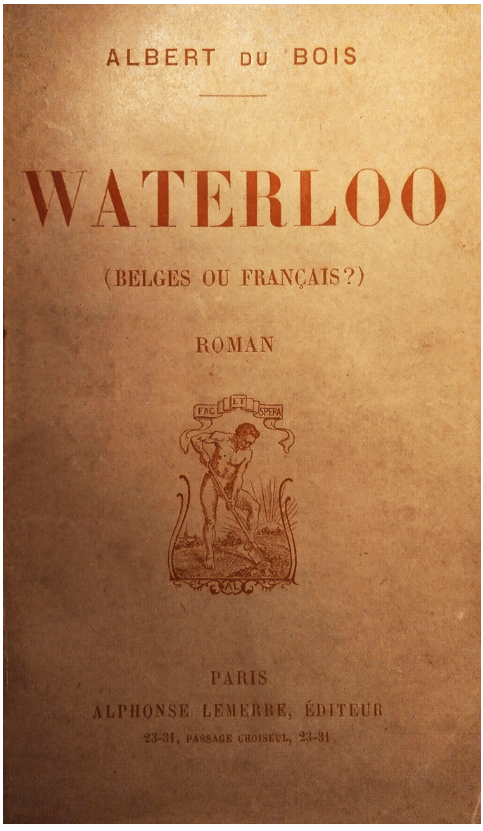
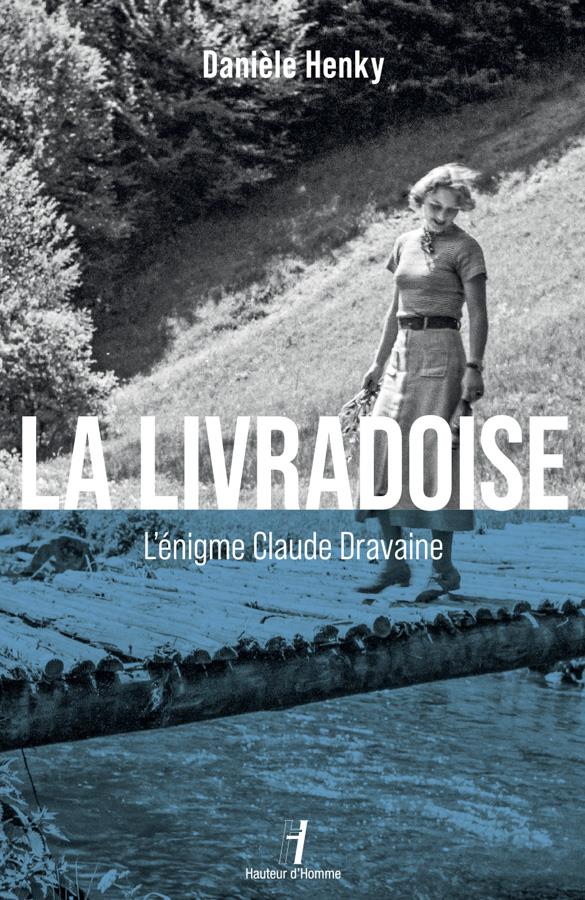
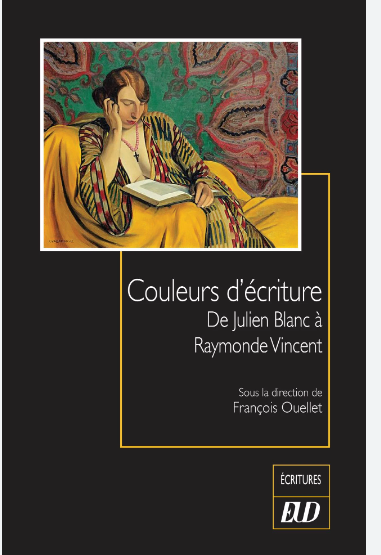
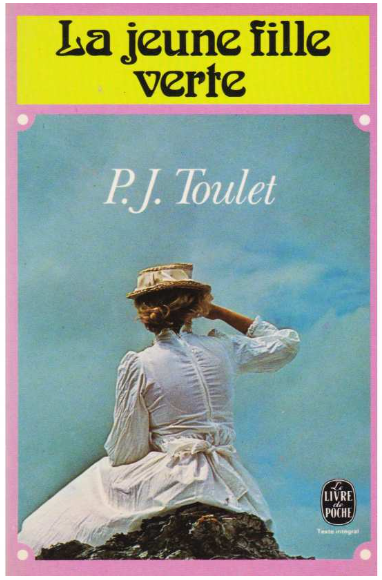
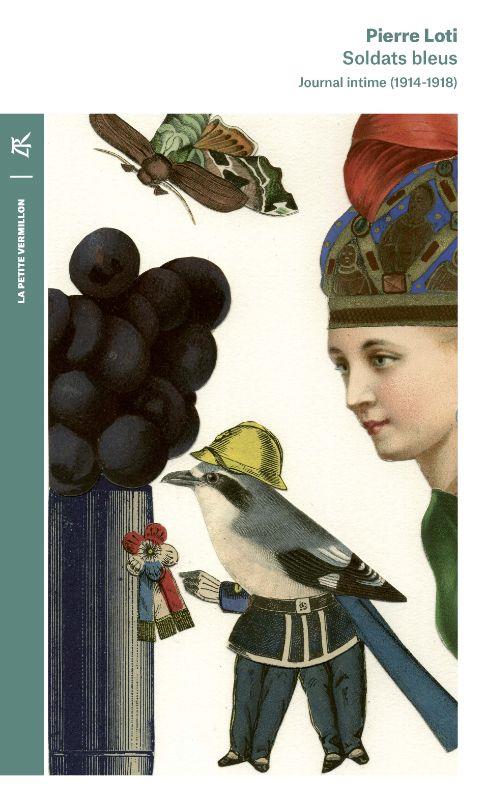
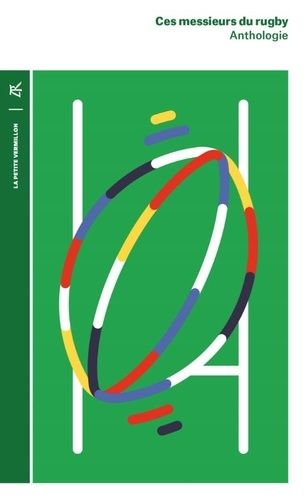
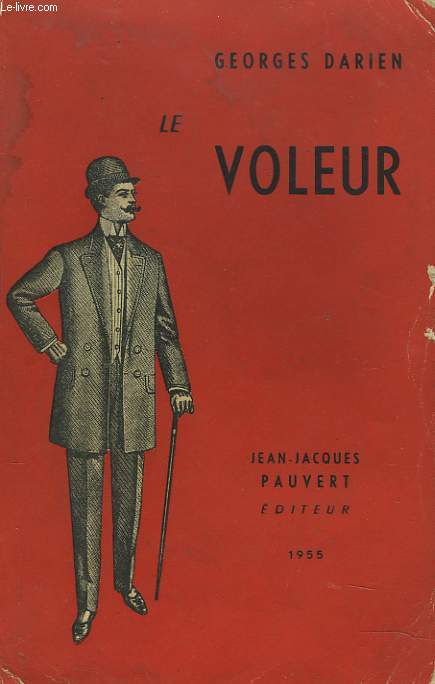
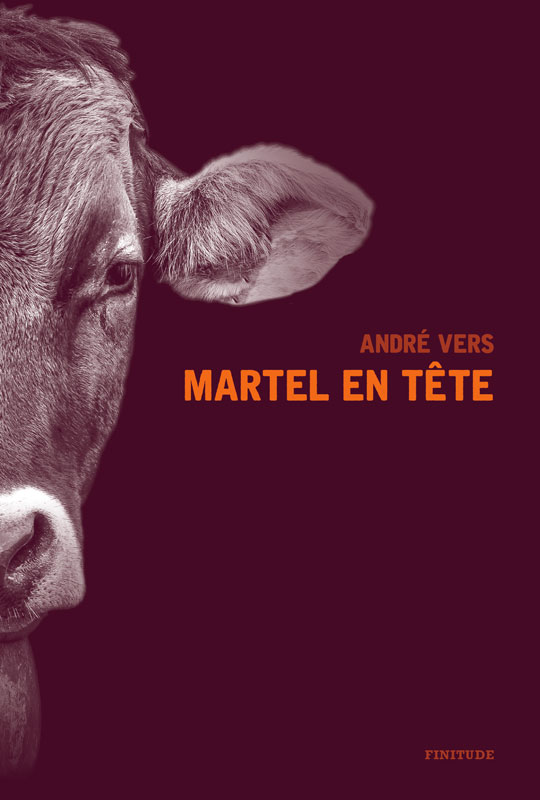

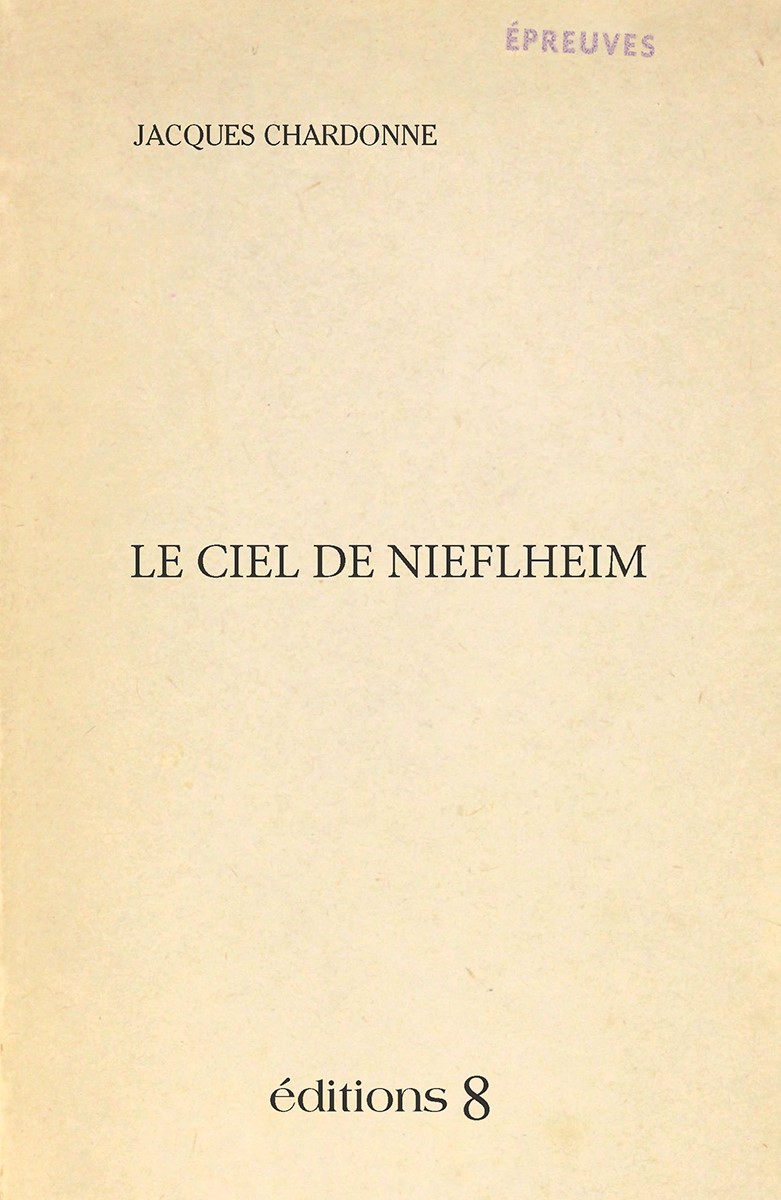
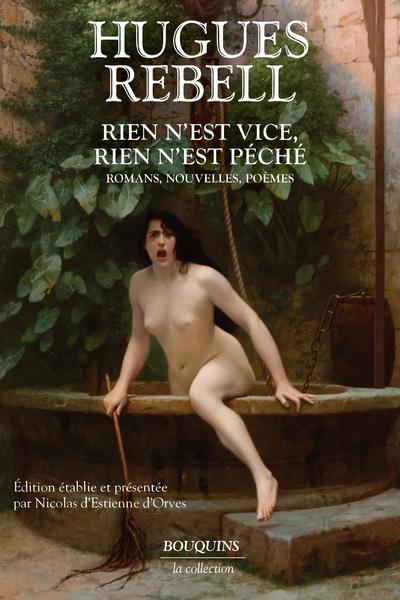
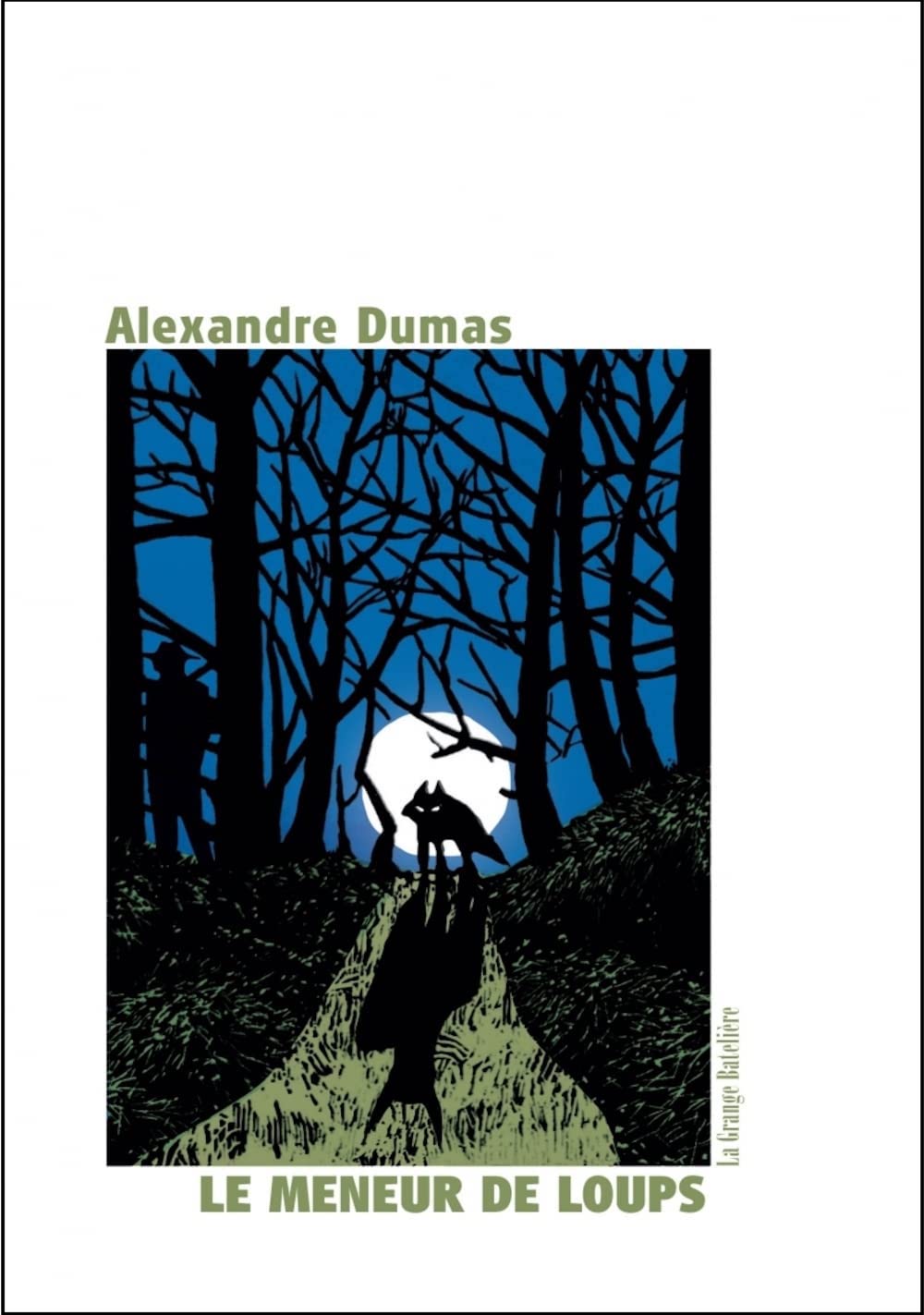
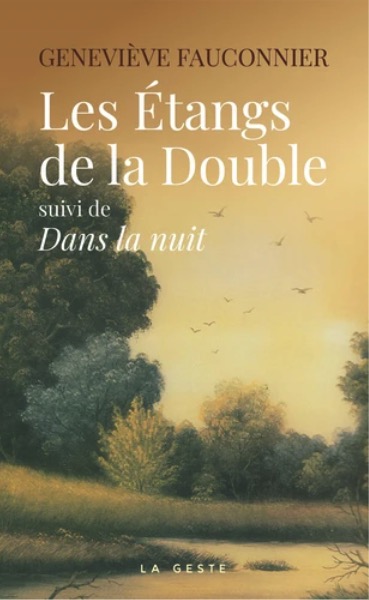
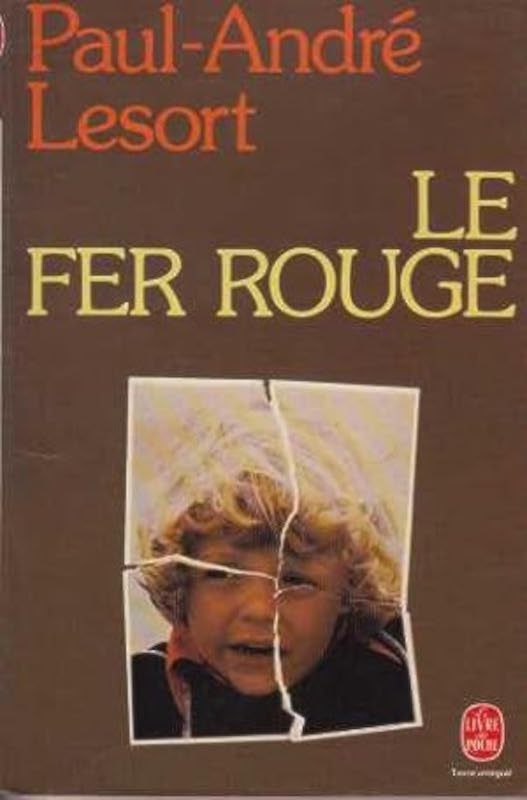

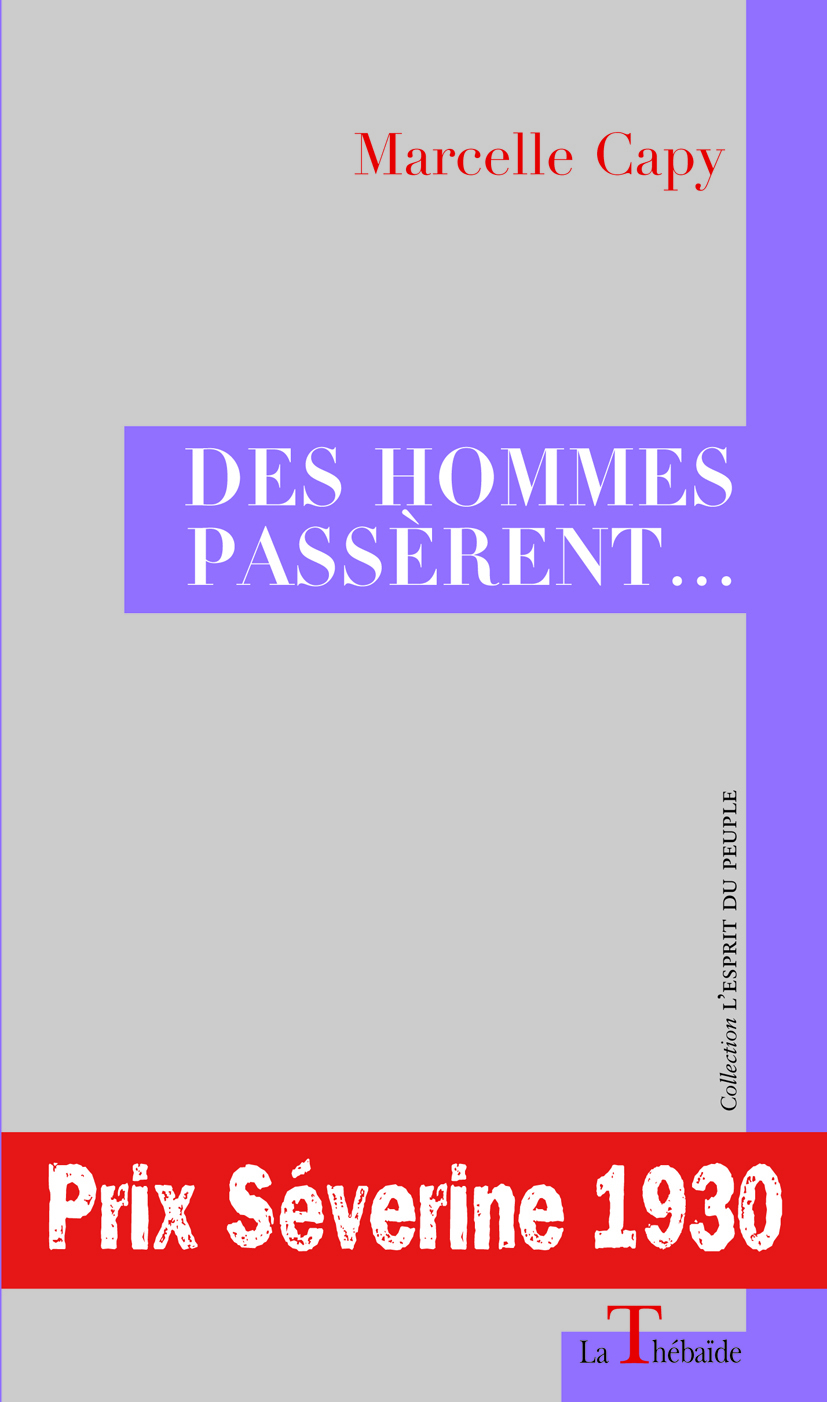
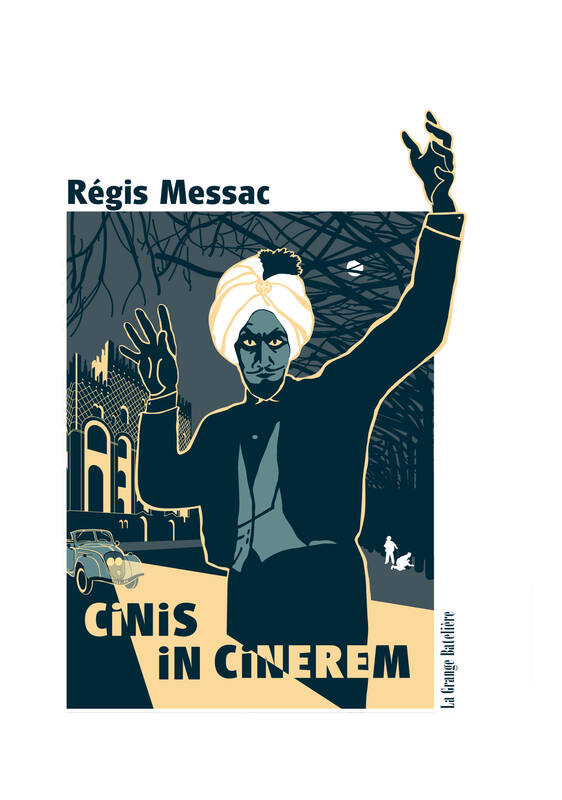
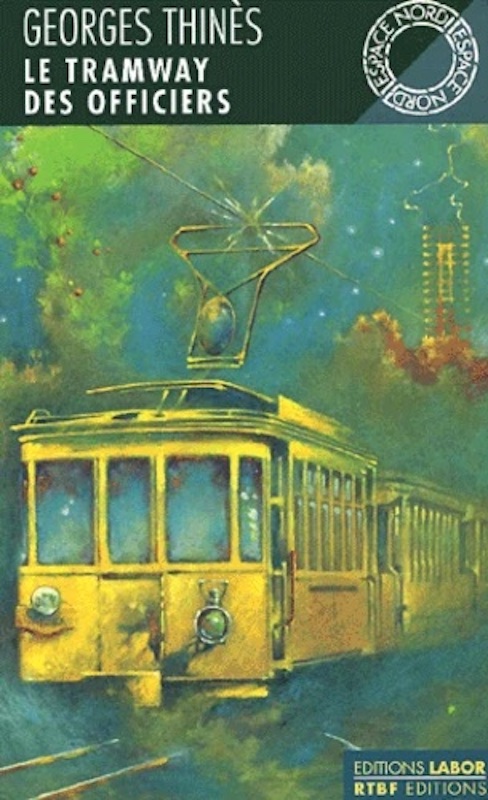
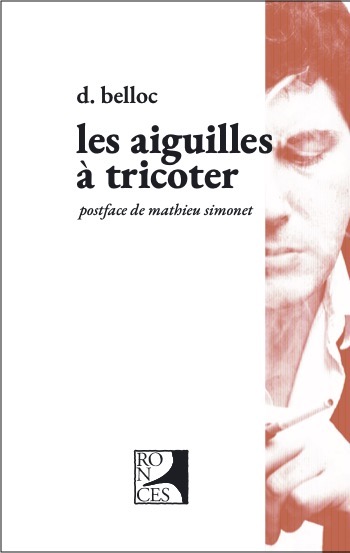
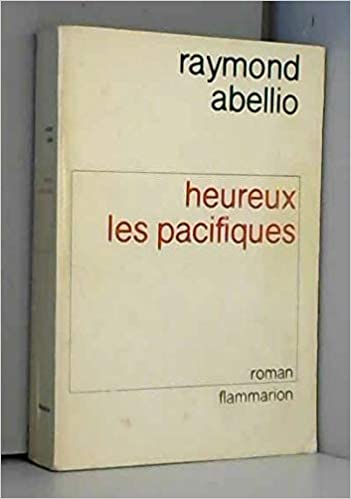
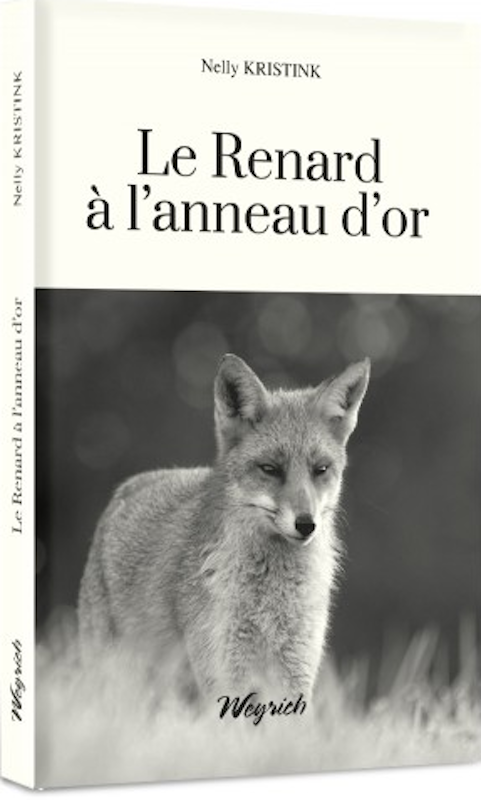
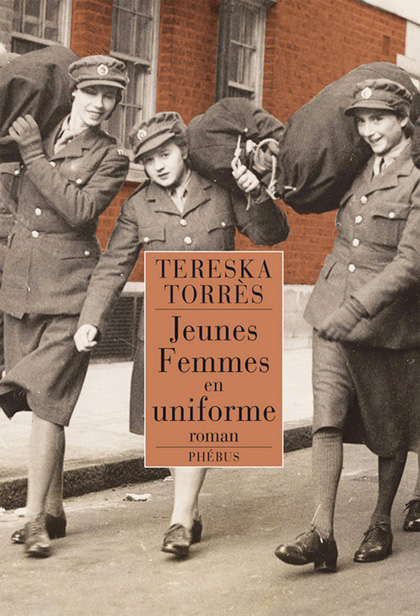
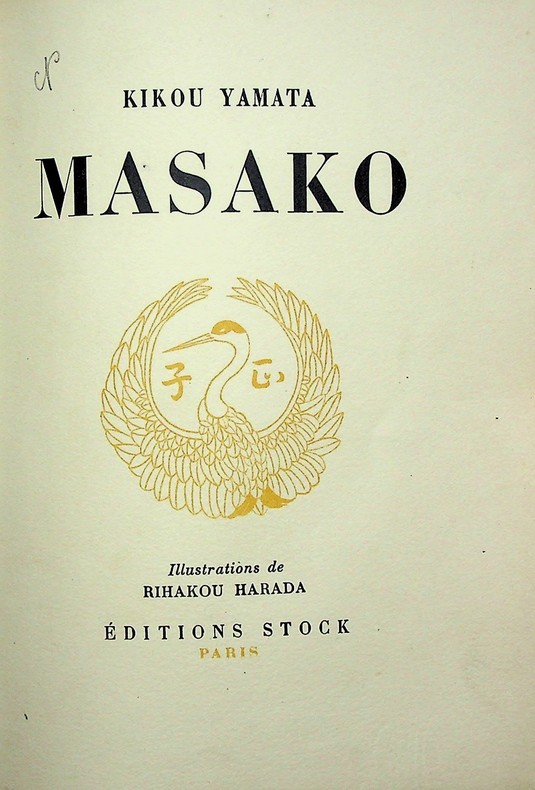
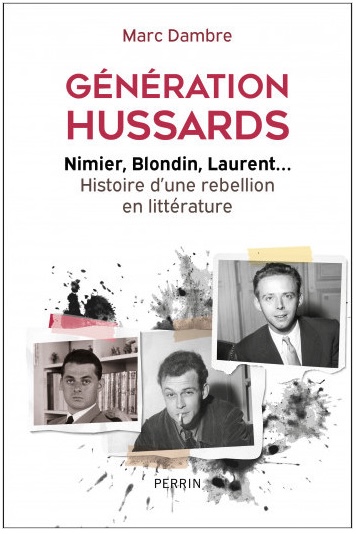
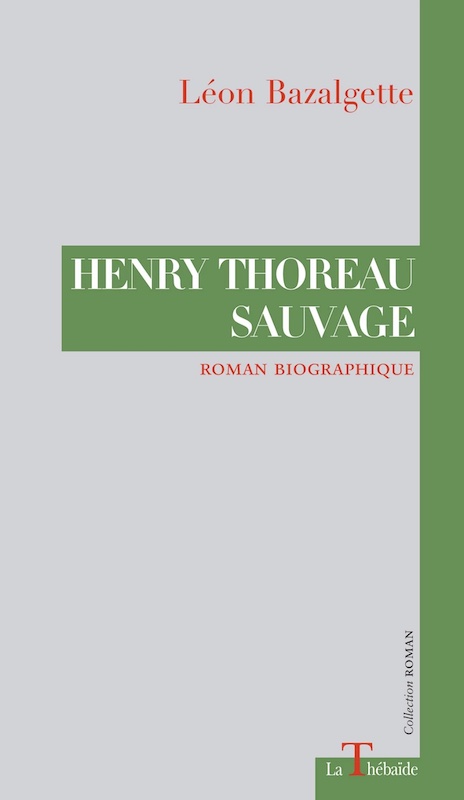
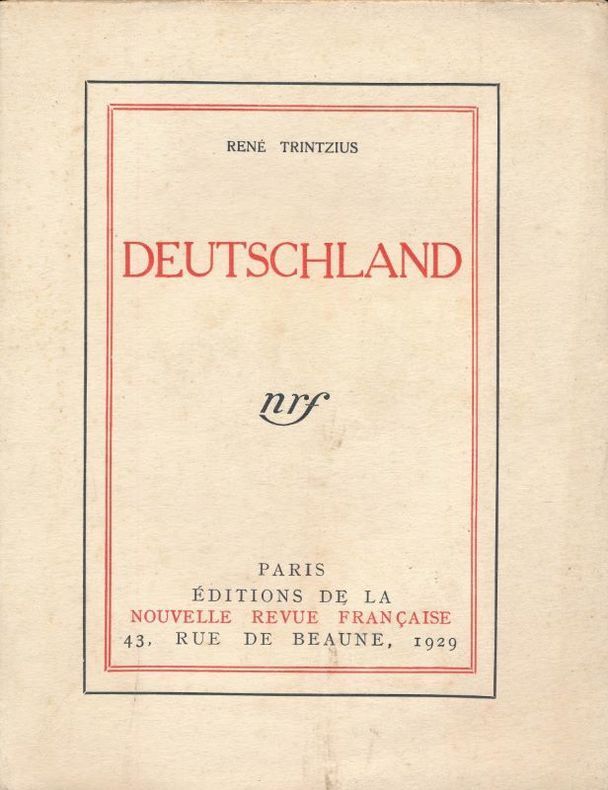
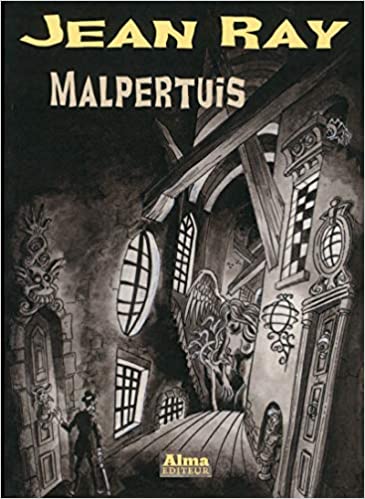
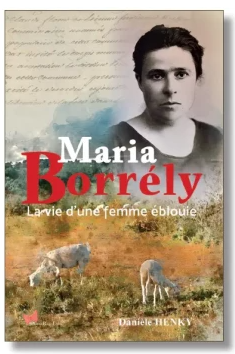
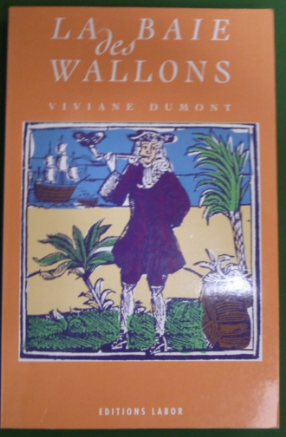
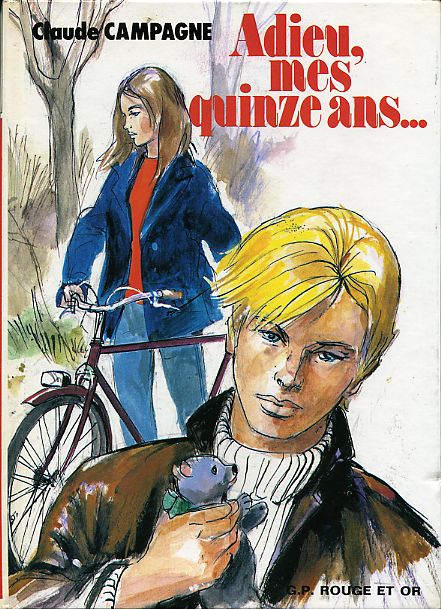
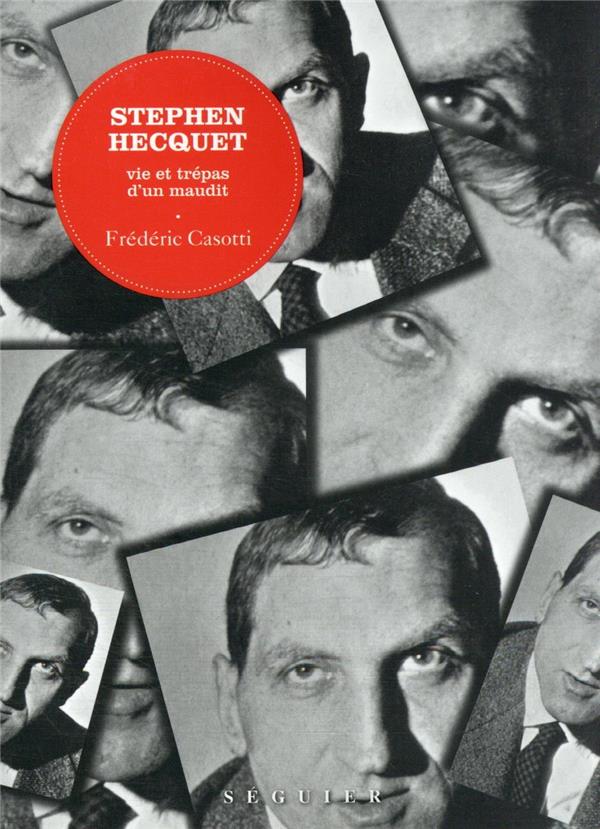
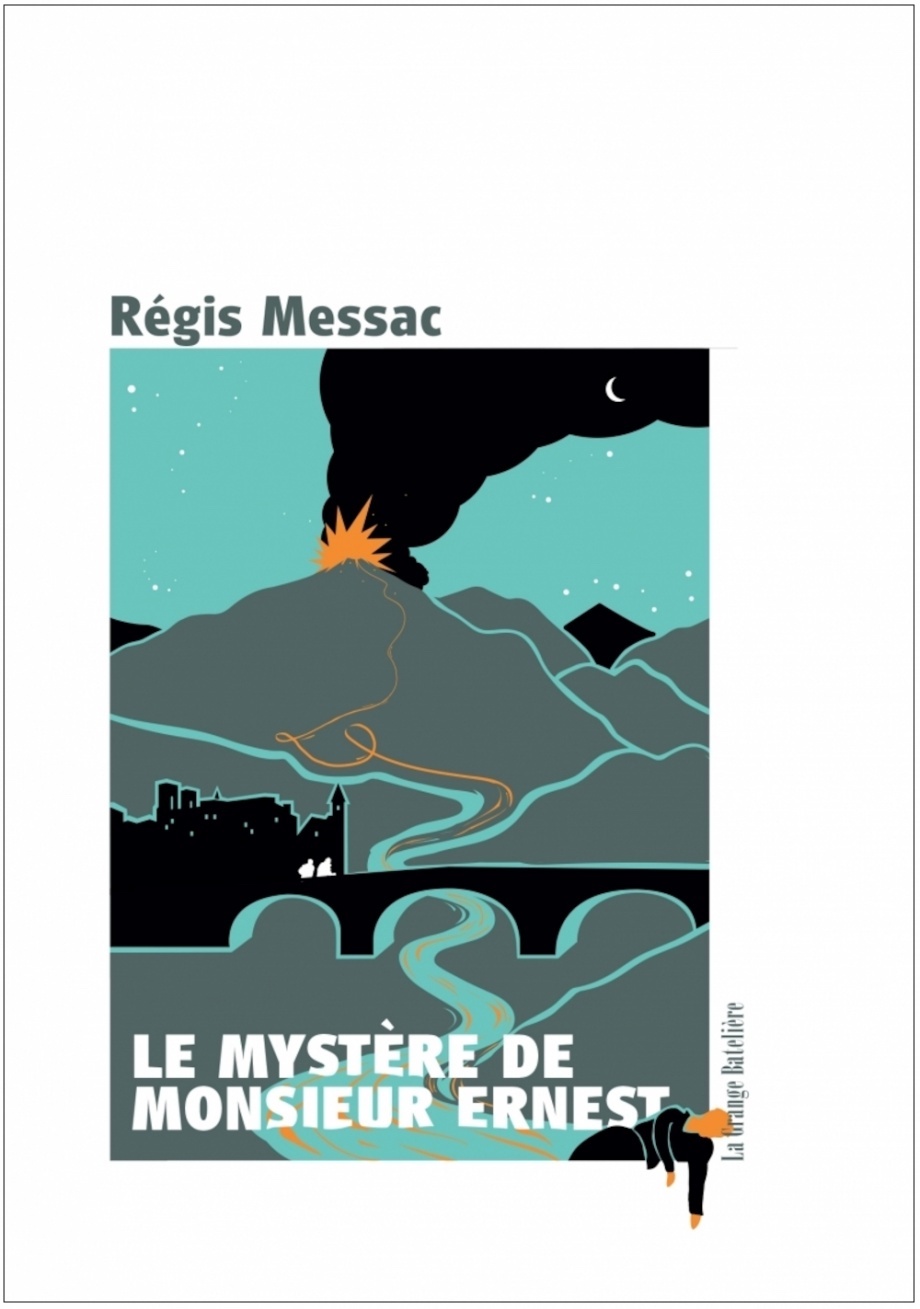

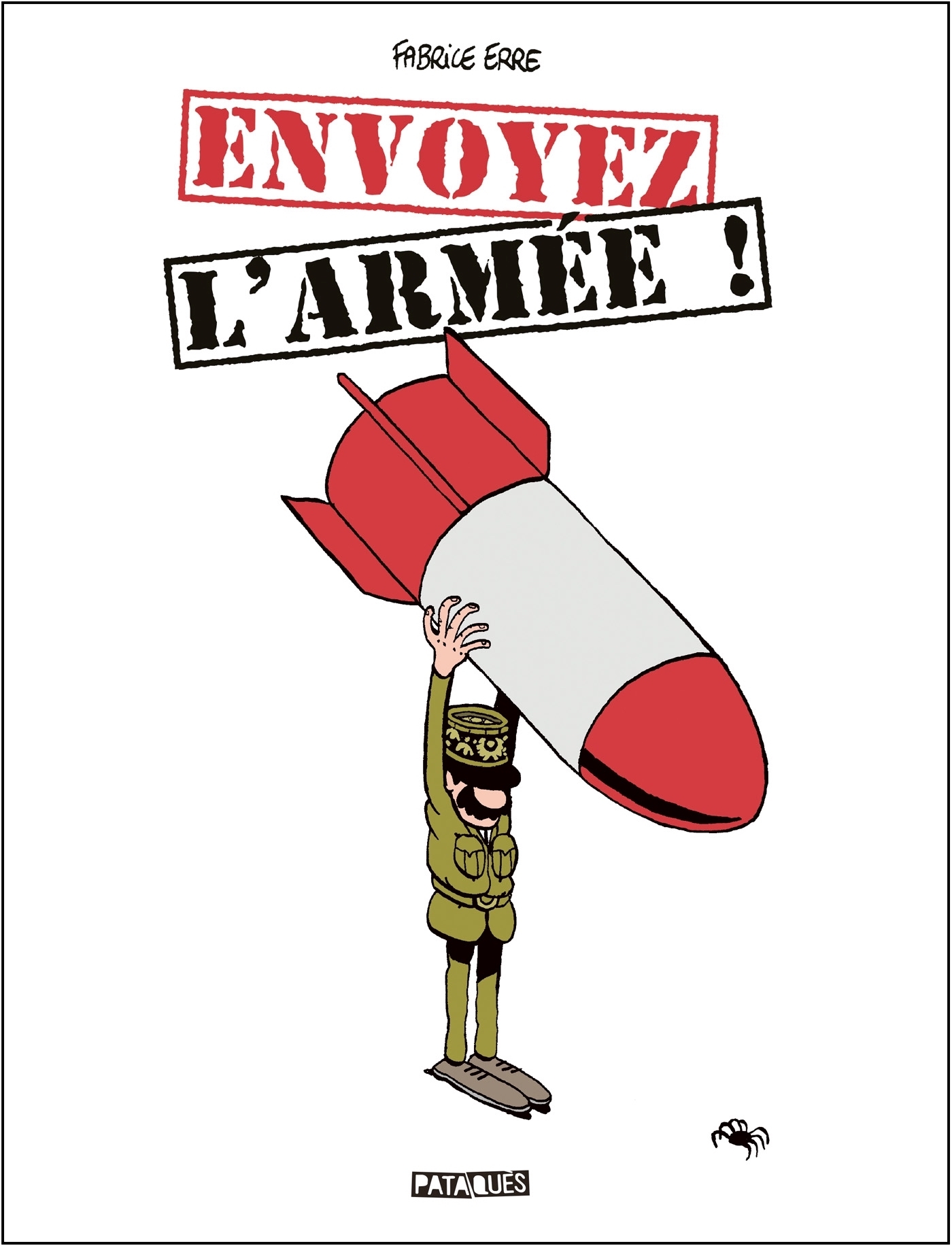
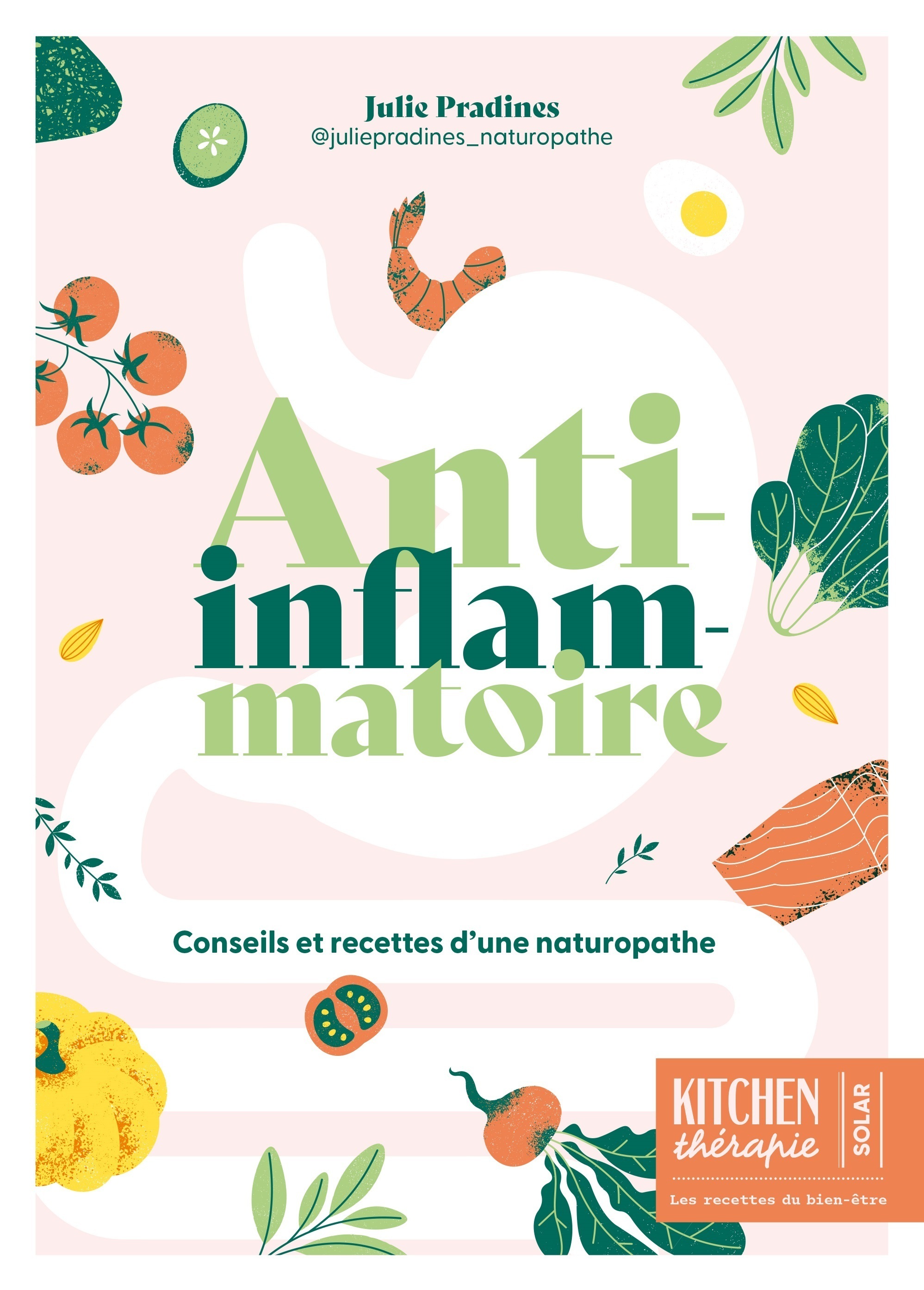
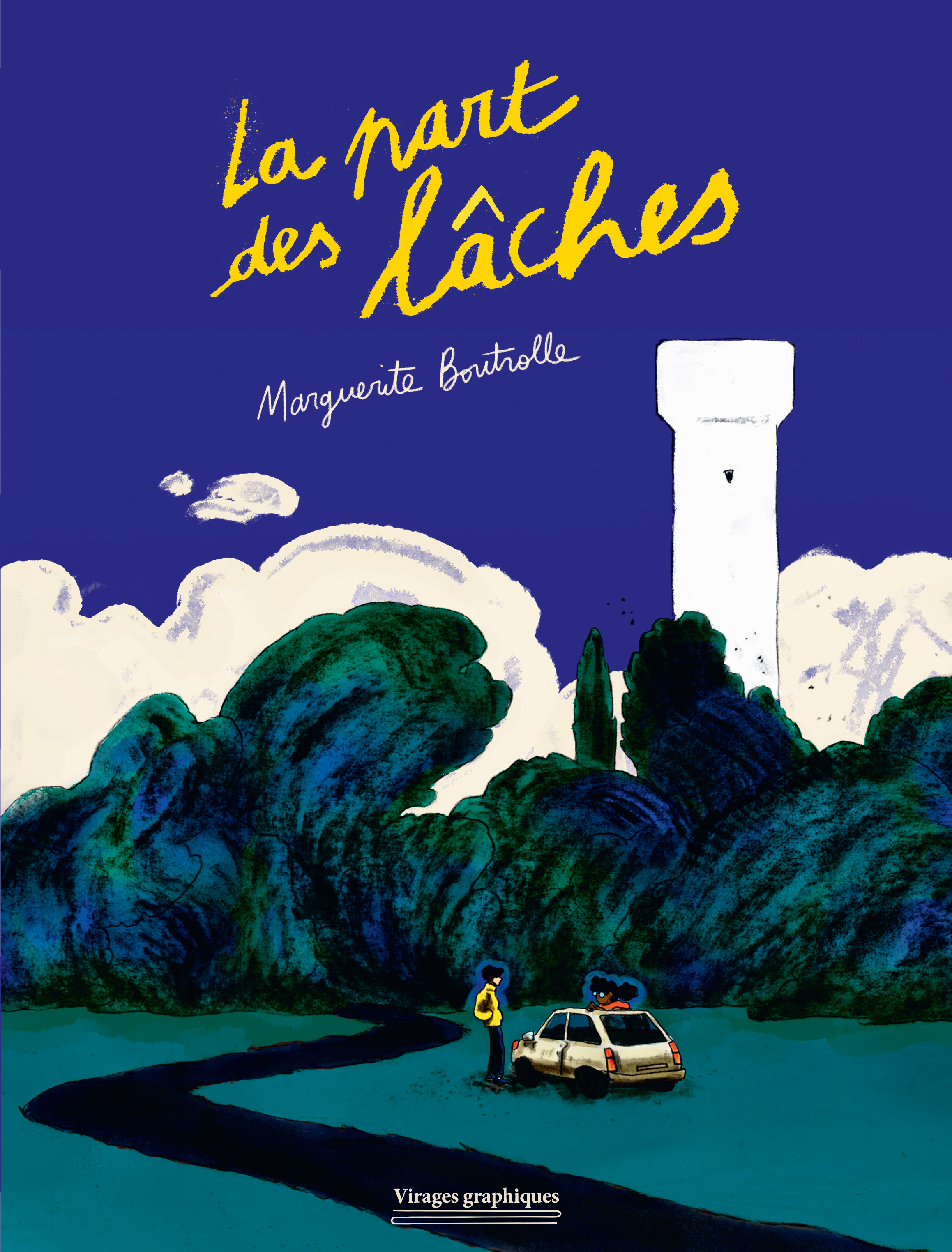

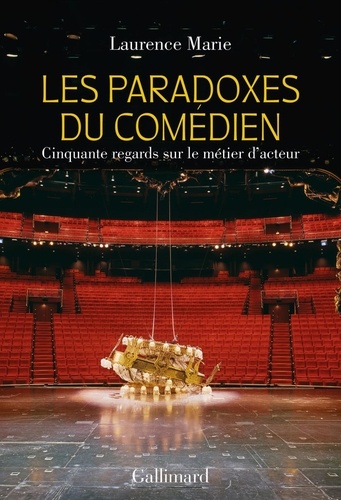
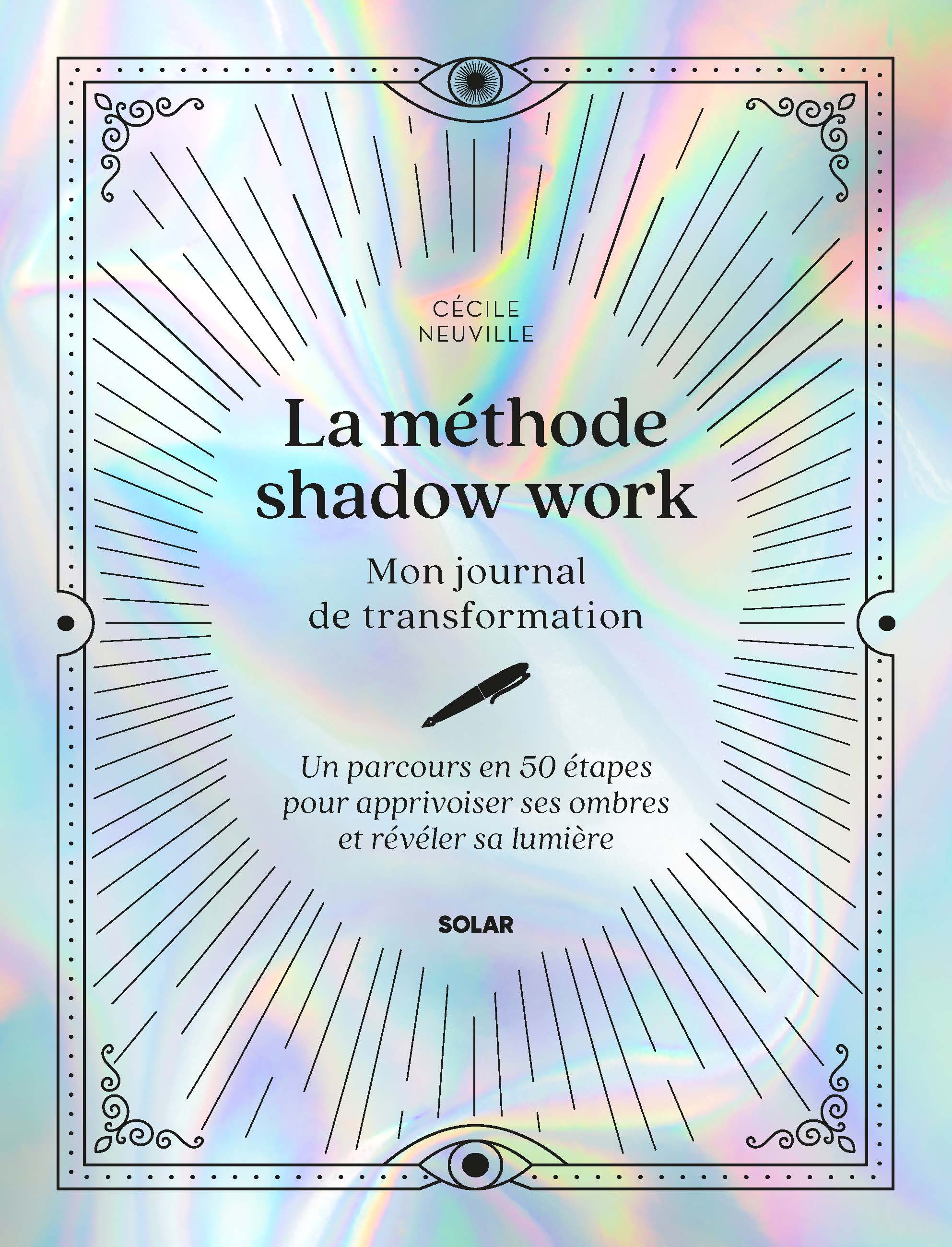
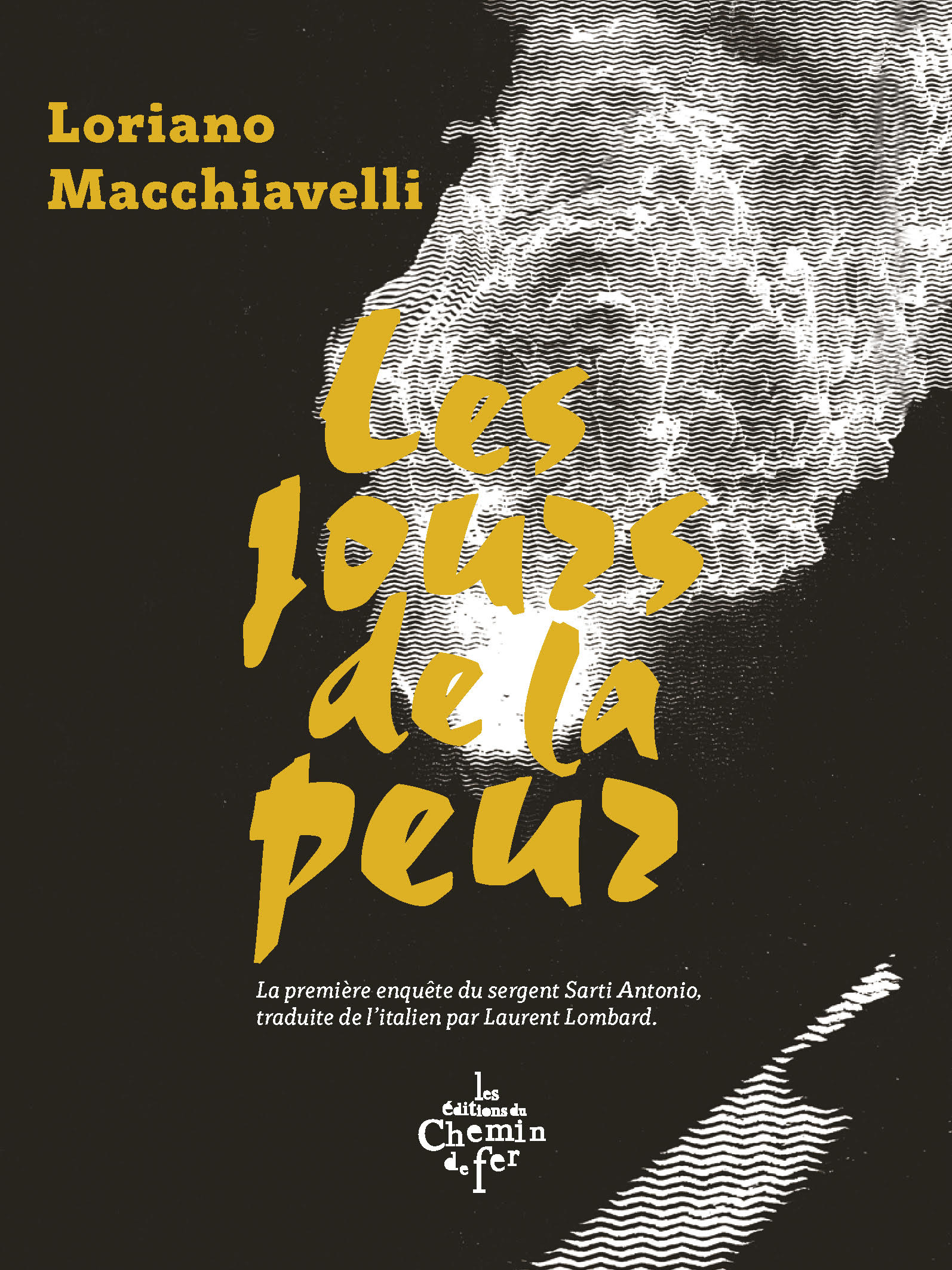
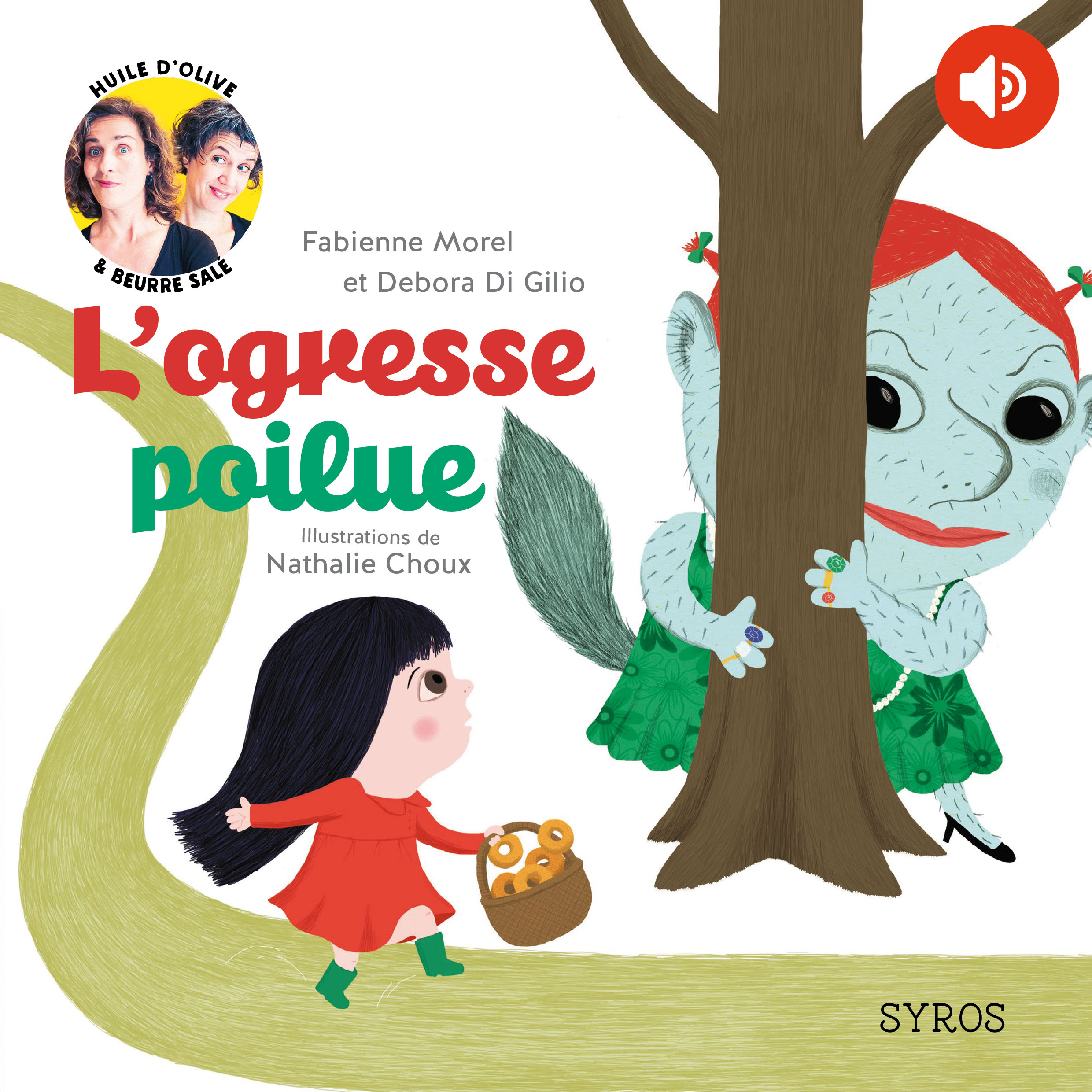
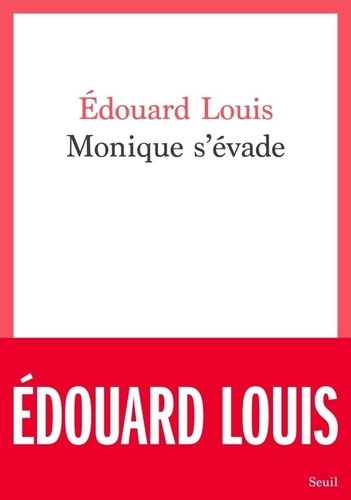
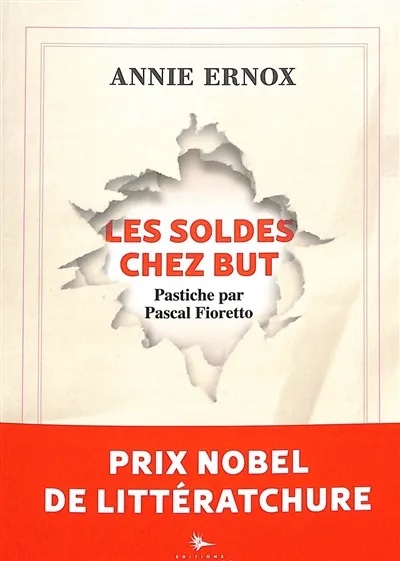
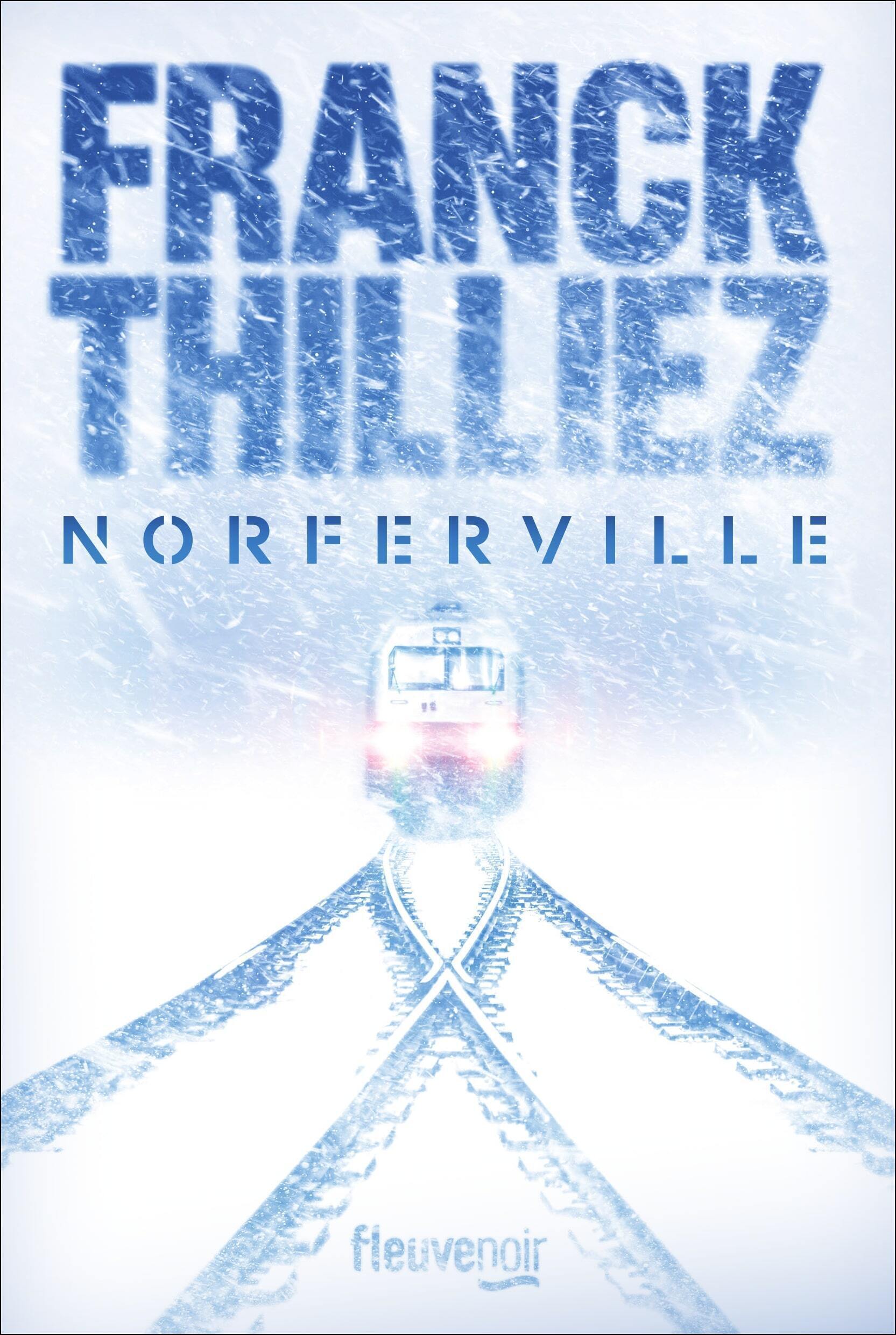
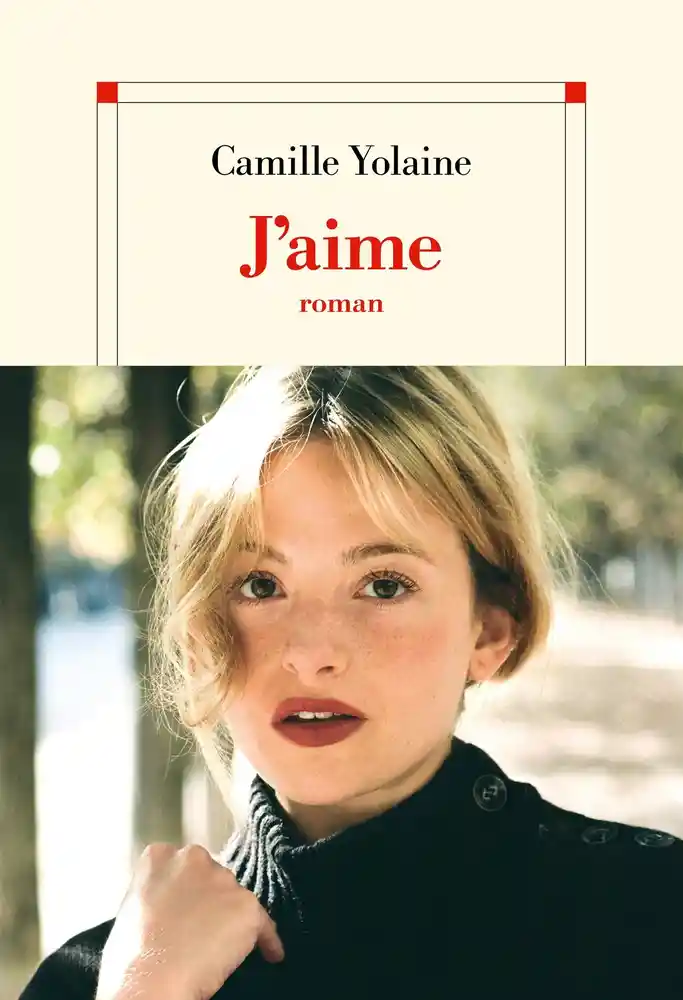
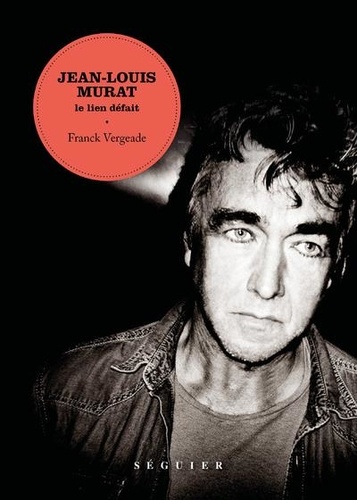
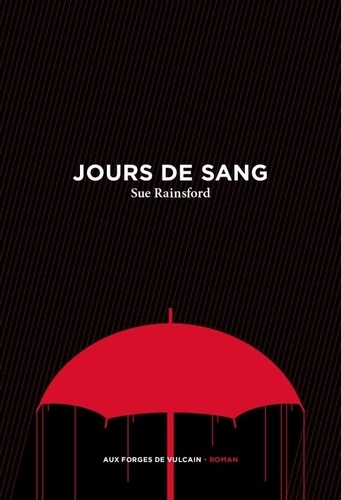
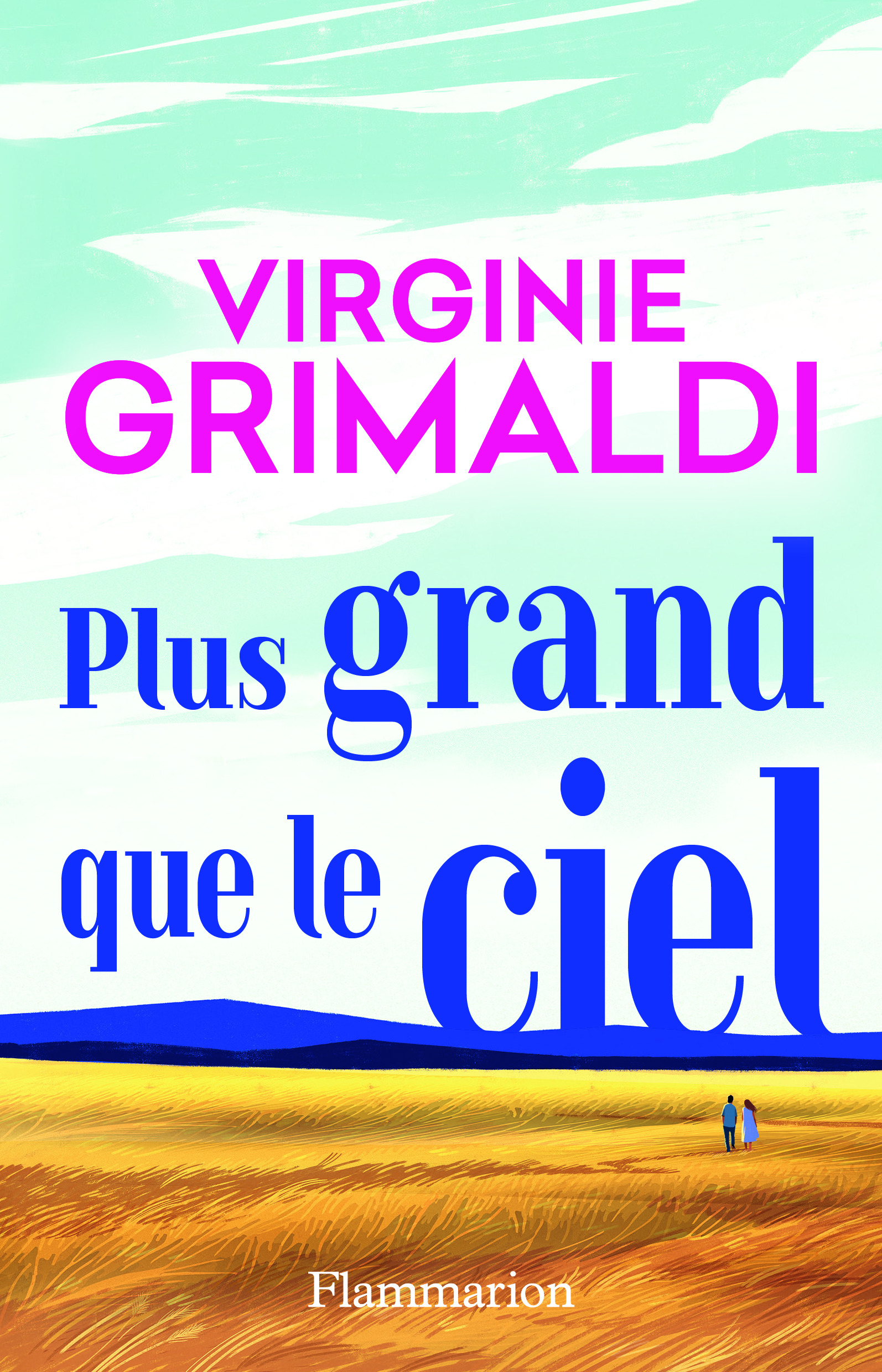
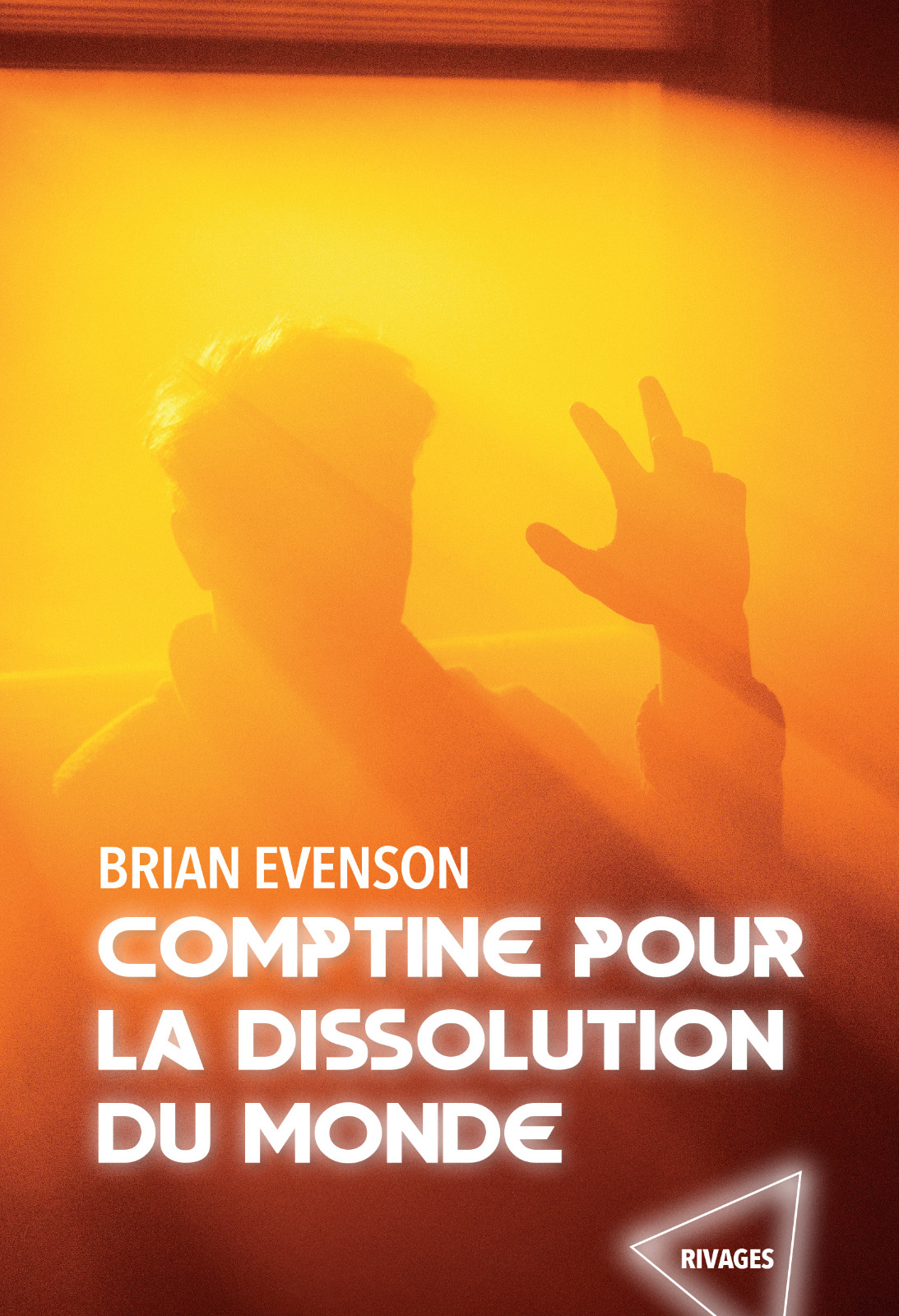
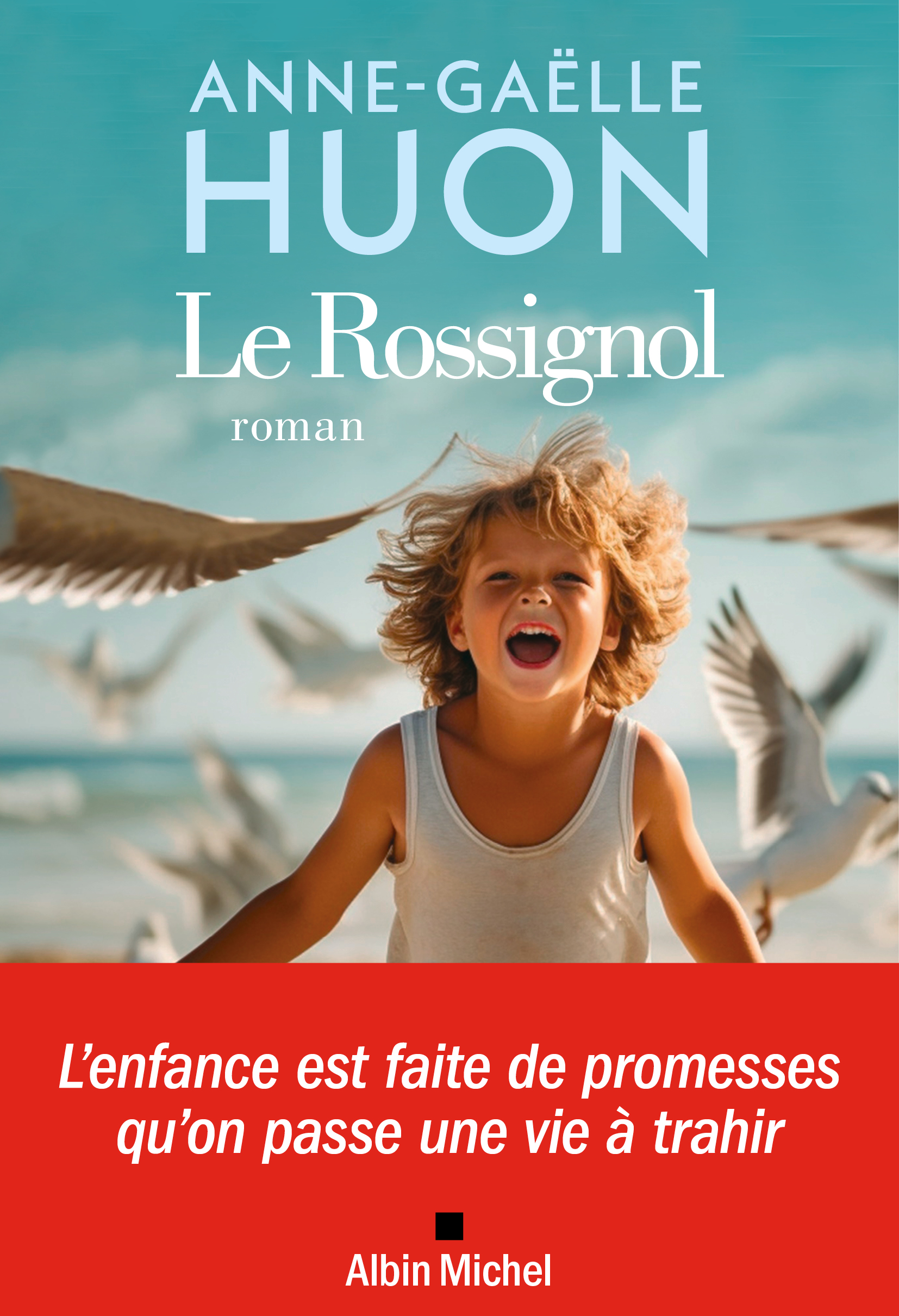
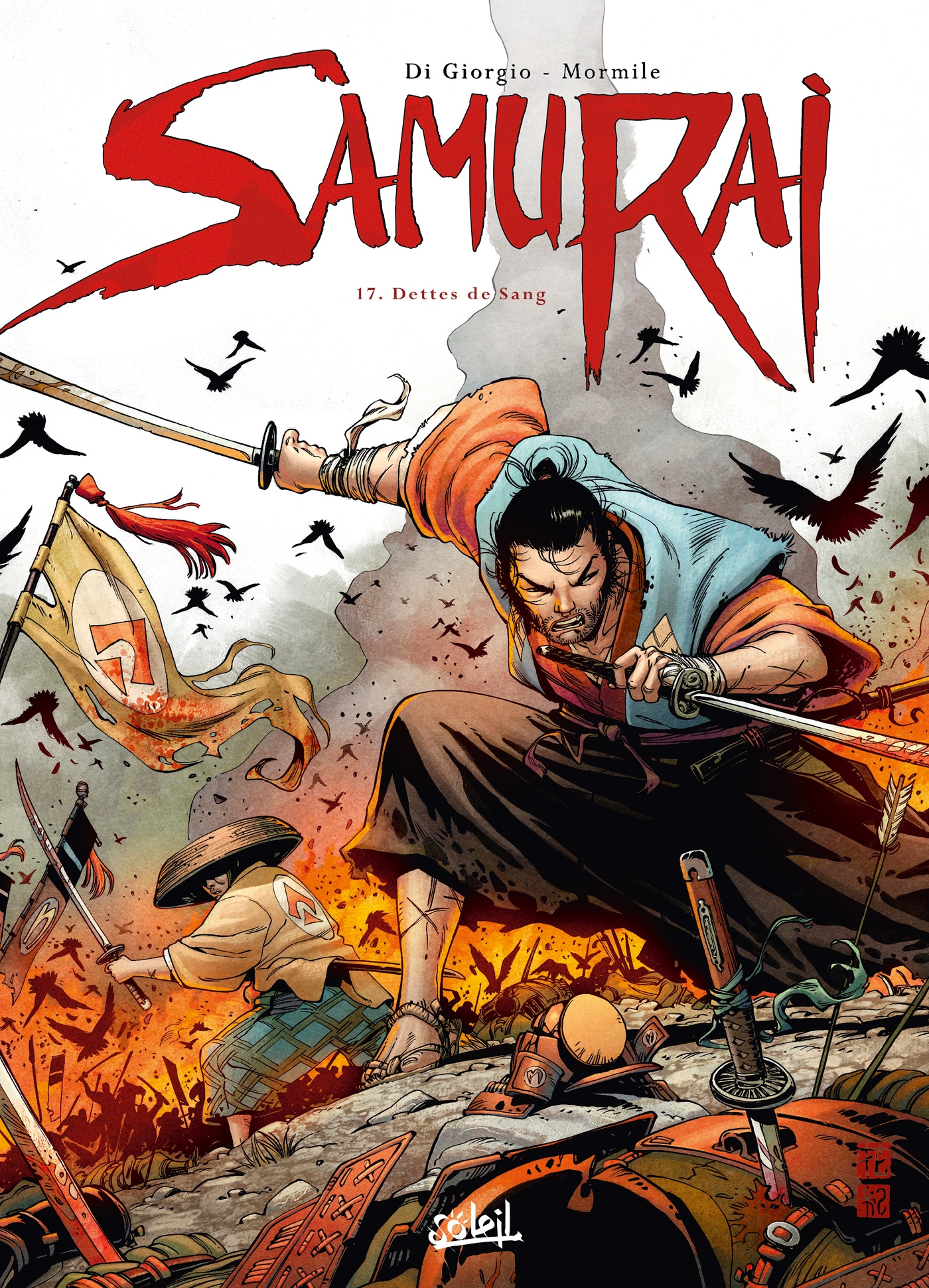


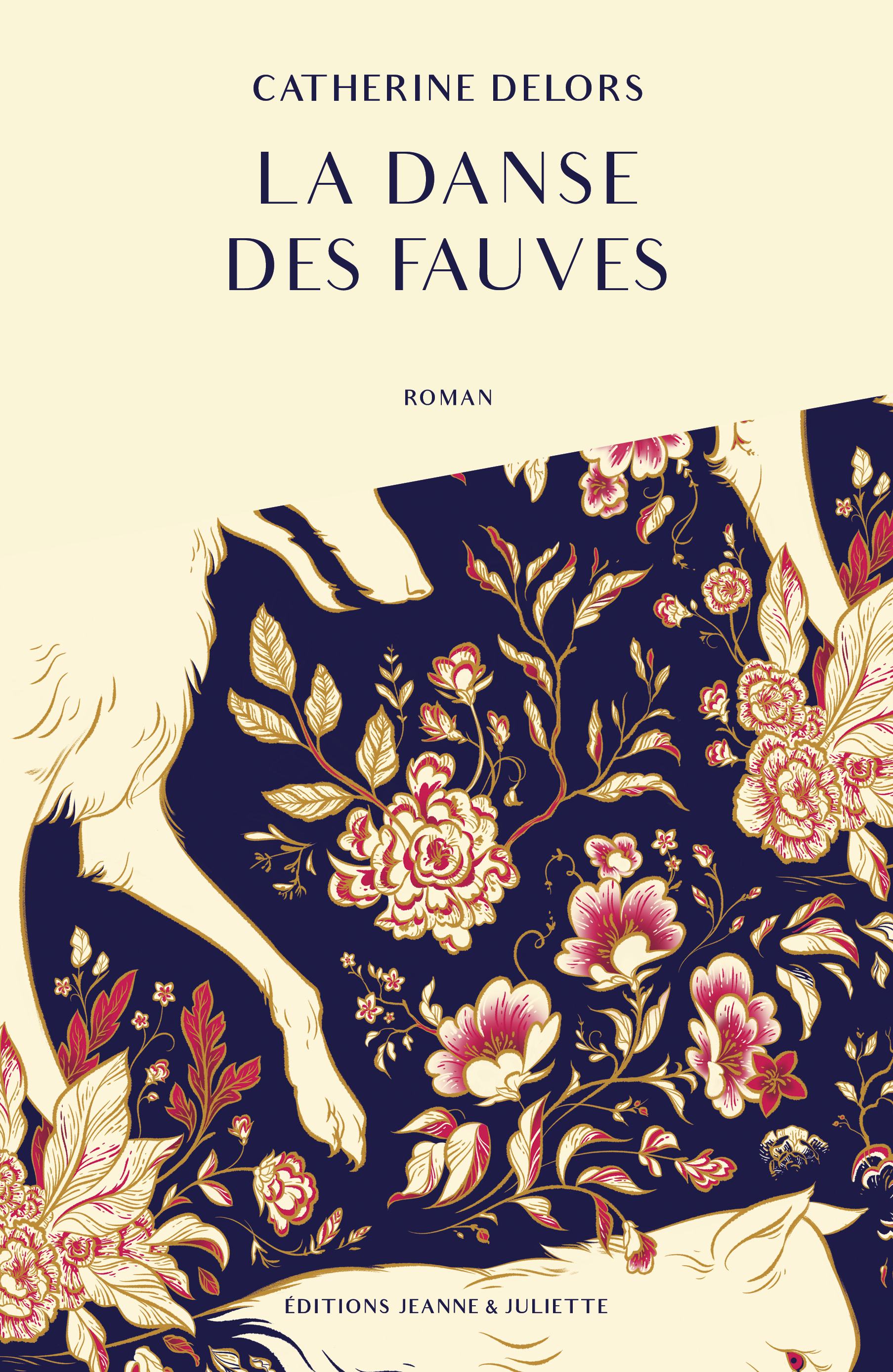
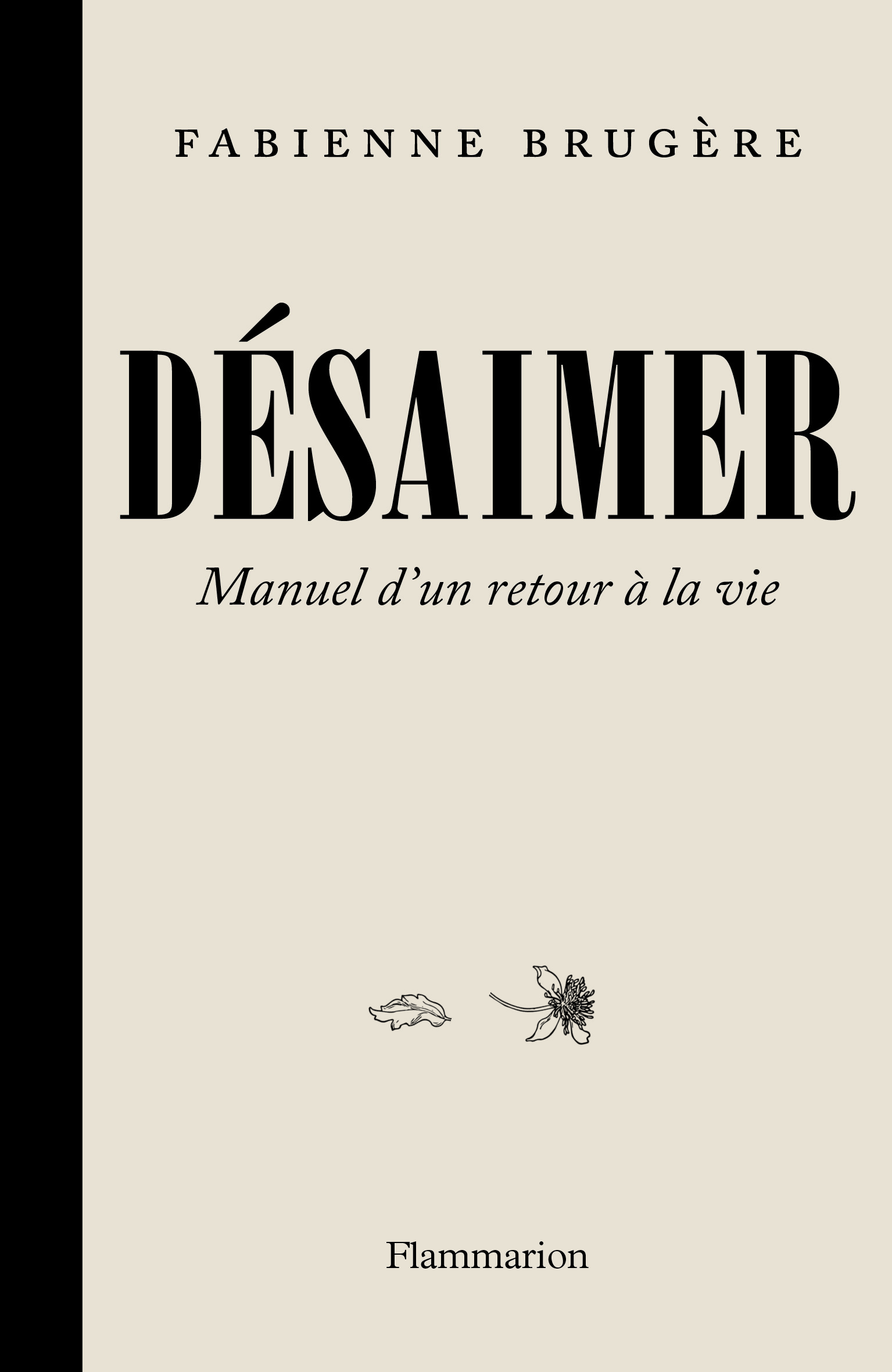
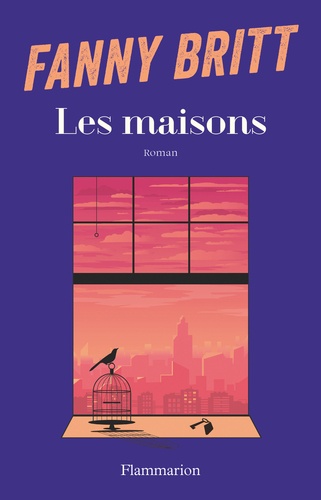
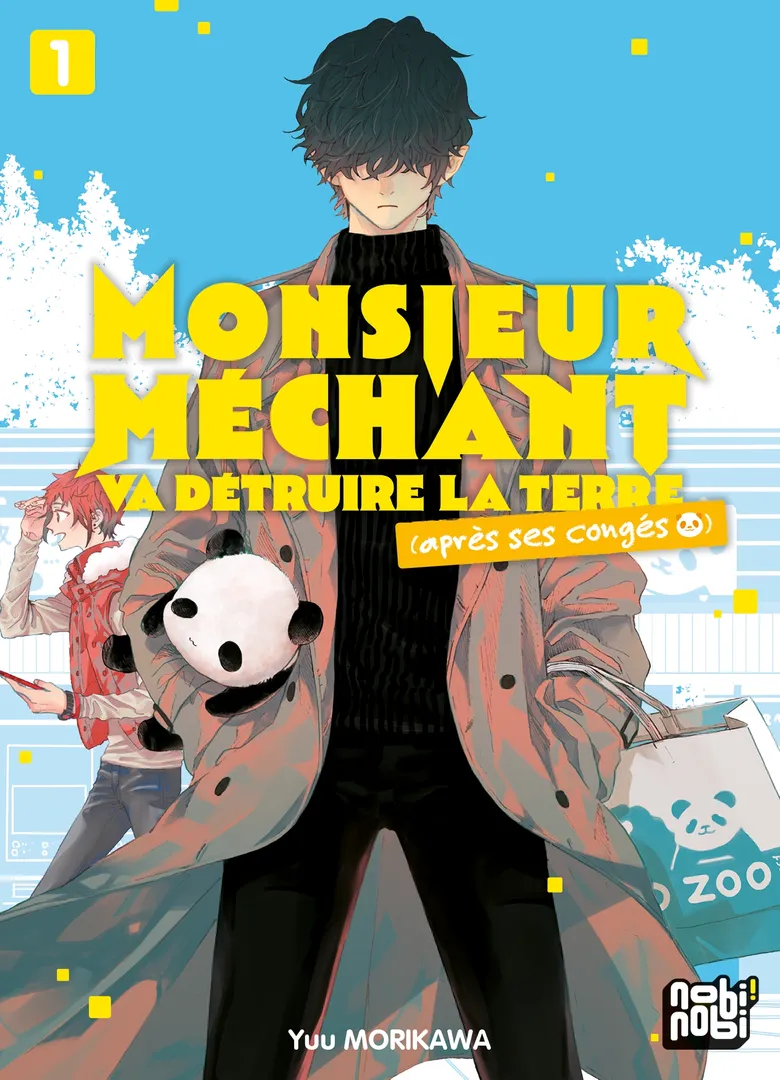

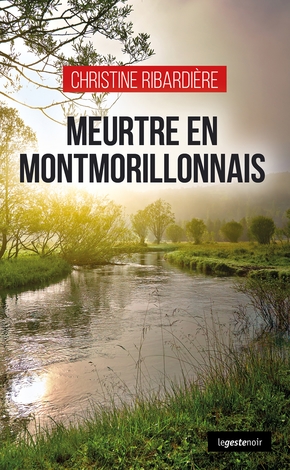
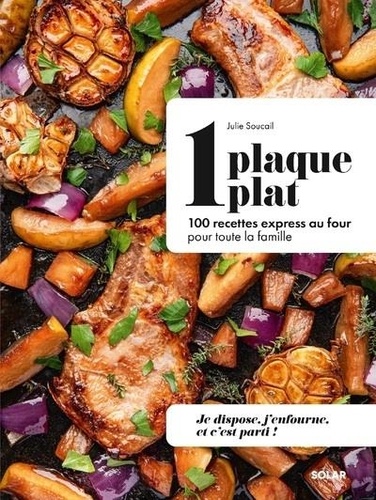
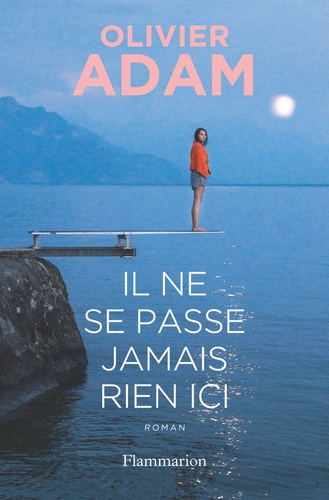
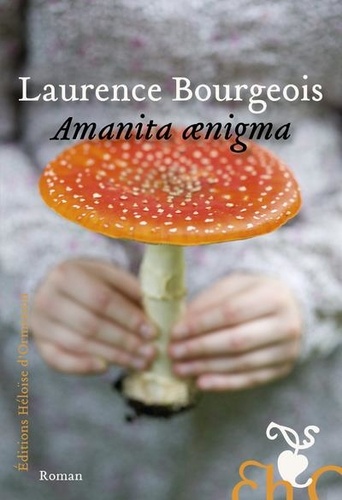
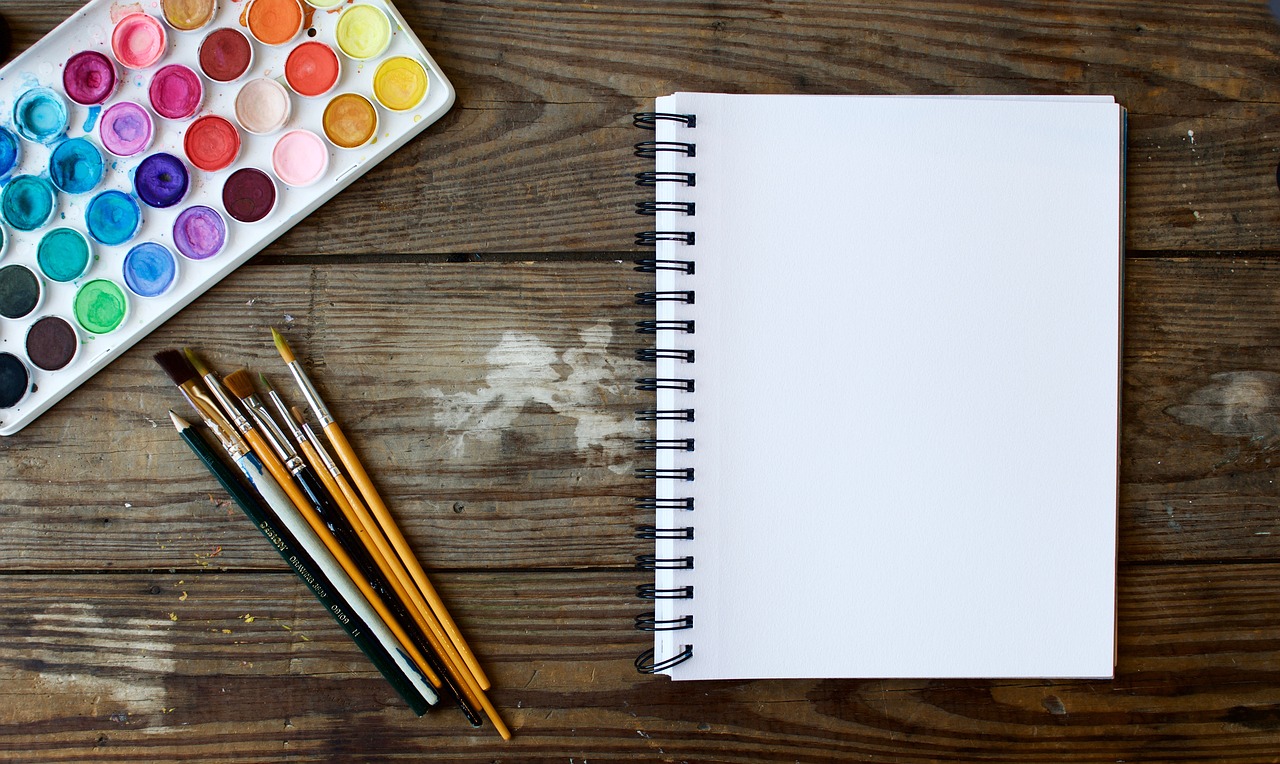
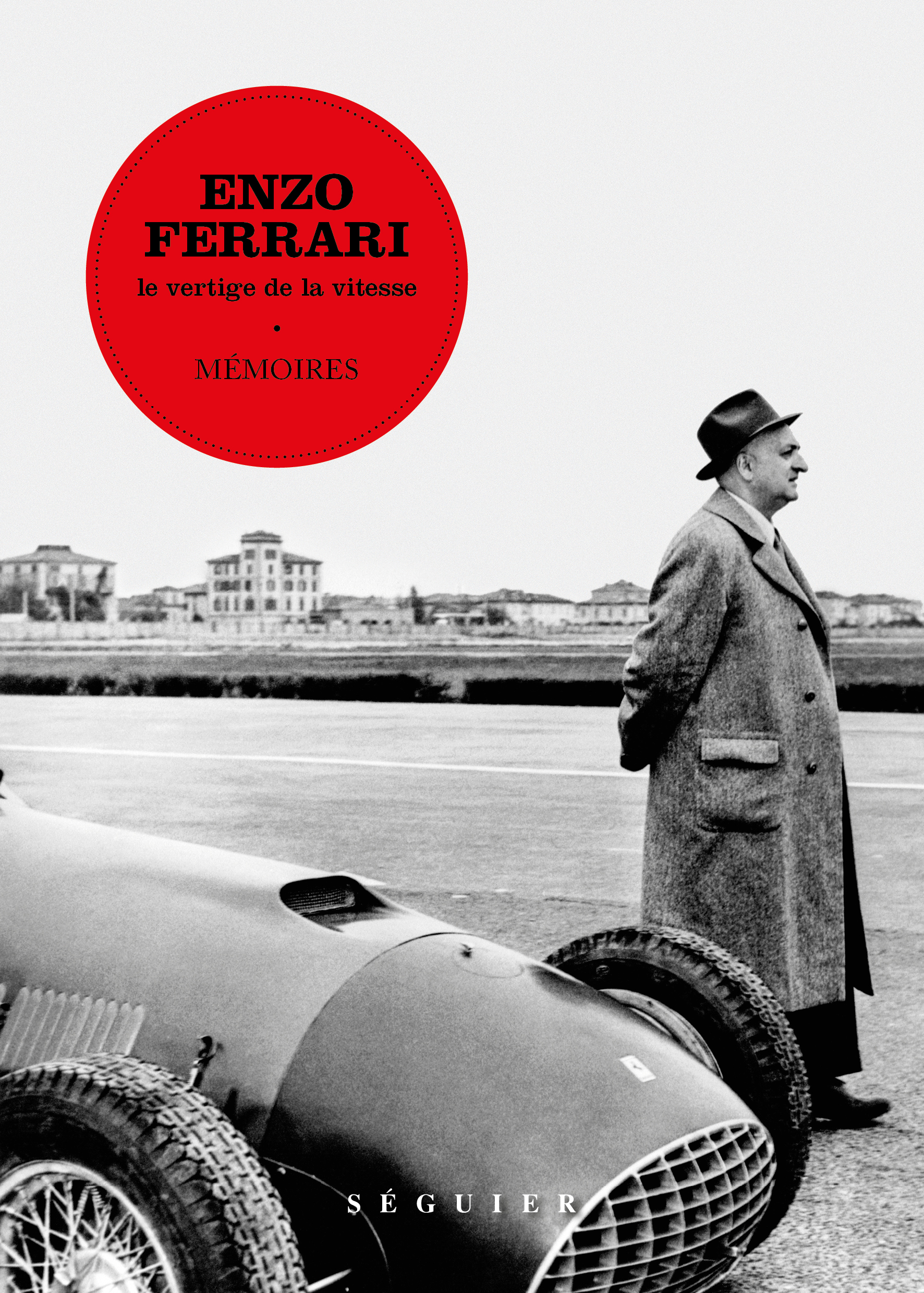
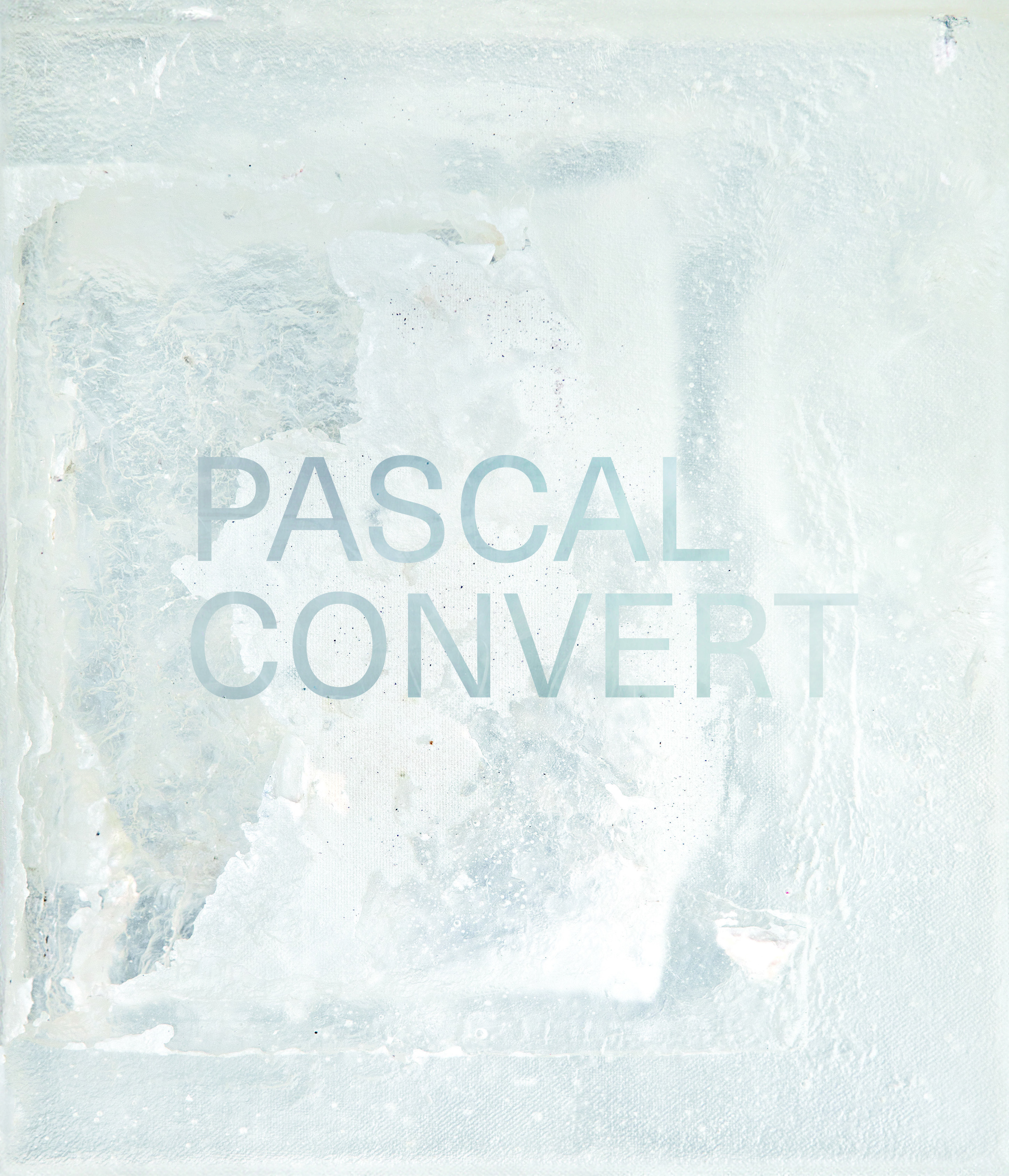
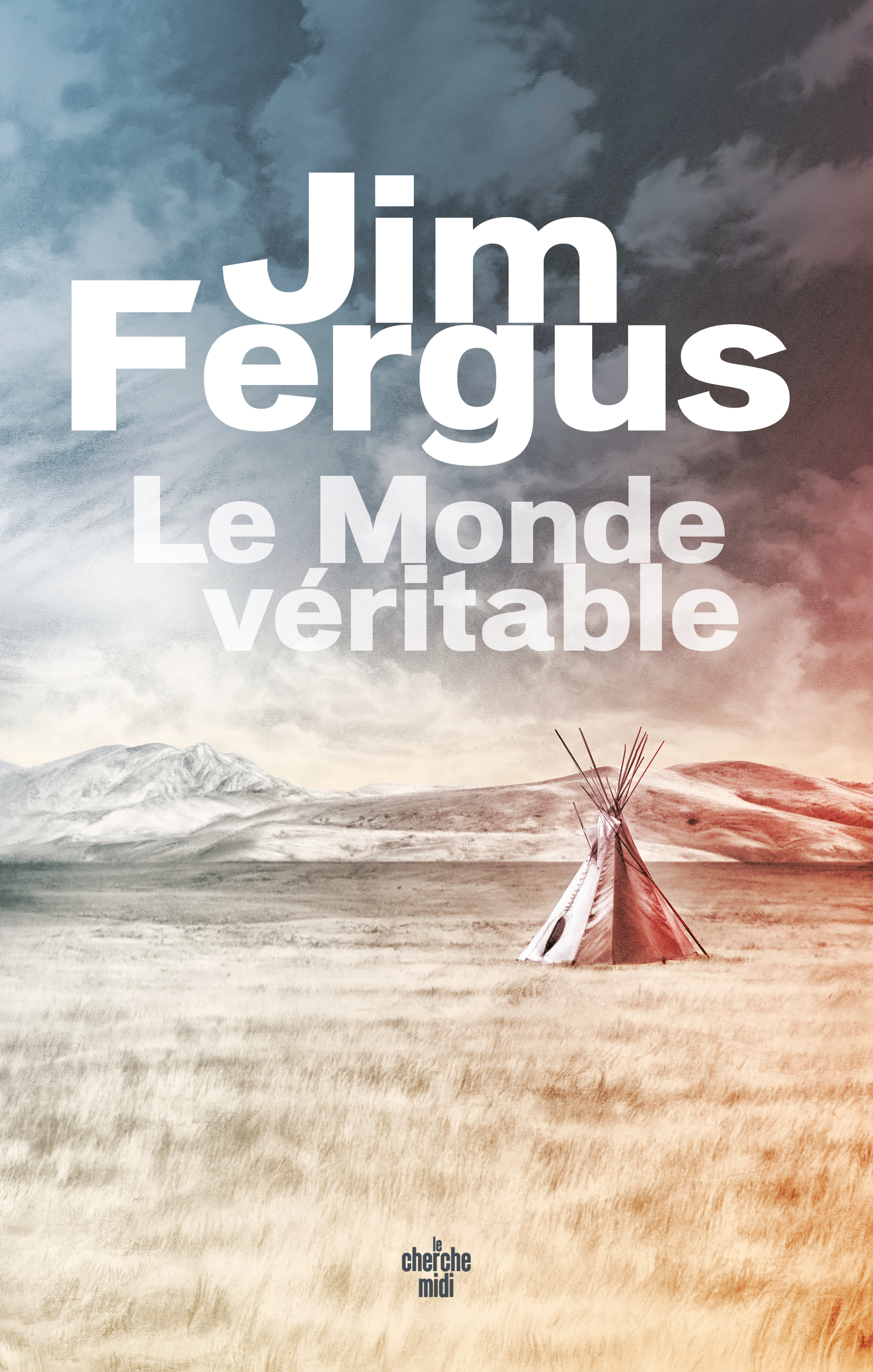
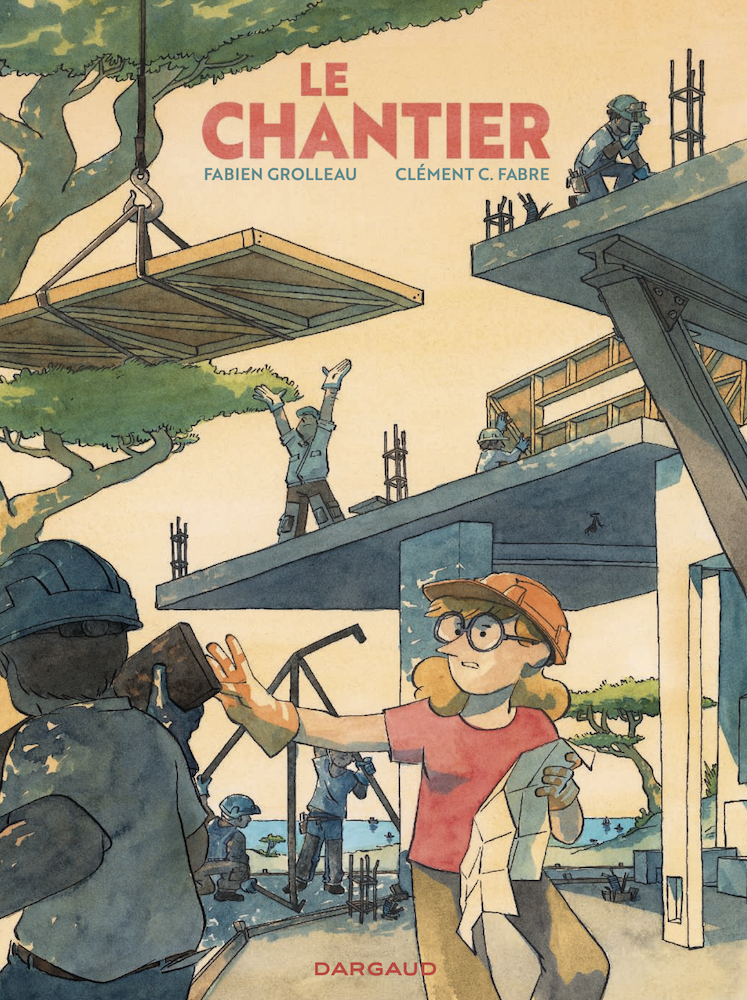
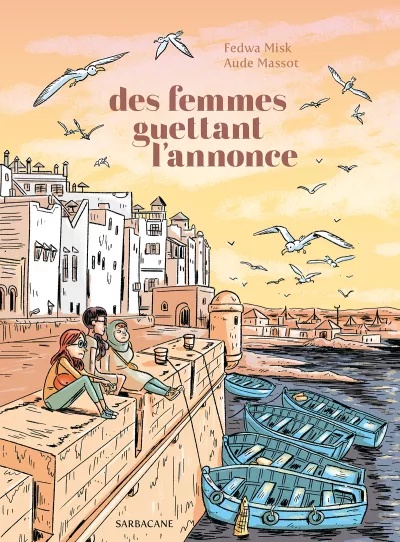

2 Commentaires
Christine Belcikowski
19/12/2018 à 06:09
L'écriture d'Émile Mâle est magnifique, pleine d'âme ; celle d'Antoine Cardinale, aussi.
Antoine Cardinale
19/12/2018 à 17:01
Merci Madame de cet éloge qui dépasse mon mérite ! Il n'a pas échappé à votre lecture, aussi attentive qu'indulgente, que le passage sur Sainte-Sabine, qu'une erreur de police -maintenant réparée- semblait donner à Emile Mâle, devait être plus modestement rendu à l'auteur de ces lignes !