L'édition scolaire, un secteur concentré par nécessité ?
Le 28/02/2019 à 09:20 par Auteur invité
1 Réactions | 9 Partages
Publié le :
28/02/2019 à 09:20
1
Commentaires
9
Partages

Le livre constitue un marché imprévisible aux chiffres de ventes fluctuants, que les éditeurs s’efforcent d’anticiper mais qu’ils ne peuvent néanmoins pas contrôler. Il est en revanche un secteur qui se met en branle tous les trois ou quatre ans, poussé par la certitude de vendre : le scolaire. Ce sont les annonces de réformes des programmes qui engendrent ces pics de productivité aussi soudains que phénoménaux, en imposant le renouvellement des manuels utilisés en cours.
Ces périodes de réformes sont particulièrement tendues en termes de production éditoriale, puisque l’éditeur se doit de respecter un calendrier très serré : il faut envoyer les spécimens (manuels réservés aux enseignants) dans les établissements scolaires dès avril-mai, sous peine de ne pas être « vu » en même temps que la concurrence par les professeurs, et donc pas acheté. La production, qui s’étale en moyenne sur un an, doit donc être lancée au plus tôt en dépit du risque de démarrer à l’aveugle si les textes officiels tardent à sortir, comme ce fut le cas cette année.
Un secteur lucratif
Cette anticipation extrême est due à la particularité du modèle économique du scolaire, qui le différencie tant des autres secteurs éditoriaux : au lieu de ne viser qu’un seul public, à la fois acheteur et utilisateur, les livres scolaires s’adressent à trois types de cibles. En effet, s’ils sont destinés à être utilisés par les élèves et les professeurs (ce qui en fait déjà un double lectorat), ils sont choisis collectivement au sein des établissements par l’ensemble des professeurs de chaque matière, qui doivent donc se mettre d’accord ensemble dans une logique de consensus.
S’ajoute le facteur économique, pour lequel intervient un troisième acteur : en effet, c’est l’État qui finance l’achat des manuels scolaires. Les départements gèrent les collèges tandis que les régions se chargent des lycées — du moins pour le moment, la question de la gratuité des manuels scolaires revenant régulièrement sur la table et restant cette année encore en suspens. Ce système de subvention permet aux éditeurs de vendre leurs livres à un prix moyen compris entre 18 € et 24 €. Multipliés par les 5 629 750 collégiens et lycéens français, l’on comprend vite la rentabilité potentielle du secteur pour les éditeurs scolaires (voir Éducation nationale).
Ce modèle économique explique en partie que le scolaire représente entre 12 % et 16 % du CA global de l’édition, indique le SNE, (L’Édition en perspective, rapports d’activité publiés entre 2011 et 2018). Cela en fait l’un des secteurs les plus lucratifs, surtout en années de réformes puisqu’elles engendrent des augmentations significatives du CA (+4 % en moyenne en 2011 et 2016, années des deux dernières réformes). Les modifications des programmes sont donc cruciales pour les éditeurs — et font par ailleurs grimper le chiffre d’affaires global de l’édition française.
En témoignent les analyses de Lagardère Publishing (Hachette Éducation) indiquant que la France constituait une « contribution essentielle à la performance » du groupe en 2017, avec une augmentation de 3,4 % de son CA, grâce au rôle joué par Hachette et Hatier notamment en cette deuxième année de réforme du collège. À l’inverse, l’absence de réforme en 2018 est explicitement identifiée comme la cause principale du « léger repli de l’activité» du groupe détenteur de Hachette et Hatier.
Peu d’acteurs pour un si gros gâteau
Alors, qui rafle le pactole ? On l’a vu, Hachette est de la partie, mais le 1er groupe éditorial français n’est pas seul.
Si depuis les lois Ferry de 1880 les manuels scolaires ont beaucoup changé, c’est moins le cas de leurs concepteurs… Pour preuve, les six plus gros acteurs du marché aujourd’hui sont pour certains présents depuis l’instauration de l’école obligatoire : Belin et Hachette se sont lancés sur le marché dès la première moitié du XIXe siècle, Hatier en 1880 et Nathan en 1881. Magnard et Bordas les ont rejoints respectivement en 1936 et 1946.
Ces six maisons — Hachette Éducation, Hatier, Nathan, Bordas, Magnard et Belin — se partagent donc à elles seules et depuis un siècle et demi la majorité du CA du scolaire, indiquent Corinne Abensour Frédéric Gomariz dans L’Édition d’éducation face aux défis du numérique. (Cercle de la libraire, 2018). En outre, leur appartenance aux groupes d’édition parmi les plus conséquents du paysage éditorial français accentue cette concentration. Hachette et Hatier appartiennent à Hachette Livre, Nathan et Bordas cohabitent dans les locaux d’Editis, Albin Michel détient Magnard, et Belin appartient à Humensis.
Des leaders bien installés
La permanence de ces géants du scolaire et la difficulté que représente l’entrée sur le marché pour d’autres maisons s’expliquent par plusieurs facteurs.
En premier lieu, l’aspect historique de ces six acteurs leur confère une sorte de légitimité sur laquelle ils n’hésitent pas à jouer : chacun rappelle sur son site l’expertise dont il bénéficie dans la conception de livres scolaires. Impossible de jouer cette carte pour un nouvel entrant sur le marché. Un autre paramètre déterminant et fortement lié au facteur historique est l’aspect financier. Le coût de fabrication d’un manuel est particulièrement élevé, en raison de la complexité de sa réalisation éditoriale. Il faut donc pouvoir anticiper ces coûts avant d’espérer profiter de la forte rentabilité des manuels produits.
Sur ce front, les phénomènes de fusions et d’acquisitions participent à élever la force de frappe des éditeurs déjà installés. Citons par exemple la nouvelle entité Humensis, née de l’union des PUF avec Belin en 2016, qui s’est suivie de la spectaculaire performance de ce dernier à l’occasion de la réforme du collège de 2016. L’éditeur scolaire s’était en effet hissé sur la 2e marche du podium des ventes cette année-là. Dans cette même logique d’union des forces, citons le regroupement des Éditeurs d’Éducation, association créée en 1985 par (les historiques) Belin, Bordas, Hachette, Hatier, Magnard et Nathan et qui a pour but de défendre les intérêts communs de ses membres.
La réforme, une brèche ouverte pour de nouveaux entrants ?
Il faut cependant relativiser l’apparente inévitable concentration du scolaire qui fait loi depuis si longtemps, en tenant compte de certains enseignements tirés de la dernière réforme du collège. La rentrée 2016 a vu l’émergence de nouveaux acteurs qui, s’ils sont encore loin de détrôner les big six, n’en sont pas moins menaçants. L’on peut citer Le Livre Scolaire par exemple, dont Les Échos rappellent que l’innovante « philosophie collaborative » — dans la mesure où un collectif d’enseignants en est à l’initiative — a su profiter de 2016 pour mettre « un million de manuels interactifs en circulation dans 1500 collèges ».
Notons que si un tel renouvellement du paysage éditorial est envisageable pour le secondaire, un autre sous-secteur majeur du scolaire ne jouit pas des mêmes perspectives et pâtit d’une concentration tout aussi (voire plus) forte : dans le petit monde des presses universitaires, la concentration est telle que seules les PUF détiennent le monopole. Par souci d’exhaustivité, il faut ajouter que la petite enfance (maternelle et primaire), troisième catégorie du scolaire dit « de prescription », relève encore d’un schéma différent.
Quoi qu’il en soit et concernant le secondaire, la rentrée 2019 nous dira si les « petits qui montent » évoqués plus haut sauront profiter de l’ouverture du marché occasionnée par la réforme du baccalauréat pour tenter de s’imposer aux côtés des grands.
Article réalisé et publié dans le cadre des travaux menés avec les élèves du Master 1 Apprentissage de l’université de Villetaneuse — Paris 13, spécialité Commercialisation du livre. Les étudiants sont invités à écrire sur un sujet lié au monde de l'édition, suivant des consignes de rédaction journalistique.

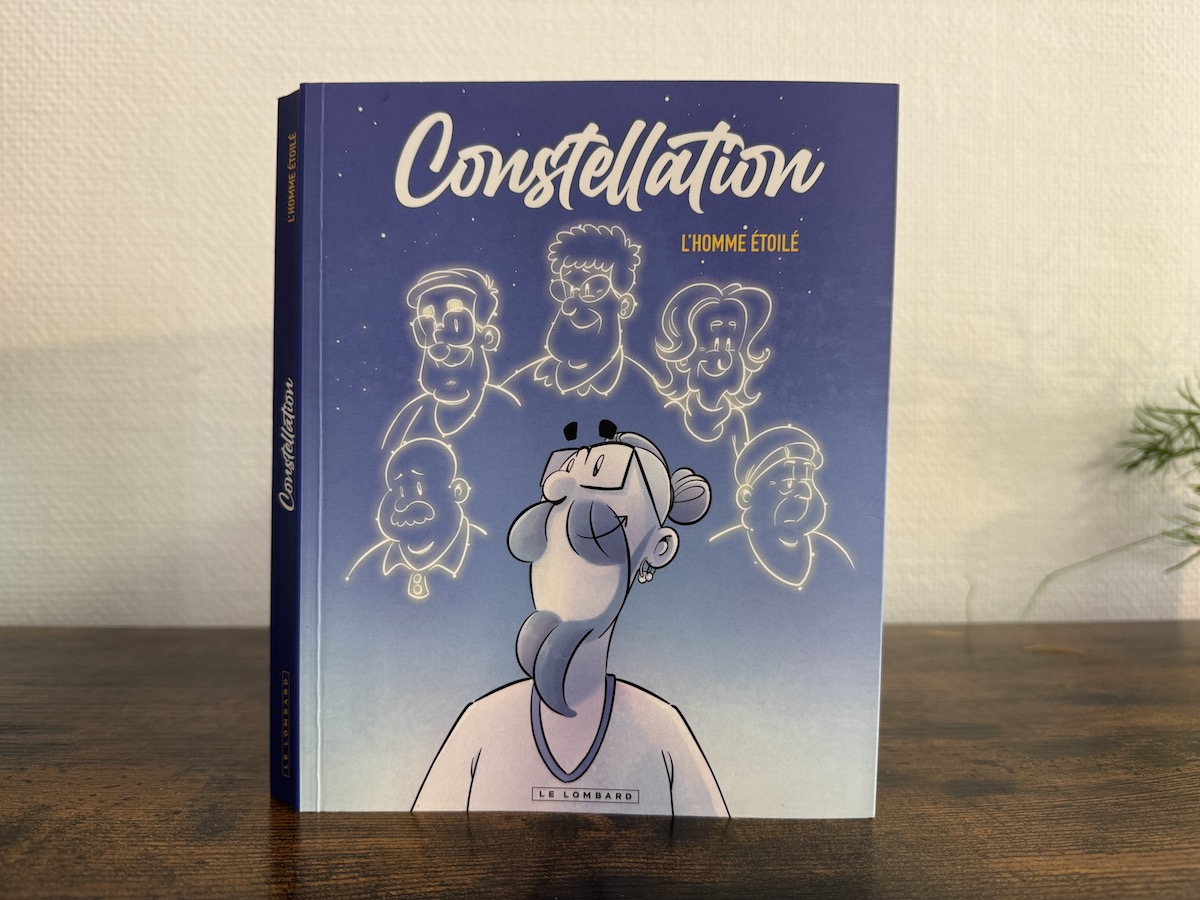
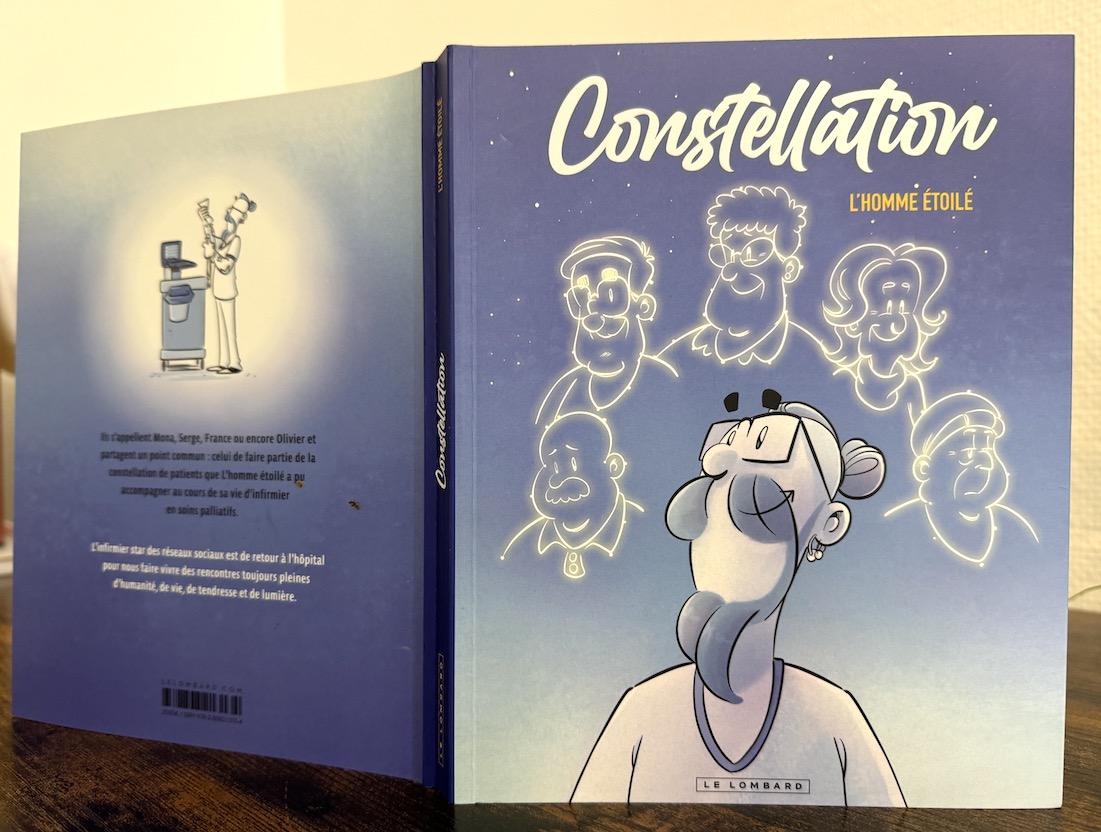



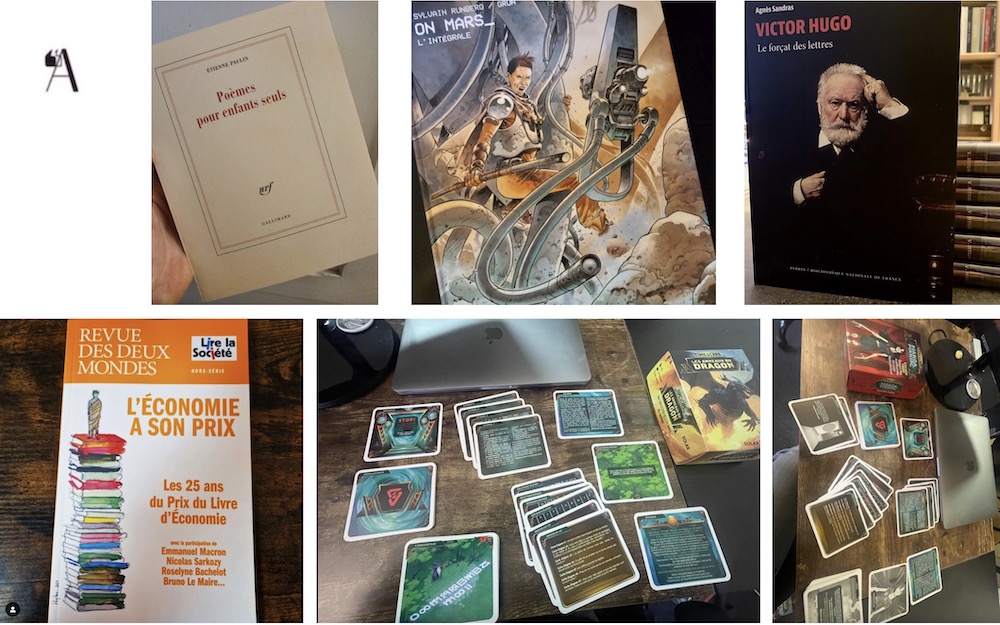







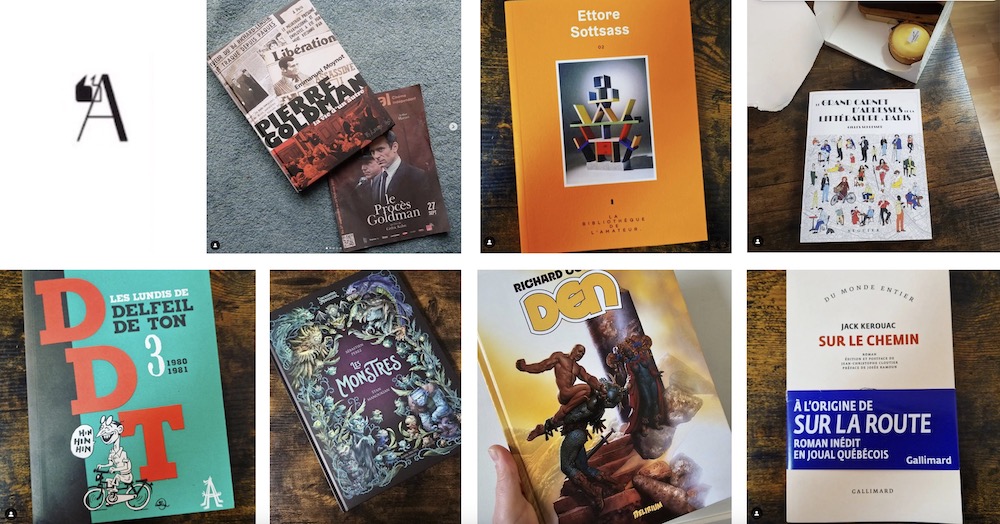




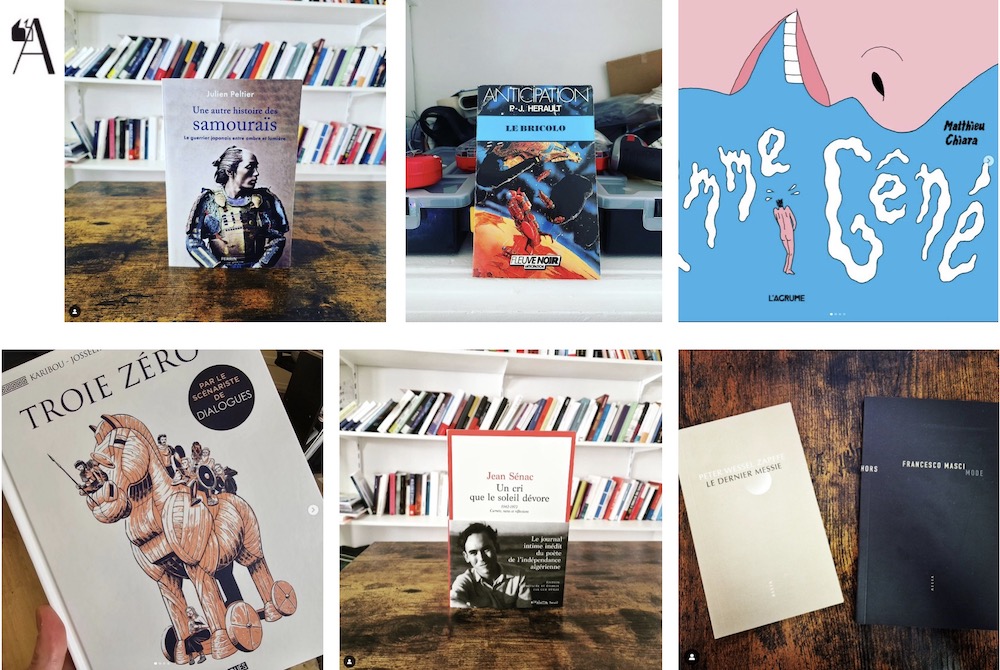
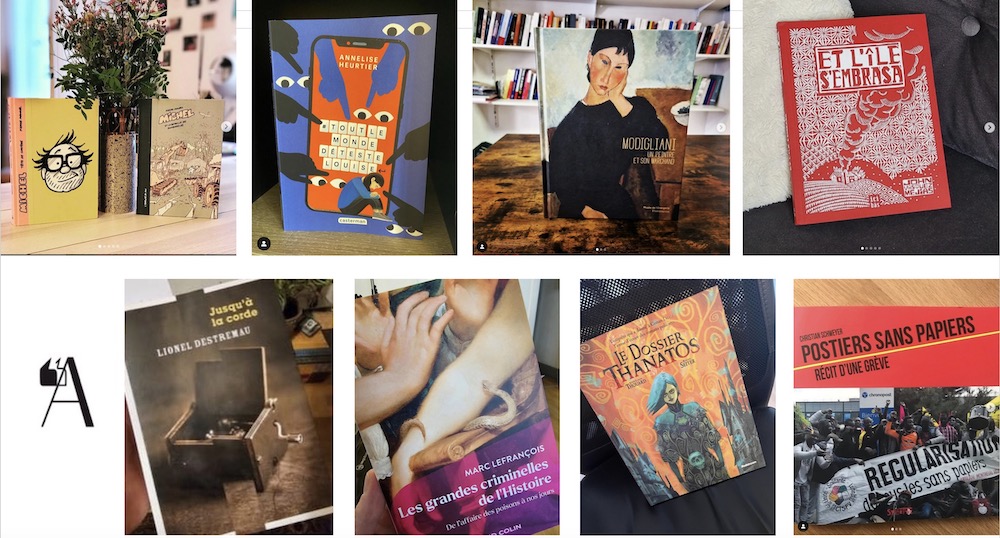



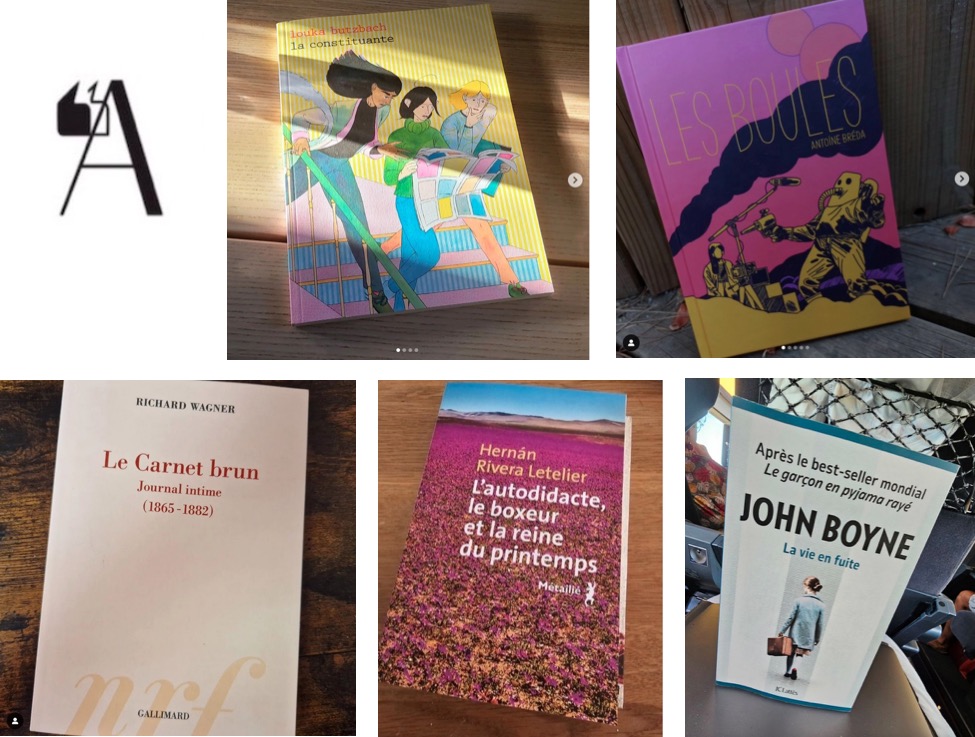
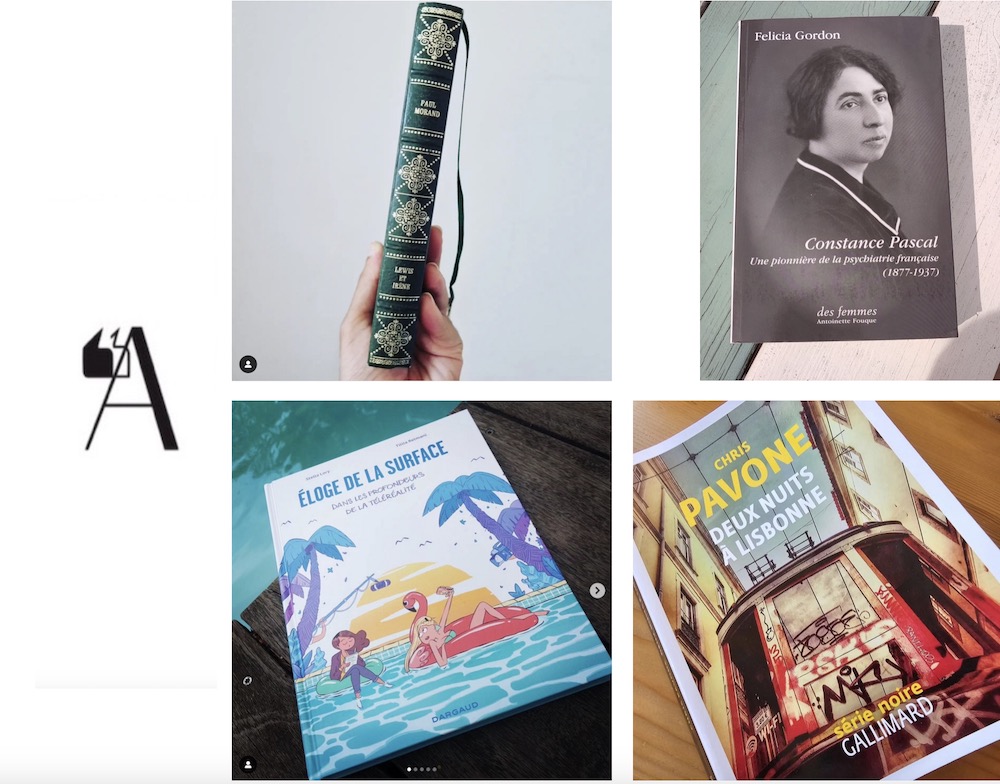
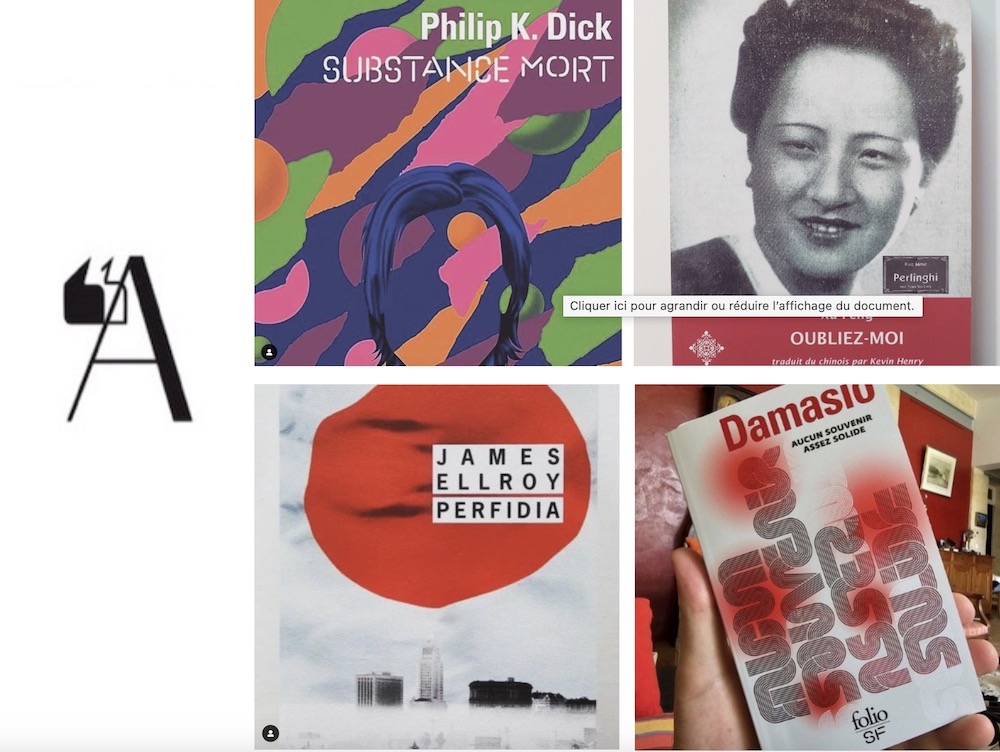

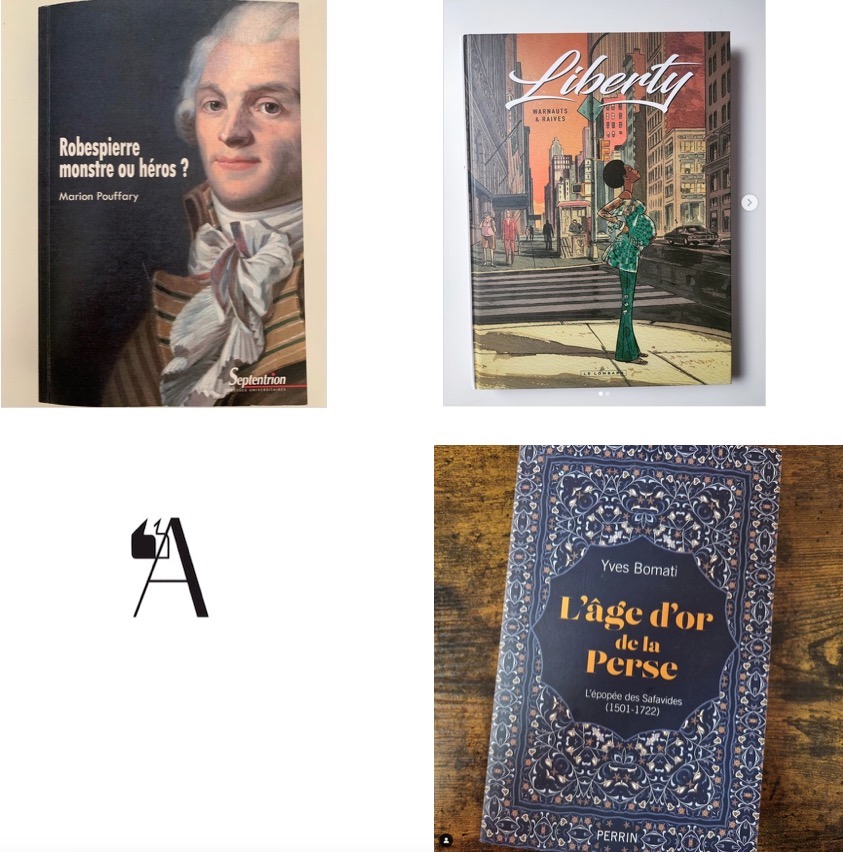













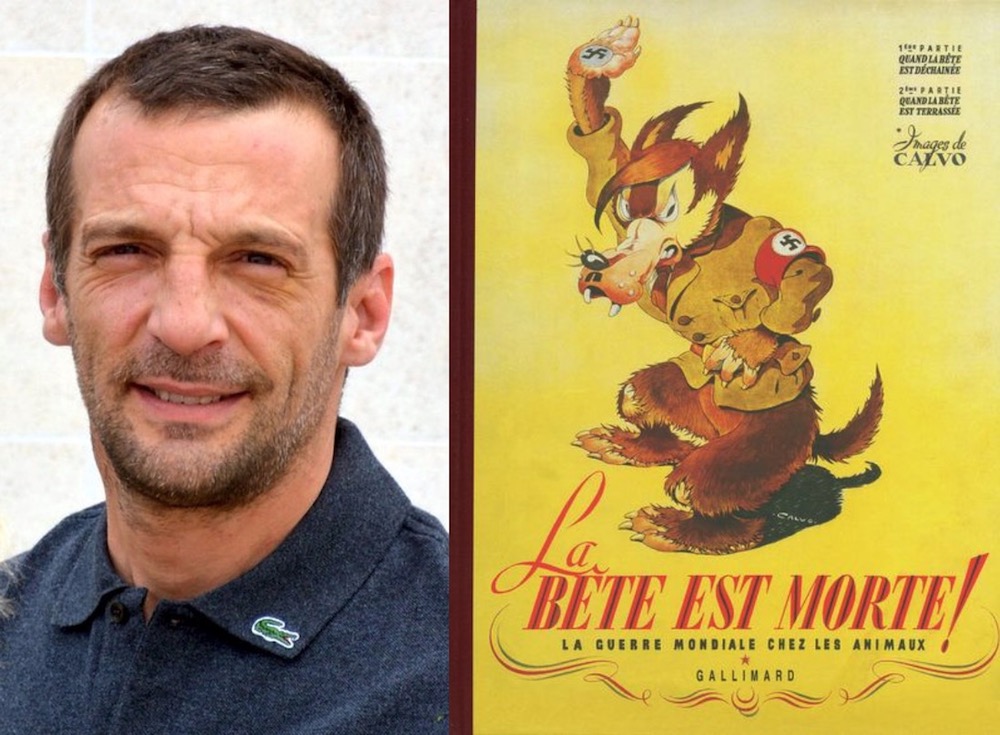




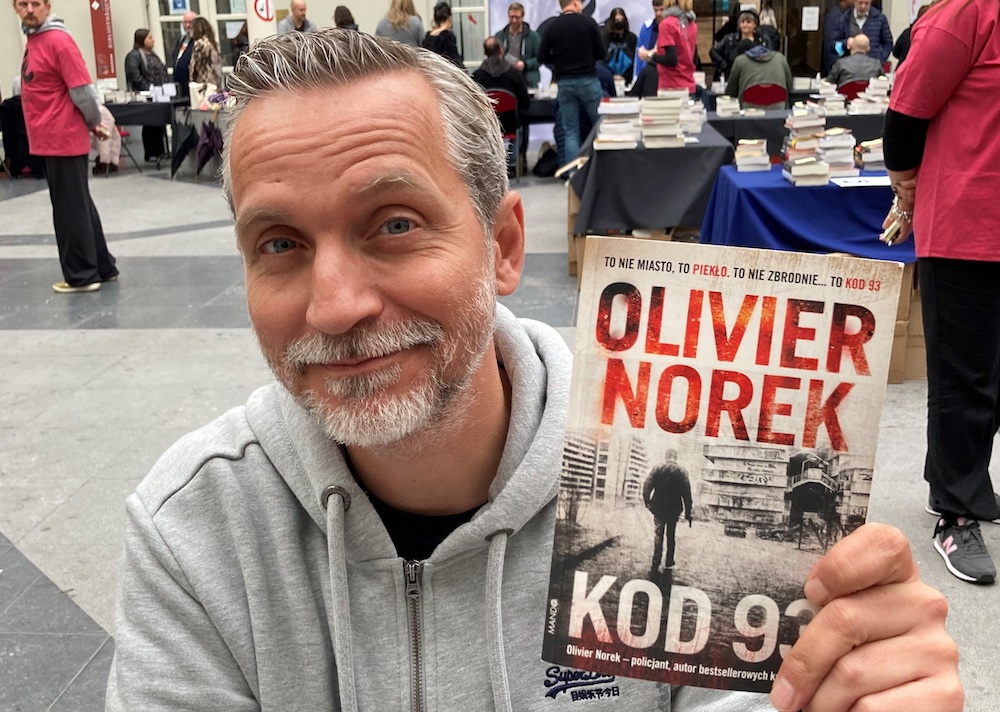
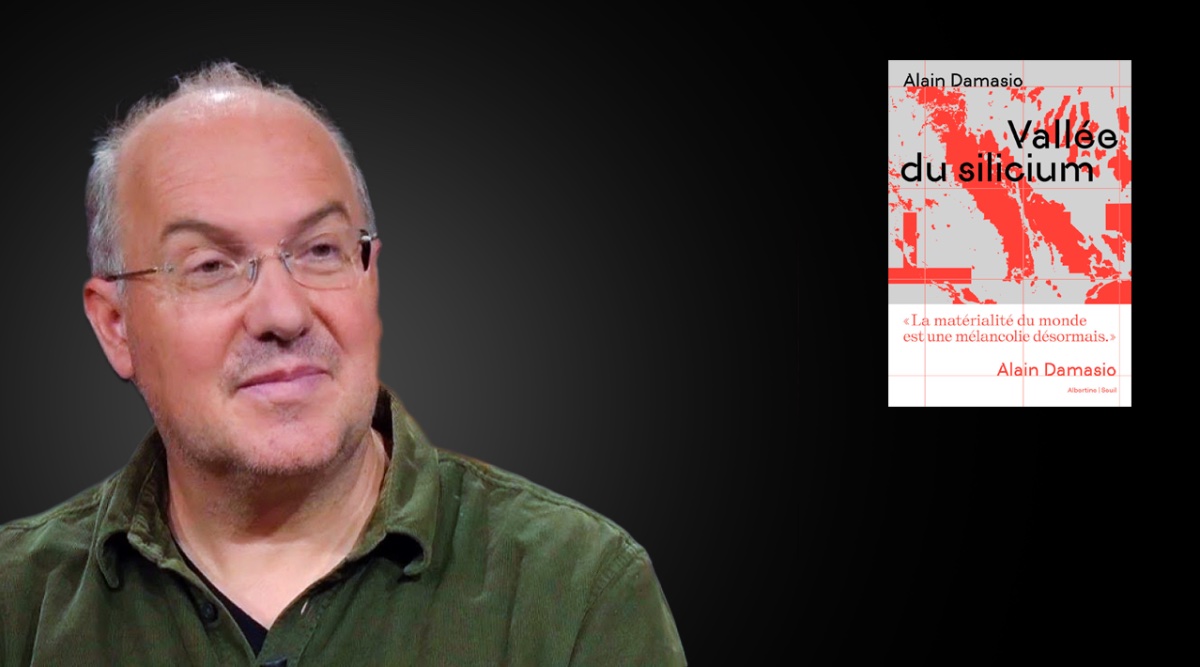





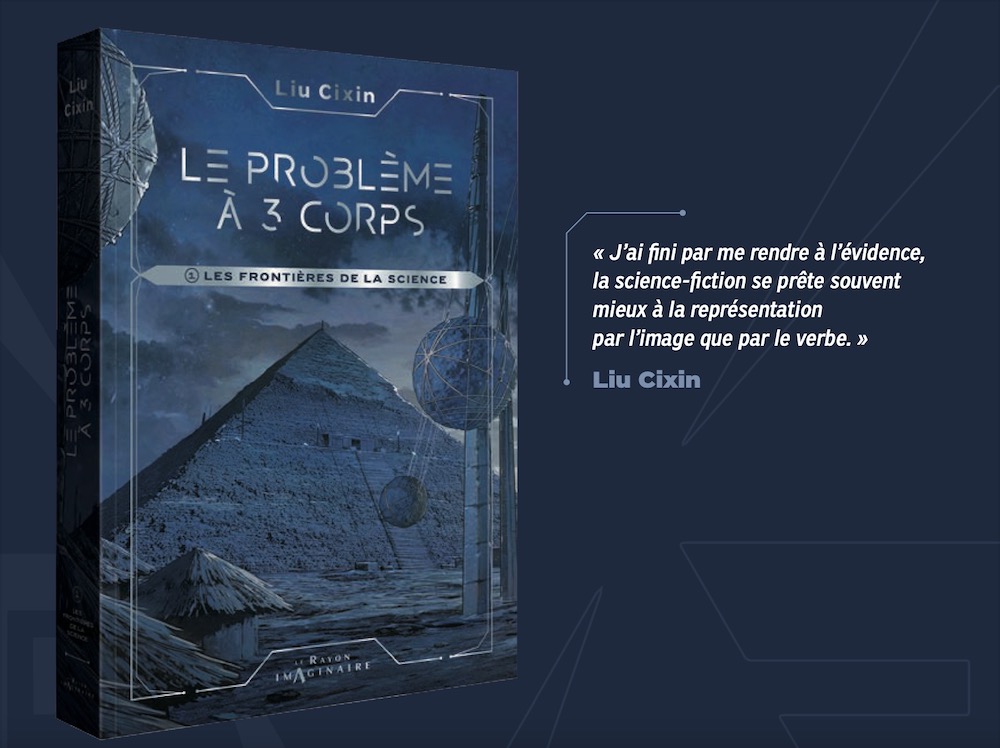





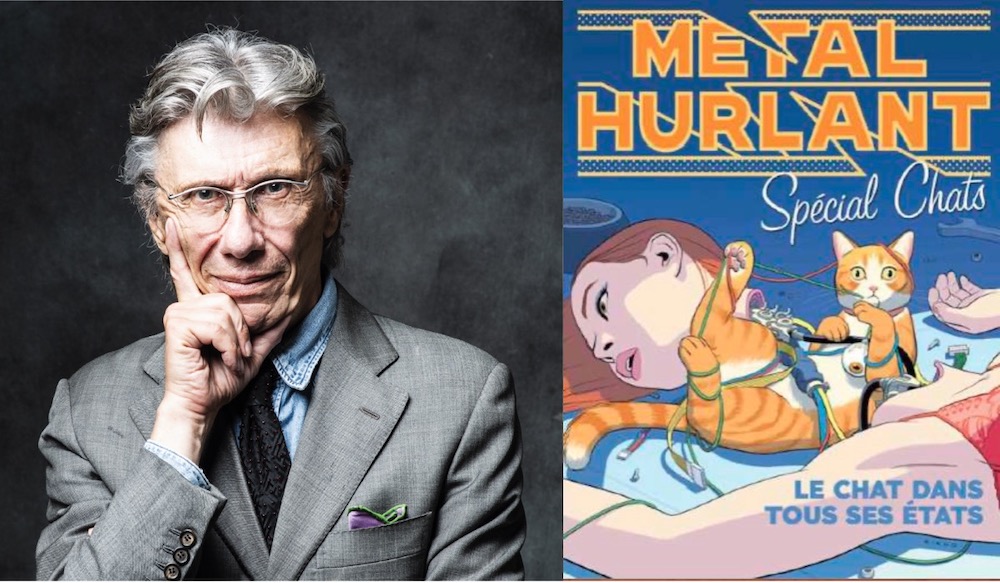






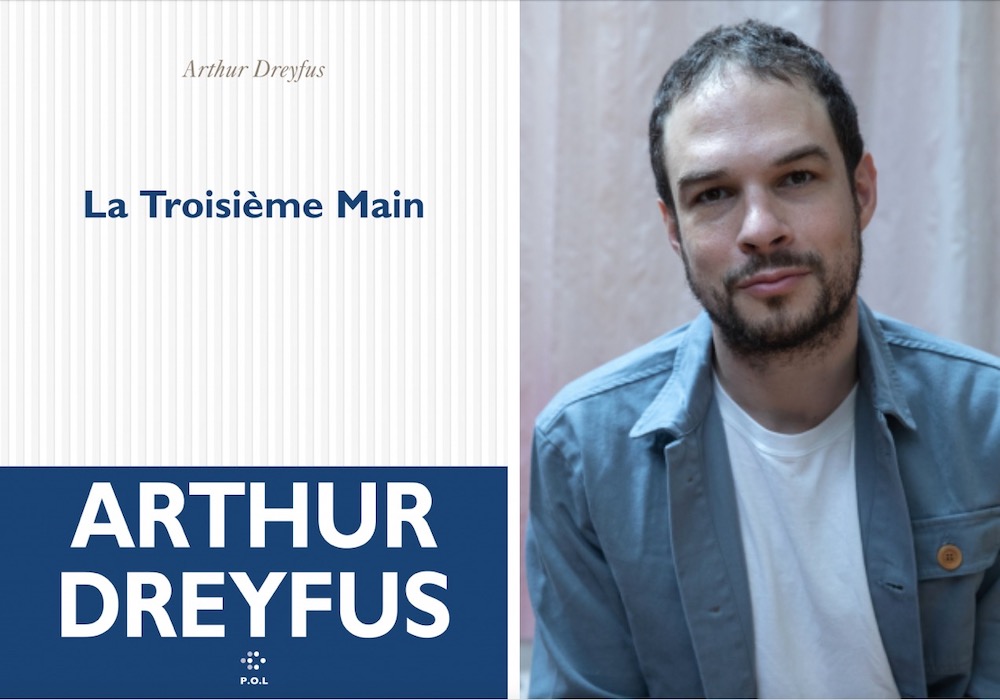




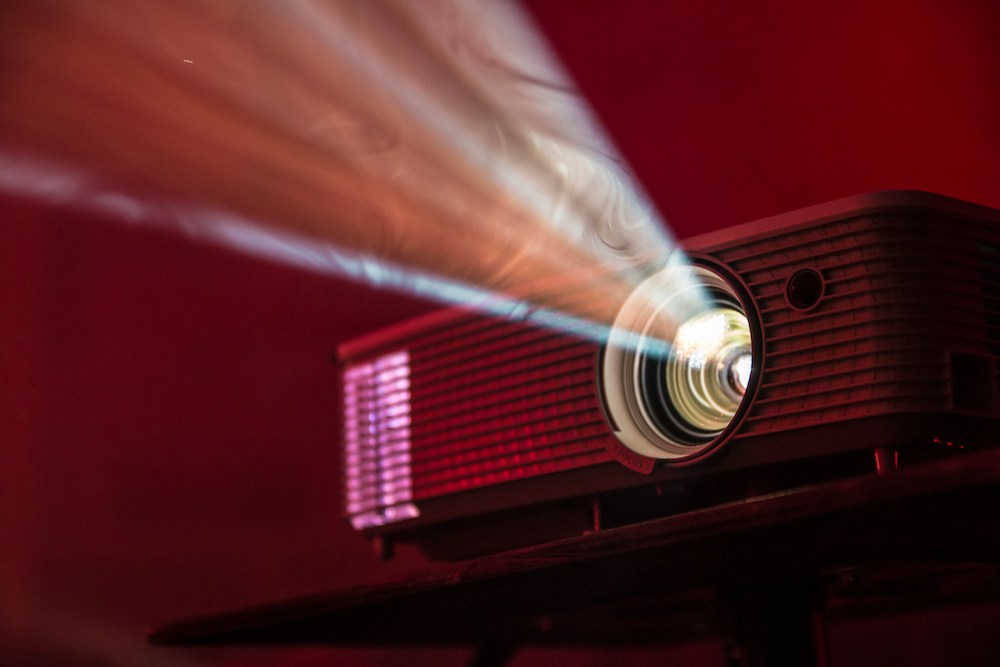

1 Commentaire
Angèle
12/03/2019 à 14:24
Merci pour cet article très complet et détaillé ! C'est un secteur d'activité très particulier, parfois difficile à comprendre de l'extérieur et il est vrai qu'avec des acteurs pur web on peut voir une disruption du marché.