Les Ensablés - Le Greco (1931) de Camille Mauclair (1/2)
En 1905, Camille Mauclair (1872-1945), sentit qu’avec le fauvisme et le début du cubisme en 1905, apparaissait un nouveau paradigme, auquel il était incapable en tant que critique de donner une réponse. Et cette incapacité signa la rupture de Mauclair avec l’art moderne. En 1931, il écrira un ouvrage critique sur le Greco, dont l’originalité le confrontera à nouveau au problème de la rupture de la tradition dans l’art pictural. Cet article paraît en deux parties. La seconde est programmée pour la semaine prochaine. Par Antoine Cardinale
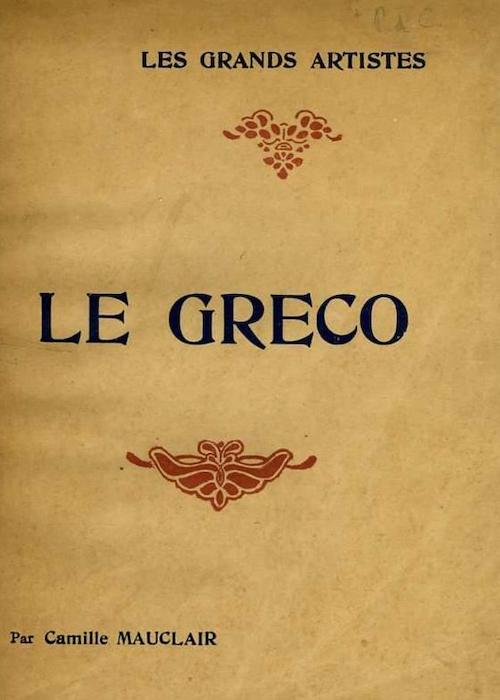
Le Grec
Dominikos Theotokopoulos dit Il Greco, ou El Greco, naît à Candie en 1541. La Crète est encore une possession vénitienne et il est bien naturel qu’un peintre ayant achevé sa formation, ayant pris la mesure de ses talents et de son ambition, sentant ses forces, se décide à partir pour Venise en 1568.
Celui qu’on nomme par facilité le Grec, il Greco, son patronyme étant imprononçable, essaya-t-il d’entrer dans les botteghe prestigieuses du Tintoret et du Véronèse, qui se disputent alors les grandes commandes ? Cela se peut. On sait en revanche avec certitude qu’il travailla dans l’atelier des Bassano. Seul Titien a pu éclipser les créations de Jacopo da Ponte, dit il Bassano, qui fonda avec ses deux fils une dynastie dont l’énorme production meuble aujourd’hui encore les musées italiens. Court séjour, suivi d’un bref passage dans l’atelier du Titien, dont les bénéfices n’apparaîtront pas dans son œuvre : le coloris velouté, la lumière qui dore les frondaisons, la sensualité du dessin : on voudrait pouvoir identifier tout cela dans l’œuvre du Greco mais l’honnêteté commande de dire que tout chez lui au contraire dément cet héritage.
On le retrouve en 1570 à Rome, hôte du cardinal Farnese et protégé de Fulvio Orsini, un des derniers parmi les grands écrivains humanistes. Pensionnaire au palazzo Farnese, ce qui suppose de fortes recommandations, il semble en avoir été littéralement chassé sans que les raisons apparaissent très clairement. Il semble qu’il critiqua trop violemment les fresques de Michel-Ange à la Sixtine, qu’il se fit fort de surpasser, et qu’il insista trop sur l’indécence des figures, ce qui constituait une charge implicite contre la Curie romaine et du milieu des arts à Rome.
Il se montre au naturel dans cet épisode : caractère impulsif, imbu de ses capacités, d’une religion sans concession ni raffinement ; et d’une certaine façon, pour l’historien d’art, l’anecdote signale combien il était étranger, et peut-être inassimilable, à l’esprit de la Renaissance. On connaît sa lettre d’excuses au cardinal Farnese, mais on n’a en revanche pas trace de la réponse. On en a la certitude, il échappe, et c’est heureux pour nous comme pour lui, à la bastonnade.
Où aller en 1572 ? la France va connaître les heures les plus sombres de la guerre de religion ; l’Angleterre n’est plus catholique et elle n’est pas encore un centre artistique ; les Allemagnes ne sont pas sûres ; reste l’Espagne, qui est dans son Siècle d’Or.
Son roi, Philippe II, fils de Charles-Quint est un ascète, passionné par le gouvernement de son royaume, et un chrétien sans concession qui tient le Grand Inquisiteur pour son meilleur ami. Il n’y a pas cent ans que Isabelle et Ferdinand ont arraché aux Arabes les derniers arpents de la péninsule et déjà Philippe, après la reine Jeanne, après Charles-Quint, règne sur l’Espagne entière, le Portugal, sur Naples et la Sicile ; il est duc de Milan et archiduc d’Autriche, prince souverain des Pays-Bas, maître des Philippines qu’on nomme en son honneur, maître des présides d’Afrique du Nord, seigneur des Amériques, qu’on rebaptise en toute simplicité la Nouvelle-Espagne, et roi de Jérusalem pour faire bonne mesure. La moitié du monde lui obéit et il faut que Dieu le regarde comme son lieutenant sur Terre. La Vraie foi règne sur ses terres et en contrepartie Dieu le comble de toute les richesses du Potosi, du Pérou et des Florides.
A chaque époque ses idées fixes. Le XVIIIème eut, pour simplifier, la morale et la nature ; le XXème en cultiva d’inquiétantes et en quantité étourdissante. Le Siècle d’Or espagnol n’en eut que deux : Dieu et le Roi. El Greco servira le second avec infiniment de crainte et de respect, et le premier avec une large dose de folie hallucinée : Dieu premier servi, tout sur terre appartenant aux princes, hors les âmes.
Sa première commande royale, Le martyre de saint Maurice, connaît un succès relatif. Il s’acclimate cependant : Il Greco devient El Greco. Quelques années s’écoulent avant qu’il reçoive enfin en 1586 la commande qui allait lui donner sa place dans l’histoire de la peinture. Le conseil de l’église Santo Tome à Tolède lui passe commande d’un tableau pour le tombeau du comte d’Orgaz : ce sera l’Enterrement du comte d’Orgaz, qui décidera de la fortune et de la gloire du peintre. El Greco ne quittera plus Tolède. Les commandes l’enrichissent, et il devient une figure centrale de peintre et de philosophe dans cette ville de culture et de dévotion, entretenant un orchestre, vivant dans un appartement royal de vingt-quatre pièces et menant en un mot un train somptueux qui ne laissera pas un ducat à sa femme et à son fils lorsqu’il mourut en 1614.
Une esthétique de l’au-delà
L’atmosphère mystique de la très catholique Espagne, l’âpre spiritualité byzantine, la mise en avant par le concile de Trente des expériences surnaturelles de la conversion mystique ; voilà les facteurs qui vont nourrir l’esthétique de ses tableaux.
Et cette esthétique est extraordinaire : dislocation du dessin, brutalité des couleurs, un style qui touche plutôt à l’art des primitifs qu’à celui les écoles de la Renaissance italienne. La perspective est piétinée, les corps s’allongent et se déforment dans un amollissement qu’irradient des jaunes phosphorescents et des rouges carmins ; comme si ces saints, ces apôtres étaient en train de fondre et de se désincarner. Michel-Ange peint des êtres surhumains, le Greco peint des êtres sortant de l’humanité.
C’est une peinture dont on ne sait dire des surprises qu’elle nous réserve s’ils constituent des négligences, des accidents ou des audaces. Son extravagance n’échappa d’ailleurs ni à ses contemporains ni à la postérité critique. Où loger le Greco : est-il le fondateur de la peinture espagnole ou un peintre byzantin mal dégrossi ? Sut-il concevoir un univers visuel unique ou ne fut-il qu’un artiste proche de l’aliénation mentale ? ses anatomies sont-elles géniales ou seulement le fruit d’une déficience visuelle ?
Pour poser le problème : on fait face à une œuvre dont le langage pictural est radicalement nouveau et à un peintre qui capte avec un peu de grossièreté les avantages de la mode. C’est un problème que la vogue d’un Picasso, par exemple, a rendu familier au critique, comme on le voit dans la citation qui suit et dont les allusions sont transparentes.
Le langage pictural du Greco a été créé pour une expression du monde mystique. Le parler, ce langage mystique, pour décrire des guitares, des pommes, des nus grossiers ou des paysages de banlieue, c’est vouloir écrire des romans de bas-naturalisme dans le style de sainte Thérèse… Il a posé en peinture, avec une hardiesse inouïe, mêlée d’inconscience, le problème d’une autre vérité que la vérité apparentielle.
On le voit, seule la vision mystique, seule une dévorante image intérieure tirée de la méditation chrétienne peut rendre légitime, pour Mauclair, le scandale de la forme : Le Greco déforme par une appétence effrénée de la désincarnation, et pour lui le Ciel seul compte
Courbet disait, dans le bon style des bouffeurs de curé, qu’il peindrait des anges quand il en aurait vu : Greco les a vu, et il les a peints.
Camille Mauclair ne romance pas la vie du Greco ; il se garde d’apporter une thèse sensationnelle ; il dit de lui ce que les historiens ont pu documenter. Il commente les tableaux en se rangeant aux attributions officielles, et fait état des conjectures seulement lorsqu’elles sont sérieuses Il cite peu, il craint de passer pour un cuistre. Il lui paraissait peu recommandable de multiplier au-delà du nécessaire les citations et les références savantes. C’est comme laisser l’étiquette et le prix sur un cadeau. Un auteur ne devrait citer, mais la chose n’est pas vérifiable, seulement ce que sa mémoire est en mesure de lui donner au moment d’écrire.
Son livre Le Greco est essentiellement une analyse de l’originalité d’une œuvre, et partant, de la singularité d’un artiste. Comment naît cette originalité, comment se construit cette singularité : et comment est-elle reçue ? Il le fait, on peut le conjecturer, en gardant à l’esprit l’époque des avant-gardes, dans lequel un nouveau Greco apparaît chaque année à Paris : Picasso et Braque, de Chirico, Modigliani, Soutine, Chagall, Mondrian, Duchamp !
En réalité, son étude est l’exploration des chemins critiques, des commandes officielles, des modes, par lesquelles une œuvre déconcertante s’impose, donne le ton, et devient classique.
L’œuvre du Greco subira deux siècles d’un oubli relatif. Du milieu du dix-septième siècle, jusqu’au milieu du dix-neuvième, le Grec et ses tableaux prennent la poussière au Prado, à l’Escurial ou dans les églises de Tolède. Il faut attendre le romantisme. C’est Théophile Gautier, dont on se méprend en le considérant seulement comme un écrivain de second rang, un bon garçon aimant les plaisirs de la table et les bonnes fortunes. Avec la publication de Tra los montes, Voyage en Espagne, en 1843, c’est lui qui ré-installe le Greco comme le peintre fondamental de l’Espagne, avec Velasquez et Goya. Baudelaire en parle, il a vu les tableaux du maître de Tolède qui étaient dans la collection du duc d’Orléans, futur « roi des Français ». Manet, Whistler et Degas eux aussi méditeront l’harmonie pensive de ses blancs, de ses gris et de ses noirs.
Le Greco, en tant que sujet critique, est contemporain de Camille Mauclair. Car il faut attendre 1902 pour voir la grande exposition au Prado de quatre-vingt-quatre tableaux ; 1908 pour avoir en Espagne un ouvrage de référence avec El Greco de Manuel Bartolomeo Cossio ; 1910 pour que Julius Meier-Graefe, marchand de tableaux et critique allemand publie un récit de voyage qui va mettre le maitre de Tolède au centre de l’attention des peintres d’avant-garde. La même année sont publiés les premiers documents d’archives sur le peintre, tandis que Barrès, avec son Greco ou le Secret de Tolède, va passionner le grand public français pour cet étrange peintre. On ne peut que déplorer que la guerre ait interrompu le projet d’Emile Bertaux de donner une monographie sur les arts à Tolède, tant l’article qu’il publia en 1912 sur le Greco, sur son italianisme et son byzantinisme, représentait un début prometteur
Il y avait avant le Greco des peintres espagnols ; il n’y avait pas de peinture espagnole. Avec toute la singularité qui fut la sienne, il créa la forme qui allait recevoir les aspirations spirituelles, les ambitions esthétiques de la civilisation espagnole. De religion grecque au cœur de la surcatholicité espagnole, réputé étranger dans les documents officiels jusqu’en 1600, il devint post mortem le peintre officiel de la très catholique Espagne, dernier Byzantin et l’un des premiers Baroques.
Suite dimanche prochain.

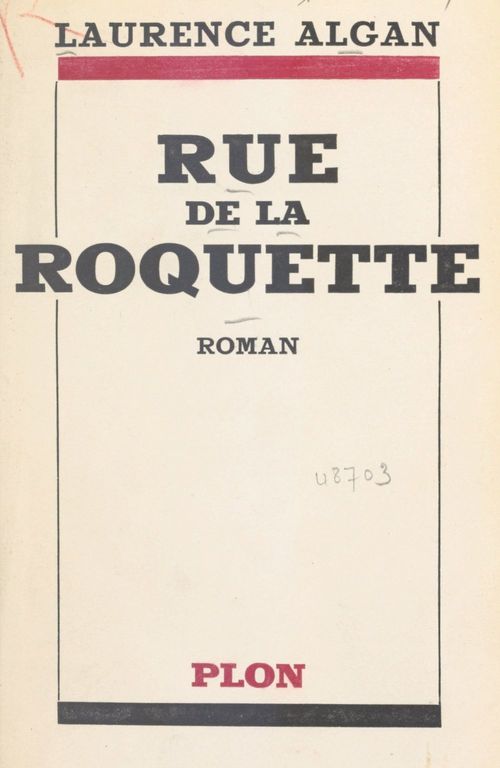
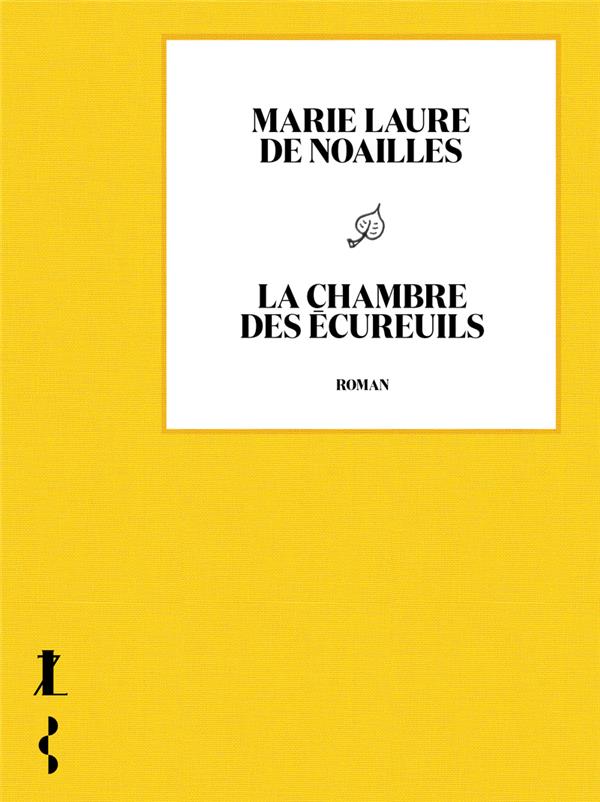
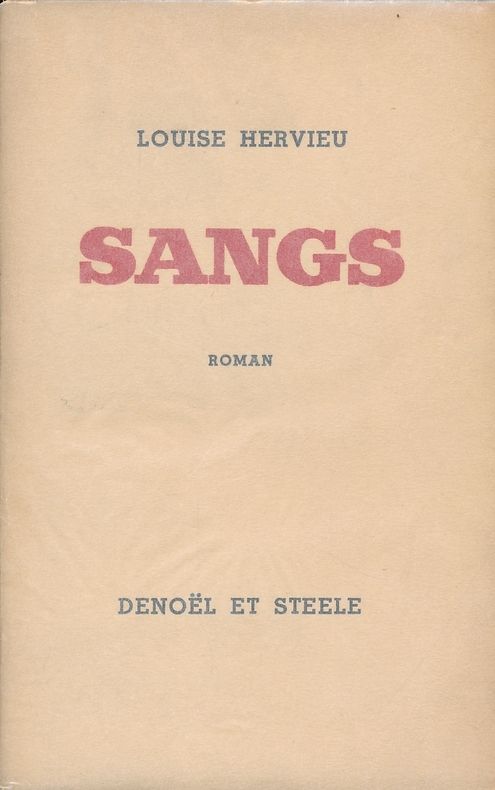
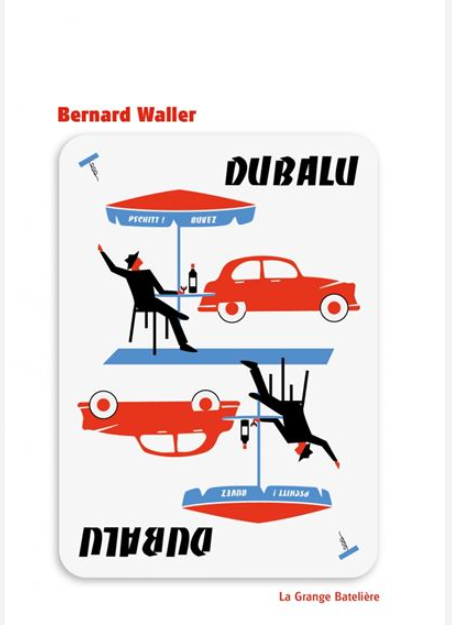
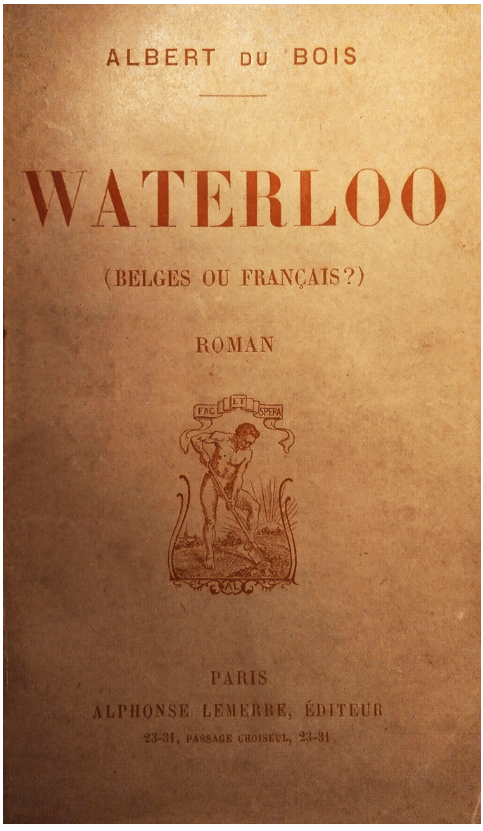

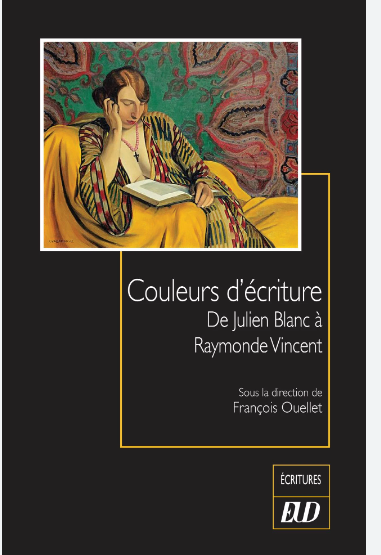
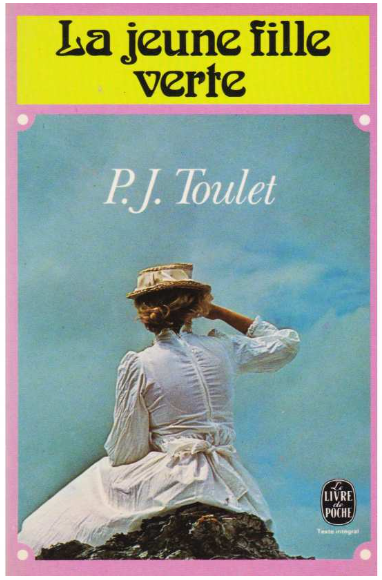
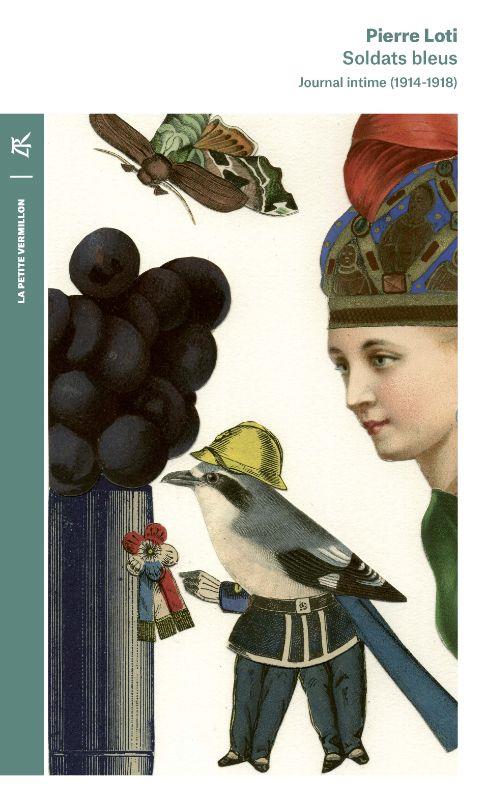
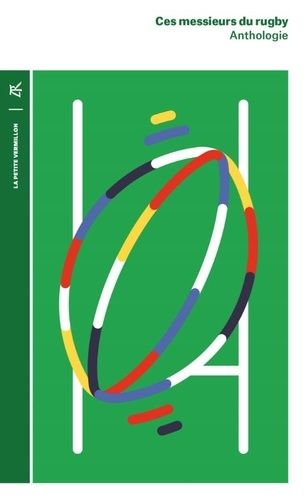
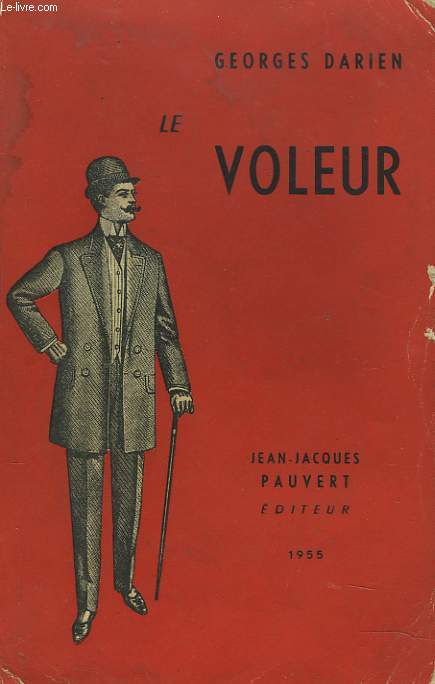
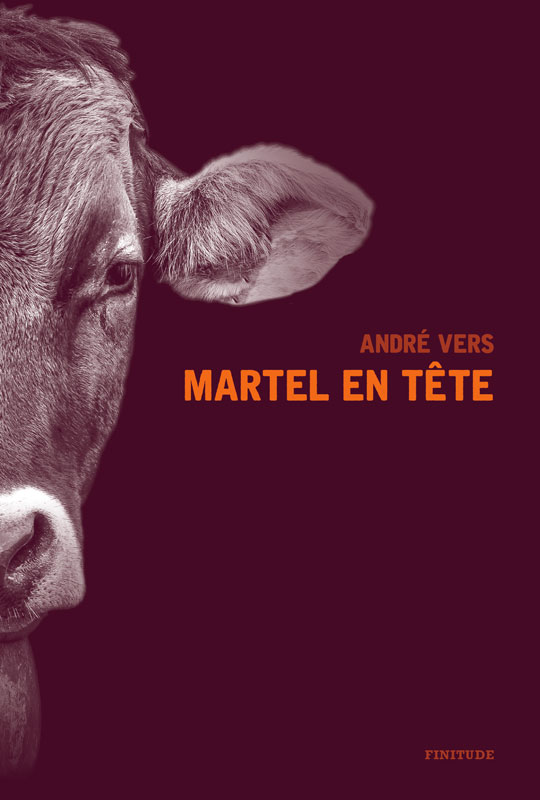

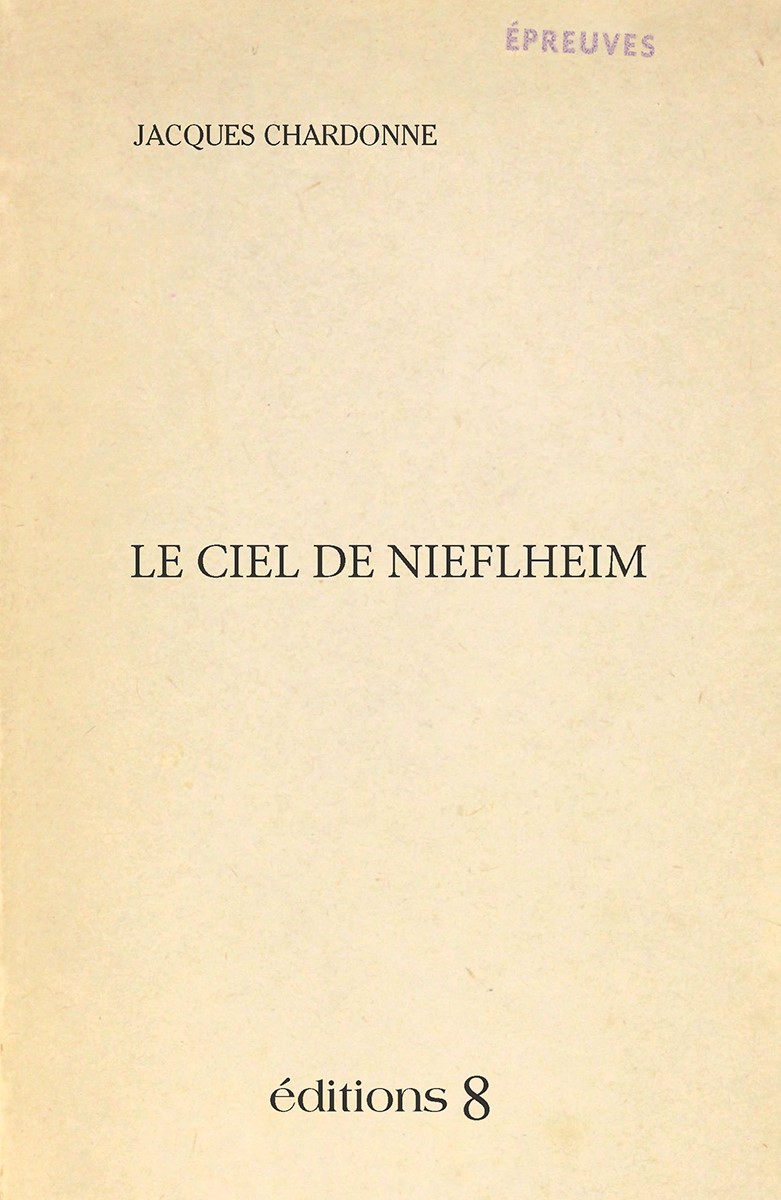
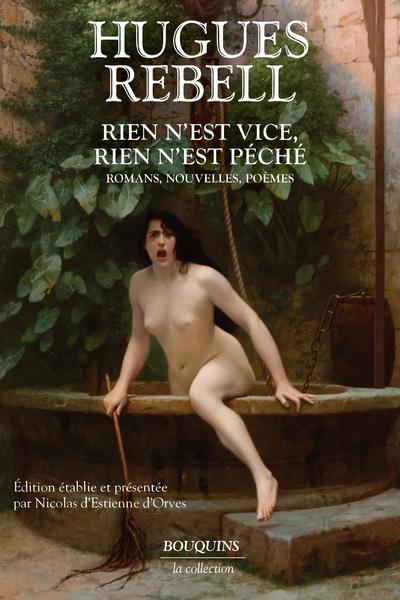
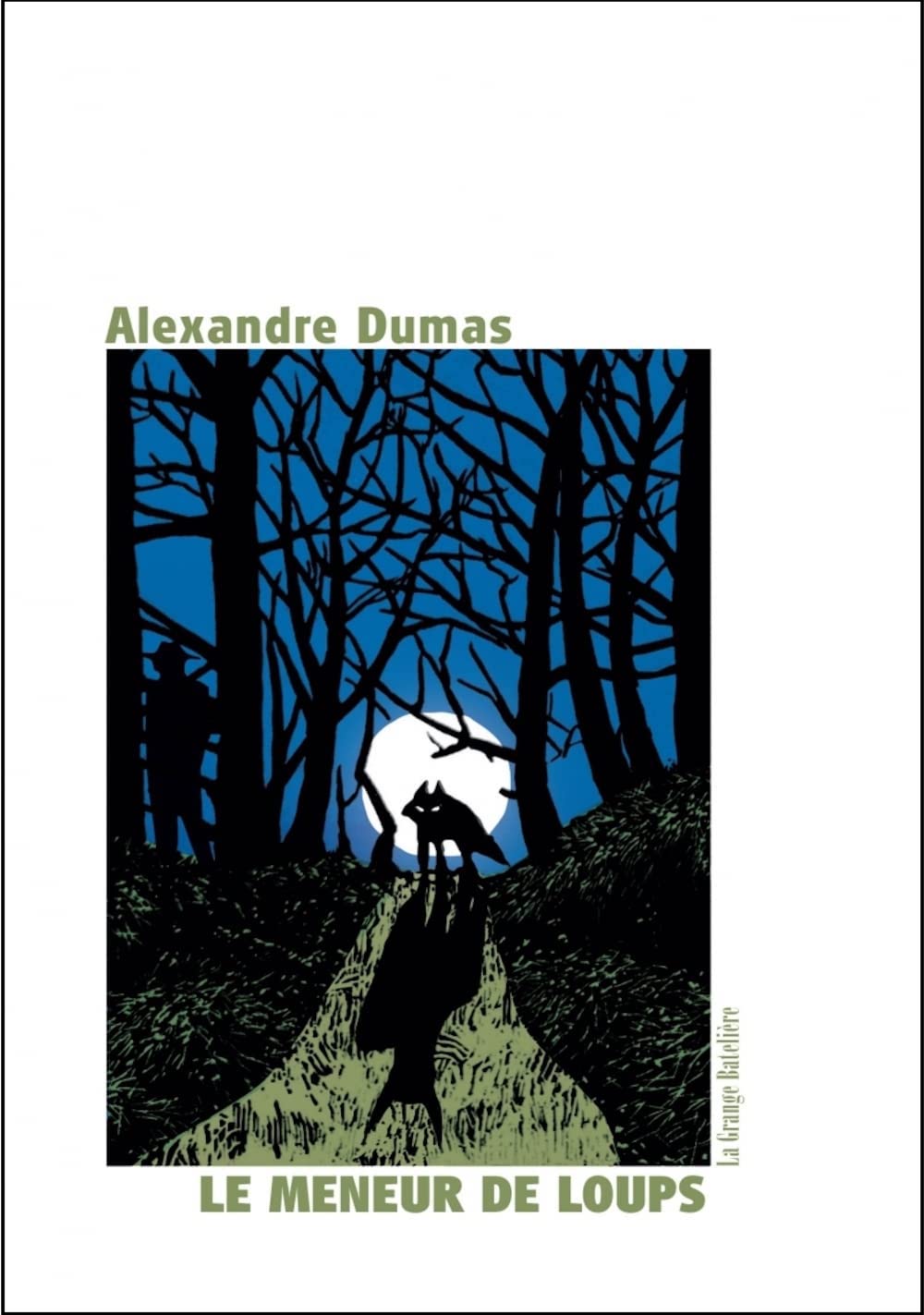

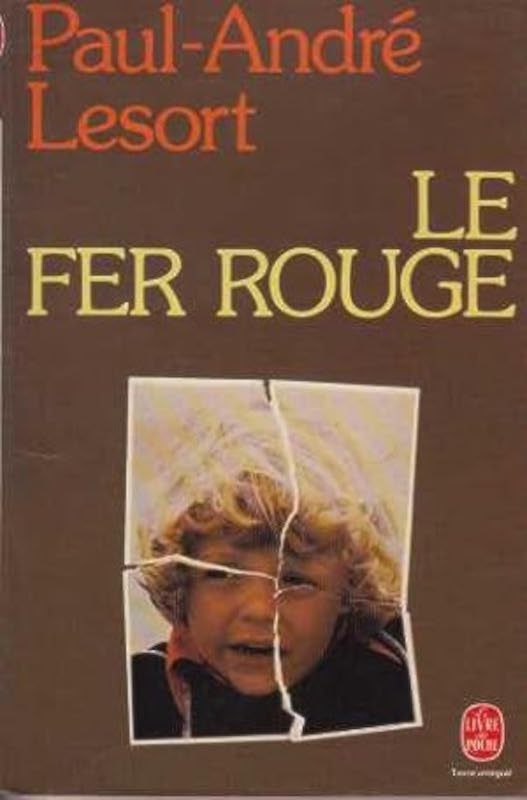


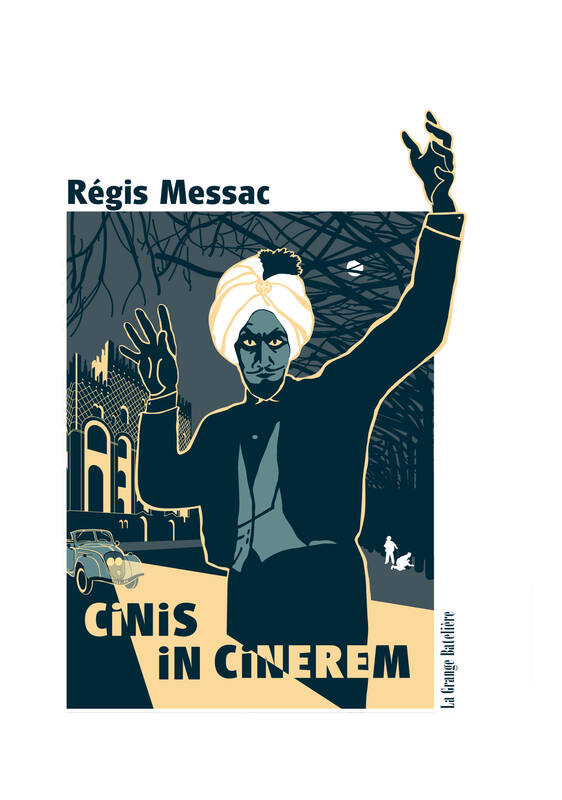

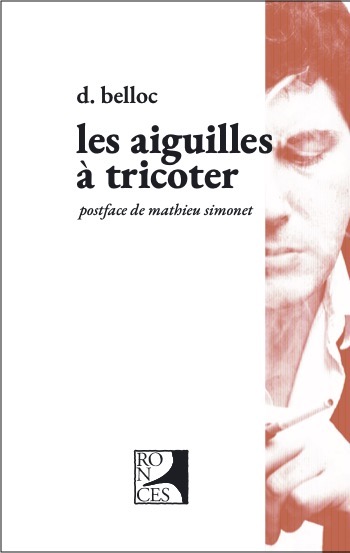
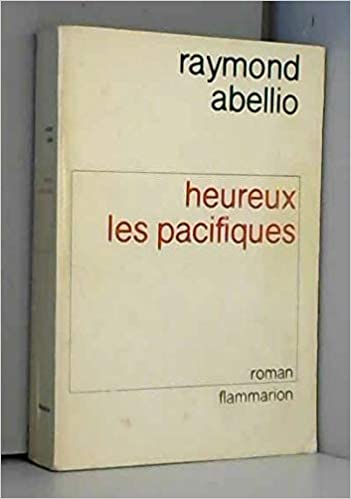
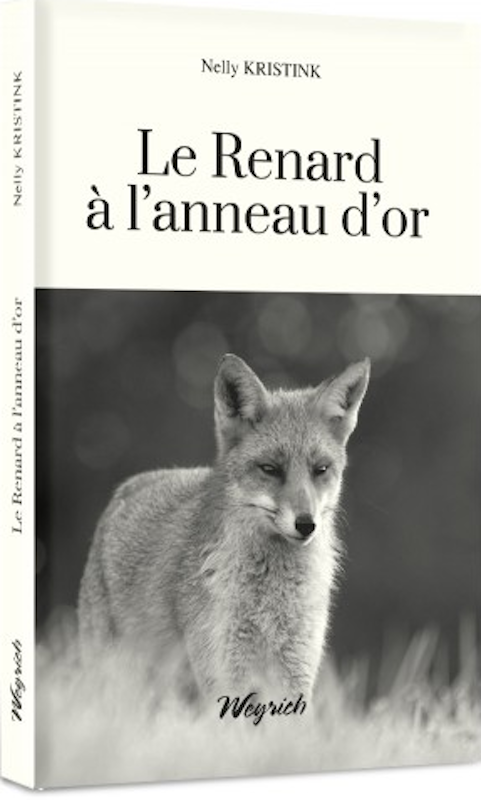
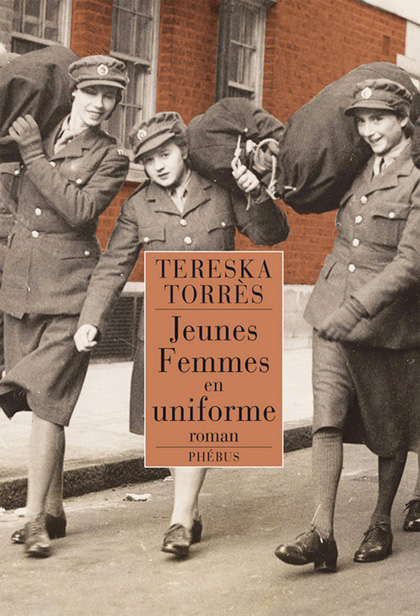
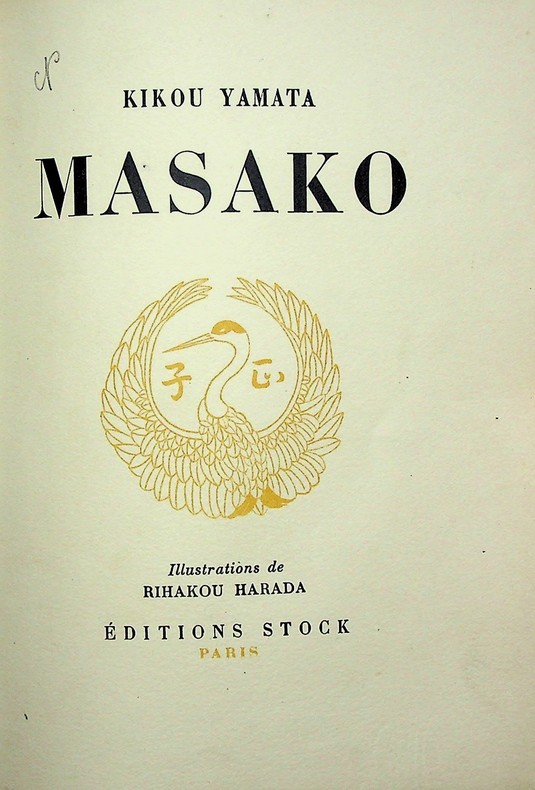
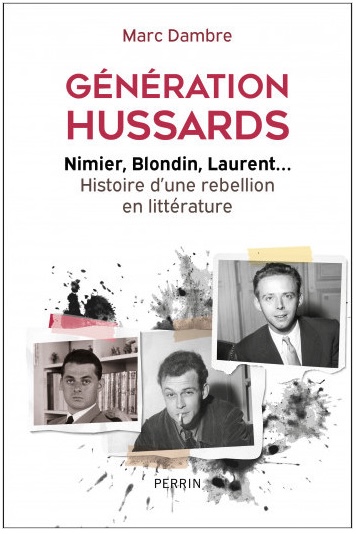
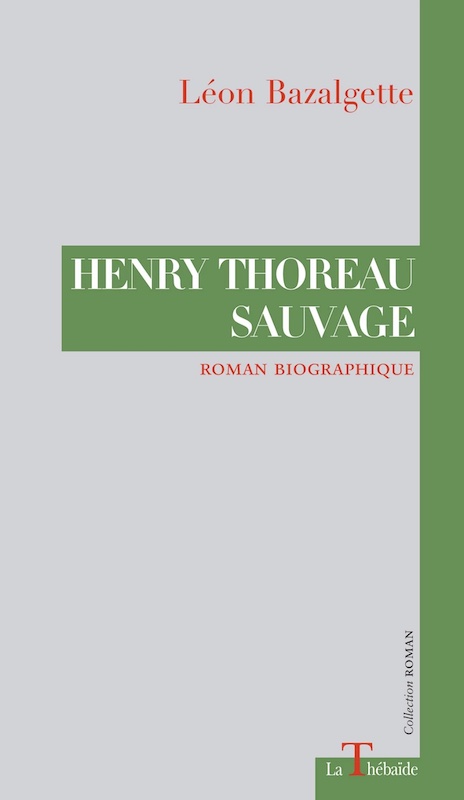

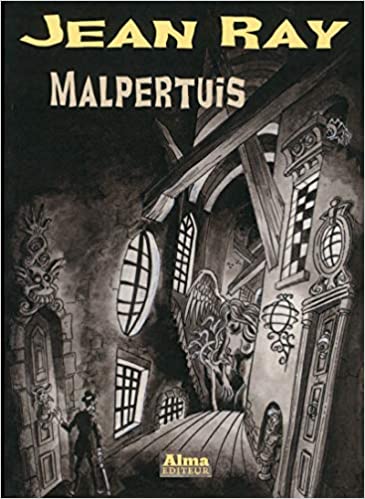
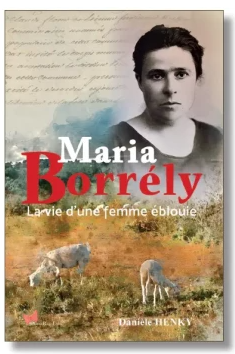
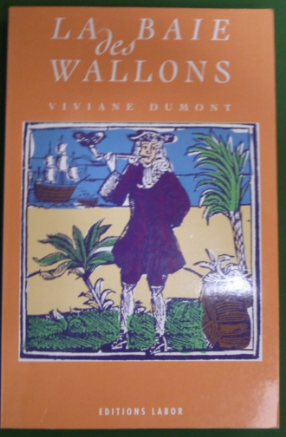

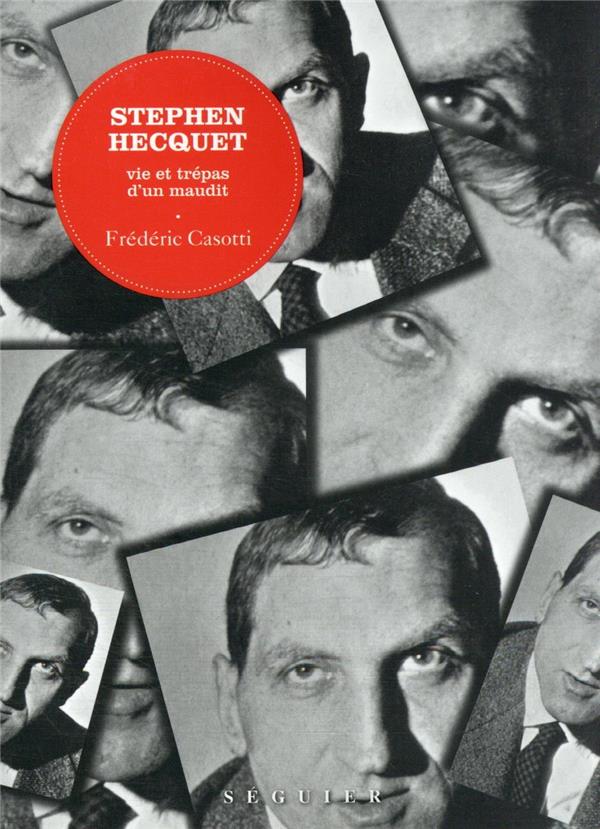

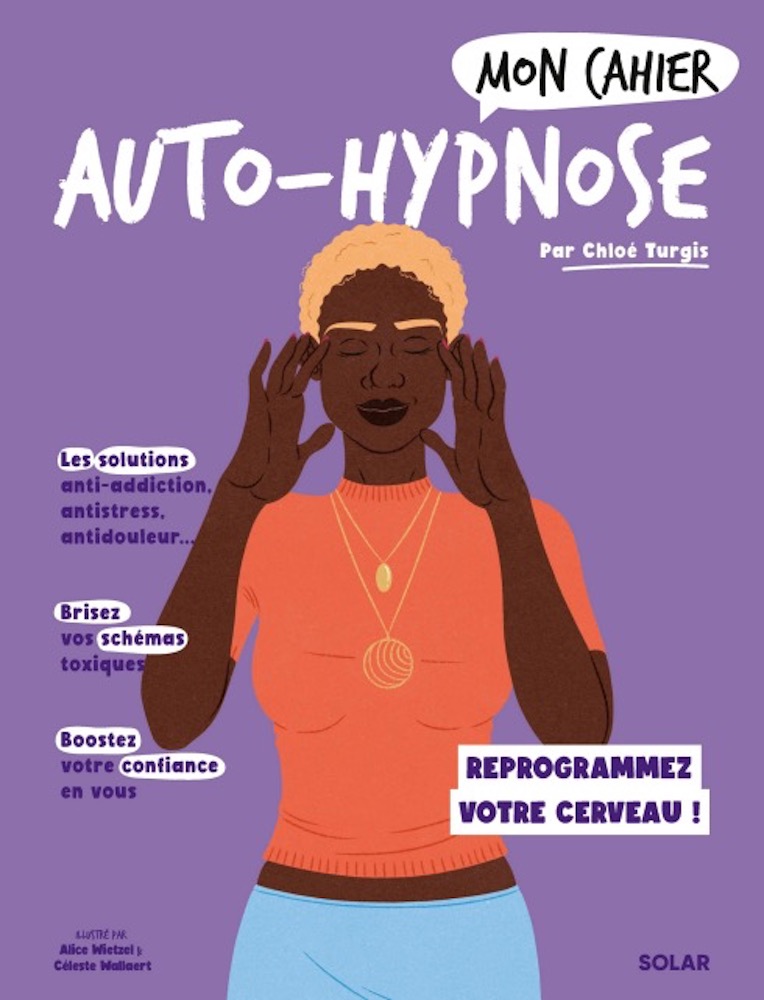
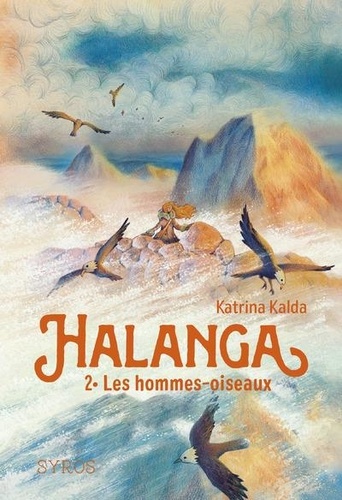
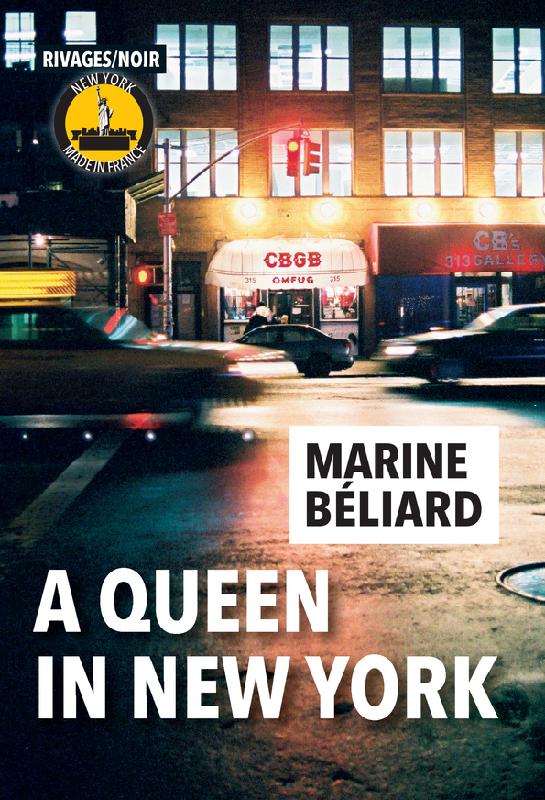



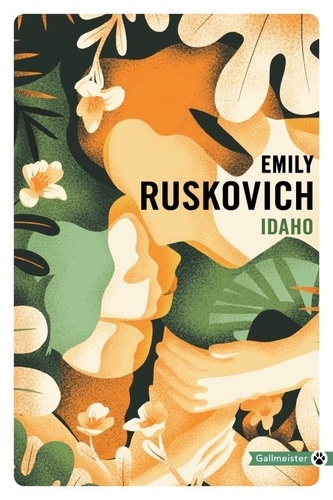
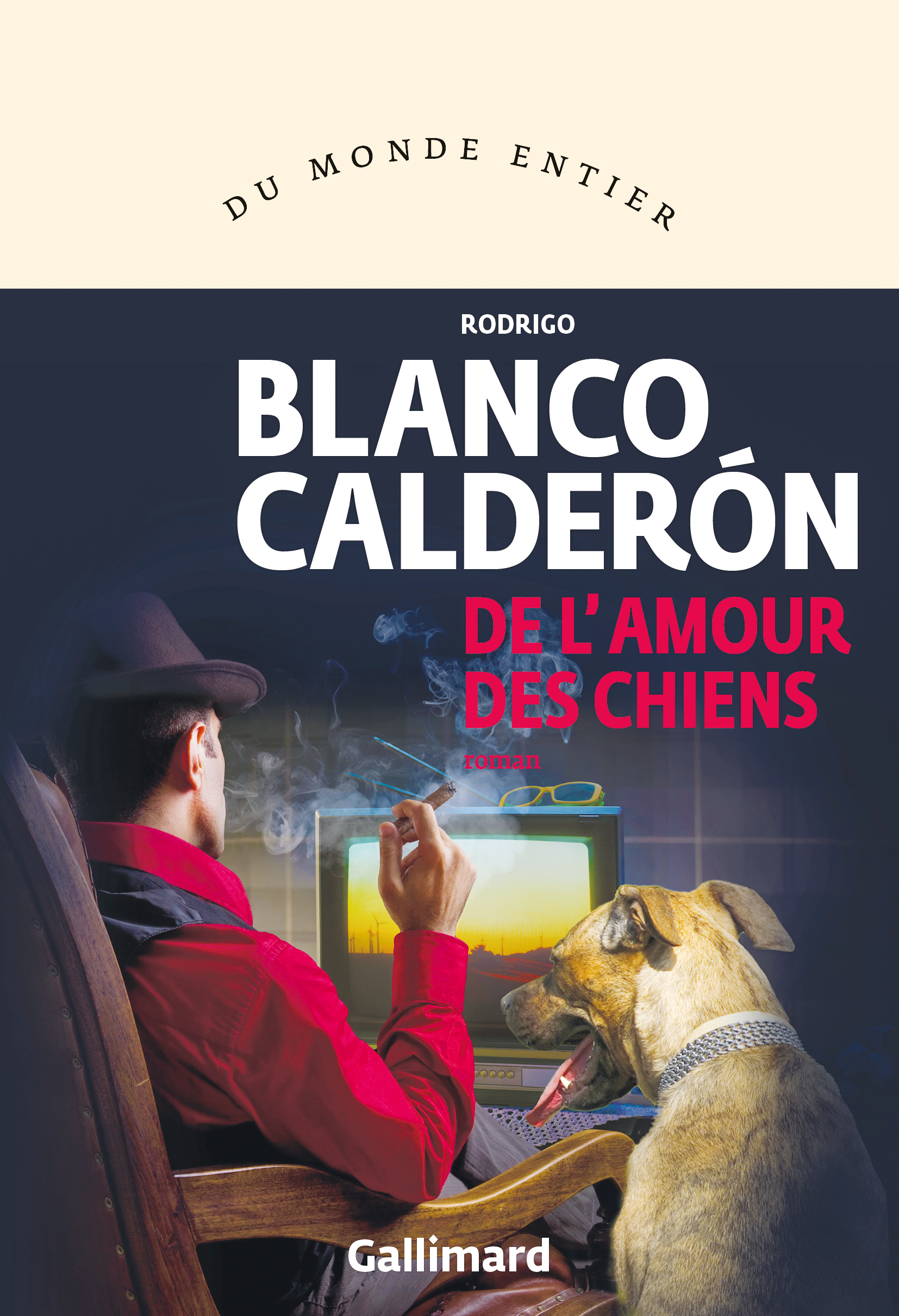





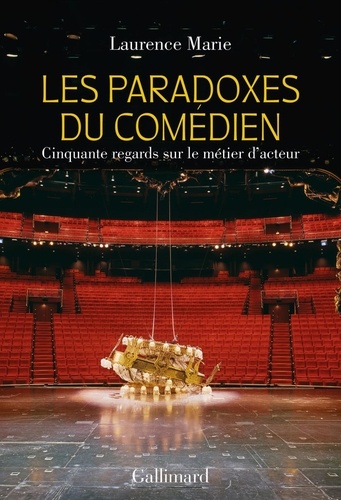
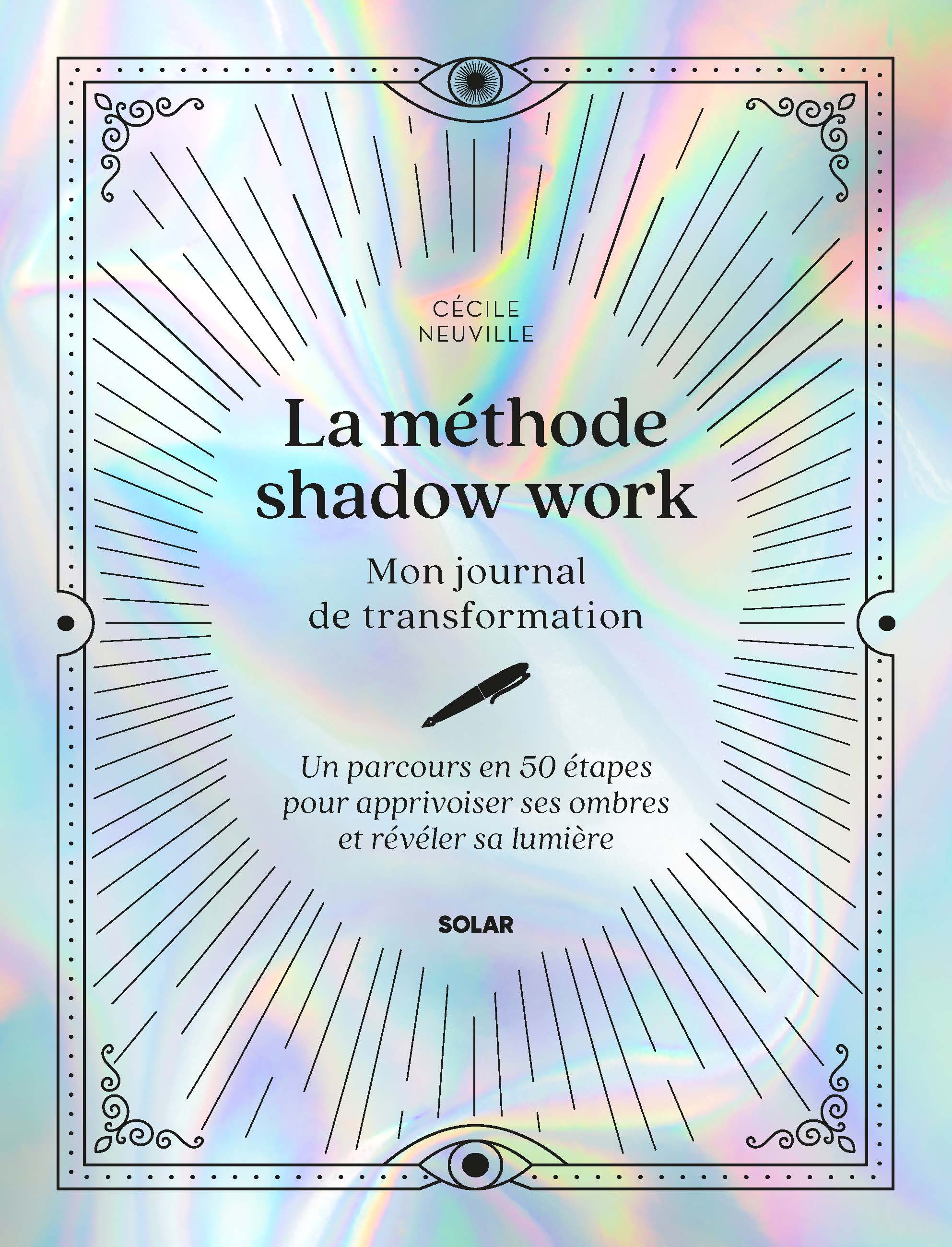


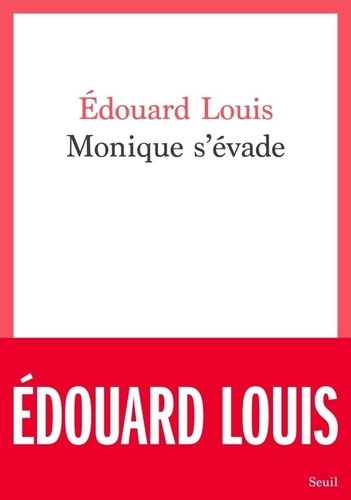
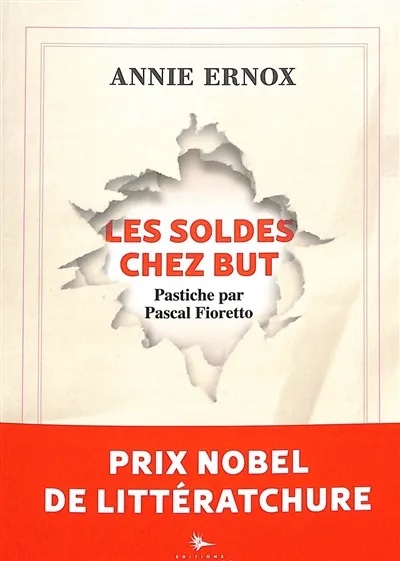
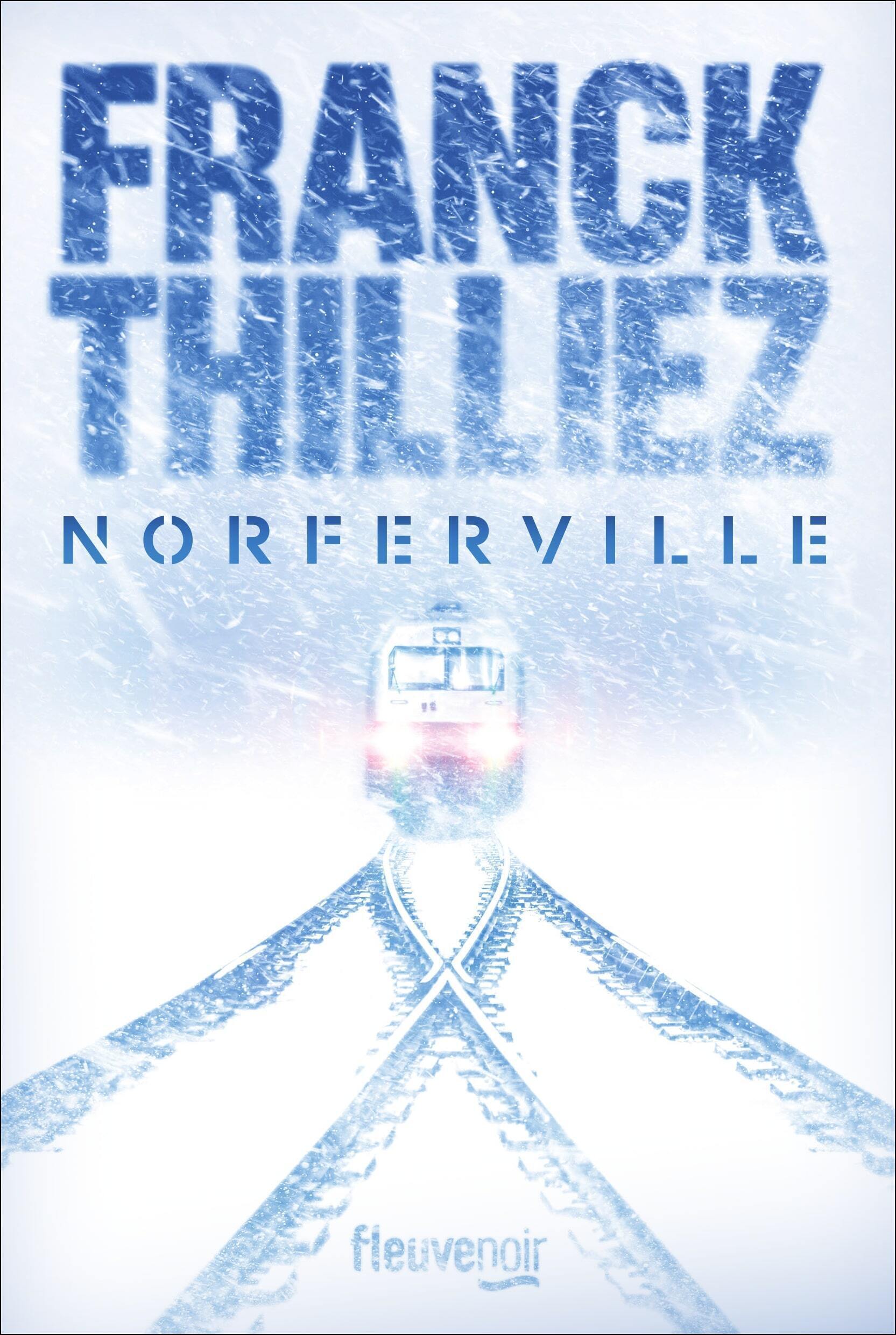
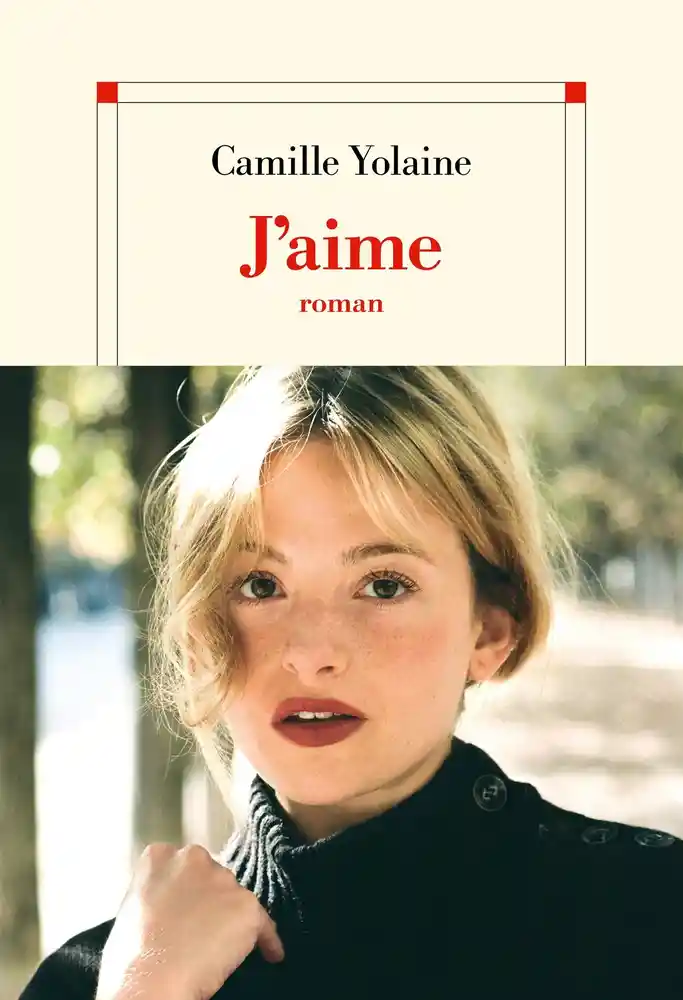
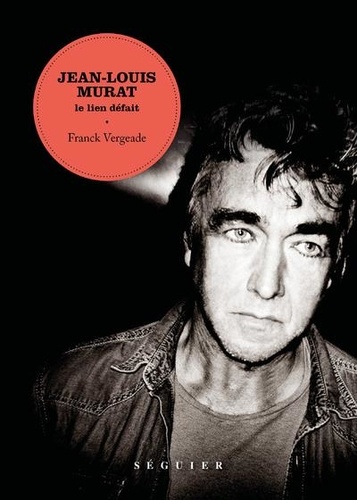
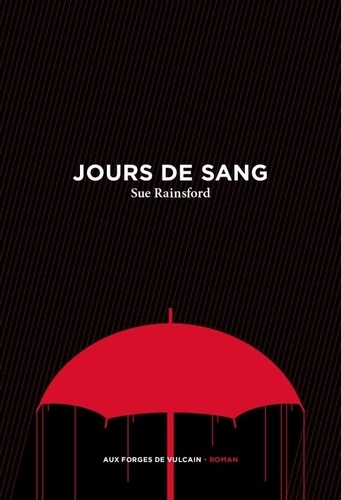







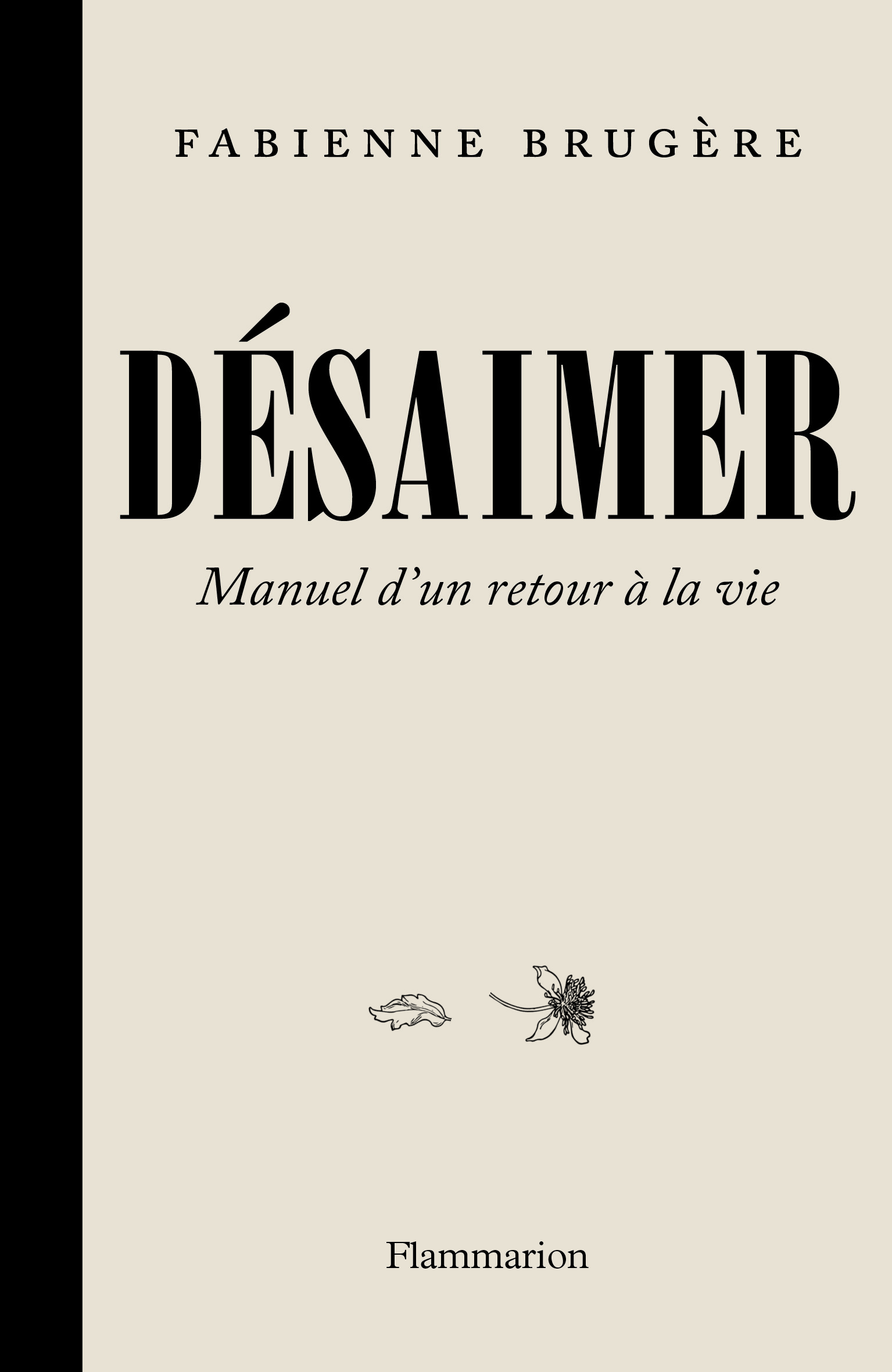
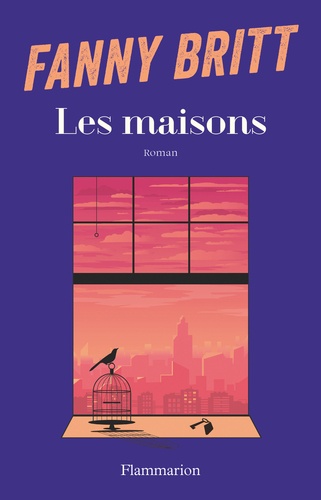



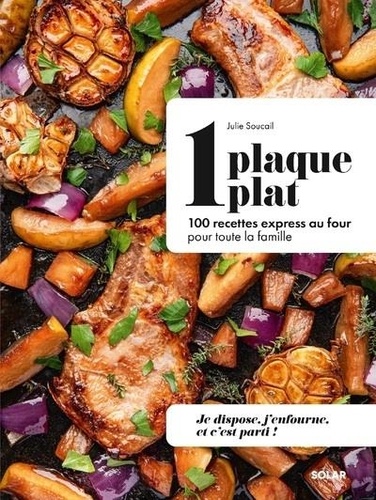

Commenter cet article